< Retour | Accueil > Publications > Actes du 2e congrès
Actes du 2e congrès
L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures
Libreville, 14 et 15 septembre 2000
« L'accès au juge constitutionnel : modalités et procédures »
Avant propos
AVANT-PROPOS

par Madame Marie Madeleine MBORANTSUO,
président de la Cour constitutionnelle du Gabon,
président de l’ACCPUF
L’ Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français a déjà trois ans d’existence. Elle a atteint, avec la première alternance intervenue à l’occasion de la deuxième assemblée générale tenue à Libreville le 13 septembre 2000, la maturité.
En ma qualité de présidente de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF), j’ai voulu, en cette période charnière de l’existence de notre Association, porter un regard sur les trois premières années de fonctionnement de notre organisation afin de mesurer le chemin parcouru et prendre l’élan nécessaire à la poursuite de nos objectifs.
L’ACCPUF qui comptait trente-six membres au moment de sa création en avril 1997 à Paris en dénombre aujourd’hui près d’une quarantaine répartie sur quatre continents (Afrique, Amérique, Asie et Europe).
Sur le plan des activités, celles-ci ont été menées au-delà du programme triennal adopté lors de l’Assemblée générale constitutive d’avril 1997. Ce qui témoigne de la vitalité de notre Association.
En effet, dès novembre 1997, l’Association a procédé à l’édition des actes du premier Congrès, suivie en novembre 1998, de la publication du premier bulletin rassemblant la jurisprudence des cours membres et relative au thème du premier Congrès « Le principe d’égalité ».
En novembre 1999, l’Association a édité sur supports papier et informatique le bulletin n° 2 qui rassemble l’ensemble des textes normatifs de nature constitutionnelle, législative et réglementaire régissant les cours membres.
Parallèlement, elle a créé, avec l’appui de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie et de la Commission de Venise, un site Internet dont l’objectif est de mettre en réseau les cours membres.
Elle a enfin diffusé trois CD-Rom, le premier sur la maquette du site, le second dans le cadre des stages de formation, le troisième à l’occasion de notre Congrès de Libreville, CD-Rom qui, même s’ils ne figuraient pas dans le programme triennal, se sont avérés indispensables.
C’est dans la poursuite de cet effort que s’est tenu à Libreville, du 11 au 12 septembre 2000, le cinquième séminaire au profit des cours de l’Afrique équatoriale, des Grands Lacs et Haïti (SAEGLH).
Sur le plan des rencontres, il convient de noter la deuxième conférence des Chefs d’institutions qui s’est tenue en septembre 1998 à Beyrouth (Liban) et les réunions du bureau qui ont eu lieu respectivement à Paris (France) en 1997, à Beyrouth (Liban) en 1998 et à Port-Louis (Ile Maurice) en septembre 1999.
Conformément aux recommandations de l’Assemblée générale constitutive, le deuxième congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français s’est tenu à Libreville au Gabon les 14 et 15 septembre 2000.
Le thème « L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures » retenu par les Chefs d’Institutions membres, en septembre 1998 à Beyrouth, a fait l’objet de débats enrichissants et prometteurs.
Les présents actes comprennent, d’une part, les rapports nationaux présentés par trente Institutions sur la base d’un questionnaire unique préparé par le bureau, d’autre part, les rapports de synthèse rédigés par la Cour constitutionnelle du Bénin, le Conseil constitutionnel du Maroc et le Tribunal fédéral Suisse, respectivement sur le droit au recours, la recevabilité de la saisine et la notion du procès équitable.
Enfin, vous trouverez le compte rendu des débats ainsi que le rapport général présenté par la Cour constitutionnelle de la République gabonaise.
La publication des actes du deuxième congrès dans la présente plaquette permet de prolonger la réflexion, tout en marquant l’événement. Ces actes constituent, sans nul doute, un instrument de référence indispensable tant 8 aux juristes qu’aux citoyens des pays membres de l’ACCPUF.
Comme lors du premier congrès, la rencontre de Libreville a été précédée le 13 septembre 2000 par l’Assemblée générale qui a amendé et complété les statuts tels qu’adoptés en 1997 à Paris, ratifié la convention passée avec le Conseil de l’Europe le 30 avril 1999 à Vaduz, examiné de nouvelles adhésions et désigné pour les trois ans à venir le Bureau de l’Association.
Les travaux du congrès de Libreville par la mobilisation des Institutions membres, des associations, des partenaires institutionnels et des personnalités avec lesquelles l’Association est en relation ont, de manière significative, illustré le rayonnement de notre Association ; celle-ci étant devenue en effet un lieu de fructueux échanges, de contacts professionnels et d’inspiration scientifique.
En ce début de siècle et à l’ère de la mondialisation tous azimuts, je formule le souhait de voir l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français devenir un grand espace de solidarité.
Puisse-t-elle être la matrice de la future « citoyenneté francophone » notamment par l’harmonisation des principes de droit en vue de la promotion et de la protection des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, éléments de consolidation de l’État de droit et de la démocratie.
I.Questionnaire
Questionnaire soumis aux cours constitutionnelles
L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures
Remarques préliminaires
Délimitation du sujet
Il s’agit exclusivement du contrôle en constitutionnalité des normes (traités, lois, règlements [décrets, arrêtés, …]).
Dans la mesure où il en est un contrôle indirect, le contentieux issu de décisions de justice prises en application d’une norme contrôlée est inclus.
En revanche, le contentieux issu des consultations électorales, même lorsqu’il comprend, par voie incidente, contrôle de la constitutionnalité des normes applicables aux élections est exclu de ce recensement.
Définitions pertinentes
- Saisine-requête
Acte par lequel la Cour, le Tribunal ou le Conseil est saisi pour trancher une question de constitutionnalité. Dans ce questionnaire, les mots « saisine » et « auteur de la saisine » (en général utilisés dans les systèmes de contrôle a priori ou préventif), et les mots « requête » ou « recours » et « requérants » (en général réservés aux systèmes de contrôle a posteriori et concret) sont considérés comme synonymes.
- Modalités et procédures Cas et conditions d’ouverture des recours, de recevabilité et procédure de traitement des saisines.
Plan du questionnaire
I. Ouverture du droit de saisine
I – 1. – Aux personnes : les requérants
I – 2. – Aux actes : les actes contrôlés
I – 3. – Au temps : les délais 13
II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
II – 2. – Conditions relatives au recours
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II – 4. – Motifs du rejet (synthèse)
III. Traitement de la saisine recevable. Procédures de l’instance
III – 1. – Principe du contradictoire
III – 2. – L’égalité des armes
III – 3. – Le délai du jugement
Réponses au questinnaire [1]
Il est souhaité que les Cours constitutionnelles suivent l’ordre des questions posées. Bien entendu, elles peuvent ne pas répondre à certaines d’entre elles dont la formulation et le contenu ne correspondraient pas à l’état du droit national. Il est en tout cas demandé aux Cours de bien vouloir se conformer au regroupement selon les trois thèmes choisis.
Un tel regroupement, qui certes peut toujours être affecté d’une part d’arbitraire au regard de la diversité des situations considérées, correspond en effet à l’organisation prévisionnelle du débat qui se déroulera en trois parties avant la présentation et la discussion du rapport général. Un tel classement est nécessaire à l’élaboration de rapports de synthèse qui serviront de point de départ aux discussions menées pour chacun de ces sous-thèmes.
En outre, il est demandé aux Cours de bien vouloir annexer à la réponse une fiche dans laquelle apparaîtrait la liste de l’ensemble des textes de référence et des jurisprudences citées dans le développement de la réponse [2].
I. L’ouverture du droit de saisine
Dans cette première partie, les Cours sont invitées à fournir les éléments descriptifs complets et chiffrés concernant les saisines.
Les données chiffrées devront à chaque fois être recensées par périodes chronologiques. Ces espaces temps seront définis en fonction de l’ancienneté du contrôle de constitutionnalité exercé et/ou des étapes significatives de l’évolution de ce contrôle et ne pourront, en tout état de cause, pas dépasser dix années.
Les Cours sont invitées à commenter l’évolution de données chiffrées en apportant toutes précisions pertinentes (ex. : modifications des compétences, de la procédure, du système de partis, …).
I – 1. – Les requérants
I – 1.1. – Les Cours sont invitées à :
- faire un tableau synthétique quantitatif des saisines, classées selon le type de saisine et par période ;
- commenter ce tableau, notamment en évoquant les infléchissements de la pratique et/ou les règles devenues enjeux de débats dans la doctrine. On pourrait distinguer (liste non exhaustive, à compléter le cas échéant) :
- Saisine émanant d’une personne publique :
Organes législatifs Groupe de députés Organes exécutifs Juridictions (cas des questions préjudicielles)
Organes d’autorités régionalisées
Organes d’autorités décentralisées Médiateur
- Saisine émanant d’une personne ou de groupements privés :
Personne(s) physique(s) (préciser si et dans quel cas les non nationaux bénéficient du droit de saisir)
Personnes morales à but non lucratif et à but lucratif
Autorités religieuses
Partis politiques Syndicats
Amicus Curiae
I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Si oui :
- à la faveur de modifications de textes ;
- suite à une jurisprudence ;
- en fonction d’autres facteurs ?
Précisez à chaque fois lesquel(le)s.
I – 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Si oui sur quels textes et dans quelles conditions ?
I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Si oui, dans quels délais et selon quelles procédures ? En particulier le désistement peut-il n’être que partiel ?
I – 2. – Actes contrôlés
I – 2.1. – Classer les actes ou normes susceptibles d’être contrôlées par catégorie et donner, par périodes chronologiquement définies, le nombre de saisines dont la Cour a été valablement saisie.
I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle
- par les textes ?
- par la jurisprudence ?
I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie.
I – 3. – Les délais
I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ? Si oui, lesquels ? I – 3.2. – Dans ce tableau, les Cours sont invitées à classer par catégories d’actes contrôlés (énumérés en I-2.) les conditions de délais et la référence des textes de nature constitutionnelle, législative ou réglementaire fixant ces conditions, en précisant bien le point de départ du délai et le moment de son expiration.
I – 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Si oui, pourquoi ?
Quels problèmes spécifiques posent-ils ? Comment ceux-ci ont-ils été résolus ? (citer les jurisprudences pertinentes, leurs causes, leurs effets).
I – 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Si oui, de quel montant ? (donner des chiffres comparables pour d’autres 16 démarches devant les justices – civile, administrative, pénale, commerciale, …)
II – 1.2. – La représentation du requérant par ministère d’avocat, ou par une autre personne (précisez laquelle), est-elle :
- possible ?
- obligatoire ?
II – 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
II – 2. – Conditions relatives au recours
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures
- date de l’envoi ?
- date de la réception ?
- date de l’enregistrement ?
II – 2.3. – Par type de normes contrôlées et par type d’initiateur, les cours sont invitées à indiquer les conditions formelles et matérielles, de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur en précisant :
- Le type de support (papier libre, formulaire)
- Le type de pièces annexes indispensables
- Les mentions obligatoires, par exemple :
– identification du requérant : signature, nom, adresse, etc.
– identification de la norme ou de l’acte contesté
– moyens et conclusions : en particulier, des moyens nouveaux peuvent-ils être soulevés en cours de procédure ? Si oui, dans quels délais et selon quelles modalités ? - Autres
II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Si oui, dans quel sens et pour quelles raisons ?
II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ? À l’initiative du requérant ou de la Cour elle-même ? Cette possibilité de régularisation est-elle encadrée dans des délais ?
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
Il s’agit, dans cette partie, de décrire la procédure actuelle par laquelle la Cour déclare l’irrecevabilité d’une requête.
II – 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
II – 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Si oui, devant qui ?
II – 3.3. – La Cour statue t-elle en formation plénière ?
Si oui, sur un rapport ?
Si oui, comment est choisi le rapporteur ?
Ou dans une formation particulière ?
Si oui laquelle ? (composition, compétence)
- Comment sont enregistrées les requêtes ?
- Par qui ?
- Au vu de quelles pièces ?
Y a-t-il un tri préalable ?
II – 3.4. – La décision d’irrecevabilité :
- doit-elle être motivée ?
- doit-elle être prononcée ?
- doit-elle être publiée ?
II – 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Si oui, montant et modalités du prononcé de la sanction
II – 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ? Si oui dans quel sens et pour quelles raisons ? Estelle l’objet de projets de réformes ?
II – 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Seront ici indiqués les principaux motifs d’irrecevabilité classés par type de normes contrôlées et donnés en nombre et en proportion (pourcentage de décisions d’irrecevabilité par rapport au nombre total de requêtes déposées), en suivant, par exemple, le tableau ci-dessous.

Pour chacune des catégories de motifs retenus, la Cour est invitée à commenter le tableau en précisant :
- Le cas échéant, les modifications textuelles.
- L’évolution éventuelle de la jurisprudence.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
Dans cette troisième partie, il s’agit de décrire le traitement d’une requête recevable (de son enregistrement au rôle jusqu’à sa délibération par la formation de jugement) au regard des trois aspects principaux du « procès équitable ».
III – 1. – Principe du contradictoire
III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie (par exemple nécessité d’aviser certaines autorités ou parties potentielles au procès).
III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions (oralement, par écrit, par ministère d’avocats) les parties ont-elles accès au prétoire ?
III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
III – 2. – Égalité des armes
III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Si oui, lesquels ?
III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office :
- de moyens non soulevés dans la requête ?
- de dispositions non contestées dans la requête ?
Si oui, à quelles conditions et selon quelle fréquence procède-t-il à l’évocation d’office ?
Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
III – 3. – Délai de jugement[3]
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Si oui, lequel ?
Est-ce le même dans tous les cas ?
Les délais sont-ils respectés ?
III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
Si oui, laquelle ?
III – 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen (par type de contrôle) que prend la Cour pour statuer ?
Quel délai moyen s’écoule :
- entre la fin de l’instruction et la tenue du délibéré ?
- entre celle-ci et le prononcé de la décision ?
- entre celui-ci et la publication – ou la notification – de la décision ?
En conclusion, les Cours sont invitées à procéder à une évaluation du contrôle de constitutionnalité dans leur pays en répondant à trois questions :
- L’accès au juge constitutionnel a-t-il conduit à des adaptations structurelles de la Cour (par exemple création, renforcement ou diversification du Greffe) ;
- Existe-t-il une réforme en cours ou en projet relative à l’accès au juge constitutionnel ? Existe-t-il des propositions d’amélioration, voire de transformation du système ? Si oui, lesquelles ?
- Assiste-t-on à une professionnalisation des requêtes (et/ou des requérants) ?
Si oui, en quoi ? (longueur des requêtes, motivation, extension du champ de la requête, utilisation des précédents, ou encore, si elles n’étaient pas prévues à l’origine, l’intervention et la présence d’avocats, ont-elles modifié le procès, si oui en quoi ?…)
-
[1]
Les rapports nationaux ont été pour la plupart préparés pour le printemps 2000, les rapports de synthèse pour le début de l’été, le rapport général pour la veille du Congrès. [Retour au contenu] -
[2]
Les textes constitutionnels, organiques et législatifs peuvent être consultés dans le bulletin n° 2 de l’ACCPUF et sur son site Internet (http ://www.accpuf.org). Pour cette raison, ils ne sont pas annexés aux rapports nationaux publiés ci-après. [Retour au contenu] -
[3]
On inclura dans cette analyse, les phases délibérative et de publicité de la décision. [Retour au contenu]
II.Rapports nationaux
Rapport de la Cour d’arbitrage de Belgique
Mars 2000
Rapport établi par Pierre Vandernoot, référendaire à la Cour d’arbitrage de Belgique et Brigitte Paty, Premier conseiller à la bibliothèque de la Cour d’arbitrage de Belgique.
I. L’ouverture du droit de saisine
I – 1. – Les requérants
I – 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
La Cour d’arbitrage peut être saisie par des recours en annulation ou par des questions préjudicielles.
- Les recours en annulation peuvent être introduits par deux catégories de requérants :
1. – les requérants dits « institutionnels », c’est-à-dire les organes suivants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif : le Conseil des ministres [1] , les gouvernements des communautés et des régions [2] ainsi que les présidents des assemblées législatives [3] ;
2. – les personnes physiques et morales, de droit privé comme de droit public, à but lucratif ou sans but lucratif, auxquels la Cour assimile dans certains cas des associations de fait comme des partis politiques ou des syndicats [4].
Les requérants dits institutionnels ne doivent pas justifier d’un intérêt à agir devant la Cour, contrairement aux personnes physiques et morales.
Le recours en annulation n’ayant pas d’effet suspensif, il peut y être joint une demande de suspension, qui n’est fondée que dans deux cas : le recours invoque des moyens sérieux et il se présente un risque de préjudice grave difficilement réparable, d’une part, et, d’autre part, le recours attaque une loi identique à une loi précédente et annulée par la Cour.
- Les questions préjudicielles sont posées à la Cour par toutes les juridictions. Le mécanisme de la question préjudicielle correspond à celui de l’exception d’inconstitutionnalité et conduit les juridictions judiciaires et administratives à interroger la Cour sur la validité constitutionnelle des lois [5] qu’elles sont invitées à appliquer. Elles y sont tenues, sauf :
1. – si l’action est irrecevable [6] ;
2. – lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant le même objet ;
3. – lorsque la réponse à la question n’est pas indispensable pour rendre la décision de fond ;
4. – si la loi en cause ne viole manifestement pas la Constitution. Toutefois, la Cour de Cassation et le Conseil d’État, c’est-à-dire les plus hautes juridictions judiciaire et administrative, ne peuvent invoquer que la première exception pour se dispenser d’interroger la Cour [7].
De 1984, date d’installation de la Cour, à 1988, les recours en annulation ne pouvaient être introduits que par le Conseil des ministres et par les gouvernements des entités fédérées, la Cour pouvant être saisie en outre par des questions préjudicielles. La compétence de la Cour était limitée pendant cette période au contrôle du respect de la répartition des compétence entre l’État, les communautés et les régions.
En 1989, une importante réforme de la Cour d’arbitrage a eu pour objet d’étendre ses compétences au contrôle des principes de base du droit de l’enseignement [8] , ce qui a impliqué l’ouverture du droit de saisine à toute personne intéressée, notamment les établissements scolaires dotés de la personnalité juridique, les enseignants, les étudiants, etc. Cette extension était due à la nécessité d’offrir des garanties juridictionnelles de haut niveau, dans cette matière particulièrement sensible, aux personnes, aux institutions ou aux groupements susceptibles de se voir traités de manière discriminatoire par l’effet de l’attribution aux communautés [9] , au même moment, des compétences en matière d’enseignement. Les équilibres politiques existant auparavant au niveau fédéral étant rompus par cette réforme, il est apparu nécessaire non seulement d’écrire plus complètement les principes de base du droit de l’enseignement dans la Constitution [10], mais encore d’élargir la compétence de la Cour d’arbitrage au contrôle du respect de ces principes, contrôle rendu plus effectif encore par l’élargissement des conditions de la saisine à toute personne justifiant d’un intérêt.
Plus fondamentalement, par l’élargissement de ses compétences en 1989, la Cour a pu contrôler la compatibilité des lois aux principes de l’égalité et de la non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, le droit de saisine étant ouvert, comme pour tous les contentieux relevant de la compétence de la Cour, à toutes les personnes physiques et morales justifiant d’un intérêt. L’extension du droit de saisine opéré en 1989 a en effet eu un caractère général.
L’exigence d’un intérêt dans le chef de cette catégorie de requérants a pour effet d’exclure les recours fondés sur le seul souhait de voir respecter la Constitution, appelés « recours populaire » (actio popularis). Les tableaux suivants indiquent la part prise par chaque type de saisine, en distinguant les affaires introduites par un recours en annulation et par une question préjudicielle.
Quant aux recours en annulation :
L’établissement de statistiques au sujet des auteurs de la saisine se révèle malaisé dans la mesure où une requête peut être introduite devant la Cour, tantôt par un requérant unique, tantôt par une pluralité de requérants, personnes physiques ou morales, qui font choix de présenter leurs griefs dans un seul document introductif d’instance pour des motifs qui leur sont propres. Un numéro de rôle est alors attribué à chaque requête, quel que soit le nombre et la nature juridique de ses auteurs ; la Cour appréciant la recevabilité de la requête dans le chef de chacun d’eux pris séparément, elle la déclare le cas échéant irrecevable pour partie, dans la mesure où elle est introduite par une personne ne justifiant pas de la qualité, de la capacité ou de l’intérêt requis au regard de l’ensemble ou de certaines des dispositions attaquées, et elle n’en examine les moyens que dans la mesure de la recevabilité de la requête.
En outre, la possibilité reconnue à la Cour par l’article 100 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 organique de la Cour, de joindre les requêtes en annulation (ou les questions préjudicielles) relatives à une même norme, et de statuer sur celles-ci par un seul arrêt, ajoute encore à la difficulté de fournir des données chiffrées précises quant aux auteurs de la saisine, puisqu’un même arrêt peut statuer sur un ensemble de requêtes émanant de parties institutionnelles, de personnes physiques, de personnes morales de droit public ou de droit privé.
C’est pourquoi, au contentieux de l’annulation, les requérants sont répertoriés ci-après par catégorie plutôt que de manière individuelle. De plus, comme la Cour ne dispose pas de données statistiques quant à la répartition des requérants au sein de la catégorie des personnes morales, il n’est pas possible d’opérer les distinctions demandées entre personnes morales de droit public et personnes morales de droit privé, et au sein de cette dernière catégorie, entre celles poursuivant un but de lucre et celles à but non lucratif. Un rapport complémentaire sera établi à cet effet dès que les données statistiques nécessaires seront à la disposition de la Cour et des auteurs du présent rapport.
Il en résulte pour les périodes 1985-1988 et 1989-1999, au cours desquelles respectivement 34 et 413 arrêts ont été prononcés sur recours en annulation, une répartition des divers types de requérants selon le tableau cidessous, qui marque la très nette prépondérance des requêtes de particuliers par rapport à celles des parties institutionnelles depuis l’élargissement en 1989 des compétences et de la saisine de la Cour.

Quant aux questions préjudicielles :
Au sujet des questions préjudicielles, la faculté pour la Cour de joindre dans un même dossier, sur la base de l’article 100 précité de la Loi du 6 janvier 1989, des questions portant sur une même norme et posées le cas échéant, par des juridictions différentes, et de statuer sur celles-ci par un seul et même arrêt, justifie d’en aborder l’examen statistique selon la méthode exposée ci-avant. Il en résulte pour les périodes 1985-1988 et 1989-1999, au cours desquelles respectivement 38 et 393 arrêts ont été rendus sur des questions préjudicielles, une répartition des juridictions selon le tableau ci-dessous, qui indique la très nette prépondérance des questions posées par le Conseil d’État et dans une moindre mesure, par la Cour de Cassation, si l’on tient compte du fait que les chiffres atteints par les autres juridictions judiciaires ont été comptabilisés tous ressorts territoriaux confondus.

Sous réserve de ce qui est exposé plus haut, aucune indication ne peut être fournie quant à l’évolution de chacun des modes de saisine, la pratique ou la doctrine ne révélant aucune donnée significative à cet égard.
On peut relever toutefois le faible nombre de saisines émanant des présidents d’assemblée. Ceci est dû à plusieurs facteurs. Le principal est de nature politico-juridique : ce sont les gouvernements qui apparaissent comme chargés de la représentation de leurs entités (l’État, la communauté ou la région) devant les juridictions pour des normes qu’ils ont le plus souvent pris l’initiative de faire adopter. Comme ils jouissent de la confiance de la majorité de l’assemblée parlementaire devant laquelle ils sont responsables, la possibilité de saisine offerte aux présidents d’assemblée à la demande de deux-tiers des membres n’ajoute dans les faits aucune faculté supplémentaire. Il peut même arriver que des parlementaires, plutôt que de proposer à l’assemblée et à leur président d’introduire un recours devant la Cour d’arbitrage, interpellent le gouvernement pour l’inviter à agir devant celle-ci. D’autres motifs peuvent expliquer cette relative discrétion des présidents d’assemblée, comme le fait que leur administration est peu outillée pour ce type d’action.
11. Juges de paix (18), tribunaux de police (19), tribunaux de première instance (125), tribunaux de commerce (2), tribunaux du travail (51), cours d’appels (57), cours du travail (26), cour militaire (2).
12. Conseils de milice (1), conseils de révision (2), députations permanentes des conseils provinciaux (2), Commission permanente de recours des réfugiés (1), Conseil de la concurrence (1), diverses commissions administratives de recours (2), Commission d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence (1).
I – 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
La Cour d’arbitrage ne dispose d’aucune possibilité d’auto-saisine. Il n’y a pas davantage de saisine automatique ou obligatoire de la Cour, qui ne peut donc connaître d’affaires qu’à la suite d’un recours en annulation ou d’une question préjudicielle.
I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Les parties peuvent se désister de l’action pendante devant la Cour, mais dans des conditions différentes selon que la Cour est saisie d’un recours en annulation ou d’une question préjudicielle.
Dans le premier cas, la loi prévoit expressément en son article 98 que les parties institutionnelles peuvent se désister de leur recours en y joignant la copie conforme de la délibération par laquelle le désistement a été décidé. La loi est muette quant au droit des autres parties, non-institutionnelles (c’est-à-dire les personnes ayant à justifier d’un intérêt), à se désister, mais la Cour a jugé à ce sujet que « le droit de se désister est intimement lié à celui d’introduire un recours en annulation »[11] et qu’« on peut admettre que l’article 98 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 s’applique par analogie aux personnes physiques ou morales »[12]. Elle considère même que, lorsqu’une partie institutionnelle, qui s’était jointe au recours par une intervention volontaire, s’oppose à ce désistement, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la Cour le décrète [13].
Aux termes de l’article 98 de la Loi, « s’il y a lieu, la Cour décrète le désistement, les autres parties entendues ». Cette disposition laisse en principe à la Cour une latitude quant à la possibilité de refuser le désistement ; les travaux préparatoires de la première Loi organique relative à la Cour d’arbitrage [14] explique cette faculté par le fait que « le recours en annulation concerne une matière d’ordre public » et que « la Cour peut […] évoquer d’office divers moyens »[15].
La Cour d’arbitrage n’a jamais fait usage de cette faculté, sauf pour des motifs de procédure, comme par exemple l’irrecevabilité du recours ou l’absence de preuve de la décision de désistement [16].
Au contentieux préjudiciel, la question se pose différemment. Ce n’est que lorsque le désistement est accepté ou admis devant la juridiction qui a saisi la Cour qu’il est mis fin à la procédure devant celle-ci, et ce de manière automatique, sans pouvoir d’appréciation de la Cour. Ce système s’explique par le fait que l’affaire pendante devant la Cour sur la base d’une question préjudicielle se greffe sur une autre affaire devant un autre juge, judiciaire ou administratif, qui garde la maîtrise de la procédure à cet égard.
À part cette hypothèse, le juge ayant saisi la Cour (le juge a quo) ne peut retirer sa question ou s’en « désister ».
Il s’est toutefois instauré un dialogue entre la Cour d’arbitrage et le juge a quo sur l’opportunité de conserver une question préjudicielle au rôle de la Cour, dès lors que l’examen de l’affaire conduit cette dernière – mais à sa seule initiative – à s’interroger sur le maintien de la pertinence de la question préjudicielle, notamment à la suite d’une évolution législative [17], d’une modification d’attitude de l’administration dans le procès de fond [18], d’un doute sur la pertinence de la question [19] ou même d’un arrêt précédent de la Cour dont le juge n’a pas pu avoir connaissance au moment de son renvoi préjudiciel [20]. Dans ces cas, la Cour d’arbitrage peut renvoyer l’affaire devant le juge a quo pour qu’il se prononce sur ces questions.
Ceci peut conduire le juge du fond à considérer par exemple que la réponse à la question préjudicielle ne lui est plus indispensable, ce qui aboutit ensuite à un arrêt par lequel la Cour radie l’affaire du rôle [21]. Lorsque ce dialogue entre le juge constitutionnel et le juge du fond entraîne un prolongement excessif du délai [22], la Cour, après avoir entendu les parties, peut constater que c’est sur une autre loi que doit en réalité porter la question préjudicielle : elle radie alors aussi l’affaire du rôle, tout en laissant bien entendu ouverte la possibilité pour le juge a quo de la saisir à nouveau [23].
I – 2. – Actes contrôlés
I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé
Seuls les actes de nature législative, c’est-à-dire les lois, les décrets et les ordonnances, peuvent être contrôlées par la Cour d’arbitrage [24]. Les décrets et les ordonnances sont les normes adoptées par les organes législatifs des communautés, des régions, ainsi que de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ces entités forment les composantes fédérées de la Belgique.
Sont incluses parmi les lois contrôlées par la Cour les lois dites « spéciales », c’est-à-dire celles, à caractère quasi-constitutionnel qui sont prises à la majorité des deux-tiers des membres des assemblées fédérales et avec le concours de chacun des deux groupes linguistiques qui les composent. Les lois organisant le fédéralisme [25], prises en vertu de la Constitution, sont également soumises au contrôle de la Cour.
Les lois purement formelles, comme les lois d’assentiment à des traités internationaux [26], les lois budgétaires [27] ou même les lois de naturalisation [28] peuvent être soumises à la Cour.
Lorsque le pouvoir législatif a autorisé l’exécutif à abroger, modifier, compléter ou remplacer des lois, en vertu de la technique dite des pouvoirs spéciaux, la Cour est également compétente pour contrôler les arrêtés pris en vertu de cette habilitation, mais à la condition que ces arrêtés aient été confirmés par une loi [29].
L’incompétence de la Cour en ce qui concerne les actes du pouvoir exécutif ne l’a pas empêchée d’examiner des lois interprétées comme ayant autorisé l’exécutif à adopter tel ou tel règlement. Ce faisant, c’est la loi qui reste formellement contrôlée, mais c’est la règle de fond figurant dans le règlement qui est en réalité examinée.
Les données statistiques relatives aux types de normes mises en cause devant la Cour figurent ci-après. Les calculs relatifs aux normes soumises au contrôle de la Cour ont été effectués par norme (c’est-à-dire par intitulé normatif distinct) et non par arrêt, car ils se heurtent à plusieurs difficultés. D’une part le fait qu’une même norme peut avoir fait l’objet de plusieurs arrêts sur recours en annulation et/ou sur questions préjudicielles ; il en est ainsi lorsque les mêmes dispositions d’une norme ont fait l’objet d’arrêts distincts tantôt dans la même rédaction, tantôt dans des rédactions successives, ainsi que lorsque des articles ou parties d’articles différents d’une même norme ont été soumis au contrôle de la Cour et ont fait l’objet de plusieurs de ses arrêts. D’autre part le fait qu’il n’est pas rare que dans un même,arrêt, la Cour apprécie la constitutionnalité de plusieurs normes différentes, ou encore la constitutionnalité d’une norme en ce qu’elle modifie, complète ou abroge une norme antérieure. C’est pourquoi, dans le cadre de ce relevé, chaque norme a été comptabilisée de manière distincte et rangée dans sa catégorie propre, à l’exception des lois interprétées comme autorisant telle habilitation au pouvoir exécutif, qui ont permis à la Cour d’apprécier de manière indirecte et marginale la conformité à la Constitution d’un arrêté d’exécution, mais dont la nature législative n’est pas comme telle, spécifique.

I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Selon les indications fournies ci-avant, sous le n° I – 2.1, en raison du caractère limitatif des compétences octroyées à la Cour par l’article 142 de la Constitution et par la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, les normes à caractère non législatif ne relèvent pas de sa compétence. Lorsqu’il s’agit d’actes d’autorités administratives, centralisées ou décentralisées, le contrôle relève du Conseil d’État au contentieux de l’annulation et des juridictions administratives et judiciaires par la voie de l’exception d’illégalité. Plusieurs arrêts de la Cour ont eu l’occasion de le rappeler.
La jurisprudence de la Cour ne s’est pas prononcée de manière restrictive quant à d’éventuels actes placés en dehors de son contrôle. On a vu, toujours au n° I – 2.1 ci-avant, que l’approche de la Cour est au contraire extensive puisqu’elle inclut parmi les normes contrôlées des lois purement formelles ou des lois telles qu’interprétées par le pouvoir exécutif.
33. Voir arrêts nos 26/91, 12/94, 33/94, 67/94, 76/94 et 117/98.
34. Voir arrêts nos 22/92, 6/93, 73/95, 78/95, 13/96, 54/96, 22/98, 71/98, 50/99 et 96/99.
35. Voir arrêt no 75/98.
36. Voir arrêts nos 11/97, 35/97, 54/97, 78/98, 114/98, 119/98, 58/99 et 113/99 (certains de ces arrêts se sont prononcés sur la même disposition législative).
I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Aucune disposition législative ou constitutionnelle ne confère expressément à la Cour le pouvoir de se prononcer de manière incidente sur la constitutionnalité d’une autre norme que celle qui fait l’objet de sa saisine.
Ceci n’a pas empêché la Cour de se prononcer, dans plusieurs affaires, au sujet d’une norme au sujet de laquelle elle n’était pas directement saisie, mais dont la validité conditionnait la constitutionnalité de celle qui faisait l’objet du recours ou de la question préjudicielle. Il s’agissait dans le premier cas de décrets [30] relatifs au statut administratif du personnel d’organismes publics décentralisés qui ne pouvaient être valablement adoptés qu’à la condition qu’un arrêté royal était entré en vigueur. Comme tel était le cas, mais avec effet rétroactif et que le décret contesté était intervenu entre la date de prise d’effet rétroactif et la publication de l’arrêté, la Cour a dû se prononcer sur la validité de ce dernier en tant qu’il rétroagissait. La Cour a admis le procédé et a en conséquence rejeté le recours dirigé contre le décret [31]. Dans l’autre cas, qui concernait aussi un décret relatif au statut des fonctionnaires d’un organisme décentralisé, la question se posait de savoir si l’autonomie du législateur communautaire, auteur de ce décret, s’étendait à la fixation du statut de ce personnel. Selon un arrêté royal, tel était le cas. La Cour a toutefois déclaré cet arrêté royal illégal en raison de sa contrariété avec une disposition de la Loi organique des communautés et des régions qui interdit de faire une distinction entre les administrations centrales des entités fédérées et leurs administrations décentralisées [32], les secondes ne pouvant bénéficier de davantage d’autonomie que les premières [33].
De telles pratiques restent toutefois exceptionnelles dans la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les normes soumises à son contrôle.
Les dispositions législatives relatives à la procédure devant la Cour elle-même ont cependant fait l’objet de contestations par les parties, au regard notamment du principe constitutionnel d’égalité, des exigences du procès équitable posées par la Convention européenne des droits de l’homme et du principe général d’impartialité.
Admettant que, lorsque le procès devant le juge a quo concerne des droits et des obligations en matière civile ou une accusation en matière pénale, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pouvait lui être applicable, se référant à cet égard à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme [34], appliquant éventuellement le principe général d’impartialité dans les autres hypothèses [35], la Cour a eu à examiner les questions suivantes :
– un membre de la Cour ayant, en sa qualité de parlementaire antérieurement à sa nomination comme juge à la Cour, adopté une loi attaquée devant elle ou même rejeté un amendement se fondant sur le respect du principe d’égalité invoqué devant elle, peut-il participer au délibéré relatif à cette affaire [36] ? ;
– un membre de la Cour ayant proposé au stade de la procédure préliminaire qu’une question préjudicielle donne lieu à une réponse immédiate, c’est-à-dire à un arrêt se prononçant immédiatement sur le fond par référence par exemple à une jurisprudence précédente, peut-il encore siéger ultérieurement dans la même affaire, la proposition de réponse immédiate n’ayant pas été suivie [37] ? ;
– un membre de la Cour ayant proposé qu’un recours soit rejeté en raison de son irrecevabilité manifeste dès le stade de la procédure préliminaire peut-il encore siéger ultérieurement dans la même affaire, lorsque la Cour se prononce sur cette proposition [38] ? ;
– la procédure préliminaire [39] est-elle régulière en tant qu’elle ne prévoit pas d’audience publique permettant d’entendre les requérants [40] ? ;
– l’impossibilité d’intervenir dans une procédure préjudicielle devant la Cour d’arbitrage dans le chef des personnes pouvant justifier d’un intérêt dans des affaires analogues est elle discriminatoire par rapport aux personnes justifiant d’un intérêt dans l’affaire dont le juge a quo est saisi [41] ? ;
– la limitation du délai d’introduction des recours à la Cour d’arbitrage à six mois est-elle discriminatoire [42] ?
À l’ensemble de ces questions, la Cour d’arbitrage a répondu que les règles de procédure contestées devant elle ne comportaient aucune violation de la Constitution, de la Convention ou du principe général d’impartialité.
I – 3. – Délais
I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
I – 3.2. – Tableau des conditions de délais
Dans le tout premier avant-projet de Loi organique de la Cour d’arbitrage, aucun délai n’était prévu pour l’introduction d’un recours devant la Cour, et ce en raison du rôle fondamental qu’était appelée à jouer celle-ci dans le cadre du contentieux des conflits de compétence entre l’État, les communautés et les régions. Sur la base de l’avis de la section de législation du Conseil d’État, qui invoquait notamment la nécessité d’équilibrer le principe de constitutionnalité avec celui de la sécurité juridique, le projet de loi fut amendé par l’insertion d’un délai de principe d’un an pour l’introduction d’un recours en annulation.
Dans la Loi spéciale du 6 janvier 1989, qui a étendu à la fois les compétences de la Cour et ses possibilités de saisine, le principe d’un délai de recours a été maintenu, mais il a été réduit à six mois [43]. Tel est donc actuellement le délai de droit commun pour les recours en annulation, qu’ils émanent d’une partie institutionnelle ou d’une personne physique ou morale ayant à justifier d’un intérêt.
Le délai prend cours, en principe, à la date de la publication de la loi au Moniteur belge, c’est-à-dire au Journal officiel du Royaume de Belgique [44].
Des hypothèses particulières sont toutefois prévues d’abréviation ou de réouverture du délai.
Les recours tendant à l’annulation d’une loi d’assentiment à un traité ne sont recevables que dans le délai de soixante jours suivant la publication de la loi [45]. À l’inverse, un nouveau délai de six mois est ouvert pour l’introduction d’un recours en annulation par le Conseil des ministres ou par un gouvernement communautaire ou régional dans les trois hypothèses suivantes [46] :
- lorsqu’un recours est exercé contre une norme qui a le même objet et qui a été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le délai prenant cours à la date de la publication de ce recours au Moniteur belge ;
- lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, avec l’arrêt que cette loi violait la Constitution, le délai prenant cours à la date de la notification de l’arrêt, selon le cas, au Premier ministre et aux présidents des gouvernements ;
- lorsque la Cour a annulé une norme qui avait, en tout ou en partie, le même objet et qui avait été prise par un législateur autre que celui qui a adopté la loi, le délai prenant cours à la date de la notification de l’arrêt, selon le cas, au Premier ministre et aux présidents des gouvernements.
Les questions préjudicielles, quant à elles, ne sont soumises à aucun délai, ce qui permet à la Cour d’être saisie de questions de constitutionnalité de normes parfois très anciennes. Par l’effet de l’hypothèse de réouverture du délai de recours énoncé au 2. ci-avant, une question préjudicielle peut donc provoquer, après l’arrêt de la Cour, l’introduction d’un recours en annulation plusieurs années, voire plusieurs décennies, après l’adoption du texte contesté. Il faut observer toutefois que cette possibilité n’est ouverte qu’au Conseil des ministres et aux gouvernements régionaux et communautaires, et non aux requérants individuels. Ceci réduit l’effectivité de cette disposition, puisque ces organes institutionnels disposent d’autres moyens, comme par exemple l’introduction de projets de lois modificatifs ou abrogatoires de la loi invalidée, pour rétablir l’ordre juridique en conformité à la Constitution. Des cas se sont produits en outre où ces autorités ont laissé un texte de loi en l’état, malgré le constat d’inconstitutionnalité [47].
I – 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Comme indiqué ci-avant, le délai de recours en annulation a été fixé à un an entre 1983 et 1988 et il a été réduit à six mois à partir de 1989.
En outre, l’hypothèse de réouverture de délais indiqué au 3. plus haut a été ajoutée en 1989. Lorsque le délai est rouvert au bénéfice de l’existence d’un recours contre une norme comparable (hypothèse énoncée au 1., plus haut), cette condition est suffisante et il ne faut pas en outre que les moyens dans la deuxième affaire soient identiques à ceux invoqués dans la première [48]. Il suffit que l’objet des deux lois soit identique, sans que leur contenu soit nécessairement le même [49].
Lorsque le délai est rouvert au bénéfice d’un arrêt préjudiciel invalidant la norme attaquée, le recours ne doit pas nécessairement avoir été introduit après le premier arrêt préjudiciel ; il peut encore l’être ultérieurement, en respectant bien entendu le délai de six mois, après un autre arrêt préjudiciel portant sur la même loi [50].
I – 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
Il a été indiqué plus haut, au n° I-2.1., que, la Loi organique de la Cour ne faisant aucune distinction entre les lois pouvant faire l’objet de questions préjudicielles, la Cour a reconnu sa compétence à connaître, au contentieux préjudiciel, de lois d’assentiment à des traités internationaux. Cette compétence a été contestée sur la base de l’article 3, § 2, de la Loi organique de la Cour, qui limite le délai d’introduction d’un recours en annulation contre une pareille loi à soixante jours ; selon cette argumentation, ce dernier texte, par la brièveté du délai énoncé, signifie implicitement qu’en raison de la nécessité d’assurer la stabilité de relations internationales, aucune autre possibilité de saisine n’est ouverte devant la Cour en ce qui concerne les lois d’assentiment à un traité, le procédé du renvoi préjudiciel ne pouvant pas faire obstacle à cette règle.
La jurisprudence de la Cour sur cette question se situe dans le contexte plus large de la controverse sur la hiérarchie entre la Constitution et les règles du droit international directement applicables. La Cour d’arbitrage considère, en tout cas implicitement, que le droit international ne peut pas porter atteinte à la Constitution. D’éminents magistrats, parmi lesquels M. Jacques Velu, alors procureur général à la Cour de Cassation, a soutenu au contraire qu’en principe la primauté du droit conventionnel international directement applicable sur le droit interne implique la subordination de la Constitution [51].
II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Ni dans l’hypothèse du recours en annulation ni dans celle de la question préjudicielle, les auteurs de la saisine ne sont tenus de s’acquitter d’un droit de timbre ou d’une quelconque autre somme d’argent.
II – 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
La représentation du requérant par ministère d’avocat est possible, mais elle n’est pas obligatoire. Dans la pratique, les parties recourent fréquemment au service d’un avocat.
En vertu de l’article 75 de la Loi, la Cour peut commettre un avocat d’office. Jusqu’à présent, cette disposition n’a pas encore reçu d’application. L’arrêté royal d’exécution de cette disposition n’a d’ailleurs pas été adopté.
II – 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Enfin, comme il a été indiqué plus haut, au numéro I-1.1., les parties non institutionnelles devant la Cour qui y introduisent un recours doivent justifier d’un intérêt. En revanche, les parties institutionnelles, c’est-à-dire le Conseil des ministres fédéral, les gouvernements communautaires et régionaux et les présidents des assemblées législatives, ne doivent pas justifier d’un intérêt, celui-ci étant légalement présumé.
Même si la Cour ne s’est jamais exprimée de manière explicite sur ce point, on peut déduire de sa jurisprudence que l’intérêt du requérant, lorsqu’il est requis, doit être maintenu jusqu’à l’issue de la procédure devant elle [52]. Ceci ne signifie pas que l’adoption d’une loi nouvelle en remplacement de la loi attaquée ferait perdre l’intérêt au requérant, la première loi pouvant avoir eu des effets à l’égard de l’auteur du recours [53]. L’intérêt est toutefois dénié si la loi nouvelle vient remplacer un texte ancien qui n’a pas reçu d’exécution, soit d’une manière générale [54], soit en ce qui concerne le requérant [55]. Lorsqu’on se trouve dans cette dernière situation de loi nouvelle remplaçant une loi non exécutée, la décision définitive de la Cour sur le maintien de l’intérêt au premier recours reste suspendue à la condition du rejet du recours contre la seconde loi, qui est d’ailleurs examiné en premier lieu [56] : L’annulation de la seconde loi a en effet pour effet de faire revivre la première [57].
II – 2. – Conditions relatives au recours
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ? Les requêtes en annulation et les questions préjudicielles sont numérotées de manière continue par le Greffe, dans l’ordre de leur réception.
II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
Les requêtes doivent être envoyées par pli recommandé (c’est-à-dire enregistré de manière officielle) à la poste, et ce afin de conférer une date certaine à cet envoi. C’est la date de dépôt à la poste du pli recommandé contenant une requête en annulation qui fait foi pour vérifier si un recours est introduit dans les délais mais c’est aussi cette date qui constitue de point de départ du délai dans lequel la Cour doit rendre son arrêt sur le recours en annulation.
Les décisions juridictionnelles portant des questions préjudicielles ne doivent pas répondre à des conditions de forme relatives au respect d’un éventuel délai puisque de telles questions peuvent être posées à la Cour en tout temps, comme indiqué plus haut, au n° I-3.1. Ces décisions sont notifiées à la Cour sous la forme d’une expédition (c’est-à-dire une copie conforme) signée par le président et le greffier de la juridiction. C’est la date de la réception au Greffe de l’expédition de la décision qui constitue le point de départ pour le calcul du délai dans lequel l’arrêt répondant à une question préjudicielle doit être prononcé.
De plus, si l’article 27 de la Loi organique de la Cour ne fixe pas de délai pour la transmission à la Cour, de l’expédition de la décision de renvoi, l’article 30 prévoit quant à lui, la suspension de la procédure et des délais de procédure et de prescription, depuis la date de cette décision jusqu’à celle de la notification de l’arrêt de la Cour à la juridiction de renvoi. Il est dès lors intéressant de noter que l’expédition de la décision de renvoi parvient parfois au Greffe de la Cour avec un retard considérable. Il est même arrivé exceptionnellement que plus d’une année s’écoule entre le prononcé d’une décision judiciaire posant une question préjudicielle et sa notification à la Cour. Si ce retard est sans incidence sur le calcul des délais propres à la Cour d’arbitrage, il allonge la durée totale d’un procès et peut être dommageable pour les parties devant le juge a quo [58].
Suite à l’introduction d’une affaire, le recours et question préjudicielle sont notifiés par le Greffe de la Cour au Conseil des ministres, aux gouvernements des entités fédérées et aux présidents des assemblées parlementaires. Lorsqu’il s’agit d’une question préjudicielle, celle-ci est aussi notifiée aux parties en cause devant la juridiction qui a pris la décision de renvoi. Lorsqu’une même disposition fait l’objet d’un recours en annulation et d’une question préjudicielle antérieure, le greffier notifie en outre le recours en annulation aux parties en cause devant la juridiction qui a posé la question préjudicielle.
Pour le surplus, l’ensemble des recours en annulation et des questions préjudicielles font l’objet d’une mention au Moniteur belge.
Suite à ces notifications et à cette publication au Moniteur belge, des mémoires peuvent être introduits par les destinataires des notifications et par toute partie intéressée. Le délai prend cours soit à la notification soit à la publication de la mention du recours ou de la question au Moniteur belge.
II – 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Les requêtes en annulation sont établies sur du support papier ; il n’existe pas de formulaire à cet effet, même si certains usages sont généralement respectés dans la pratique en ce qui concerne les recours en annulation, par exemple sous la forme d’un exposé des faits, de considérations générales, d’un exposé des moyens et d’un éventuel développement de ceux-ci.
Les recours en annulation doivent être signés, selon le cas, par le Premier ministre (lorsque le recours est introduit par le Conseil des ministres fédéral), par un membre du gouvernement de l’entité fédérée que celui-ci désigne, par le président d’une assemblée législative ou par la personne justifiant d’un intérêt, chacune de ces autorités ou de ces personnes pouvant être représentées par leur avocat [59].
La requête doit être datée et elle doit indiquer l’objet du recours et contenir un exposé des faits des moyens [60].
Le requérant doit joindre à sa requête une copie de la loi faisant l’objet du recours, et, le cas échant, de ses annexes [61]. Si le recours est introduit par le Conseil des ministres, par un gouvernement d’une entité fédérée ou par le président d’une assemblée législative, la requête doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme à la délibération par laquelle l’autorité collégiale a décidé d’intenter le recours [62]. Ceci concerne également les présidents d’assemblée puisqu’ils ne peuvent agir qu’à la requête des deux tiers des membres de ladite assemblée.
Les personnes morales de droit privé ou de droit public doivent également satisfaire aux exigences formelles d’introduction des recours, notamment par la production de la preuve de la décision prise et des statuts lorsqu’il s’agit de personnes morales de droit privé. Le cas échéant, la Cour peut demander la communication de la preuve de la publication des statuts aux annexes du Moniteur belge ou de la décision d’intenter ou de poursuivre le recours ou encore d’intervenir [63].
Comme il a été indiqué plus haut, la Cour est saisie des questions préjudicielles par la transmission d’une expédition (c’est-à-dire d’une copie conforme selon les formes prévues par la législation applicable à la juridiction) de la décision de renvoi, signée par le président et par le greffier de la juridiction. La décision de renvoi indique les dispositions de la loi faisant l’objet de la question et elle précise éventuellement les articles pertinents des normes de référence par rapport auxquelles la loi en cause fait l’objet du contrôle. Toutefois la Cour d’arbitrage peut reformuler la question préjudicielle [64].
Comme on l’a montré plus haut, sous le numéro II-2.2., des mémoires peuvent être introduits par les parties intervenantes. À l’occasion du premier dépôt des mémoires, les intervenants peuvent formuler à cette occasion de nouveaux moyens. Subséquemment, les parties ne peuvent plus en invoquer. Toutefois, la Cour peut elle-même soulever des moyens d’office ou poser des questions aux parties, à l’occasion de l’ordonnance dite de mise en état, par laquelle, à l’issue de la procédure écrite, la Cour fait savoir aux parties que l’affaire peut être plaidée [65]. Ceci peut conduire les parties à développer, à l’appui ou en réponse aux moyens d’office soulevés par la Cour, des arguments nouveaux.
Les mentions suivantes doivent encore figurer dans les requêtes en annulation : le domicile ou le siège en Belgique ou encore le domicile élu en Belgique, dix copies certifiées conformes de la requête et l’inventaire des pièces éventuellement déposées.
Pour le surplus, on peut rappeler que toute notification émanant des parties, notamment celle de la requête, se fait sous la forme d’un envoi recommandé à la poste, c’est-à-dire faisant l’objet d’une certification officielle par ce service public [66].
II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Les conditions formelles d’introduction des requêtes en annulation et des questions préjudicielles n’ont pas connu d’évolution significative dans le temps.
II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Il n’existe aucune possibilité de régularisation de la requête. Toutefois, dans une affaire, la Cour a admis qu’une seconde requête adressée dans le délai « remplaçait » la première, irrégulière [67].
On peut rappeler en outre que, même lorsqu’une personne morale omet de joindre à sa requête la preuve de la publication de ses statuts ou de sa décision d’intenter ou de poursuivre le recours, elle peut faire parvenir ces documents par la suite, à la demande du Greffe [68].
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II – 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
La recevabilité des recours et des questions préjudicielles est appréciée par la Cour d’arbitrage elle-même, dans l’arrêt qui clôture la procédure.
Lorsque le recours ou la question est manifestement irrecevable ou qu’ils ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour, les deux juges rapporteurs désignés pour examiner l’affaire peuvent faire rapport en ce sens devant le président dans un délai de trente jours au maximum suivant la réception de la question ou de la requête. Les conclusions des juges-rapporteurs sont notifiées aux parties dans ce délai d’un mois. Ces dernières disposent de quinze jours pour introduire un mémoire justificatif. Le président et les juges-rapporteurs, formant une « chambre restreinte » peuvent alors prononcer un arrêt constatant l’irrecevabilité ou l’incompétence de la Cour ; si la proposition des juges-rapporteurs n’est pas retenue, la chambre restreinte le constate par ordonnance et la procédure normale suit son cours. Cette procédure, dite « préliminaire », est réglée par les articles 69 à 71 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage.
II – 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Aucune voie de recours n’est ouverte contre la décision d’irrecevabilité ou d’incompétence.
II – 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
Comme il a été indiqué plus haut, les recours et les questions préjudicielles sont enregistrées par le Greffe dans l’ordre chronologique de leur réception.
Ensuite, s’il n’est pas fait application de la procédure préliminaire décrite ci-dessus, sous le n° II-3.1., la procédure poursuit son cours normal.
Les sièges ayant à connaître des affaires sont connus au préalable. Ils sont composés des deux présidents de la Cour et, selon un tour de rôle établi à l’avance, au début de chaque année judiciaire, de cinq juges en manière telle que, dans cette composition de sept magistrats, il y en ait trois néerlandophones et quatre francophones, et l’inverse l’année suivante. Les deux premiers juges de chaque siège sont automatiquement considérés comme étant les juges-rapporteurs, l’un du rôle linguistique néerlandais, l’autre du rôle linguistique français [69], en manière telle que chaque juge exerce les fonctions de rapporteur dans une affaire sur cinq en moyenne [70]. De cette manière, les affaires sont distribuées aux sièges et aux rapporteurs de manière automatique selon l’ordre de réception de celles-ci au Greffe, sans que quiconque puisse exercer une influence sur la composition ou le choix du siège qui jugera.
Lorsqu’il l’estime nécessaire, chacun des présidents peut soumettre une affaire à la Cour d’arbitrage réunie en séance plénière. Les présidents y sont tenus lorsque, parmi les sept juges qui composent le siège, deux juges en font la demande [71]. Ce sont alors les deux juges-rapporteurs du siège initial qui poursuivent leurs fonctions en cette qualité.
II – 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
Comme tous les arrêts de la Cour, ceux qui se prononcent sur la recevabilité et la compétence sont motivés, prononcés en audience publique et publiés au Moniteur belge ainsi que dans le recueil officiel de la Cour [72].
II – 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Aucune mesure, notamment aucune amende, n’est prévue pour réprimer l’abus du droit d’agir.
II – 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
La procédure relative à la déclaration de l’irrecevabilité n’a pas évolué dans le temps, sauf l’introduction de la procédure préliminaire, décrite plus haut sous le n° II-3.1., lors de la réforme de la Cour en 1989. Cette innovation a été rendue nécessaire par l’instauration du recours individuel par la même réforme [73].
II – 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Les motifs pour lesquels la Cour déclare l’irrecevabilité, au sens large, des recours en annulation et des questions préjudicielles peuvent être systématisés comme suit.
Pour l’examen des causes d’irrecevabilité des recours en annulation et des questions préjudicielles, il a été tenu compte tant de la motivation que du dispositif des arrêts. Il en résulte que, lorsque le dispositif d’un arrêt mentionne le rejet du recours mais que l’examen des considérants laisse apparaître que celui-ci a été rejeté pour des motifs d’irrecevabilité totale ou partielle, il en a été tenu compte dans les chiffres mentionnés ci-dessous. De plus, dans la mesure où la Cour examine la recevabilité de la requête dans le chef de chaque requérant pris séparément et au regard de chacune des dispositions attaquées, un même arrêt peut présenter des causes d’irrecevabilité multiples qui ont été prises en considération pour l’établissement du relevé qui suit. Les pourcentages sont calculés par rapport à l’ensemble des causes d’irrecevabilité constatées.

III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III – 1. – Principe du contradictoire
III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Comme il a été indiqué plus haut sous le numéro II-2.2., in fine, dès que les requêtes en annulation et les questions préjudicielles sont enregistrées par le Greffe, elles sont notifiées par celui-ci au Conseil des ministres fédéral, aux gouvernements des entités fédérées ainsi qu’aux présidents des assemblées législatives fédérales et fédérées. Lorsqu’il s’agit d’une question préjudicielle, la décision de renvoi est également notifiée aux parties à la procédure ayant donné lieu au renvoi.
Ces notifications n’interviennent toutefois qu’après l’issue éventuelle de la procédure préliminaire évoquée plus haut, sous les numéros II-3.1. et II-3.3., in fine.
Chacun des destinataires de ces notifications ont le droit d’introduire un mémoire, sans avoir à justifier de leur intérêt.
Parallèlement, le Greffe ayant fait publier au Moniteur belge (c’est-à-dire le Journal officiel du Royaume de Belgique) une mention relative à l’existence d’une question préjudicielle ou le recours en annulation, toute personne justifiant d’un intérêt peut adresser un mémoire à la Cour.
Seules les personnes ayant introduit des mémoires sont réputées parties à la procédure et peuvent à ce titre déposer ultérieurement un second mémoire [74].
III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
La procédure devant la Cour d’arbitrage est essentiellement écrite.
Comme il vient d’être exposé, un large accès à celle-ci est prévu, non seulement aux parties institutionnelles, mais également aux personnes justifiant d’un intérêt, ce qui inclut notamment les personnes justifiant d’un intérêt dans la cause dans la juridiction qui ordonne le renvoi préjudiciel [75].
À l’issue de la procédure écrite, la Cour décide, sur la base d’un rapport des juges-rapporteurs, si l’affaire est en état. Dans ce cas, elle fixe la date d’une audience au cours de laquelle chacune des parties, dans les limites énoncées plus haut, sous le n° III-1.1., pourra être entendue, assistée le cas échéant d’un avocat [76].
L’audience de la Cour d’arbitrage est publique. Dans la pratique, il est fréquent que des affaires particulièrement sensibles, notamment sur le plan politique, soient suivies par des journalistes et que la presse y fasse largement écho.
III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
La description sommaire de la procédure permet de se convaincre du caractère totalement contradictoire de la procédure devant la Cour d’arbitrage. Lorsqu’un moyen d’office est soulevé ou que des parties font état d’éléments nouveaux, notamment à l’audience, la Cour est attentive à permettre à chaque partie de pouvoir émettre ses observations en toute connaissance de cause.
Peut-être le caractère contradictoire de la procédure serait-il encore mieux assuré si les rapports faits à l’audience par les juges-rapporteurs étaient préalablement soumis aux parties avant le jour de l’audience elle-même. Tel est le sens d’une disposition figurant dans un récent avant-projet de loi de réforme de la Cour d’arbitrage.
III – 2. – Égalité des armes
III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Outre des pièces internes, comme par exemple les preuves de notifications, le dossier de la procédure devant la Cour d’arbitrage se compose de l’acte introductif, c’est-à-dire de la requête en annulation, complétée le cas échéant d’une demande de suspension [77], ou de la décision juridictionnelle 47 portant la question préjudicielle, des mémoires des parties intervenantes (en ce compris le plus souvent le mémoire du Conseil des ministres ou du gouvernement représentant l’entité ayant adopté la norme en cause) et des mémoires en réponse des autres parties. Aux termes de l’article 88 de la Loi organique de la Cour, « toute personne qui […] adresse un mémoire à la Cour est tenue d’y joindre le dossier qu’elle détient », accompagné d’un inventaire.
Après l’échange des mémoires, la Cour examine si l’affaire est en état d’être plaidée devant elle. Si c’est le cas, elle le constate par une ordonnance, qui fixe également la date de l’audience.
Si l’affaire n’est pas en état, une ordonnance énonce les devoirs à accomplir par les juges-rapporteurs ou par les greffiers. Elle peut mentionner les moyens qui paraissent devoir être examinés d’office et invite alors les parties à déposer un mémoire dans le délai qu’elle fixe. Parfois, la Cour se contente de poser des questions aux parties en les invitant aussi à déposer un mémoire complémentaire.
Plus rarement, l’audience révèle la lacune d’un dossier. La Cour peut alors ordonner le dépôt de pièces complémentaires.
À l’exception de la note de mise en état, et sous la réserve des actes résultant des pouvoirs d’instruction de la Cour, très rarement mis en œuvre, aucune pièce émanant de la Cour n’est notifiée aux parties. Les rapports d’audience par exemple, prononcés par les juges-rapporteurs, ne font pas l’objet d’une notification préalable aux parties.
Aucune pièce n’est exclue de la procédure et chaque partie reçoit la notification des mémoires et de l’inventaire des dossiers éventuels, ces derniers pouvant être consultés au Greffe, dont les heures d’ouverture font l’objet d’un arrêté royal publié au Moniteur belge.
III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Aux termes de l’article 91 de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, la Cour a des pouvoirs d’instruction et d’investigation les plus étendus. Elle peut notamment correspondre directement avec le Premier ministre, avec les présidents des assemblées législatives et des gouvernements, ainsi qu’avec toute autorité publique, entendre contradictoirement les parties avant l’audience et se faire communiquer par elles et par toute autorité publique tous documents et renseignements ayant trait à l’affaire, entendre toute personne dont elle estime l’audition utile, procéder sur les lieux à toutes constatations, et commettre des experts.
Elle peut, par ordonnance, déléguer aux rapporteurs des pouvoirs d’instruction et d’investigation qu’elle détermine. Dans la pratique, il est arrivé que les greffiers se voient investis d’une pareille mission, pour des renseignements à caractère principalement matériel.
La Cour peut décider que les personnes entendues le soient sous serment, les parties et leurs avocats convoqués 86[78]. Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer est puni d’une amende. La non-comparution et le refus de témoigner sous serment fait l’objet d’un procès-verbal transmis au ministère public et les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile ainsi que la subornation des témoins sont applicables à cette procédure.
En cas de descente sur les lieux, les parties et leurs avocats sont convoqués. L’éventuelle expertise se fait selon les règles applicables en droit commun, ce qui implique notamment une parfaite contradiction entre les parties 87[79].
Jusqu’à présent, la Cour n’a pas eu l’occasion de faire application de ses pouvoirs d’instruction énoncés sous ce n° III-2.3., à l’exception de l’un ou l’autre devoir d’information auquel il est procédé par l’office du greffier.
III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête / de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés par le juge ?
Le contrôle de constitutionnalité relevant par nature de l’ordre public, la Cour d’arbitrage peut soulever d’office des moyens non soulevés dans la requête, soit, avant l’audience, dans l’ordonnance de mise en état 88[80], soit, après l’audience, en cours de délibéré par un arrêt interlocutoire.
À ce jour, la Cour n’a soulevé un moyen d’office après l’audience, au stade du délibéré, que dans son seul arrêt n° 81/95 89[81]. Elle ne dispose pas à ce jour de statistiques relatives aux questions ou aux moyens d’office soulevés par elle dans l’ordonnance de mise en état.
Lorsque la Cour soulève un moyen d’office ou qu’elle interroge les parties, chacune d’entre elles a la possibilité de faire connaître son point de vue, parfois oralement à l’audience, le plus souvent par la voie d’un mémoire.
III – 3. – Délai de jugement
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Aux termes de l’article 109 de la Loi organique de la Cour d’arbitrage, les arrêts doivent être prononcés par la Cour dans les six mois de l’introduction de l’affaire, avec une double prorogation éventuelle de six mois, ce qui porte le délai maximal à dix-huit mois.
La Cour est soumise à ces délais dans chaque type de contentieux (contentieux des conflits de compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées ou contentieux de fond), peu importe sa saisine (recours en annulation ou question préjudicielle).
Toutefois, lorsqu’une demande de suspension accompagne le recours en annulation, la Cour statue « sans délai » [82], soit en pratique entre un mois et trois mois après la demande. La Cour doit prononcer son arrêt sur la demande principale d’annulation dans les trois mois de l’éventuel arrêt de suspension, lorsque celle-ci est ordonnée.
Ces délais ont toujours été respectés. Il faut préciser toutefois qu’en cas de décès d’une partie devant la juridiction de fond ayant posé une question préjudicielle à la Cour, la procédure devant celle-ci est suspendue jusqu’à la reprise d’instance [83], ce qui peut provoquer un allongement du délai conformément à la loi. Lorsque, comme elle l’a fait dans une affaire [84], la Cour d’arbitrage pose une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, le délai est inévitablement prolongé de la durée de la procédure devant la Cour de Luxembourg.
La saisine de la Cour reste limitée dans tous les cas aux normes faisant l’objet du recours ou de la question préjudicielle. Toutefois, à titre exceptionnel, la Cour considère que, lorsque des dispositions sont indissociablement liées à des dispositions régulièrement attaquées dont elle prononce l’annulation, l’annulation de celles-là par voie de conséquence s’impose et se justifie pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques [85].
III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
Comme il a été indiqué plus haut, sous le n° III-2.1., l’instruction préparatoire, consistant principalement en un échange de mémoires, est clôturée par une ordonnance de la Cour relative à la mise en état de l’affaire
III – 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
Le tableau ci-dessous indique la durée moyenne de la procédure pour chaque type d’arrêts, depuis l’entrée en vigueur de la Loi spéciale du 6 janvier 1989, en distinguant d’une part, l’ensemble des arrêts prononcés après mise en œuvre de la procédure préliminaire, et d’autre part les différents types d’arrêts rendus dans le cadre de la procédure ordinaire. Il indique en outre, à titre de comparaison, les durées moyennes constatées pour la période 1999-2000 94[86].
Le délai moyen de prononcé d’un arrêt est calculé par affaire, sur la base du nombre de jours écoulés entre la saisine de la Cour (c’est-à-dire pour les recours en annulation et les demandes de suspension, la date de dépôt à la poste du pli recommandé contenant la requête, et pour les questions préjudicielles, la date de réception au Greffe de l’expédition de la décision de renvoi) et la date de prononcé de l’arrêt de la Cour. Il en résulte qu’un arrêt sur recours en annulation rendu sur procédure ordinaire intervient en moyenne dans les douze mois de l’introduction de l’affaire devant la Cour tandis qu’un arrêt sur question préjudicielle est prononcé dans les onze mois. Les arrêts sur demande de suspension interviennent quant à eux en moyenne dans les deux mois de l’introduction de la demande. Les chiffres récents montrent une légère tendance à l’allongement du délai moyen pour les questions préjudicielles, la proportion de celles-ci dans l’ensemble du contentieux traité étant en nette augmentation, tandis que le délai moyen de prononcé des arrêts sur recours en annulation tend à diminuer.

La Cour ne dispose actuellement d’aucune donnée statistique en ce qui concerne le délai écoulé entre la fin de l’instruction et la tenue du délibéré, de même qu’entre celle-ci et le prononcé de l’arrêt.
En ce qui concerne le délai de publication au Moniteur belge (Journal officiel du Royaume), en raison du nombre peu élevé d’arrêts rendus durant la période 1985-1988, celui-ci était alors d’une vingtaine de jours. Depuis 1989, le nombre de jours écoulés entre le prononcé d’un arrêt et sa publication au Journal officiel a doublé en raison de la très forte augmentation du nombre annuel d’arrêts rendus ; il a même triplé en ce qui concerne les arrêts sur questions préjudicielles. Aucune donnée statistique précise n’est toutefois disponible actuellement.
Les arrêts sont notifiés le jour même de leur prononcé, au plus tard le lendemain, à leurs destinataires.
Conclusion
1. – Créée en 1980 et installée en 1984, la Cour d’arbitrage a vu le nombre des affaires introduites devant elles augmenter progressivement, nécessitant une adaptation du nombre des membres du personnel.
Entre 1984 et 1989, le cadre du personnel était établi comme suit :

Depuis 1989, à la suite de l’extension des compétences de la Cour 95[87], le cadre a été étendu et se présente comme suit 96[88] :

97. Agents de niveau supérieur, affectés à la bibliothèque, à la documentation ou à la révision de la traduction.
En 1997, le cadre des attachés ou des conseillers-adjoints ou conseillers ou premiers conseillers a été complété de deux unités, faisant passer le total de 36 à 38 personnes.
Le cadre des référendaires a également été adapté à cette occasion, passant de dix à quatorze personnes. Les référendaires sont des magistrats engagés par la Cour à la suite d’un concours et chargés d’assister la Cour et chacun de ses membres.
La Cour est en outre assistée de deux greffiers.
2. – Au début de ce mois de mars 2000, le Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi visant principalement à étendre les compétences de la Cour d’arbitrage au contrôle des lois au regard de l’ensemble des droits et des libertés garantis par la Constitution. Le texte adopté ne prévoit pas de modification quant à la saisine de la Cour et au droit d’accès à celle-ci.
Certaines lois ne pourraient toutefois plus faire l’objet de questions préjudicielles : il s’agit de celles par lesquelles le pouvoir législatif a donné son assentiment aux traités relatifs aux Communautés européennes ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme et à ses Protocoles additionnels.
En outre, selon ce même avant-projet, les juridictions ne sont plus tenues de poser une question préjudicielle dans les procédures de référé (judiciaire et administratif) et de contrôle de détention préventive.
L’extension des compétences de la Cour entraînera probablement une augmentation de son personnel. L’avant-projet de loi prévoit déjà que le nombre de référendaires passera de quatorze à vingt-quatre personnes.
3. – Depuis la création de la Cour d’arbitrage, les parties, tant celles qui introduisent des affaires devant la Cour que celles qui interviennent pour défendre la légalité des lois en cause, ont tendance à recourir à des avocats, le plus souvent spécialisés en droit public et administratif ou dans la branche du droit faisant l’objet de la législation concernée (droit fiscal, droit social, droit familial, etc.). On ne peut donc faire état d’une évolution allant en ce sens, cette tendance se manifestant depuis l’origine.
La participation de ces spécialistes contribue généralement à la clarification des débats devant la Cour et à une information pertinente de celle-ci, spécialement dans les domaines particulièrement complexes et techniques sur lesquels la Cour peut être amenée à se pencher.
ANNEXE
Rapport complémentaire au sujet des recours introduits devant la Cour d’arbitrage de Belgique par des personnes morales
À la 4e page du rapport de la Cour d’arbitrage de Belgique [p. 28 du présent volume], à la fin de l’alinéa 2, il est annoncé un rapport complémentaire relatif à la ventilation plus précise entre les requérants ayant la qualité de personnes de droit privé. Tel est l’objet du présent rapport complémentaire.
L’affinement des statistiques au sujet des recours en annulation introduits par des personnes morales a en effet permis d’obtenir l’aperçu plus précis qui suit, dans lequel les chiffres et les pourcentages peuvent sensiblement varier par rapport à ceux qui figurent dans le texte d’origine, dès lors que la méthode appliquée pour le dénombrement des requérants est une méthode de calcul par catégorie et que plusieurs catégories distinctes de personnes morales peuvent être à l’origine d’une même requête en annulation. Le tableau qui suit remplace celui qui figure à la 4e page du rapport.

98. Sont notamment classés dans cette catégorie les recours introduits par les villes et communes, les provinces, les centres publics d’aide sociale, les associations de communes, les établissements et les organismes publics, …
99. Sont classés dans cette catégorie les recours introduits par les personnes morales de droit privé constituées sous forme d’associations sans but lucratif (ASBL).
100. Sont classés dans cette catégorie les recours introduits par les sociétés à objet commercial quelle qu’en soit la forme.
101. À l’exception des associations à caractère professionnel constituées sous la forme d’association sans but lucratif, qui sont répertoriées dans la catégorie propre à cette forme de personnes morales.
-
[1]
C’est-à-dire le collège réunissant les ministres et les secrétaires d’État fédéraux nommés par le Roi. [Retour au contenu] -
[2]
Les communautés et les régions forment les entités fédérées de la Belgique, auxquels il faut ajouter la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française dans la Région de Bruxelles-Capitale. [Retour au contenu] -
[3]
C’est-à-dire les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat (assemblées de l’État fédéral) et des Conseils de communauté et de région, en ce compris les assemblées de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. Les présidents d’assemblée n’agissent qu’à la requête de deux-tiers des membres de celle-ci. [Retour au contenu] -
[4]
Dans certains cas, la jurisprudence de la Cour d’arbitrage admet en effet à titre exceptionnel que des syndicats ou des partis politiques puissent introduire des recours devant elle, notamment lorsque la loi leur reconnaît une compétence (ex. : la concertation syndicale) ou un droit (ex. : le financement des partis, la protection du sigle électoral) affecté par la loi en cause. Dans la suite du présent rapport, lorsqu’il sera question des personnes morales pouvant agir devant la Cour, ce concept devra être compris comme incluant dans ces conditions certaines associations de fait [Retour au contenu] -
[5]
On entend par « loi » toute norme à caractère législatif, ce qui inclut les décrets et les ordonnances communautaires et régionaux. [Retour au contenu] -
[6]
Cette exception est levée si l’irrecevabilité est tirée de normes faisant elles-même l’objet de la question préjudicielle. [Retour au contenu] -
[7]
D’autres exceptions, à caractère prétorien, ont été invoquées, comme par exemple celles tirées de la nécessité de respecter le délai raisonnable requis par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. [Retour au contenu] -
[8]
C’est-à-dire principalement la liberté de l’enseignement, le droit à l’enseignement, le droit à une éducation morale et religieuse, l’égalité et le principe de légalité. [Retour au contenu] -
[9]
Rappelons qu’en Belgique les communautés sont des entités fédérées disposant d’une parcelle du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif dans certaines matières. [Retour au contenu] -
[10]
Article 24 de la Constitution. [Retour au contenu] -
[11]
Arrêt no 40/99. [Retour au contenu] -
[12]
Jurisprudence constante, not. l’arrêt no 77/95. [Retour au contenu] -
[13]
Arrêt no 40/99. [Retour au contenu] -
[14]
Il s’agit de la Loi du 28 juin 1983. [Retour au contenu] -
[15]
Sénat, Doc. parl., 1982-1983, no 246/2, p. 217. [Retour au contenu] -
[16]
Arrêts nos 49/94, 15/95 et 54/95. [Retour au contenu] -
[17]
Arrêts nos 59/95, 59/98 et 100/98, 10/99 et 57/99. [Retour au contenu] -
[18]
Arrêt no 79/97. [Retour au contenu] -
[19]
Arrêt no 137/98. [Retour au contenu] -
[20]
Arrêt no 119/98. [Retour au contenu] -
[21]
Arrêt no 133/98. [Retour au contenu] -
[22]
Le délai dans lequel la Cour doit prononcer ses arrêts est de six mois, pouvant être prolongé deux fois, soit un total maximal de dix-huit mois [Retour au contenu] -
[23]
Arrêt no 129/98. [Retour au contenu] -
[24]
On rappelle qu’à défaut de précision dans le présent rapport, le mot « loi » y désigne l’ensemble des normes législatives adoptées par les organes législatifs de l’État et des entités fédérées. [Retour au contenu] -
[25]
Par exemple la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. [Retour au contenu] -
[26]
Art. 3, § 2, de la Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage. Même si cette loi ne prévoit expressément la compétence de la Cour à l’égard des lois d’assentiment aux traités internationaux que sur un recours en annulation, la Cour s’est également estimée compétente à l’égard de pareilles lois lorsqu’elle est saisie de questions préjudicielles (arrêts nos 26/91, 12/94, 33/94 et 67/94). [Retour au contenu] -
[27]
Not. arrêts nos 54/96 et 22/98. [Retour au contenu] -
[28]
Arrêt no 75/98. [Retour au contenu] -
[29]
Not. arrêts nos 58, 71, 2/89, 73/93, 61/93, 4/94 et 70/95. 32. Not. arrêts nos 54/97, 78/98, 58/99, 119/98 et 113/99. [Retour au contenu] -
[30]
C’est-à-dire de « lois » d’entités fédérées. [Retour au contenu] -
[31]
Arrêts nos 31/95 et 45/95. [Retour au contenu] -
[32]
Il s’agit de l’article 87, § 4, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. [Retour au contenu] -
[33]
Arrêt no 39/97. [Retour au contenu] -
[34]
Not. l’arrêt Ruiz-Mateos, 23 juin 1993. Voy. les arrêts nos 35/94, 49/97, 50/97, 51/97, 52/97 et 55/97. Ces arrêts se prononcent dans un sens différent des arrêts nos 4, 5, 6 et 32, prononcés auparavant. [Retour au contenu] -
[35]
Arrêts nos 35/94 et 49/97. [Retour au contenu] -
[36]
Arrêt no 35/94. [Retour au contenu] -
[37]
Arrêt no 49/97. [Retour au contenu] -
[38]
Arrêts nos 50/97 et 51/97. [Retour au contenu] -
[39]
C’est-à-dire la procédure de « filtrage » par laquelle, dès l’introduction d’un recours en
annulation ou d’une question préjudicielle, la Cour peut, sur la proposition des juges-rapporteurs
et après avoir donné aux parties la possibilité de s’en expliquer par écrit, dire un recours irrecevable, non fondé ou ne relevant pas de la compétence de la Cour, et ce de manière manifeste, ou dire une question préjudicielle irrecevable, sans objet, donnant lieu à une réponse immédiate ou ne relevant pas de la compétence de la Cour, et ce de manière toujours manifeste (voy. le no II – 3.1, plus bas). [Retour au contenu] -
[40]
Arrêts nos 50/97, 51/97, 52/97 et 55/97. [Retour au contenu] -
[41]
Arrêt no 56/93. [Retour au contenu] -
[42]
Arrêt no 118/98. [Retour au contenu] -
[43]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 3, § 1er. [Retour au contenu] -
[44]
Ibid. [Retour au contenu] -
[45]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 3, § 2 [Retour au contenu] -
[46]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 4. [Retour au contenu] -
[47]
Un avant-projet de loi de réforme de la Cour d’arbitrage élargirait cette hypothèse de réouverture du droit de recours aux personnes physiques et morales justifiant d’un intérêt. [Retour au contenu] -
[48]
Arrêt no 10/86. [Retour au contenu] -
[49]
Arrêt no 59/92. [Retour au contenu] -
[50]
Arrêt no 11/89. Rappelons toutefois que seuls le Conseil des ministres et les gouvernements des entités fédérées peuvent s’autoriser de cette hypothèse de réouverture du délai de recours. [Retour au contenu] -
[51]
Sur ces questions, cons. M. Melchior et P. Vandernoot, « Contrôle de constitutionnalité et droit communautaire dérivé », rapport présenté par la Cour d’arbitrage au colloque des cours constitutionnelles des États de l’Union européenne, organisé par le Conseil constitutionnel de France à Paris, les 25 et 26 septembre 1997, Revue belge de droit constitutionnel, 1998, pp. 3 à 45, spéc. les nos 1 à 5. [Retour au contenu] -
[52]
Not. arrêts nos 35/93, 40/95, 33/98 et 128/98. [Retour au contenu] -
[53]
Not. arrêts nos 74/92 et 40/95. La Cour a d’ailleurs invalidé une loi relative à la procédure devant le Conseil d’État en tant qu’elle était interprétée comme faisant perdre son intérêt à un recours en annulation d’un acte administratif lorsque le requérant, par la suite de sa mise à la pension, ne pouvait plus prétendre à obtenir le bénéfice de cet acte, la Cour considérant que l’intérêt était maintenu par la perspective d’un recours indemnitaire faisant suite à l’éventuelle constatation de l’excès de pouvoir par le juge administratif (arrêt no 117/99). Cette jurisprudence montre que la Cour se montre assez méfiante à l’égard d’une éventuelle perte de l’intérêt en cours de procédure. [Retour au contenu] -
[54]
Arrêt no 33/98. Tel est évidemment le cas si la loi nouvelle a un effet rétroactif (arrêt no 71/99). [Retour au contenu] -
[55]
Arrêt no 128/98. [Retour au contenu] -
[56]
Arrêt no 97/99. [Retour au contenu] -
[57]
Arrêts nos 33/98, 128/98, 71/99, 82/99 et 97/99. [Retour au contenu] -
[58]
Arrêts nos 44/93, 48/93, 13/95 et 10/2000. [Retour au contenu] -
[59]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 5. [Retour au contenu] -
[60]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 6. [Retour au contenu] -
[61]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 7. [Retour au contenu] -
[62]
Ibid. [Retour au contenu] -
[63]
Ibid. [Retour au contenu] -
[64]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 27. [Retour au contenu] -
[65]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 90. 73. Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 81 et 82. [Retour au contenu] -
[66]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 82. [Retour au contenu] -
[67]
Arrêt no 36/97. [Retour au contenu] -
[68]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 7, alinéa 3. [Retour au contenu] -
[69]
La Cour se compose de douze membres, soit six du rôle linguistique néerlandais et six du rôle linguistique français. Parmi ces douze juges, deux présidents sont élus, soit un par groupe linguistique. [Retour au contenu] -
[70]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 59, 67 et 68. [Retour au contenu] -
[71]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 110, 111 et 114. [Retour au contenu] -
[72]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 56. le n° II-3.1., lors de la réforme de la Cour en 1989. Cette innovation a été rendue nécessaire par l’instauration du recours individuel par la même réforme [Retour au contenu] -
[73]
Voy. le no I – 1.1, plus haut. Incompétence l’acte soumis au contrôle de la Cour est un article de la Constitution ou résulte d’un choix fait par le constituant [Retour au contenu] -
[74]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 74 à 89. [Retour au contenu] -
[75]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 87, § 1er. [Retour au contenu] -
[76]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 90, 103 et 104. [Retour au contenu] -
[77]
Comme le recours en annulation n’a pas d’effet suspensif de l’exécution de la loi attaquée, le requérant peut, par un acte séparé ou dans le corps même de la requête, demander la suspension de la loi, et ce dans deux hypothèses : le recours invoque des moyens sérieux et il se présente un risque de préjudice grave difficilement réparable, d’une part, et, d’autre part, le recours attaque une loi identique à une loi précédente et annulée par la Cour. [Retour au contenu] -
[78]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 92. [Retour au contenu] -
[79]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 93. [Retour au contenu] -
[80]
Voy. le no III – 2.1, plus haut. [Retour au contenu] -
[81]
La Cour a répondu à ce moyen par l’arrêt no 23/96. [Retour au contenu] -
[82]
Art. 23 de la Loi organique de la Cour. [Retour au contenu] -
[83]
Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage, art. 97. [Retour au contenu] -
[84]
Arrêts nos 6/97 et 120/98. [Retour au contenu] -
[85]
Arrêt no 73 ; dans le même sens : les arrêts nos 42/97, 80/97 et 66/98. [Retour au contenu] -
[86]
Il est tenu compte des arrêts de la Cour jusqu’à l’arrêt no 24/2000 du 23 février 2000. [Retour au contenu] -
[87]
Voy., plus haut, la réponse aux questions nos I – 1.1 et I – 1.2. [Retour au contenu] -
[88]
Arrêté royal du 6 novembre 1989, Mon. b., 28 novembre 1989. [Retour au contenu]
Rapport de la Cour constitutionnelle du Bénin
Mars 2000
La Cour constitutionnelle du Bénin est une création de la Constitution du 11 décembre 1990.
Les règles de fonctionnement et d’organisation de cette juridiction ont été précisées par la Loi n° 91-009 du 4 mars 1991 portant Loi organique sur la Cour constitutionnelle et complétées par le Règlement intérieur et certains décrets.
Ces décrets sont :
- le Décret n° 94-11 du 26 janvier 1994 portant obligations des Membres de la Cour constitutionnelle et dont l’article 2 a été modifié par le Décret n° 97-275 du 9 juin 1997 ;
- le Décret n° 94-12 du 26 janvier 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat général de la Cour constitutionnelle et dont l’article 5 a été modifié par le Décret n° 97-274 du 9 juin 1997.
I. L’ouverture du droit de saisine
La Cour constitutionnelle est saisie par une simple requête et la procédure devant elle est écrite, gratuite, secrète. Elle est contradictoire selon la nature de la requête ; article 26 du Règlement intérieur.
I – 1. – Les requérants
I – 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
Conformément aux dispositions de la Constitution et de la Loi organique n° 91-009 du 4 mars 1991, la Cour peut être saisie par :
- tout citoyen, pour les lois après leur promulgation, pour les lois, textes réglementaires et les actes administratifs censés porter atteinte aux droits de la personne humaine et des libertés publiques ; articles 3-122 de la Constitution ; article 24 de la Loi organique sur la Cour ;
- tout citoyen, par la procédure d’inconstitutionnalité dans une affaire qui le concerne et qui est en examen devant une juridiction de l’ordre judiciaire ; article 24 de la Loi organique ;
- le président de la République pour les lois organiques et ordinaires avant leur promulgation ; article 121 de la Constitution ; articles 19 et 20 de la Loi organique sur la Cour ;
- tout membre de l’Assemblée nationale pour les lois ordinaires avant leur promulgation ; articles 121 de la Constitution et 20 de la Loi organique ;
- les présidents de l’Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du Conseil Économique et Social pour le Règlement intérieur de l’Institution qu’ils dirigent ; article 21 de la Loi organique ;
- le président de la République et le président de l’Assemblée nationale pour les engagements internationaux ; article 146 de la Constitution.
Depuis la mise en place de la Juridiction constitutionnelle en 1991, trois cent quatre vingt et un (381) recours ont été enregistrés dans le domaine du contrôle de constitutionnalité des normes au 31 décembre 1999.
L’accroissement progressif des recours s’explique d’une part par le fait que les modalités de saisine rendent la Cour accessible à tous les citoyens, d’autre part par le fait qu’il s’agit d’une nouvelle juridiction qui a très tôt acquis une grande crédibilité et qui de ce fait leur inspire confiance. La Cour constitue pour eux le dernier rempart. Cet accroissement se justifie aussi par la volonté manifeste des citoyens d’exercer pleinement un droit accordé par la Constitution elle-même, tous les acteurs de la vie politique et tous les citoyens étant animés par le souci de l’enracinement des acquis de la démocratie.
Saisine émanant d’une personne publique

Total : 111 recours
Saisine émanant d’une personne et de groupements privés :

Total : 270 recours
I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évoluées dans le temps ?
Les conditions d’ouverture du recours ont évolué aussi bien à la faveur de modifications de textes que suite à une jurisprudence.
- Depuis le 18 novembre 1997, le Règlement intérieur a été modifié en son article 29 alinéa 2 en vue de permettre la recevabilité des recours initiés par les citoyens qui ne savent pas signer. Cet alinéa est désormais libellé ainsi qu’il suit : « … Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale. »
- Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour a évolué dans le sens de l’admission des recours des étrangers. En effet, par sa décision 12 DC du 13 août 1992, le Haut Conseil de la République siégeant en qualité de Cour constitutionnelle, avait déclaré irrecevable la requête n’émanant pas d’un citoyen béninois.
En revanche, dans sa décision DCC 97-045 du 13 août 1997, la Cour a statué favorablement sur le recours d’un expatrié danois et ce en conformité avec l’article 39 de la Constitution qui énonce : « Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi… »
I – 1.3. – La Cour elle-même dispose-elle d’une possibilité d’auto-saisine :
L’article 121 alinéa 2 de la Constitution offre à la Cour constitutionnelle la possibilité de se saisir d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 23 du Règlement intérieur permettent à la Haute Juridiction de « s’auto saisir » lorsqu’elle « constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle ». Elle peut donc la rectifier d’office et procéder à tous amendements jugés nécessaires.
I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Les requérants peuvent se désister de leur saisine et aucun délai n’est prescrit en la matière. Toutefois, pour être prise en considération, la lettre de désistement doit parvenir à la Cour avant que celle-ci ne statue sur la requête initiale.
Quant au caractère partiel du désistement, il dépend du requérant.
I – 2. – Actes contrôlés
I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé :

I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Aux termes des dispositions de l’article 131 alinéa 3 de la Constitution : « La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative, judiciaire et des comptes de l’État… Les décisions de la Cour 60 suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif, ainsi qu’à toutes les juridictions. » En conséquence, les décisions et actes judiciaires ne peuvent pas être soumis au contrôle de constitutionnalité de la Haute Juridiction.
I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Aux termes des dispositions de l’article 114 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est « juge de la constitutionnalité de la loi ». Il en résulte que, quel que soit l’objet de la saisine, la Cour est saisie de la loi dans son entièreté. En conséquence, le juge constitutionnel est habilité à juger de l’ensemble de la loi, en dehors des griefs et moyens évoqués par les requérants.
I – 3. – Les délais
I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Aucun délai n’est fixé pour les recours contre les actes réglementaires. Ces actes ne sont déférés à la Cour qu’après leur publication ou leur mise en application.
I – 3.2. – Tableau des conditions de délais :

I – 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Les délais de saisine n’ont pas changé.
I – 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
Aucune critique relative aux délais de saisine n’est pour l’instant parvenue à la Cour.
II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Le requérant n’est astreint à aucun droit de timbre. « La procédure devant la Cour constitutionnelle est écrite, gratuite, secrète et contradictoire selon la nature de la requête». – Article 26 du Règlement intérieur.
II – 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
La représentation n’est pas obligatoire. Mais « les parties peuvent se faire assister de toute personne physique ou morale compétente. Celle-ci peut déposer des mémoires signés par les parties concernées ». – Article 28 du Règlement intérieur.
II – 1.3. – Le requérant doit-iI démontrer son intérêt à agir ?
Il n’est pas nécessaire que le requérant démontre son intérêt à agir puisque tout citoyen peut saisir directement la Cour. Toutefois, le requérant doit préciser l’objet de la saisine.
II – 2. – Conditions relatives au recours
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Tous les courriers sont enregistrés par ordre d’arrivée et numérotés de façon chronologique. Les requêtes considérées comme des recours sont 62 ensuite affectées d’un second numéro suivi de la syllabe « REC » (la première du mot RECOURS). Ce système de numérotation adopté depuis le début de l’année 1999 permet d’avoir à tout moment une idée du nombre de recours enregistrés. Exemple : Recours n° 0162 / 0009 / REC : cette requête est le 0162e courrier enregistré au Secrétariat de la Cour et le 09e recours de l’année.
II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
Les requêtes sont enregistrées au fur et à mesure de leur réception. C’est donc cette date d’enregistrement qui entre en ligne de compte pour la suite de la procédure.
II – 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Aucune disposition légale n’interdit que des moyens nouveaux puissent être soulevés au cours d’une procédure. L’essentiel est que la Cour soit, en tout état de cause, saisie avant que le recours ne soit examiné en audience plénière.
Conditions formelles

Conditions matérielles

II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Une amélioration a été apportée aux conditions formelles d’ouverture du recours, suite à la modification de l’article 29 alinéa 2 du Règlement intérieur. Cet article désormais libellé comme suit : « Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses nom, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale », permet au requérant analphabète de saisir la Haute Juridiction.
II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Il n’existe pas une procédure formelle de régularisation d’une requête. Le requérant peut, avant la délibération sur son recours initial, saisir à nouveau la Cour pour lui apporter d’autres précisions. La Cour pourrait elle aussi, au cours de l’instruction du recours initial, amener à la régularisation d’une requête en sollicitant du requérant des informations complémentaires. D’une façon générale, et plus particulièrement dans les cas de violation des droits de la personne, des délais sont impartis aux différentes parties en vue d’une mise en état rapide des dossiers.
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
Les modalités de rejet pour irrecevabilité sont multiples. En effet, l’article 29 alinéa 2 nouveau du Règlement intérieur prescrit : 64 « Pour être valable, la requête émanant d’une organisation non gouvernementale, d’une association ou d’un citoyen doit comporter ses noms, prénoms, adresse précise et signature ou empreinte digitale. »
Lorsqu’une requête ne satisfait donc pas à l’une quelconque de ces exigences, elle est déclarée irrecevable.
De même, le défaut de qualité ou de capacité d’un requérant à saisir la juridiction constitutionnelle dans une matière donnée entraîne l’irrecevabilité de la requête.
II – 3.1. – Qui statue sur la recevabilité du recours ?
Pour statuer sur la recevabilité d’un recours, la Cour se réunit en session plénière et statue sur le rapport écrit du rapporteur désigné.
II – 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
« Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. ». – Article 124 alinéas 2 et 3 de la Constitution.
II – 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
La Cour statue toujours en assemblée plénière, et pour délibérer valablement, elle doit comprendre au moins cinq (5) membres.
- Article 19 du Règlement intérieur.
- Lorsque la Cour est saisie d’une requête, celle-ci est enregistrée par les services du Secrétariat général suivant la date d’arrivée. – Article 25 du Règlement intérieur.
- Le dossier de la procédure est ensuite transmis à un rapporteur désigné par le président. Le rapporteur procède à l’instruction de l’affaire en vue d’un rapport écrit à soumettre à la Cour.
- Article 27 alinéas 1 et 2 du Règlement intérieur. Sans être l’objet d’une procédure définie au préalable, l’attribution des dossiers aux rapporteurs par le président est faite de façon à ne pas surcharger les uns par rapport aux autres. Et chaque conseiller, quelle que soit sa spécialité, est en mesure de participer pleinement aux travaux de la Cour.
- Toutes les correspondances déposées à la Cour sont enregistrées et soumises au visa du secrétaire général. À la lecture du courrier, ce dernier détermine, sur la base du contenu de chaque correspondance, l’orientation efficiente à y donner. Il soumet ensuite ses propositions au président de la Cour qui donne l’orientation définitive.
- Le tri des recours en constitutionnalité se fait donc au moment du règlement du courrier normal.
II – 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
D’une façon générale, toutes les décisions de la Cour comportent les visas des textes appliqués, les motifs sur lesquels elles se fondent et un dispositif. – Article 20 du Règlement intérieur.
La décision rendue est prononcée à l’audience.
À l’instar de toutes les décisions de la Cour, les décisions d’irrecevabilité sont publiées au Journal officiel ou dans un Journal d’annonces légales. – Article 21 du Règlement intérieur.
II – 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Les requérants peuvent saisir la Cour autant de fois qu’ils le désirent. Ils ne sont passibles d’aucune amende pour abus du droit d’agir.
II – 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
Les différents textes fondamentaux qui régissent l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle en cette matière sont toujours les mêmes.
II – 4. – Motifs de rejet. Synthèse

Total des requêtes déposées : 381.
Total des décisions d’irrecevabilité : 80.
Pourcentage : 20,99 %.
Défaut de signature : 10 soit 12,5 % des irrecevabilités et 2,62 % des requêtes déposées.
Défaut d’adresse précise : 4 soit 5 % des irrecevabilités et 1,04 % des requêtes.
Défaut de capacité : 14 soit 17,5 % des irrecevabilités et 3,67 % des requêtes.
Défaut de qualité : 23 soit 28,75 % des irrecevabilités et 6,03 % des requêtes.
Défaut d’objet : 18 soit 22,5 % des irrecevabilités et 4,72 % des requêtes. Autorité de chose jugée : 11 soit 13,75 % des irrecevabilités et 2,88 % des requêtes déposées.
- Les recours relatifs au Règlement intérieur des Institutions n’ont pas fait l’objet de rejet. Les irrecevabilités pour défaut de signature ont baissé au fil des années suite à la modification de l’article 29 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle le 18 novembre 1997.
- Par ailleurs, la Cour s’est déclarée incompétente quant au contrôle de cinquante-huit (58) normes ou décisions que nous n’avons pas cru devoir intégrer dans le tableau des irrégularités. En effet, l’examen révélait souvent que les requérants l’invitaient à un contrôle de légalité desdites normes ou décisions plutôt qu’à un contrôle de constitutionnalité ou que les décisions échappaient à son contrôle. Il s’agit de treize (13) lois, trois (3) ordonnances, neuf (9) décrets, cinq (5) arrêtés, dix-neuf (19) décisions administratives, cinq (5) décisions judiciaires, quatre (4) autres actes.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III – 1. – Principe du contradictoire
III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Lorsque la Cour se trouve valablement saisie, sur la base des articles 121, 122, 123 et 146 de la Constitution, elle avise immédiatement le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, et le cas échéant, les présidents de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Économique et Social, lorsqu’ils sont concernés. Ces derniers en informent les membres de l’Assemblée et des organes en question. – Article 26 de la Loi organique. En dehors de ces cas expressément cités, la procédure devant la Cour est secrète. Elle est contradictoire selon la nature de la requête.
III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
Les parties ont accès au procès par écrit, en fournissant à la Cour soit des renseignements complémentaires à la requête, soit des documents devant lui permettre de rendre sa décision. Les parties peuvent se faire assister de toute personne physique ou morale compétente. Celle-ci peut déposer au dossier des mémoires, mais ces mémoires doivent être signés par les parties concernées. Les débats ne sont pas publics.
III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
On peut être amené à conclure que le procès en inconstitutionnalité n’est que partiellement contradictoire eu égard à la procédure de type inquisitorial de la Cour, aux pouvoirs d’investigation très étendus du rapporteur désigné et au caractère secret de l’instruction. Toutefois, il faut y apporter un bémol puisque les parties ont la possibilité de se faire assister par toutes personnes physiques ou morales compétentes, et les mis en cause sont parfois invités à s’expliquer sur les griefs portés contre eux. – Article 27 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur.
III – 2. – Égalité des armes
III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Une simple lettre qui remplit les conditions de validité d’un recours (art. 29 du Règlement intérieur) peut conduire à une procédure. Il faudrait y joindre naturellement la copie de l’acte à soumettre au contrôle de constitutionnalité. Il n’existe pas une liste exhaustive de pièces à déposer.
III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Le système de communication de pièces n’est pas de mise en matière de 68 contrôle de constitutionnalité. Aucune pièce n’est transmise aux parties.
III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Dans le cadre de l’instruction d’une affaire, le rapporteur désigné dispose de pouvoirs d’investigation très étendus. Il peut entendre les parties ou toute personne dont l’audition lui paraît opportune ou solliciter par écrit des avis qu’il juge nécessaires. Il peut également se transporter sur les lieux.
III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge
Il résulte des dispositions de l’article 114 de la Constitution que, quel que soit l’objet de la saisine, la Cour est habilitée à juger de la loi dans son entièreté.
De même, conformément à l’article 121 alinéa 2 de la Constitution :
« … Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censé porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine… »
Dans les cas de violation des droits de la personne, les parties, en particulier les mis en cause, sont invitées à produire des observations sur les griefs soulevés d’office par la Cour.
III – 3. – Délai de jugement
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
La Haute Juridiction est tenue de rendre ses décisions dans des délais constitutionnels prédéfinis. Ainsi :
- lorsque la Cour est saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques, elle doit statuer dans un délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.
- Article 120 de la Constitution ;
- lorsqu’elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits de la personne humaine, sa décision doit intervenir dans un délai de huit (8) jours. – Article 121 de la Constitution ;
- lorsque la Cour est saisie sur la constitutionnalité d’une loi par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui concerne un citoyen, la décision doit intervenir dans un délai de trente (30) jours.
- Article 122 de la Constitution.
La Haute Juridiction essaie dans la mesure du possible d’observer les délais impartis par la Constitution. Toutefois :
- la nécessité de diligenter la plupart du temps des mesures d’instruction pour mieux cerner la demande ou les questions soulevées par le requérant, ou pour disposer d’éléments d’appréciation adéquats ;
- le retard accusé par les parties pour répondre aux dites mesures d’instruction diligentées par la Haute Juridiction, en dépit des lettres de rappel ;
- le nombre de plus en plus croissant de recours enregistrés ; font que ces délais ne sont pas systématiquement respectés.
III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
La procédure formelle de clôture de l’instruction est énoncée à l’article 27 alinéa 4 du Règlement intérieur qui stipule : « Le rapport analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Il est déposé au Secrétariat général qui le communique sans délai aux membres de la Cour… »
III – 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
À la fin de l’instruction, le rapport est déposé au secrétaire général qui se charge de mettre le dossier en état et de le mettre au rôle à l’audience la plus proche.
Le délai entre la fin de l’instruction et le prononcé de la décision est fonction de l’ampleur et de la longueur des débats à l’audience. Dans certains recours, les délibérations s’étendent sur plusieurs séances en raison de la difficulté des questions soulevées.
En tout état de cause, la décision est prononcée aussitôt après le délibéré.
La décision est notifiée aux parties seulement après sa signature par le rapporteur et le président, puis publiée au Journal officiel. D’une façon générale, les décisions sont signées le jour même du prononcé ou au plus tard dans les quarante huit heures. Les lettres de notification et de demande de publication au Journal officiel sont expédiées au plus tard dans les quarante huit heures qui suivent la signature. Mais la publication n’intervient que quinze jours (en moyenne) plus tard.
Conclusion
- À l’heure actuelle, l’accès au juge constitutionnel n’a encore conduit à aucune adaptation structurelle. Toutefois, eu égard au nombre impressionnant de recours dont la Cour est saisie, des réflexions sont en cours qui pourraient conduire à la création d’un service de Greffe.
- Aucune réforme n’est en cours ou en projet en ce moment, concernant l’accès au juge constitutionnel.
- On ne note pour l’instant aucune professionnalisation des requêtes.
Rapport de la cour constitutionnelle de Bulgarie
Mars 2000
Rapport établi par Alexander Arabadjiev,
juge à la Cour constitutionnelle de Bulgarie.
Remarque préliminaire
La Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie est créée conformément à la Constitution de 1991 qui établit un système de contrôle de constitutionnalité a posteriori.
L’acte de procédure par lequel la Cour constitutionnelle bulgare est saisie est désigné par la notion « demande ». En principe cette notion n’est pas utilisée dans la Constitution lorsqu’il s’agit de l’accès à la Cour constitutionnelle. L’article 150, alinéa 1 de la Constitution où sont énumérées les autorités et les personnes qui ont le droit de saisir la Cour constitutionnelle stipule : « La Cour constitutionnelle peut être réunie à l’initiative [de]… » Ceci dit, lors de l’énumération des compétences de la Cour et de la désignation de sa compétence fondamentale /et aussi la plus spécifique/ – celle de se prononcer sur la constitutionnalité des lois – l’article 149, alinéa 1, point 2 de la Constitution utilise quand même, et donc introduit, la notion de « demande » dans l’expression « … se prononce, lorsqu’elle est saisie, sur demande visant l’établissement de l’inconstitutionnalité des lois… ». Le même mot est utilisé aussi dans la disposition analogique de la Loi sur la Cour constitutionnelle (art. 12, point 2) qui n’utilise que ce mot (mais traduit en français par le mot « requête ») pour désigner l’acte par lequel la procédure constitutionnelle démarre, à savoir la « demande » que les sujets autorisés à saisir la Cour, et définis à l’article 150, alinéa 1 de la Constitution, déposent à la Cour. Non seulement la Constitution et la Loi sur la Cour constitutionnelle, mais aussi le Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle, qui est adopté par la Cour elle-même et constitue donc une source importante de normes réglementant le procès constitutionnel, utilisent cette même notion.
Cette notion est utilisée aussi régulièrement par la Cour constitutionnelle elle-même dont chaque acte commence habituellement par une phrase type : « La procédure est ouverte sur demande de… » D’autre part lorsque la Cour ne conclut pas à l’établissement de l’inconstitutionnalité, c’est-à-dire lorsqu’elle constate que la « demande » n’est pas fondée, elle « rejette la demande ». Il faut cependant noter que dans des actes antérieurs de la Cour on peut rencontrer aussi le terme « requête » qui est ensuite complètement abandonné. Le terme « requérant/requérants », bien qu’il soit utilisé pour désigner « l’auteur/les auteurs » de la demande, n’est pas lui non plus affirmé dans la pratique car parfois « l’auteur de la demande » peut être désigné par le terme « dépositaire » (de la demande). Indépendamment de cette diversité relative de termes qui sont utilisés dans la pratique, il est sûr que l’acte par lequel démarre la procédure constitutionnelle s’appelle « demande ».
Il faut souligner que dans la législation et la jurisprudence bulgares le terme « demande » est typique seulement pour la procédure constitutionnelle ; il n’est synonyme d’aucun des actes juridiques analogues de la juridiction civile ou pénale [1] . Or, l’opinion qui existe dans la doctrine juridique, selon laquelle la « demande » dans le procès constitutionnel est ce que sont la demande en justice dans le procès civil et l’acte d’accusation dans le procès pénal, confirme la thèse qu’il s’agit d’un acte spécifique de la procédure constitutionnelle.
Conformément à l’art. 19, al. 1 de la Loi sur la Cour constitutionnelle, celle-ci se prononce sur la recevabilité des demandes par un arrêt à huis clos, alors que l’article 25 du Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle stipule que l’affaire portée devant cette Cour se déroule en deux phases : la première, au cours de laquelle sont tranchées les questions touchant à la recevabilité et la deuxième qui est consacrée au jugement de l’affaire sur le fond. La Cour se prononce sur la recevabilité des demandes par un arrêt (art. 19, al. 1 de la Loi sur la Cour constitutionnelle). C’est au cours de la phase de la recevabilité que sont tranchées (en principe) les questions de savoir si la Cour constitutionnelle a été saisie par un sujet autorisé par la Constitution à le faire et si l’acte attaqué par la demande est susceptible d’un contrôle en constitutionnalité.
D’autre part l’art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle stipule : « La Cour constitutionnelle se prononce elle-même sur sa compétence à connaître des questions dont elle est saisie. » Cette disposition peut être considérée comme ayant une importance de principe dépassant les problèmes relatifs aux exigences formelles pour la recevabilité d’une demande [2] .
I. L’ouverture du droit de saisine
I – 1. – Les requérants
I – 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
Les sujets autorisés à saisir la Cour constitutionnelle sont énumérés dans la disposition de l’article 150, alinéa 1 de la Constitution dont il a été déjà question. Il s’agit notamment d’au moins un cinquième des députés, du président de la République, du Conseil des ministres, de la Cour suprême de Cassation, de la Cour suprême administrative et du procureur général. (Vu la compétence qui est attribuée à la Cour constitutionnelle aux termes de l’article 149, al. 1, p. 3, deuxième phrase de la Constitution, de régler les litiges entre les organes d’autogestion locale et les organes exécutifs centraux, la deuxième phrase de l’article 150, al. 1 stipule que des conflits de compétence de ce genre peuvent être également soumis par les conseils municipaux.)
Avant de commenter la question relative aux sujets autorisés par la Constitution à saisir la Cour constitutionnelle et les chiffres démontrant comment les sujets en question ont exercé ce droit, il faut signaler que hors ces sujets reste la saisine aux termes de l’article 150, al. 2 de la Constitution qui précise notamment que : « Lorsqu’est établie la non conformité entre une loi et la Constitution, la Cour suprême de Cassation ou la Cour suprême administrative suspend la procédure et saisit la Cour constitutionnelle. »
Les dispositions de la Constitution citées ci-dessus laissent clairement entendre que la Constitution ne garantit pas à toute personne, à toute organisation non-gouvernementale ou à tout groupe de personnes un accès direct [3] à la juridiction constitutionnelle. Autrement dit, le recours individuel n’est pas prévu. Il faut cependant dire que l’énumération dans l’article 150, al. 1 de la Constitution est considérée comme exhaustive. D’autre part, il s’ensuit de cette énumération que la possibilité d’auto-saisine de la Cour est exclue, c’est à-dire la Cour n’agit pas ex-officio. Or, du point de vue de toutes les compétences de la Cour constitutionnelle [4] il faut noter que hors des sujets, désignés dans l’article 150, al. 1 de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être saisie aussi par le président de la République et le vice-président de la République (en cas de démission, conformément à l’article 97, al. 2 en relation avec al. 2, p. 1 et 2), par deux tiers des députés (en cas d’engagement de la responsabilité du président ou du vice-président de la République conformément à l’article 103, al. 2 de la Constitution) et par un juge constitutionnel (en cas de présentation d’une démission conformément à l’article 148, al. 1, p. 2). Le tableau n° 1 sur les saisines ci-dessous montre comment les sujets autorisés par la Constitution à saisir la Cour constitutionnelle ont exercé leur droit dès la création de la Cour constitutionnelle (le 3 octobre 1991) jusqu’à la fin de 1999 y compris pour les affaires sur lesquelles une décision a été rendue [5].
Tableau n° 1 Demandes par type de dépositaires (pour les affaires sur lesquelles une décision a été rendue)
DÉPOSITAIRES

Si donc le tableau ci-dessus reflète le nombre des saisines, faites en tenant compte de toutes les compétences de la Cour constitutionnelle, le Tableau 1.a. qui suit ne porte que sur celles dirigées contre les actes susceptibles d’être contrôlés en constitutionnalité.
Tableau 1 a.
Autorités ayant le droit de saisir (Demandes par lesquelles sont attaqués des lois, des actes de l’Assemblée nationale et du président de la République conformément à l’art. 149, al. 1, p. 4)

Quant à l’analyse des chiffres, présentés dans les deux tableaux, il faut tenir compte avant tout du fait qu’ils portent sur toute la période de l’existence de la Cour constitutionnelle pendant laquelle la Cour a fonctionné sous le même régime, établi par la Constitution et la Loi sur la Cour constitutionnelle, lesquelles n’ont subi aucune modification. Mais la pratique de la Cour a subi entre-temps une certaine évolution par rapport à certains des sujets ayant le droit de saisir la Cour (par exemple les deux cours suprêmes dans les hypothèses de l’article 150, al. 1 et 2 de la Constitution) et par rapport aux actes susceptibles d’être contrôlés en constitutionnalité.
Il est significatif que sur tous les sujets ayant le droit de saisir la Cour, ce droit a été le plus souvent exercé par « au moins un cinquième des députés » [6] . Ce fait témoigne de la nature classique de la juridiction constitutionnelle, à savoir offrir à la minorité parlementaire la possibilité de se défendre contre « le dictat » de la majorité. Cette nature du droit de saisir la Cour constitutionnelle qui est attribué à ce sujet se manifeste aussi par le fait que sur un total de 113 demandes, déposées à la Cour par « un groupe »[7] de députés, 58 portent sur la contestation de la constitutionnalité de lois et 20 autres sont dirigées contre les décisions de l’Assemblée nationale (y compris contre le Règlement sur l’organisation et l’activité de l’Assemblée nationale).
Quant à la possibilité qu’au moins un cinquième des députés puisse saisir la Cour constitutionnelle, celle-ci a déjà eu l’occasion de signaler 8[8] que lorsqu’elle est saisie d’un nombre inférieur d’un cinquième des députés, on constate l’absence d’un sujet autorisé conformément à l’article 150, al. 1 de la Constitution et non pas un défaut réparable de la demande. À ce sujet la Cour a souligné qu’il s’agit de l’expression libre de la volonté, ce qui représente intuitu personae pour chaque député, et il serait donc inadmissible et contraire au droit de « donner des consignes » aux députés ayant signé la demande de la compléter en attirant les signatures d’autres députés. La question du nombre des députés ayant signé une demande a été posée devant la Cour aussi dans une autre hypothèse – le retrait de signatures de la part de certains députés 9[9] après l’introduction de la demande devant la Cour. Dans de tels cas la Cour acceptait 10[10] la position suivante : si, après le retrait d’une/des signature(s) d’un/des député(s) ayant déjà signé la demande déposée à la Cour constitutionnelle, le nombre des signatures qui restent baisse au-dessous d’un cinquième de tous les députés, on constate l’absence de sujet autorisé aux termes de l’article 150, al. 1 de la Constitution, et la procédure est suspendue. Mais cette position n’a pas été toujours incontestable. Dans des opinions dissidentes de membres de la Cour il a été soutenu « … qu’une fois saisie par une demande valable, la Cour constitutionnelle ne peut pas être dessaisie par la volonté du sujet qui a déposé la demande. L’introduction devant la Cour constitutionnelle d’une demande valable visant l’établissement de l’inconstitutionnalité de la disposition d’une loi, engendre un litige de constitutionnalité de celle-ci que la Cour doit obligatoirement régler et garantir de cette façon la primauté de la loi fondamentale. Le contraire signifierait une renonciation à la justice constitutionnelle. Le procès constitutionnel, une fois ouvert valablement, ne peut être laissé à l’appréciation de l’autorité qui a saisit la Cour ». Comme il a été cependant signalé, cette question a été résolue par la Cour non au niveau du désistement 11[11] mais vu la présence ou l’absence d’un sujet autorisé à saisir la Cour.
En même temps la Cour a accepté [12] que dans le cas d’introduction de deux actes différents, dont chacun signé d’un nombre inférieur à un cinquième des députés, il s’agit de deux demandes différentes, émanant chacune d’un nombre de députés insuffisant, qui ne peuvent être jointes même si elles sont dirigées contre le même acte de l’Assemblée nationale et ont le même fondement [13]. La Cour a dû faire face aussi à l’hypothèse, lorsque dans le cadre d’une demande commune formulée par un nombre suffisant de députés, se distinguent deux « groupes » qui défendent des positions différentes [14]. Il est admis que la Cour constitutionnelle n’est pas valablement saisie d’un cinquième des députés lorsque ces députés n’expriment pas la même volonté et la même position sur l’objet de la demande.
Concernant la recevabilité des demandes déposées par le sujet en question ayant procédé à la saisine, la jurisprudence de la Cour, prévoit que la Cour se prononce encore sur deux questions. Il est accepté [15] que le droit de saisir la Cour constitutionnelle dépende seulement de deux conditions : la première est que ceux qui saisissent la Cour aient le statut de députés et la seconde est qu’ils forment un groupe d’un nombre déterminé de personnes, ce qui veut dire que le vote émis par les députés lors de l’adoption de l’acte respectif du parlement est sans importance (c’est-à-dire il est sans importance s’ils ont voté pour ou contre l’acte en question) [16]. La question ne s’est jamais non plus posé qu’un député exerce son droit d’initiative législative au lieu de saisir la Cour constitutionnelle [17].
Il est suffisant d’autre part que les députés, signataires de la demande, jouissaient de cette qualité au moment de l’introduction de la demande ; le fait, qu’au cours de la procédure l’activité de la législature à laquelle ils auraient appartenu ait été suspendue (à cause de dissolution) est sans importance [18]. La situation de l’échéance du mandat régulier d’un sujet ayant le droit de saisir la Cour constitutionnelle a surgi cependant aussi par rapport au président, sans pour autant provoquer des complications [19]. En principe, l’échéance du mandat régulier d’une autorité ayant le droit de saisir la Cour constitutionnelle ne peut pas avoir des conséquences sur la réception et l’examen de la demande si au moment de la suspension du mandat cette demande a été valablement déposée et n’a pas été retirée. Dans l’hypothèse, où le nouveau gouvernement se désiste de la demande [20] , déposée par le précédent, la Cour a déjà souligné que le (nouveau) Conseil des ministres en tant que successeur en droit du cabinet précédent peut maintenir la demande, exposer des observations sur les questions soulevées, y compris se désister d’elle [21].
En examinant de nouveau le tableau ci-dessus il faut commenter aussi le fait que du point de vue du nombre des demandes déposées la deuxième place revient au procureur général [22]. D’une part, le fait que le procureur général figure parmi les sujets ayant le droit de saisir la Cour constitutionnelle peut être expliqué par la position constitutionnelle de cette institution en Bulgarie, parce qu’elle fait partie du pouvoir judiciaire, alors que procureurs ont le même statut que celui des juges (l’art. 126, al. 2 de la Constitution stipule : « Le procureur général exerce le contrôle de la légalité… » et l’art. 127, al. 1 stipule « Le Procureur veille au respect des lois… »). D’autre part, une analyse relative à l’objet des demandes déposées par le procureur général, montre que, ni au niveau des normes régissant le droit de saisir la Cour constitutionnelle, ni du point de vue de la jurisprudence de la Cour, il n’existe une doctrine de compétence « limitée » ou de compétence « spéciale » (« d’objet », c’est-à-dire qui porte uniquement sur des questions déterminées selon les fonctions constitutionnellement définies de l’autorité publique respective). Dans ce sens, chacune des autorités citées à l’art. 150 al. 1 de la Constitution peut déposer des demandes visant l’établissement de l’inconstitutionnalité des lois, des autres actes du parlement, ainsi que des actes émanant du président [23]. C’est une conclusion tirée pour les besoins du présent rapport. Elle n’a pas expressément sa place dans un acte de la Cour, mais elle pourrait être tirée par voie négative – dans la mesure où elle n’a pas fait l’objet d’une discussion au sein de la Cour et que la Cour n’a pas accepté le contraire [24]. Ceci dit, une telle conclusion catégorique devrait être considérée comme assez discutable, surtout si elle est appliquée au droit de la Cour suprême de Cassation et de la Cour suprême administrative de saisir la Cour constitutionnelle ce qui doit être lié directement à leur activité juridictionnelle.
En ce qui concerne les deux cours suprêmes, la Cour suprême de Cassation et la Cour suprême administrative, dont la qualité de sujet ayant le droit de saisine a été discutée au sein de la Cour constitutionnelle, il faut avant tout signaler leur activité extrêmement faible quant au nombre des saisines qu’elles ont faites (seulement deux saisines qui ont abouti à des décisions rendues [25]. Ce fait suscite des questions dont les réponses sont hors l’objet du présent rapport, bien que l’on puisse espérer que le seul mécanisme de l’article 150, al. 2 de la Constitution pourrait assurer une partie essentielle du nombre total des demandes déposées à la Cour constitutionnelle. Il est nécessaire, pour les besoins du présent rapport, d’évoquer l’évolution dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les pouvoirs de la Cour suprême de Cassation et de la Cour suprême administrative aux termes de l’article 150, al. 1 et 2 de la Constitution. Comme il a été déjà noté, ces deux Cours sont citées dans l’alinéa 1 parmi les autorités sur l’initiative desquelles la Cour constitutionnelle agit. D’autre part, l’alinéa 2 stipule que lorsque la non conformité est établie entre une loi et la Constitution, ces deux Cours suspendent la procédure et saisissent la Cour constitutionnelle. Initialement, (arrêt n° 6 du 30 juin 1992, a. c. n° 12/1992) la Cour constitutionnelle a accepté, que dans les deux hypothèses, celle de l’alinéa 1 et celle de l’alinéa 2, c’est la Cour suprême [26] qui est compétente en tant qu’organe auquel participent tous ses membres /en session plénière/, et non certains de ses membres ou chambres. Le cas échéant la Cour constitutionnelle a été saisie par une chambre de la Cour supérieure composée de trois juges. Or, ensuite (arrêt n° 1 du 1 juillet 1997, a. c. 5/1997) cette pratique est abandonnée. Il est accepté, que le pouvoir commun des deux cours suprêmes aux termes de l’article 150, al. 1 de la Constitution, peut être exercé par la réunion générale du collège respectif /pénal ou civil/ de la Cour suprême de Cassation et par la réunion générale de la Cour suprême administrative. En ce qui concerne le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle aux termes de l’article 150, al. 2 celui-ci revient aux différentes chambres des deux Cours, chargées du litige judiciaire concret. Il est souligné que le fait de limiter seulement à la réunion générale d’un collège ou à la session plénière de la Cour suprême respective la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle, en pratique vide de son contenu la disposition de l’article 150, al. 2 de la Constitution. À ce sujet la Cour constitutionnelle note que lorsque le législateur constitutionnel parle d’une Cour suprême dans l’hypothèse de l’article 150, al. 2, il n’envisage pas certainement les organes supérieurs représentatifs des deux Cours suprêmes, mais la Cour suprême respective en tant qu’un organe juridictionnel dans un litige judiciaire concret, c’est-à-dire lors de l’exercice de sa compétence juridictionnelle qui est réalisée par ses chambres. En ce qui concerne le pouvoir commun des Cours suprêmes aux termes de l’art. 150, al. 1 de la Constitution, il est noté qu’il peut être exercé par la réunion commune du collège respectif, mais non par les différentes chambres qui sont chargées d’un litige judiciaire concret.
Il est intéressant de noter qu’en rendant cet arrêt, la Cour constitutionnelle avait constaté que la solution qui en découlait n’était pas conforme aux dispositions en vigueur de la Loi sur le pouvoir judiciaire, ces dispositions, paraît-il, étant mises en conformité avec l’approche initiale de la Cour. En changeant son approche, la Cour a signalé que l’interprétation des dispositions constitutionnelles feront partie de ses compétences, alors que le législateur sera obligé de mettre la législation en conformité avec ces dispositions constitutionnelles, respectivement avec la façon dont elles sont interprétées par elle-même. C’est notamment l’interprétation donnée avec cet arrêt qui a conditionné les changements dans la Loi sur le pouvoir judiciaire qui stipule maintenant : « lorsque, au cours de l’examen de l’affaire, la Cour suprême de Cassation constate que la loi qui doit être appliquée est contraire à la Constitution, elle suspend la procédure et saisit la Cour constitutionnelle » (art. 84, al. 2). Une disposition identique figure aussi dans la Loi sur la Cour suprême administrative (art. 10). En même temps, la Loi sur le pouvoir judiciaire prévoit une approche particulière « de signalisation » mise à la disposition de tous les juges, procureurs et juges d’instruction c’est-à-dire à la disposition des tribunaux et parquets de degré inférieur. L’article 13 de la Loi sur le pouvoir judiciaire stipule : « lorsque le tribunal estime que la loi est contraire à la Constitution, il en avise la Cour suprême de Cassation ou la Cour suprême administrative, alors que les procureurs et les juges d’instruction en avisent le procureur général afin que soit saisie la Cour constitutionnelle ». Cette possibilité est sans doute prévue pour compenser le champ limité des sujets aux termes de l’article 150, al. 1 de la Constitution et en particulier la limitation du pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle seulement aux Cours suprêmes, sans y inclure les tribunaux de degré inférieur. Vu d’ailleurs le fait, qu’en pratique même ce pouvoir n’est pas exercé, il n’est pas possible d’évaluer l’efficacité de cette approche.
La qualité des autres sujets, désignés à l’article 150, al. 1 de la Constitution, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent exercer ce pouvoir, n’ont pas suscité jusqu’à présent de questions et de problèmes dans la pratique de la Cour [27]. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la recevabilité des demandes, la Cour se borne généralement à la constatation qu’elle a été saisie par un sujet, autorisé conformément à l’article 150, al. 1 de la Constitution, qui a déposé une demande en vue d’exercer le pouvoir prévu par la Constitution. À cet égard la Cour suit la règle que l’énumération de l’article 150, al. 1 est exhaustive et déclare irrecevables les demandes qui sont déposées par exemple par des ministres, se motivant par le fait que les ministres ou les vice-ministres ne sont pas investis de ce pouvoir [28]. Dans de tels cas la formule utilisée est que la demande, déposée par une personne ne jouissant pas du pouvoir respectif, est inadmissible du point de vue procédural et par conséquent est déclarée irrecevable. Il conviendrait de noter à ce sujet que le Tableau 1.a. révèle aussi que le Conseil des ministres (le gouvernement) n’a jamais déposé aucune demande visant l’établissement de l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un autre acte du parlement, ni d’un acte du président.
Il faut signaler cependant que vu l’accès limité à la Cour constitutionnelle, en particulier en ce qui concerne les personnes physiques et morales, la Cour elle-même est à la recherche d’une soit disant « compensation ». Cette idée est à la base de l’arrêt n° 1 du 1er juillet 1997, a. c. n° 5/1997, bien que les motifs pour lesquels il a été rendu ne l’expriment pas et qu’ils sont d’eux-mêmes en conformité avec la bonne interprétation de la Constitution. La même idée anime la Cour quant à la recherche d’une solution à la question relative aux parties intéressées. Cette question n’est pas directement liée aux problèmes concernant les sujets autorisés à saisir la Cour constitutionnelle, mais se rapporte le plus généralement aux participants au procès constitutionnel. En même temps, la jurisprudence montre que jusqu’à présent cette question est traitée dans le contexte du problème relatif à l’accès à la Cour constitutionnelle en général. Pour cette raison et compte tenu du fait dans que dans la liste concernant les requérants, présentée dans le questionnaire, parmi les saisines possibles figure aussi la saisine émanant de Amicus Curiae – une figure à laquelle « les parties intéressées » se rapprochent le plus dans le sens de la pratique de la Cour – nous avons jugé que pour les besoins du présent rapport il serait opportun de présenter ici ce type de participants à la procédure.
L’art. 18, al. 2 de la Loi sur la Cour constitutionnelle stipule notamment qu’une fois l’ouverture de la procédure prononcée par le président de la Cour, « les institutions intéressées sont tenues informées de l’ouverture de la procédure et se voient fixer un délai pour le dépôt, par écrit, de leurs observations et des éléments de preuve ». Selon l’art 21, al. 1er du Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle, les organes et les personnes intéressés sont déterminés par la Cour. Les deux textes laissent croire que l’expression « organes [et personnes] intéressés » ne visent que les sujets qui sont, soit directement engagés dans l’adoption de l’acte attaqué par l’Assemblée nationale, soit chargés de son application, soit directement concernés par lui. C’est le point de départ aussi dans l’approche de la Cour, mais sa pratique évolue progressivement dans le sens d’un élargissement du champ des sujets qui pourront bénéficier de la possibilité de participer à la procédure en exprimant leurs observations sur l’affaire en question.
Sans entrer dans les détails on peut dire que cette évolution, qui a commencé dès la première étape du développement de la Cour, a eu pour résultat de voir surmontée l’idée du caractère purement institutionnel des parties « intéressées » et d’aboutir à l’affirmation de la thèse que des parties « intéressées » peuvent être aussi des organisations non-gouvernementales dont 84 la sphère d’activité coïncide avec la sphère d’application de l’acte contesté.
Il s’ensuit donc que le champ des parties intéressées que la Cour admet à participer à la procédure, est hétérogène. Il inclut bien sûr les individus (les personnes physiques) qui sont directement concernés par les actes individuels de l’Assemblée nationale, mais aussi des organisations non-gouvernementales (sociétés, associations, etc.) qui peuvent être « intéressées » aussi bien du point de vue de leur attitude vis-à-vis des problèmes traités dans l’acte en question, que du point de vue de la qualité qu’elles ont d’exprimer les intérêts de leurs membres qui pourraient être concernés par l’acte (la loi). Cette tendance a évolué à tel point que les organisations qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme et qui se sont affirmées dans le pays [29] ont régulièrement la possibilité d’exprimer leurs observations sur des demandes dont l’objet porte sur des droits et libertés fondamentales (constitutionnels ou découlant des accords internationaux auxquels la Bulgarie est partie).
Il faut signaler à ce sujet aussi qu’en dépit du fait que les parties intéressées sont constituées d’office par la Cour, par un arrêt de recevabilité rendu à cette fin, dans nombre de cas elles peuvent être constituées à la demande de l’organisation respective. Reste hors l’objet du présent rapport la question de l’utilité d’une telle participation et celle de savoir si l’intervention de telles parties a permis à la Cour d’enrichir ses conclusions en matière des faits et du droit. Il faut, de toute façon, noter que la fonction d’assister la Cour n’est ni la seule, ni la plus importante. L’approche de la Cour dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire lors d’une telle participation est dans une grande mesure incitée par le désir d’élargir l’accès à la Cour à travers l’expression d’observations (y compris des plaintes) ce que la saisine directe ne permet pas à cause du nombre restreint des sujets autorisés à saisir la Cour. La participation à titre de partie intéressée n’influence pas l’effet des décisions qui en principe sont obligatoires pour tous les organes de l’État, toutes les personnes et tous les citoyens (art. 14, al. 6 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Avant de terminer sur cette question, il conviendrait d’évoquer aussi les cas dans lesquels une demande intervient au cours d’une procédure déjà ouverte sur la base d’une autre demande, et quand entre les deux demandes il existe un lien au niveau de l’objet ; dans ce cas le lien logique et juridique entre les dispositions attaquées d’une seule et même loi détermine la jonction des deux affaires dans une seule procédure et le prononcé d’une décision commune pour les deux affaires [30].
I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Comme il a été déjà noté, pendant toute la période de son existence la Cour constitutionnelle a fonctionné sous le même régime juridique. C’est-à-dire que les conditions n’ont pas changé en ce qui concerne les personnes autorisées à saisir la Cour constitutionnelle. Le seul changement, découlant d’un tournant dans la jurisprudence de la Cour, concerne les saisines de la part des chambres de la Cour suprême de Cassation et de la Cour suprême administrative aux termes de l’article 150, al. 2 de la Constitution (v. I-1.1. ci-dessus). La Cour n’a pas été confrontée à des cas dans lesquels elle aurait été en mesure d’élargir le champ strictement défini des sujets ayant le droit de la saisir [31].
L’article 149 (2) de la Constitution stipule : « La loi ne peut attribuer ni retirer des compétences à la Cour constitutionnelle ». Indépendamment du fait que cette disposition porte directement sur le retrait et l’attribution de compétences à la Cour constitutionnelle, il est généralement admis que l’élargissement du champ des sujets ayant le droit de saisir la Cour constitutionnelle exige aussi une modification de la Constitution.
I – 1.3. – La Cour dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Il a été déjà noté que la Cour constitutionnelle ne dispose pas de la possibilité de s’auto-saisir, c’est-à-dire que la Cour n’agit pas ex officio. Bien que cette situation fasse l’objet de critiques dans la doctrine juridique, c’est bien elle qui correspond à la réglementation du droit constitutionnel. Dans la mesure où cette question était soulevée devant et par la Cour constitutionnelle, c’était dans le cadre de l’exercice d’un contrôle en constitutionnalité de ce qu’on appelle les dispositions « liées », c’est-à-dire celles que la demande déposée à la Cour ne traite pas (v. I-2.), ainsi que dans les cas de désistement de demandes(v. I-1.4. ci-dessous). Il faut entendre par dispositions « liées » les dispositions qui ne sont pas directement contestées dans la demande déposée à la Cour mais, se prononçant sur l’objet de cette demande la Cour constate également leur inconstitutionnalité ou bien établit que leur inconstitutionnalité découle du lien systématique et logique qu’elles ont avec les dispositions qui font l’objet de la demande. L’art. 22, al. 1, première phrase stipule : « Par sa décision, la Cour se prononce uniquement sur la requête dont elle a été saisie. » Le mot « uniquement » est suffisamment explicite et catégorique. Vu cette disposition, la Cour n’a pas été en mesure d’élargir l’objet de sa décision afin de l’étendre sur d’autres dispositions qui sont hors l’objet de la demande (y compris sur les soit disant dispositions « liées »). Cette hypothèse ne doit pas se confondre avec la situation dans laquelle, la Cour, qui a accepté qu’une disposition qui fait partie de l’objet de la demande n’est pas inconstitutionnelle en elle-même, constate en même temps que, vu son lien systématique et logique avec d’autres dispositions, jugées elles inconstitutionnelles, cette disposition pourrait entraîner, si elle restait en vigueur, des résultats inconstitutionnels et donc son maintien en vigueur est inadmissible du point de vue constitutionnel. Dans de tels cas même la disposition, qui n’est pas inconstitutionnelle en elle-même, peut être déclarée inconstitutionnelle [32].
Une hypothèse complètement différente est celle que contiennent les motifs de la décision n° 17 du 16 décembre 1999, a. c. n° 14/1999 lorsque, pour motiver l’inconstitutionnalité de deux alinéas d’une disposition, la Cour a accepté, que toute la disposition était contraire à la Constitution, y compris les deux autres alinéas qui n’étaient pas attaqués. Finalement, les alinéas faisant l’objet de la demande étaient déclarés inconstitutionnels parce qu’ils appartenaient à un mécanisme inconstitutionnel créé avec toute la disposition.
I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle bulgare connaît l’institution du « désistement ». Les conditions dans lesquelles le sujet ayant saisi la Cour peut se désister de sa saisine ne sont régies ni par la Loi sur la Cour constitutionnelle, ni par le Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle. Lorsque cette question a été posée pour la première fois devant la Cour (arrêt n° 4 du 18 février 1993, a. c. n° 26/1992) la déclaration du désistement fut respectée et la procédure sur l’affaire suspendue, mais la possibilité de se désister est liée aussi à la phase initiale de la procédure, c’est-à-dire qu’elle doit intervenir avant que la Cour ait statué sur la recevabilité de la demande. Une telle argumentation crée l’impression que la possibilité de se désister de la saisine dépend de la phase dans laquelle se trouve la procédure : celle jusqu’à la recevabilité de la demande en vue de son examen sur le fond ou celle qui suit. Il semble que cette conception est aussi à la base d’un acte rendu plus tard par la Cour, l’arrêt n° 8 du 19 décembre 1996. Indépendamment de ce fait, par deux arrêts du 27 avril 1999 [33], rendus après la recevabilité des demandes en vue de leur examen sur le fond, la Cour a suspendu la procédure sur les deux affaires se basant sur les déclarations qui lui ont été adressées par le nouveau procureur général et affirmant qu’il se désistait des demandes en question (déposées par le précédent procureur général) et à la suite desquelles les deux procédures étaient notamment ouvertes. Les motifs des deux arrêts contiennent aussi des références à des arrêts précédents (notamment les deux mentionnés ci-dessus) mais seulement sur le principe, c’est-à-dire vu la possibilité qui existe de suspendre la procédure sur une affaire en cas de désistement de la saisine. La question de savoir à quelle phase de la procédure le désistement est intervenu n’a pas été posée ni discutée et la suspension a été statuée sans d’autres considérations.
Il est caractéristique que ces deux actes de la Cour ont été rendus à l’unanimité. Les membres de la Cour n’ont pas soutenu la thèse selon laquelle la procédure constitutionnelle ne doit pas se confondre avec la procédure civile et les principes du procès civil sont inapplicables au procès constitutionnel qui a un caractère public. Comme il a été déjà mentionné dans le point I-1.1. ci-dessus, ces considérations ont été évoquées dans l’hypothèse du retrait de signatures de la part de députés faisant partie d’un « groupe » de députés ayant saisi la Cour constitutionnelle. Dans ce contexte, bien que spécifique, la thèse est soutenue qu’en principe il est impossible pour les autorités, énumérées à l’art. 150, al. 1 de la Constitution, de se désister des demandes qu’elles auraient déposées à la Cour constitutionnelle, car à travers leur saisine elles n’exercent pas leur propre droit, elles ne sont pas « maîtres du procès » et d’une façon générale ne sont pas titulaires de droits subjectifs publics ou privés auxquels elles demandent et obtiennent une protection à travers le procès constitutionnel qui n’est pas destiné à servir les intérêts de ceux qui l’ont initié.
La conception exposée ci-dessus n’a pas été soutenue lors de l’adoption de la dernière jurisprudence de la Cour en ce qui concerne la possibilité de désistement. Compte tenu des deux arrêts du 27 avril 1999 cette possibilité paraît incontestable et ceci indépendamment de la phase à laquelle le désistement intervient. La suspension de la procédure en cas de désistement est considérée comme une expression de l’inadmissibilité de la Cour d’agir ex-officio.
Jusqu’à présent la Cour n’a pas eu à connaître de la situation dans laquelle une demande avait déjà été retirée, puis formulée de nouveau, et dans laquelle se serait posée la question de la recevabilité de la nouvelle demande [34].
I – 2. – Les actes contrôlés
I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé :
Conformément à l’article 149, al. 1, p. 2 de la Constitution de la République de Bulgarie, la Cour constitutionnelle se prononce lorsqu’elle est saisie, sur les demandes visant l’établissement de l’inconstitutionnalité :
- des lois ;
- des autres actes de l’Assemblée nationale ;
- des actes du président de la République.
D’autre part aux termes de l’article 149, al. 1, p. 4 de la Constitution, la Cour statue sur la conformité des accords internationaux, conclus par la République de Bulgarie avec la Constitution, avant leur ratification [35]
- , ainsi que sur la conformité des lois avec les normes universellement reconnues du droit international et les accords internationaux auxquels la Bulgarie est partie.
(À part le contrôle en constitutionnalité sur les actes susmentionnés la Cour constitutionnelle : - donne des interprétations contraignantes de la Constitution, art. 149, p. 1 ;
- règle les litiges relatifs à la compétence entre l’Assemblée nationale, le président et le Conseil des ministres, comme entre les organes d’autogestion locale et les organes exécutifs centraux, art. 149, al. 1, p. 3 ;
- se prononce sur les litiges relatifs au caractère constitutionnel des partis et associations politiques, art. 149, al. 1, p. 5 ;
- se prononce sur les litiges concernant la légalité de l’élection du président et du vice-président, art. 149, al. 1, p. 6 ;
- se prononce sur les litiges concernant la légalité de l’élection des députés, art. 149, al. 1, p. 7 ;
- se prononce sur des accusations formulées par l’Assemblée nationale à l’encontre du président et du vice-président, art. 149, al. 1, p. 8 ;
- établit l’illégitimité et /ou/ l’incompatibilité en tant que raison de suspension avant terme du mandat des députés, art. 72, al. 2 en relation avec al. 1, p. 3 ;
- prend des décisions relatives à la présentation d’une démission de la part du président et du vice-président et à l’établissement d’une incapacité durable du président et du vice-président d’accomplir leurs pouvoirs pour cause de maladie grave en tant que raison de suspension avant terme de leurs fonctions, art. 97, al. 2 en relation avec al. 1, p. 1 et 2 ;
- prend des décisions relatives à la suspension avant terme du mandat d’un juge de la Cour constitutionnelle, art. 148, al. 2 de la Constitution et art. 11, al. 2 de la Loi sur la Cour constitutionnelle.)
Vu l’objet du présent rapport, à savoir le contrôle en constitutionnalité des normes, le tableau n° 2 ci-dessous montre le nombre des contestations, adressées à la Cour, selon le type des actes :
Tableau n° 2
Compétences exercées par la Cour constitutionnelle sur des affaires sur lesquelles des décisions ont été rendues
Article 149, al. 1, p. 2

Article 149, al. 1, p. 4

Au sujet des chiffres figurant dans ce tableau, il faut noter tout d’abord qu’ils portent sur les compétences de la Cour aux termes de l’art. 149, al. 1, p. 2 et 4 de la Constitution [36]. Sur toutes les décisions rendues jusqu’à présent par la Cour, celles relatives au contrôle en constitutionnalité des normes constituent 75,3 %. Il est nécessaire de mentionner ici une précision : dans l’art. 149, al. 1, p. 2 de la Constitution il est question en général de l’établissement de l’inconstitutionnalité des lois et des autres actes de l’Assemblée nationale, ainsi que des actes du président. Conformément à l’art. 86, al. 1 de la Constitution, à part les lois, l’Assemblée nationale adopte des décisions, des déclarations et des appels. Elle adopte aussi le Règlement de l’organisation de son activité (art. 73). Les actes émis par le président sont des décrets, des appels et des messages (art. 102, al. 1). L’Analyse des actes qui font l’objet du contrôle en constitutionnalité montre que ces actes peuvent être aussi bien juridiques (lois, décisions, décrets) que non-juridiques. D’autre part les décrets du président, susceptibles d’un contrôle en constitutionnalité, peuvent avoir un caractère individuel (et non normatif).
Le contrôle en constitutionnalité des actes juridiques de l’Assemblée nationale et du président n’a pas suscité de problèmes [37]. Tout au début de son activité, par l’arrêt du 5 décembre 1991, a. c. n° 17/1991, prononcé au sujet de la contestation de la constitutionnalité d’une décision de l’Assemblée nationale, prise conformément à l’art. 84, p. 8 de la Constitution (attribuant à l’Assemblée nationale la compétence d’élire et de relever de leurs fonctions les dirigeants de la Banque nationale de Bulgarie et d’autres institutions prévues par la loi), la Cour a accepté qu’en principe sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité les décisions de l’Assemblée nationale qui par leur nature entraînent des conséquences obligatoires relevant du droit public. De telles conséquences apparaissent aussi lorsque l’Assemblée nationale exerce sa compétence aux termes de l’art. 84, p. 8, indépendamment du fait que cette compétence concerne directement une personne physique. La décision du parlement n’entraîne pas que des conséquences juridiques relevant du droit du travail ou du droit civil, c’est-à-dire n’entraîne pas que des conséquences qui concernent uniquement le domaine du droit civil d’une personne physique, mais il s’agit là de l’exercice de fonctions relevant du droit public, liées à la direction d’une institution de l’État (bien que la décision porte concrètement sur la destitution d’une personne physique) [38].
Dans un arrêt suivant [39]. prononcé dans une procédure ouverte sur une demande dirigée contre une décision du parlement aux termes de laquelle l’immunité d’un député a été levée, la Cour a souligné que conformément à l’art. 86, al. 2 de la Constitution les décisions de l’Assemblée nationale sont obligatoires pour tous les organes de l’État, les organisations et les citoyens, ces décisions étant ainsi placées (par la Constitution), en ce qui concerne leur effet juridique, au même niveau que les lois et distinguées d’autre part des autres actes du parlement comme les déclarations et les appels. En tenant en même temps compte de l’importance de l’objet de la décision contestée, à savoir la levée de l’immunité d’un député, et vu aussi les conséquences relevant du droit public, la Cour a considéré que cette décision est susceptible d’être contrôlée en constitutionnalité indépendamment de son caractère non-normatif.
C’est également pendant les premières années après sa création, que la Cour s’est prononcée sur la question de savoir si le Règlement sur l’organisation et l’activité de l’Assemblée nationale est susceptible d’un contrôle en constitutionnalité. Une réponse affirmative a été donnée à cette question tout en signalant que le Règlement du parlement est incontestablement un acte juridique du parlement, bien que relevant d’un domaine juridique spécial et en tant que tel ne fait pas exception à la catégorie « autres actes de l’Assemblée nationale »[40].
La Cour a été confrontée aussi à une hypothèse concrète, qu’elle a appelé « décision-refus » car il s’agit d’un acte de l’Assemblée nationale avec un contenu négatif, c’est-à-dire le refus de donner droit à une demande concrète. Il a été noté que les « décisions-refus » peuvent avoir toutes les caractéristiques des actes juridiques si elles relèvent des compétences du parlement et sont émises selon la procédure et les modalités prévues par la Constitution et le Règlement sur l’organisation de l’activité de l’Assemblée nationale. La recevabilité d’une demande dirigée contre un tel acte est fondée sur le fait qu’elle ne conteste pas un acte absent, mais la perfection constitutionnelle d’un acte de l’Assemblée nationale qui existe dans la réalité juridique.
En ce qui concerne les décrets du président en tant qu’objet de contrôle en constitutionnalité de la part de la Cour constitutionnelle, vu leur caractère non-normatif, la jurisprudence, extrêmement limitée, ne révèle pas de questions particulières qui se soient posées à la Cour et que celle-ci ait résolu. Au contraire : la Cour se contentait de constater que l’établissement de l’inconstitutionnalité des actes du président fait partie de ses compétences [41]. Dans un seul cas, celui concernant un décret du président de la République relatif à la nomination d’un juge à la Cour constitutionnelle, la Cour a accepté, que la demande visant l’inconstitutionnalité de ce décret était irrecevable, parce que l’appréciation selon laquelle se fait l’élection ou la nomination d’un juge (y compris la nécessité d’avoir fait preuve de « hautes qualités… et morales ») appartient uniquement à l’organe qui est compétent pour cela. « Elle n’est pas susceptible d’un contrôle de constitutionnalité parce qu’elle est personnelle et souveraine [42]. »
Pour ce qui est de l’objet essentiel du contrôle en constitutionnalité, à savoir les lois, il est incontestable que, ce sont elles, surtout et avant tout, qui sont susceptibles d’un tel contrôle.
La Cour a expressément examiné la question de savoir si la loi annuelle sur le budget de l’État est susceptible d’un contrôle en constitutionnalité et a donné une réponse affirmative (arrêt du 13 juin 1995, a. c. n° 14/1995 et arrêt du 25 juillet 1995, a. c. n° 13/1995). Au cours de la seconde des affaires mentionnées une hypothèse intéressante a été discutée, à savoir celle de ne pas inclure à la loi annuelle sur le budget les dépenses budgétaires pour l’entretien d’un organe public, qui est créé par la Constitution et exerce des compétences définies par la Constitution. La Cour s’est appuyée dans ce cas sur la conception selon laquelle les lois annuelles sur le budget ne sont des lois qu’au sens formel que parce qu’elles sont votées par le parlement sous le nom « lois », alors qu’elles ne comportent pas dans leur contenu essentiel de normes juridiques et leurs textes sont par conséquent des actes par lesquels sont gérés des moyens du fonds monétaire de l’État ; en tant que tels elles sont donc des actes administratifs. Sur la base de cette conception la conclusion est faite que le refus, en tant qu’acte de l’Assemblée nationale, est possible d’autant qu’il l’est dans la sphère de l’activité des organes administratifs. Ainsi et compte tenu de l’objet du contenu de la loi annuelle sur le budget de l’État, la Cour a abouti à la conclusion qu’il s’agit « d’un autre acte de l’Assemblée nationale » au sens de l’art. 149, al. 1, p. 2, appelé « acte-refus », et en tant que tel, cet acte a été déclaré recevable en vue de son examen [43].
I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Vu ce qui précède, on peut conclure qu’en général il n’existe pas de catégories d’actes de l’Assemblée nationale qui par définition soient placés hors contrôle de constitutionnalité. Dans la mesure où la Cour n’a pas été encore saisie par une demande dirigée contre des actes non-juridiques de l’Assemblée nationale (déclarations et appels) et du président (appels et messages), la question de savoir s’ils sont susceptibles d’être contrôlés en constitutionnalité par la Cour demeure ouverte [44].
La jurisprudence montre que devant la Cour ont été déjà posées les questions suivantes qu’elle a résolu et qui sont liées au thème que nous sommes en train d’évoquer, à savoir des actes placés hors contrôle :
- Le contrôle en constitutionnalité de lois qui sont adoptées avant la présente Constitution. La jurisprudence initiale de la Cour n’accepte pas que des lois, qui sont adoptées avant l’entrée en vigueur de la Constitution, soient susceptibles d’être contrôlées en constitutionnalité, parce que la Constitution elle-même prévoit des mécanismes pour l’abrogation de telles lois lorsqu’elles lui sont contraires [45].. Cette approche est ensuite abandonnée. Par ses arrêts, respectivement du 18 juillet 1995, a. c. n° 19/1995 et du 11 janvier 1996 a. c. n° 31/1995, la Cour accepte, la première fois implicitement et la seconde explicitement, que « sur un litige de constitutionnalité d’une loi la Cour est toujours compétente pour se prononcer par une décision ». Le moment auquel la loi a été adoptée est sans importance, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la Constitution, le législateur ne fait pas de différence sinon il l’aurait dit dans une disposition constitutionnelle. Dans ce sens la Cour a corrigé sa pratique courante. « Le tournant est fondé sur des considérations liées aux difficultés de l’application du mécanisme prévu par la Constitution et concernant les lois adoptées avant l’entrée en vigueur de celle-ci [46]. »
- Hors contrôle de constitutionnalité sont placées aussi les lois qui ont perdu leur validité avant l’entrée en vigueur de la Constitution [47]. – L’arrêt n° 4 du 21 juillet 1994, a. c. n° 5/1994, sur une demande dirigée contre des dispositions du Code pénal qui prévoient la peine de mort, présente aussi une importance de principe. Dans ce cas la demande est déclarée irrecevable aussi pour d’autres motifs [48]
- , mais il est souligné qu’une forme de procédure a été utilisée « afin qu’une question soit réglée non par le parlement, devant lequel elle est pendante… mais par la Cour constitutionnelle ». Ce cas illustre merveilleusement bien l’idée qu’on croit énoncée à l’art. 13 de la Loi sur la Cour constitutionnelle, compte tenu en plus des considérations sur lesquelles est fondé le refus de la Cour de s’occuper de cette question, à savoir : « Il est inadmissible d’utiliser des formes de procédure pour atteindre des objectifs dont l’aboutissement relève de la compétence de ceux qui s’adressent à la Cour constitutionnelle [49]… Si l’Assemblée nationale avait exprimé par ses actes sa volonté sur la question de la peine de mort, la Cour constitutionnelle serait obligée de se prononcer sur ces actes au cas où elle aurait été saisie par les sujets conformément à l’art. 150 de la Constitution. Or, le parlement n’ayant pas exprimé sa position, il est inadmissible que la Cour constitutionnelle… s’attribue ces compétences. » La considération que « … dans ces circonstances concrètes le problème de la peine de mort ne relève pas de ses compétences » reflète la conception que la question de la recevabilité des demandes, adressées à la Cour constitutionnelle, ne se limite pas à l’appréciation formelle de la légitimité du sujet ayant procédé à la saisine et de l’objet du contrôle que la Cour doit exercer, mais que pour sa solution on peut tenir compte d’autres principes constitutionnels – par exemple du principe de la séparation des pouvoirs. Il faut cependant dire qu’il n’y a pas eu une autre occasion (ou une autre affaire) pour discuter cet aspect de la question de la recevabilité et donc cette idée n’a pas encore évolué.
- Au sujet d’une hypothèse, évidente du point de vue de la manière dont elle est résolue, à savoir l’abrogation entre temps de la part du parlement d’une loi dont la constitutionnalité est contestée devant la Cour constitutionnelle, la Cour a décidé que « l’abrogation, y compris l’abrogation tacite, d’une disposition contestée mène à la suspension de l’affaire faute d’objet »[50]. Dans ce cas concret il s’agit de l’abrogation tacite d’une disposition d’une loi qui est contestée devant la Cour constitutionnelle, et à sa place est créée une norme juridique nouvelle qui régit un cas tout à fait différent. Ainsi la Cour s’est trouvée dans la situation lorsque « … est absent l’objet de l’affaire sur lequel… [la Cour] est obligée de se prononcer par une décision sur le fond. La disposition attaquée étant abrogée, le litige de constitutionnalité et de conformité avec des accords internationaux auxquels la Bulgarie est partie n’existe pas ». Dans une autre hypothèse similaire, créée après que la demande visant l’établissement de la constitutionnalité de quelques dispositions d’une loi a été déclarée recevable, la Cour a constaté que la nouvelle loi abrogeait une partie des dispositions attaquées et en modifiait d’autres. Il est constaté en même temps, que vu le moment de son entrée en vigueur, fixé par la nouvelle loi ellemême (vacatio legis), au moment du prononcé de la décision [51]. les dispositions contestées devant la Cour ne sont pas expirées, c’est-à-dire elles font toujours partie du droit en vigueur et pour cette raison le changement législatif ne constitue pas un obstacle pour procéder à une vérification de leur conformité à la Constitution.
- Dans une autre hypothèse spécifique, lorsque la Cour a dû se prononcer sur une demande visant l’établissement de l’inconstitutionnalité d’un accord international conclu par la République de Bulgarie après sa ratification par l’Assemblée nationale, la Cour a décidé « qu’une demande visant l’établissement de l’inconstitutionnalité de certaines dispositions [d’un accord international qui est ratifié par une loi] est irrecevable. Est recevable une demande visant l’établissement de l’inconstitutionnalité uniquement de l’acte de ratification de l’Assemblée nationale, à savoir la loi de ratification [52]…. ».
- En ce qui concerne une demande visant l’établissement de l’inconstitutionnalité d’une loi, fondée sur des allégations aux termes desquelles cette loi ne régit pas une question déterminée, la Cour a accepté ne pas être compétente d’examiner des allégations relatives à la présence de lacunes dans une loi [53]
- Devant la Cour a été posée aussi la question relative à la recevabilité d’une demande visant l’établissement de l’inconstitutionnalité d’une disposition d’une loi, laquelle loi dans son ensemble a déjà fait l’objet d’un contrôle et dont la demande visant l’établissement de son inconstitutionnalité a été entièrement rejetée par une décision précédente. La demande précédente contenait des allégations selon lesquelles onze dispositions de la loi étaient contraires à la Constitution ce qui conduit à l’inconstitutionnalité de la loi dans son ensemble en dépit du fait que le reste des dispositions n’était pas inconstitutionnel. La disposition, qui fait l’objet de la demande suivante, n’a pas été expressément incluse dans la demande précédente respectivement la décision. Voilà pourquoi il a été accepté [54] que par rapport à cette disposition n’est pas opposable l’autorité de la chose jugée et la demande est recevable parce que la règle de l’art. 21, al. 5 de la Loi sur la Cour constitutionnelle est inapplicable [55].
- Dans l’hypothèse d’une demande déclarée déjà irrecevable, et visant l’établissement de l’inconstitutionnalité d’une disposition d’une loi, la Cour a déclaré irrecevable une deuxième demande d’un autre sujet en acceptant que « l’interdiction d’un deuxième examen des demandes… ne porte pas seulement sur les cas, lorsque la Cour constitutionnelle s’est prononcée par une décision sur une demande ayant le même objet, mais aussi lorsque la demande a été déclarée irrecevable par un arrêt, le sujet autorisé…l’ayant déposé étant sans importance » [56]
- En ce qui concerne le champ des actes contrôlés il est intéressant de noter aussi le fait que la Cour a eu l’occasion de déclarer irrecevable une demande visant à déclarer la nullité d’une décision de la Cour constitutionnelle en soulignant qu’elle ne peut pas abroger, modifier ou déclarer la nullité de ses propres décisions [57]
I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
L’hypothèse que révèle la question, évoquée comme nous l’avons fait, n’a pas encore été posée devant la Cour constitutionnelle bulgare. En même temps cette question permet d’évoquer une autre hypothèse à laquelle la Cour a trouvé une solution en l’absence d’un texte applicable issu de la Constitution ou de la Loi sur la Cour constitutionnelle. Il s’agit du cas où la Cour déclare l’inconstitutionnalité d’une loi par laquelle est abrogée ou modifiée une loi précédente. À ce sujet la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 7 du 19 juin 1995, a. c. n° 9/1995 et dans sa décision n° 8 du 19 juin 1995, a. c. 12/1995 (au sujet de l’établissement de l’inconstitutionnalité de dispositions qui modifient des dispositions précédentes), ainsi que dans sa décision n° 22 du 31 octobre 1995, a. c. n° 25/1995, décide que « lorsque est déclarée l’inconstitutionnalité d’une loi par laquelle est abrogée ou modifiée une loi en vigueur, cette dernière rétablit sa validité dans la rédaction avant l’abrogation ou la modification à partir de l’entrée en vigueur de la décision de la Cour »[58]. Vu cette approche, la Cour acceptait plus tard qu’elle était compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité des rédactions précédentes d’une disposition contestée, si il est fait droit à la demande relative à la disposition en vigueur [59].
I – 3. – Délais
La réglementation du procès constitutionnel en Bulgarie ne contient pas une exigence selon laquelle les demandes doivent être déposées dans des délais fixés par la Constitution ou par la Loi sur la Cour constitutionnelle. Seul le délai initial est fixé. Aux termes de l’art. 17, al. 2 de la Loi sur la Cour constitutionnelle, les demandes visant l’établissement de l’inconstitutionnalité des lois et autres actes de l’Assemblée nationale ainsi que des actes du président, peuvent être déposées à la date de la publication desdits textes. Dans l’hypothèse d’une demande visant l’établissement de la conformité d’une loi avec un accord international auquel la Bulgarie est partie (art. 149, al. 1, p. 4 de la Constitution), la Cour a eu l’occasion de signaler qu’une telle demande est irrecevable quand elle vise à établir la conformité de dispositions d’une loi avec un accord international auquel la Bulgarie n’est pas encore partie (c’est-à-dire un accord qui n’est pas encore entrée en vigueur à l’égard de la Bulgarie) [60].
II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
L’introduction d’une demande devant la Cour constitutionnelle n’est soumise à aucune taxe de la par de l’État. Ni la Loi sur la Cour constitutionnelle, ni le Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle ne prévoient cette exigence.
II – 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
La représentation du requérant (du dépositaire de la demande) par ministre d’avocat doit être considérée comme une possibilité dont il jouit, mais non comme une obligation. Dans la Loi sur la Cour constitutionnelle et le Règlement n’est pas requise la condition selon laquelle la demande, qui sera déposée, doit être rédigée obligatoirement par un avocat ou par un autre représentant qui satisfait à des conditions déterminées. Cela concerne aussi les autres documents (observations, etc.) qui peuvent éventuellement être présentées au cours de la procédure.
Vu l’approche évoluée de la Cour constitutionnelle concernant le type de séances qu’elle tient et les possibilités déjà accrues d’organiser des séances publiques avec la participation des parties, le Règlement prévoit notamment que les parties à l’affaire, qui sont des organes publics collectifs, des institutions publiques ou des personnes physiques, et qui participent de toute façon à la séance publique à travers leur président, dirigeant ou président du conseil d’administration, peuvent autoriser une autre personne à les représenter (art. 27 b, al. 1, première et deuxième phrase). La possibilité de participer au procès par l’intermédiaire d’un représentant est prévue aussi pour le président de la République, le procureur général ainsi que pour les autres organes publics individuels qui sont des parties à l’affaire en question (art. 27 b, al. 1, phrase 3). Dans ces cas sous « parties à l’affaire » il faut entendre tous les participants à la procédure, y compris les parties intéressées [61], constituées par la Cour et non seulement les dépositaires de la demande.
Le Règlement régit à part la question de la représentation dans les cas où la demande est introduite par « un groupe » de députés. Avant sa modification, intervenue par décision n° 5 du 6 avril 1999 il prévoyait l’exigence suivante : « lorsque la demande est formulée par un groupe de députés il faut indiquer le nom de la personne à laquelle peuvent être communiquer des informations relatives à l’affaire » (art. 18, al. 2, p. 2, deuxième phrase). La rédaction modifiée de cette disposition, qui reflète une pratique déjà affirmée de la Cour, stipule : « Lorsque la demande est formulée par un groupe de députés, le premier d’entre eux est considéré comme leur représentant, sauf si un autre est désigné. »
Cette modification, comme on vient de le dire, résulte aussi de la pratique créée en la matière par la Cour, laquelle pratique, on peut dire, a été libérale lors de l’application de l’exigence requise initialement d’indiquer un représentant du « groupe » dans la demande elle-même, bien que des cas soient connus dans lesquels aux dépositaires de la demande des instructions explicites sont données pour indiquer la personne à laquelle doivent être communiquées les informations relatives à l’affaire. La question de la représentation d’un groupe de députés ne doit pas être confondue avec la possibilité qui existe pour un député d’être l’interprète de la volonté commune de tout le groupe et de formuler en leur nom une nouvelle demande laquelle, comme il est indiqué au point II-2.3. ci-dessous, serait irrecevable.
II – 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
La recevabilité des demandes visant l’établissement de l’inconstitutionnalité des lois et des autres actes de l’Assemblée nationale, ainsi que des actes du président, ne dépend pas de la démonstration d’un intérêt juridique. Une telle condition de recevabilité de ces demandes n’est pas prévue ni dans la Constitution, ni dans la Loi sur la Cour constitutionnelle et ne ressort pas non plus de la jurisprudence de la Cour [62].
II – 2. – Conditions relatives au recours
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les questions évoquées dans ce point ne sont pas d’un intérêt juridique essentiel pour l’évolution de la procédure constitutionnelle en Bulgarie (au sens de la façon dont elle se déroule et des conséquences juridiques éventuelles) parce que comme il a été indiqué dans le point I-3., l’introduction des demandes contre des actes de l’Assemblée nationale et du président n’est pas liée à des délais.
Bien sûr la Cour constitutionnelle a son Greffe qui fonctionne selon des règles dûment établies. Ces règles sont définies par la Cour elle-même dans le Règlement relatif à l’organisation de son activité, chapitre « Greffe ». Conformément à l’art. 38 de ce Règlement la Cour constitutionnelle tient les registres suivant :
- – registre pour le courrier reçu et registre pour le courrier expédié ;
- – annuaire alphabétique des procédures ouvertes ;
- – registre dans lequel sont inscrites les procédures ouvertes ;
- – registre des séances judiciaires ;
- – registre des documents secrets ;
- – registre des amendes ;
- – registre des pièces à conviction ;
- – registre des archives pour le transfert des affaires jugées, du Greffe aux archives.
Chaque document qui parvient est enregistré dans le registre pour le courrier reçu le jour même de sa réception et ce numéro, ainsi que la date de la réception sont marqués sur le document lui-même (art. 39, al. 1 du Règlement). Le même procédé est pratiqué pour tous les papiers y compris pour les demandes. C’est-à-dire que sur les demandes est inscrit d’abord le numéro d’enregistrement selon la date de leur réception, et ensuite le numéro de l’affaire qui est intentée sur la base de la demande spécifique.
II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
Étant donné, que du point de vue des délais d’introduction des demandes est prévu une seule condition – que les demandes visant l’établissement de l’inconstitutionnalité des lois et des autres actes aux termes de l’art. 149, al. 1, p. 2 de la Constitution, peuvent être introduites à la date de la publication desdits textes – la question de la date qui fait foi pour la suite des procédures n’est pas d’une grande importance. Bien sûr cette question peut se poser notamment au sujet du respect de la condition citée. Mais, poser cette question ici ne peut qu’obtenir une réponse éventuelle et abstraite, car jusqu’à présent il n’y a pas eu de situations dans lesquelles la Cour a dû se prononcer à ce sujet. On pourrait considérer comme date faisant foi pour la suite des procédures celle de la réception de la demande et de son enregistrement dans le registre du courrier reçu, mais des spéculations pourraient apparaître aussi en ce qui concerne la date de l’examen de la demande par la Cour à laquelle la demande s’avérerait valable.
II – 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Les conditions formelles et matérielles de recevabilité des demandes actuellement en vigueur, telles qu’elles sont établies par la pratique de la Cour, en application de la Loi sur la Cour constitutionnelle et le Règlement relatif à l’organisation de son activité sont les suivantes :
Les conditions formelles sont déterminées à l’art. 17, al. 1 de la Loi sur la Cour constitutionnelle : « Les demandes introduites devant la Cour constitutionnelle doivent être présentées par écrit, être motivées et être accompagnées de preuves, également portées par écrit », ainsi que dans l’art. 18 du Règlement qui stipule que les demandes doivent être présentées par écrit et doivent être motivées. Elles doivent contenir les éléments suivants : désignation de la cour ; raison sociale, nom et siège,adresse des organes et des personnes qui ont introduit la demande ; désignation d’un représentant dans le cas où la demande est introduite par un groupe de députés ; raison sociale, nom et siège social, adresse des organes et des personnes intéressés qui selon l’auteur de la demande doivent être présents à la séance de la Cour ; exposé des motifs sur le bien fondé de la demande ; objet de la demande ; numéro d’enregistrement et cachet de l’organe ayant introduit la demande ; signature de la personne ayant introduit la demande.
Ces exigences sont requises pour tous les sujets qui saisissent la Cour et pour tous les types de demandes (du point de vue des compétences de la Cour) qui peuvent être déposées à la Cour constitutionnelle. Il n’y a pas de procédure spéciale pour les divers types de procès en fonction du contrôle que la Cour exerce.
L’art. 19 du Règlement de la Cour stipule que lorsque la demande ne satisfait pas à toutes les conditions, le président de la Cour fixe un délai pour sa régularisation. Si l’organe ou la personnes ayant présenté la demande ne procède pas à sa régularisation dans les délais fixés, le président présente la demande en vue de son examen par la Cour constitutionnelle qui décide si la demande doit être retournée.
En pratique le non-respect des conditions formelles est rare et même nul. Voilà pourquoi sans avoir tacitement abrogé ce pouvoir du président de la Cour, on peut considérer qu’un ordre différent des actions procédurales est affirmé. Tout commence par une ordonnance du président de la Cour qui ouvre la procédure et désigne un ou quelques rapporteurs et fixe la date de la séance (sur la recevabilité).
C’est au cours de la séance sur la recevabilité que les juges procèdent à un examen pour savoir si la demande satisfait aux conditions formelles et matérielles en vue de sa recevabilité.
(N.B. – Dans ce point du questionnaire figure aussi la question sur la possibilité de soulever des moyens nouveaux en cours de procédure. Pour la pratique de la Cour constitutionnelle bulgare la réponse à cette question est affirmative, mais elle demande des réflexions plus approfondies et pour suivre l’ordre du questionnaire nous lui réserverons une place plus détaillée dans le point suivant.)
En principe conformément à l’art. 22, al. 1 [63]. de la Loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour se prononce seulement sur la demande dont elle est saisie, mais « n’est pas limitée par les motifs d’inconstitutionnalité indiqués ». Dans ce sens et dans la mesure où l’objet de la demande demeure le même, les parties peuvent soulever des moyens nouveaux d’inconstitutionnalité ; la Cour n’est pas elle non plus limitée par les motifs indiqués dans la demande, mais doit qualifier d’office du point de vue juridique les faits et les circonstances qui y sont exposés. Dans ce cas sous « les parties » il faut entendre toutes les parties intéressées et non pas seulement les dépositaires de la demande. Par exemple dans le cas de l’affaire constitutionnelle n° 17/1993 (décision n° 15 du 28 septembre 1993) ouverte sur la base d’une contestation de constitutionnalité de la décision de l’Assemblée nationale de démettre de ses fonctions le directeur général de l’Agence Télégraphique Bulgare, ce dernier, constitué partie intéressée (et non-dépositaire de la demande qu’il ne peut évidemment pas être) a soulevé des moyens complètement nouveaux et différents de ceux, sur lesquels se basait la demande, et qui furent l’objet d’une analyse à part dans les motifs de la décision sur le fond.
On peut donc, conclure que soulever des moyens nouveaux est en principe possible, sans que cette démarche soit liée à des délais spéciaux autres que ceux fixés par la Cour pour la présentation desobservations des parties. La question évoquée ci-dessus doit être distinguée d’une autre hypothèse à laquelle la Cour constitutionnelle a fait face. Il s’agit non pas de soulever des moyens nouveaux, mais en réalité d’une demande complémentaire. Dans ce cas, la Cour a décidé que lorsqu’une observation nouvelle est déposée sur une procédure constitutionnelle déjà ouverte et que cette observation contient une demande complémentaire, c’est-à-dire qui a un autre objet, la Cour l’accepte en vue de son examen sur le fond seulement si elle est formulée par le même sujet qui a procédé à la saisine et si elle a un lien avec l’objet de la procédure, ouverte sur la base de la demande initiale. Il est signalé aussi que, dans les cas d’une demande formulée en cours et dans le cadre d’une procédure pendante devant la Cour constitutionnelle, restent valables les exigences énoncées à l’art. 17, al. 1 de la Loi sur la Cour constitutionnelle et l’art. 18, al. 1 du Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle. Dans la mesure où la nouvelle demande a été formulée dans une observation supplémentaire, signée seulement par « le représentant » d’un groupe de députés, il est signalé « qu’un député ne peut être l’interprète de la volonté commune de 58 députés, cette volonté étant considérée comme un ensemble de volontés concordantes de tous », pour qu’il soit admissible qu’il formule une nouvelle demande au nom de tous [64].
II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Les conditions formelles et matérielles de recevabilité des demandes n’ont pas changé dans le temps. Du point de vue de leur réglementation dans la Loi sur la Cour constitutionnelle et le Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle, ces conditions n’ont subi aucun changement pendant toute cette période, c’est-à-dire à partir de la création de la Cour. Quant à la jurisprudence de la Cour, l’évolution qu’elle a subie à certains égards a été déjà évoquée dans le rapport et il n’est pas donc nécessaire d’y revenir en détail.
II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
À ce sujet il conviendrait de signaler que la régularisation de la demande est en principe possible. Selon la procédure courante, la Cour doit d’abord constater la présence de défauts et donner ensuite des instructions au dépositaire de la demande en vue de sa régularisation [65]. C’est la Cour elle-même qui fixe les délais pour la régularisation des demandes, car de tels délais ne sont établis par une aucune norme. Au cas où la demande présente des défauts substantiels et sa régularisation n’est pas effectuée conformément aux instructions de la Cour, la demande est déclarée irrecevable [66]. En même temps dans sa pratique la Cour a eu déjà l’occasion de constater une contradiction entre les motifs et le petitum de la demande et que cette contradiction pouvait être surmontée par voie d’interprétation. Dans de tels cas la priorité est donnée à la volonté réelle des auteurs de la demande, exprimée dans les motifs, tout en acceptant qu’il ne soit pas nécessaire de renvoyer la demande à ses dépositaires en vue d’observations supplémentaires [67]. Mais dans un autre cas de contradiction entre les motifs et le petitum, lorsque la contradiction était due à des imprécisions dans les motifs, la contradiction n’a pas pu être surmontée par voie d’interprétation et l’auteur de la demande en a été avisé afin de présenter les précisions nécessaires [68].
La Cour a eu l’occasion de noter qu’elle peut demander que la régularisation de la demande se poursuive pendant toute la durée de la procédure constitutionnelle [69].
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II – 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
Il a été déjà noté que la Cour constitutionnelle se prononce sur la recevabilité des demandes au cours d’une phase précise de la procédure, celle de la recevabilité.
II – 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ? L’acte par lequel la Cour se prononce sur la recevabilité (l’arrêt) n’est pas susceptible de recours.
II – 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
Sur toutes les questions, y compris celle de la recevabilité, la Cour siège en formation plénière avec la participation de tous les juges. Des formations particulières (plus restreintes) ne sont pas prévues. Pour toutes les affaires est désigné un ou quelques juges rapporteurs en fonction de la complexité de l’affaire. Le juge-rapporteur est désigné par le président de la Cour par la même ordonnance que celle de l’ouverture de la procédure.
II – 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle motivée, prononcée, publiée ?
Les arrêts par lesquels les demandes sont déclarées irrecevables, sont prononcés à huis clos (art. 19, al. 1 de la Loi sur la Cour constitutionnelle). Tous les actes de la Cour sont motivés (art. 23, al. 2 du Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle). En ce qui concerne en particulier les actes par lesquels une demande est déclarée irrecevable l’art. 19, al. 2 de la Loi sur la Cour constitutionnelle stipule : « Lorsqu’une demande est déclarée irrecevable, elle est renvoyée au destinataire, accompagnée d’un arrêt motivé. » La remise d’une copie de l’arrêt est aussi une façon de le rendre public, c’est-à-dire d’aviser l’auteur de la demande. À la différence des décisions de la Cour, qui sont publiées au Journal officiel cette publication étant l’une des conditions de leur entrée en vigueur (art. 152, al. 2 de la Constitution), les arrêts eux, accompagnés des motifs, sont publiés au J.O. « lorsque le président de la Cour constitutionnelle en décide » (art. 4, al. 1, p. 4 de la Loi sur le Journal officiel ». Mais, il est vrai qu’en pratique, il est rarement nécessaire de publier au J.O. des arrêts sur l’irrecevabilité, et que cette possibilité n’est examinée que lorsque la question traitée revêt une importance de principe [70]. Il n’y a pas eu, jusqu’à présent des cas de publication au J.O. des arrêts sur la recevabilité des demandes.
II – 3.5. – Les requérants abusifs sont-elles passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Étant donné que les dépositaires des demandes devant la Cour constitutionnelle ne doivent s’acquitter d’aucun droit de timbre, les dépositaires de demandes abusifs ne sont passibles d’aucune amende pour abus du droit d’agir.
II – 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
À présent la procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité doit être considérée comme affirmée dans le sens de la partie II.4 ci-dessous. Une éventuelle évolution porterait sur les questions relatives aux sujets autorisés à saisir la Cour et aux actes susceptibles d’être contrôles qui ont été déjà évoquées dans le présent rapport.
II – 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Vu ce qui a été dit dans le point précédent, seront indiqués ici les motifs de rejet qui ne concernent pas les sujets ayant le droit de saisir la Cour ni les actes contrôlés. En ce sens la pratique révèle les motifs suivants de rejet des demandes :
- objet mal défini de la demande coïncidant de surcroît avec des questions sur lesquelles la Cour constitutionnelle s’est prononcée ;
- absence d’un exposé des motifs sur le bien fondé de la demande [71].
Tous les motifs d’irrecevabilité (respectivement les principaux motifs d’irrecevabilité) pour lesquels la Cour a rejeté des demandes (dirigées contre des lois et autres actes de l’Assemblée nationale, ainsi que contre des actes du président) peuvent être illustrés par les données présentées sommairement ci-dessous et qui remplacent le tableau prévu dans cette partie par le questionnaire :
- demandes présentées par des sujets n’ayant pas le droit de saisir la Cour constitutionnelle
- 2 demandes. Ici, dans une catégorie à part doivent être classées les demandes présentées par des députés dont le nombre est inférieur à un cinquième de leur nombre total, lorsqu’on accepte que le sujet ayant le droit de saisine est absent – 3 demandes ;
- demandes ayant pour objet un acte qui n’est pas susceptible d’être contrôlé en constitutionnalité ou en général des demandes qui échappent à la compétence de la Cour constitutionnelle, y compris celles relatives à l’interprétation de lois ou se fondant sur des allégations de lacunes dans une loi – 6 demandes. Il faut mentionner à part le cas des lois /actes/, adoptées avant la dernière Constitution, qui selon une approche, déjà abandonnée, n’étaient pas susceptibles d’un contrôle en constitutionnalité – 3 demandes ;
- demande qui est déclarée irrecevable, parce qu’elle porte sur un cas, traité dans une autre demande ayant le même sujet, mais sur laquelle la Cour a déjà prononcé une décision ou, et qui porte sur un cas, traité dans une autre demande ayant le même objet, mais déjà rejetée – 1 demande ;
- demandes, qui sont déclarées irrecevables parce qu’elles présentent des défauts substantiels et il n’est pas procédé à leur régularisation selon les instructions de la Cour – 3 demandes ;
- demandes dont la déclaration d’irrecevabilité découle du pouvoir aux termes de l’art. 149, al. 1, p. 4 de la Constitution : a) de statuer sur la conformité d’une loi avec un accord international auquel la Bulgarie est partie – 1 demande ; b) de statuer sur la conformité avec la Constitution d’un accord international déjà ratifié – 1 demande ; et c) de statuer sur la conformité d’une loi avec la Charte internationale des droits de l’homme pour laquelle il est accepté ne pas être un accord international – 1 demande.Les données [72] constituent 14 % de toutes des demandes déposées.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III – 1. – Principe du contradictoire
III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
La question relative à la participation éventuelle des parties au procès et à l’application du principe du contradictoire à la phase de la recevabilité de la demande se pose uniquement au niveau de la participation des parties soidisant intéressées à cette phase de la procédure.
Il a été déjà noté que les institutions et personnes intéressées sont définies généralement par la Cour (sauf les cas où elles-mêmes demandent à se constituer). En général, les parties intéressées sont constituées en même temps qu’est déclarée la recevabilité de la demande en vue de son examen sur le fond et ceci en tenant compte de leur participation à la phase du jugement de l’affaire. Or, dans des cas isolés, lorsque la Cour constate qu’une demande présente des défauts et qu’il faut procéder à sa régularisation, l’ordre est inversé – on commence, parallèlement aux instructions pour la régularisation de la demande, par constituer les parties intéressées. Les parties intéressées ont la possibilité d’exprimer leurs observations sur la recevabilité qui sont prises en considération par la Cour [73]
III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
Dans la mesure où en principe la Cour constitutionnelle siège hors la présence des institutions et personnes intéressées (art. 27, al. 1 du Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle), la participation des parties intéressées aux séances selon la règle a lieu sous forme d’observations présentées par écrit. Dans la mesure où le dépôt d’observations à l’étape de la déclaration de recevabilité constitue une exception (v. le point précédent), ces observations sont normalement présentées à la phase du jugement de l’affaire sur le fond.
Lorsque la Cour constitutionnelle décide de tenir une séance publique (art. 27, al. 2 de son Règlement), celle-ci a lieu à la deuxième phase de la procédure. Dans la pratique il n’y a pas eu jusqu’à présent des séances publiques à la phase de la recevabilité de la demande et le Règlement lui-même prévoit expressément de telles séances uniquement à la deuxième phase de la procédure qui est consacrée au jugement de l’affaire sur le fond.
III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
On ne peut pas répondre par un simple oui ou non quand il s’agit de dire si la procédure constitutionnelle en Bulgarie par rapport au contrôle des actes, est entièrement ou partiellement contradictoire. La participation des parties intéressées et la possibilité de présenter des observations soulevant aussi des moyens supplémentaires d’inconstitutionnalité accorde à la procédure un caractère contradictoire. D’autre part, le fait que la Cour puisse déclarer une loi inconstitutionnelle sans être limitée par les motifs d’inconstitutionnalité indiqués (art. 22, al. 1, deuxième phrase de la Loi sur la Cour constitutionnelle), sans être obligée d’aviser préalablement les parties constituées et l’autorité qui l’a saisi et sans attendre leurs observations supplémentaires, accorde à la procédure un caractère d’office.
III – 2. – Égalité des armes
III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Bien que l’art. 17, al. 1 du Règlement de la Cour constitutionnelle exige que la demande soit motivée et accompagnée de preuves, la jurisprudence n’a pas établi de critères et exigences strictes et spécifiques concernant les preuves qui doivent obligatoirement accompagner la demande. Tout dépend des particularités du cas. Par exemple, dans le cas de l’affaire constitutionnelle n° 3/1996, la demande visant l’établissement d’inconstitutionnalité d’une décision de l’Assemblée nationale se fondait sur des allégations concrètes qui devaient être prouvées. Après avoir avisé les dépositaires de la demande de produire de telles preuves, et après avoir constaté ensuite que ces deniers n’avaient pas produit les preuves requises, la Cour a accepté que dans ce cas, la production de preuves sur le bien fondé de la demande, soit une exigence relevant de la bonne et due forme de la demande, et que la bonne et due forme de la demande, c’est-à-dire le respect des conditions requises à l’art. 18 du Règlement de la Cour constitutionnelle, constitue la condition procédurale préalable nécessaire à son examen [74] L’absence de cette condition préalable est la raison pour laquelle la demande a été déclarée irrecevable. Il s’agit là d’une solution de la Cour qui est entièrement fondée sur les exigences auxquelles la demande doit répondre, indépendamment de la possibilité qui existe pour la Cour d’exiger d’office des preuves, ce qui a été d’ailleurs demandé à l’auteur de la demande.
III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises ou accessibles ?
L’article 29, al. 4 du Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle stipule que la Cour accorde aux organes et personnes intéressées la possibilité de prendre connaissance des preuves qui sont recueillies. Dans la pratique jusqu’à présent il n’y a pas eu de cas d’accès limité des parties aux pièces relatives à l’affaire, y compris à certaines de ces pièces.
III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
La Cour constitutionnelle peut exiger (d’office) des preuves supplémentaires écrites et rechercher l’avis d’expert. Nul n’a le droit de refuser de présenter les informations ou preuves documentaires, quand bien même il s’agirait de secrets d’État ou officiels (art. 20, al. 1 et 2 de la Loi sur la Cour constitutionnelle et art. 29, al. 2 et 3 du Règlement relatif à l’organisation de l’activité de la Cour constitutionnelle). À ce sujet la Cour a eu l’occasion de décider que, si elle juge nécessaire, elle peut exiger des informations même d’une partie intéressée constituée comme telle à une affaire [75].
III – 2.4. – Le juge constitutionnel peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête / de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
Comme il a été noté à plusieurs reprises, conformément à l’art. 22, al. 1, deuxième phrase de la Loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour n’est pas limitée par les motifs d’inconstitutionnalité indiqués. Il s’agit là d’une approche stable dans la pratique de la Cour que celle-ci suit, d’autant plus qu’elle ne suscite pas de problèmes. Bien sûr, la pratique selon laquelle aux parties, y compris au dépositaire de la demande, n’est pas accordée la possibilité d’exprimer des observations sur les moyens qui sont soulevés d’office par la Cour, peut être qualifiée comme un problème de procédure. En pratique cela n’est très souvent même pas possible, car généralement la Cour soulève des moyens d’office dans sa décision sur le jugement de l’affaire sur le fond, sans révéler au préalable devant les parties son intention d’agir en ce sens.
En ce qui concerne la possibilité d’étendre le contrôle sur des dispositions non contestées dans la demande, il a été déjà noté qu’une telle possibilité n’existe pas (v. I-1.3.).
III – 3. – Délai de jugement
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
L’art. 21, al. 4 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fixe un délai de deux mois dans lequel la Cour doit rendre sa décision et qui commence à partir du moment dans lequel la Cour estime que les preuves recueillies sont suffisantes. Ce délai est le même pour toutes les catégories d’affaires. En général, il est respecté et en pratique la Cour rend ses décisions longtemps avant son expiration. Le délai moyen entre la fin du jugement de l’affaire et le prononcé de la décision est d’environ un mois.
III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’ionstruction ?
La procédure formelle de « clôture de l’instruction » consiste en le prononcé d’un arrêt par lequel la Cour constate que les délais accordés aux parties pour présenter des observations et produire des preuves ont expiré et que sont recueillies les preuves nécessaires après quoi la Cour déclare qu’elle peut procéder à l’examen de l’affaire sur le fond.
Une fois cet arrêt rendu, la Cour procède à des délibérations et au prononcé de sa décision sur le fond.
III – 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
Sur cette question voir III-3.1. ci-dessus.
Conclusion
On peut dire que du point de vue des questions examinées dans le présent rapport, la Cour, en appliquant les normes juridiques en vigueur, a établi une approche permanente qui a permis à sa pratique de s’affirmer et donc d’être connue et prévisible pour les sujets qui saisissent la Cour et pour les parties intéressées. Le fait d’avoir une pratique affirmée facilite le parcours des sujets qui procèdent à la saisine quant aux démarches à suivre tout en servant de garantie en matière d’égalité des armes.
- – Quant à l’accès au juge constitutionnel, la Cour n’a pas dû procéder à des adaptations structurelles.
- – La question relative à l’élargissement de l’accès à la Cour constitutionnelle fait l’objet de discussions publiques, aussi bien parmi les universitaires qu’au sein de la société. Les idées qui sont discutées portent sur l’introduction du recours individuel ou l’éventualité d’accorder le droit de saisir la Cour constitutionnelle à l’ombudsman, une instance qui n’existe pas encore en Bulgarie mais dont la création est l’objet de discussion. La première de ces deux idées est partagée par la Cour constitutionnelle elle-même. Or, de toute façon, l’élargissement de l’accès à la Cour constitutionnelle, et la mise en conformité des mécanismes de contrôle constitutionnel qui en découle, demanderait la modification de la Constitution. Il est nécessaire à cet effet que naisse la volonté politique correspondante et que les conditions de sa réalisation soient réunies.
- – Dans certains cas on peut constater une attitude plus professionnelle à l’égard des demandes qui résulte, d’une part, du fait que la pratique courante de la Cour est déjà une pratique affirmée et, d’autre part, de l’expérience professionnelle spécifique qui est acquise. En parlant de cette expérience il faut tenir compte de la contribution des juristes (avocats) possédant des qualités et une formation spécifique qui leur permettent de préparer des demandes bien motivées (fondées) y compris sur la base de la jurisprudence créée par la Cour.
-
[1]
Or, cela est évident aussi de l’usage purement linguistique d’un terme complètement différent comme « demande » au lieu de demande en justice, plainte, proposition ou autre. Dans ce sens indépendamment du fait que la Constitution et la Loi sur la Cour constitutionnelle utilisent des termes différents, finalement les deux termes « demande » et « requête » visent la même action et il s’agit du même acte – celui par lequel une initiative est engagée devant la Cour constitutionnelle et une procédure constitutionnelle ouverte. [Retour au contenu] -
[2]
Sur cette question v. I-2.2. ci-dessous. [Retour au contenu] -
[3]
Concernant la possibilité d’un accès indirect, v. ci-dessous. [Retour au contenu] -
[4]
V. I-2. ci-dessous. [Retour au contenu] -
[5]
Le nombre total des décisions pour l’année respective ne correspond pas toujours aux demandes parce que certaines décisions sont rendues sur la demande de deux ou plus de deux sujets, autorisés à saisir la Cour constitutionnelle. Ce tableau est établi compte tenu de toutes les compétences de la Cour constitutionnelle. Pour le contrôle en constitutionnalité des normes (ou plus exactement des actes de l’Assemblée nationale et du président) voir le Tableau 1.a. [Retour au contenu] -
[6]
C’est-à-dire 48 députés parce que le parlement bulgare – l’Assemblée nationale – n’a qu’une chambre et compte 240 députés (art. 63 de la Constitution). [Retour au contenu] -
[7]
Le terme « groupe » est établi par le Règlement relatif à l’organisation et à l’activité de la Cour constitutionnelle. Il est régulièrement utilisé dans des actes de la Cour en tant que désignation du sujet en question sans qu’il contienne bien sûr une suggestion de personnification du sujet, bien que la question de la composition du groupe puisse soulever, comme il devient clair du texte plus loin des problèmes concernant la légitimité du sujet. Plus loin (v. 2. ci-dessous) est évoquée la question de la représentation du « groupe ». [Retour au contenu] -
[8]
Arrêt du 26 janvier 1993, a. c. n° 1/1993. [Retour au contenu] -
[9]
Concernant la possibilité de retirer des signatures v. I-1.4. [Retour au contenu] -
[10]
Arrêt n° 1 du 24 février 1994, a. c. n° 21/1993 et Arrêt n° 6 du 29 octobre 1996, a. c. n° 23/1996. [Retour au contenu] -
[11]
Sur la possibilité de se désister d’une demande v. I-1.4. ci-dessous. [Retour au contenu] -
[12]
Arrêt n° 1 du 24 février 1994, a. c. n° 21/1993 susmentionné. [Retour au contenu] -
[13]
Dans ce cas les deux « groupes » pris ensemble auraient dépassé le nombre requis et la demande deviendrait recevable. Telle est la position que défend une opinion dissidente jointe à l’arrêt en question et soutenant notamment qu’il s’agit d’un droit individuel des députés qui ne peut être exprimé que conjointement et que l’important est l’essence de la volonté exprimée individuellement par chacun des députés – voilà pourquoi il ne s’agit pas de deux « groupes ». Bien que les signatures soient déposées sur deux documents distincts ce qui compte, c’est le lien logique entre les volontés exprimées que contient dans chacun d’eux. [Retour au contenu] -
[14]
Arrêt n° 4 du 21 juillet 1994, a. c . n° 5/1994. Il s’agit d’une demande d’interprétation de la Constitution sur le sujet de la peine de mort, ainsi que d’une demande visant l’établissement de l’inconstitutionnalité des dispositions du Code pénal prévoyant cette peine. Cet arrêt contient aussi un second motif d’irrecevabilité de la demande dans le sens que la Cour n’est pas compétente, car l’Assemblée nationale en tant que le porteur unique du pouvoir législatif est celle qui tranche sur la question de la peine de mort (v. sur la même question I-2. ci-dessous). [Retour au contenu] -
[15]
Arrêt du 18 mars 1993, a. c. n° 4/1993. [Retour au contenu] -
[16]
Dans la décision n° 25 du 29 septembre 1998, a. c. n° 22/1998 est discuté un argument des députés ayant déposé la demande, à savoir que la décision de l’Assemblée nationale qu’ils contestent est adoptée en l’absence de quorum. En étudiant cet argument la Cour a constaté qu’il s’agissait d’une contradiction entre le nombre des députés présents à la séance du parlement, d’une part, et le nombre de ceux d’entre eux qui ont exécuté leur obligation de voter, d’autre part. Il a été constaté aussi que la présence du quorum n’a pas été contestée au cours de la séance et une vérification du quorum n’a pas été demandée. Vu ces circonstances il est noté que la référence (dans la demande) d’absence de quorum constitue un abus du droit de saisir la Cour constitutionnelle ce qui n’est pas du tout souhaitable du point de vue de la justice constitutionnelle. Cette constatation, qui est faite dans la décision et non à la phase de la recevabilité de la demande, n’a pas eu de conséquence sur la suite qui lui a été réservée, et elle a été rejetée avec d’autres motifs [Retour au contenu] -
[17]
Dans l’arrêt n° 4 du 21 juillet 1994, a. c. n° 5/1995 par lequel la demande est déclarée irrecevable avec d’autres motifs, on trouve le texte suivant : « Pour l’essentiel une forme juridique est utilisée… pour qu’une question soit résolue non par le parlement, devant lequel elle est pendante et il y a des projets de lois en la matière, mais par la Cour constitutionnelle. Il est inadmissible d’utiliser des formes de procédure (lesquelles dans ce cas ne sont même pas efficaces) pour atteindre des objectifs qui relèvent de la compétence de ceux qui saisissent la Cour constitutionnelle. » [Retour au contenu] -
[18]
Arrêt du 29 décembre 1991, a. c. n° 1/1991. À la première demande sur cette affaire une deuxième a été jointe, introduite par des députés de la l’Assemblée nationale suivante. On ne peut que se livrer à des spéculations pour ce qui est de savoir comment la Cour aurait agi en cas d’absence d’une deuxième demande et d’un motif contre la régularité de la première étant donné qu’elle émane de députés de l’Assemblée nationale dissoute. En principe un tel motif n’est pas juridique. [Retour au contenu] -
[19]
Décision n° 5 du 18 février 1997, a. c. n° 25/1996. Concernant le cas de retrait d’une demande d’un porteur postérieur de l’autorité publique respective, v. I-1.4. [Retour au contenu] -
[20]
Concernant la possibilité de retirer la demande v. I-1.4. ci-dessous [Retour au contenu] -
[21]
Arrêt n° 4 du 18 février 1993, a. c. n° 26/1992. [Retour au contenu] -
[22]
Dans le présent rapport il n’est pas noté que les chiffres du Tableau 1.a. concernent l’ancien procureur général et que le procureur général en exercice, entré en fonction en février 1999, n’a déposé jusqu’à présent aucune demande devant la Cour constitutionnelle. [Retour au contenu] -
[23]
Dans des commentaires sur la pratique de la Cour constitutionnelle, des informations (non officielles) ont été discutées concernant l’existence près le parquet d’un service spécial pour la réception des plaintes des citoyens et des organisations, considérées comme un signal pour le dépôt éventuel de demandes à la Cour constitutionnelle. Bien que cette activité ne soit pas officialisée, la question a été discutée de savoir si une telle activité ne constituait pas un palliatif du recours constitutionnel individuel, qui n’est pas prévu dans la Constitution bulgare, mais cette façon de l’introduire est critiquée. [Retour au contenu] -
[24]
Dans la décision n° 17 du 3 octobre 1995, a. c. n° 13/1995, rendue dans une procédure ouverte notamment sur la demande du procureur général (visant à établir l’inconstitutionnalité de lois, y compris de dispositions d’une loi annuelle sur le budget de l’État) il est signalé que la recevabilité de la demande est évaluée « … en tenant compte de la légitimité subjective du demandeur ». Or, cette idée ne semble être développée dans le sens dans lequel nous l’examinons maintenant. Comme il est noté plus loin dans le texte, en principe la Cour se borne à constater qu’elle a été saisie par un sujet autorisé à le faire en vertu de l’art. 150 al. 1 de la Constitution. [Retour au contenu] -
[25]
En dehors des chiffres figurant au Tableau n° 1 et au Tableau 1 a, la Cour constitutionnelle a été saisie encore trois fois ; le premier cas est examiné ci-dessous, dans les deux autres les demandes ont été rejetées avec un autre motif (v. I-2.).) [Retour au contenu] -
[26]
Au moment où cet arrêt était rendu, en Bulgarie existait une Cour supérieure qui, aux termes de ce même arrêt, assumait les fonctions de la Cour suprême de cassation et de la Cour suprême administrative jusqu’à leur création, y compris le droit de saisir la Cour constitutionnelle. [Retour au contenu] -
[27]
Concernant, par exemple, le droit dont jouit le président de la République de présenter des demandes à la Cour constitutionnelle visant l’établissement de l’inconstitutionnalité d’une loi, l’exercice de ce pouvoir n’a jamais été lié au fait de savoir si le président avait, avant cela, exercé son droit de veto, à savoir son droit de renvoyer une loi à l’Assemblée nationale en vue d’une nouvelle délibération /art. 101, al. 1 de la Constitution/. [Retour au contenu] -
[28]
Arrêt n° 6 du 2 mars 1993, a. c. n° 7/1993 ; Arrêt n° 7 du 19 octobre 1993, a. c. n° 20/ 1993. [Retour au contenu] -
[29]
Il y a même un cas de participation d’une organisation, « Interights », dont le siège est à l’étranger (a.c. n° 16 /1998). [Retour au contenu] -
[30]
Arrêt du 26 septembre 1996, a. c. n° 20/1996. V. la note de bas de page n° 4. [Retour au contenu] -
[31]
Par l’arrêt n° 4 du 14 octobre 1999, a. c. n° 13/1999, la Cour a déclaré irrecevable une demande d’un conseil municipal relative à un litige de compétence avec les organes exécutifs centraux, en acceptant que la demande ne soulève pas en réalité un litige, mais dans la mesure où elle conteste la constitutionnalité d’une loi, celle-ci ne peut être examinée à la demande d’un conseil municipal. [Retour au contenu] -
[32]
Décision n° 21 du 14 novembre 1996, a. c. n° 19/1996. [Retour au contenu] -
[33]
Respectivement a. c. n° 35/1998 et a. c. n° 2/1999. [Retour au contenu] -
[34]
En général en ce qui concerne la question de formuler une nouvelle demande sur le même sujet, voir ci-dessous. [Retour au contenu] -
[35]
C’est l’unique hypothèse dans laquelle le contrôle a priori est exercé. [Retour au contenu] -
[36]
Dans des commentaires scientifiques sur les pouvoirs aux termes des p. 2 et 4 de l’art. 149 de la Constitution, le contrôle en constitutionnalité des actes de l’Assemblée nationale et du président est généralement examiné de manière globale, y compris sous la dénomination « Contrôle sur les normes exercé par la Cour constitutionnelle ». [Retour au contenu] -
[37]
Dans la théorie juridique cependant a été discutée la question de soumettre à un contrôle les décrets de grâce du président, ainsi que ceux concernant l’annulation des créances non recouvrables de l’État, la nomination et la destitution de leurs fonctions des fonctionnaires d’État. [Retour au contenu] -
[38]
Les motifs de l’arrêt laissent entendre qu’a été examinée aussi la question de savoir si dans les cas où la décision de l’Assemblée nationale n’a que des conséquences relevant du droit civil, elle serait susceptible d’un contrôle de constitutionnalité. Il est indiqué qu’une décision n’a pas été prise sur cette question de principe car elle était hors l’objet de l’affaire. [Retour au contenu] -
[39]
Du 27 juillet 1992, a. c. n° 19/1992 [Retour au contenu] -
[40]
Arrêt du 2 juillet 1992, a. c. n° 13/1992. [Retour au contenu] -
[41]
Arrêt du 1 avril 1993, a. c. n° 9/1993 (décret aux termes de l’art. 93, p. 13 de la Constitution concernant la dénomination d’une localité) ; Arrêt du 8 juillet 1999, a. c. n° 9/1999 (Décret conformément à l’art. 98, p. 6 de la Constitution concernant de la destitution de ses fonctions d’un représentant diplomatique) V. aussi note en bas de page n° 36. [Retour au contenu] -
[42]
Décision n° 11 du 20 octobre 1994, a. c. n° 16/1994. [Retour au contenu] -
[43]
Dans ses motifs la même décision contient aussi des réflexions concernant l’admissibilité du contrôle en constitutionnalité par rapport au « refus », celui-ci étant une expression de la compétence de l’organe législatif en matière de création de normes. À ce sujet il est souligné qu’une appréciation sur la constitutionnalité d’un tel acte serait inadmissible car il exprime la politique législative de l’État. [Retour au contenu] -
[44]
Dans les motifs de l’arrêt du 5 décembre 1991, a. c. n° 17/1991 susmentionné il est indiqué que la rédaction du texte de l’art. 149, al. 1, p. 2 de la Constitution permet d’accepter que « dans ce groupe sont classés tous les “autres” actes de l’Assemblée nationale, qui selon l’art. 86, al. 1 sont notamment les décisions, les déclarations et les appels adoptés par elle ». La Cour n’a pas poursuivi ces réflexions, s’étant limité à l’objet de l’affaire, à savoir une décision de l’Assemblée nationale. Il faut noter que la théorie juridique entend de cette façon aussi le sens de l’art. 149, al. 1, p. 2 : un acte non-juridique peut lui aussi être contraire à la Constitution, peut ne pas correspondre à ses principes, à son esprit général ; il est tout à fait possible qu’un appel ou un message contienne des éléments inconstitutionnels, qui pourraient déstabiliser le système politique et juridique. [Retour au contenu] -
[45]
Arrêt du 29 décembre 1991, a. c. n° 1/1991 ; Arrêt n° 5 du 4 juin 1992, a. c. n° 11/ 1992 [Retour au contenu] -
[46]
En ce qui concerne notamment les lois adoptées avant l’entrée en vigueur de la Constitution, mais à une autre occasion, la Cour, en interprétant la question de l’action directe de la Constitution (décision n° 10 du 6 octobre 1994, a. c. n° 4/1994) a décidé que chaque organe chargé de l’application du droit (organe judiciaire, administratif, etc.) peut décider d’appliquer directement la Constitution « pour le compte » d’une loi, adoptée avant l’entrée en vigueur de celle-ci, et qui lui est contraire. Dans la mesure où cette décision est rendue avant que la Cour constitutionnelle ne commence à recevoir, en vue de leur examen, des demandes dirigées contre des lois adoptées avant l’entrée en vigueur de la Constitution, se pose la question de savoir comment cette approche, admettant que les lois en question puissent être désavouées par tout tribunal ou organe administratif, correspond à la compétence, attribuée à la Cour constitutionnelle, de se prononcer sur la constitutionnalité de ces lois. [Retour au contenu] -
[47]
.Arrêt n° 3 du 14 juillet 1994, a. c. n° 7/1994. Sur une autre affaire, n° 13/1998, la Cour a déclaré la recevabilité en vue de son examen d’une demande dirigée contre une loi de confiscation de 1947, en acceptant que cette loi est toujours en vigueur (et non à effet immédiat, arrêt du 7 avril 1998). [Retour au contenu] -
[48]
V. I-1.1. ci-dessus et la note de bas de page n° 13. [Retour au contenu] -
[49]
députés, c’est-à-dire les membres de l’organe législatif. V. aussi ci-dessus les notes en bas de page n° 17. [Retour au contenu] -
[50]
Arrêt n° 8 du 21 novembre 1997, a. c. n° 5/1997. [Retour au contenu] -
[51]
N° 14 du 30 septembre 1999, a. c. n° 1/1999 [Retour au contenu] -
[52]
Arrêt n° 2 du 27 juillet 1995, a. c. n° 16/1995. Cet arrêt n’a pas été prononcé à l’unanimité par la Cour. Dans des opinions dissidentes, des membres de la Cour expriment la position que même les accords internationaux qui sont ratifiés sont susceptibles d’un contrôle en constitutionnalité, parce que l’accord international est un acte normatif, c’est-à-dire un acte qui contient des normes juridiques, qui est une source du droit, et la ratification n’existe pas « d’elle-même » car le contenu essentiel et matériel de la volonté exprimée en vue d’une ratification est toujours l’accord international que l’on ratifie. À ce sujet est soutenue aussi l’opinion selon laquelle la loi ratifiée pourrait être susceptible d’un contrôle en constitutionnalité en tant qu’un « autre acte de l’Assemblée nationale » au sens de l’art. 149, al. 1, p. 2 de la Constitution. Sur ce sujet v. art. 149 al. 1, p. 4 de la Constitution [Retour au contenu] -
[53]
Arrêt n° 2 du 14 avril 1994, a. c. n° 1.1994 [Retour au contenu] -
[54]
Décision n° 6 du 22 avril 1993, a. c. n° 4/1993 [Retour au contenu] -
[55]
Art. 21, al. 5 de la Loi sur la Cour constitutionnelle stipule : « Lorsque la Cour, par voie de décision ou d’arrêt, a conclu à l’irrecevabilité d’une demande, aucune autre demande ne peut être introduite pour le même motif ». [Retour au contenu] -
[56]
Arrêt n° 5 du 17 septembre 1996, a. c. n° 16/1996 [Retour au contenu] -
[57]
Arrêt n° 4 du 18 avril 1996, a. c. n° 6/1996. [Retour au contenu] -
[58]
Ces décisions n’étaient pas incontestables. Dans des opinions dissidentes des membres de la Cour ont contesté la compétence de la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la volonté du législateur de modifier ou d’abroger une loi ainsi que de déclarer le renouvellement de la validité de la loi précédente. [Retour au contenu] -
[59]
Arrêt du 26 juin 1997, a. c. n° 6/1997 ; Arrêt du 9 avril 1998, a. c. n° 12/1998. Au second arrêt sont jointes les opinions dissidentes de deux juges, qui soutenaient la thèse selon laquelle la Cour n’est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité de dispositions qui sont abrogées, dont l’effet est suspendu. [Retour au contenu] -
[60]
Arrêt n° 1 du 5 mars 1999, a. c. n° 20/1997. Dans cet arrêt est évoquée une question intéressante pour la jurisprudence de la Cour, celle de savoir si on peut soumettre à l’examen des demandes conformément à l’art. 149, al. 1, p. 4 de la Constitution, dans les cas où l’accord international n’est pas publié au J.O. Aux termes de l’art. 5, al. 4 de la Constitution la publication d’un accord au J.O. est l’une des conditions pour qu’il fasse partie du droit interne et pour qu’il ait la priorité sur les normes de la législation interne qui lui sont contraires. Aucune réponse n’a été donnée à cette question, ceci n’étant pas nécessaire pour les besoins de l’affaire. [Retour au contenu] -
[61]
V. I-1.1. ci-dessus. [Retour au contenu] -
[62]
La Cour a formulé expressément l’exigence d’un intérêt par rapport à l’interprétation de la Constitution en tant que condition de recevabilité des demandes par lesquelles elle est saisie pour exercer son pouvoir aux termes de l’art. 149, al. 1, p. 1 de la Constitution de donner des interprétations contraignantes de la Constitution). [Retour au contenu] -
[63]
Arrêt du 29 septembre 1992, a. c. n° 26/1992 [Retour au contenu] -
[64]
Arrêt du 13 juin 1995, a. c. n° 11/1995. [Retour au contenu] -
[65]
Par exemple, arrêt du 12 janvier 1993, a. c. n° 34/1992 ; arrêt du 5 février 1998, a. c. n° 20/ 1997. [Retour au contenu] -
[66]
Arrêt n° 2 du 9 février 1997, a. c. n° 34/1997 ; Arrêt n° 2 du 14 avril 1994, a. c. n° 1/ 1994. [Retour au contenu] -
[67]
Arrêt du 31 mars 1998, a. c. n° 11/1998. [Retour au contenu] -
[68]
Arrêt du 31 juillet 1997, a. c. n° 12/1997 ; Arrêt du 22 juin 1995, a. c. n° 13/1995. [Retour au contenu] -
[69]
Arrêt n° 3 du 12 mars 1996, a. c. n° 3/1996. [Retour au contenu] -
[70]
Voir l’arrêt n° 4 du 14 octobre 1999, a. c. n° 13/1999. Or, cet arrêt a été rendu au cours d’une procédure qui est hors l’objet du présent rapport, à savoir sur un litige de compétence entre un conseil municipal et des organes exécutifs centraux. [Retour au contenu] -
[71]
Arrêt n° 3 du 12 mars 1996, a. c. n° 3/1996. [Retour au contenu] -
[72]
C’est hypothétique et en ce sens ce chiffre est extrêmement exagéré, car il y a des demandes qui ont été déclarées seulement partiellement irrecevables mentionnées ci-dessus montrent que les demandes déclarées irrecevable [Retour au contenu] -
[73]
Exemple le plus récent v. arrêt du 5 février 1998, a. c. n° 20/1997. [Retour au contenu] -
[74]
Arrêt n° 3 du 12 mars 1996, a. c. n° 3/1996. [Retour au contenu] -
[75]
Arrêt du 8 mars 1995, a. c. n° 1/1995 [Retour au contenu]
Rapport de la cour suprême du Burkina Faso
Août 2000
Introduction
La Constitution du 2 juin 1991 en son article 152, consacre le contrôle de constitutionnalité au Burkina Faso. Ce contrôle est confié à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette haute juridiction sont régis par l’Ordonnance n° 91 0051PRES du 26 août 1991. L’arrêté n° 93 – 002/CS/SG du 20 novembre 1992 portant Règlement intérieur de la Cour suprême complète en certains points les dispositions de ladite Ordonnance.
I. L’ouverture du droit de saisine
I – 1. – Les requérants
La Chambre constitutionnelle, conformément à la Constitution est saisie par :
- le président du Faso ;
- le Premier ministre ;
- le président de l’Assemblée nationale ;
- le président de la Chambre des représentants ;
- un cinquième (1/5) au moins des membres de l’Assemblée nationale.
I – 1.1. – Tableau quantitatif des saisines :

I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Aucune évolution des conditions d’ouverture n’est intervenue.
I – 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Aucune possibilité d’auto-saisine n’est offerte à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême.
I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Les dispositions de la Loi ne prévoient pas cette éventualité et la Cour elle-même n’a pas encore connu une telle sollicitation.
I – 2. – Actes contrôlés
La Chambre constitutionnelle assure le contrôle de la constitutionnalité des lois organiques, des lois ordinaires et des règlements des deux Assemblées parlementaires (Assemblée nationale et Chambre des représentants) ; elle statue sur les contestations relatives au caractère législatif des propositions et amendements soumis à l’Assemblée nationale et sur la constitutionnalité des clauses insérées dans les engagements internationaux. Elle se prononce également sur les projets d’ordonnances pris en vertu des lois d’habilitation par le gouvernement.
I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé :

I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Ni les dispositions constitutionnelles ou légales, ni la jurisprudence de la Cour ne définissent de normes ou d’actes hors contrôle.
I – 2.3. – À L’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Une question similaire ne s’est pas encore posée devant la Cour.
I – 3. – Délais
I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Les recours relatifs à la nature législative ou réglementaire d’une disposition sont recevables sans délai.
I – 3.2. – Tableau des conditions de délai :

I – 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ? Aucun changement n’est intervenu en la matière.
I – 3.4. – Sont ils l’objet de critiques, pour quelles raison ? La question ne fait pas encore l’objet de débats, en raison sans doute de ce que les requérants possibles sont limités en nombre et qualité.
II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Aucun droit de timbre n’est acquitté par le requérant.
II – 1.2. – La représentation du requérant doit elle se faire ministère d’avocat ?
La procédure devant la chambre constitutionnelle n’étant pas contradictoire et les séances n’étant pas publiques, la représentation du requérant n’est pas admise (art. 34 et 35 de l’ordonnance n° 91 – 0051/ PRES du 26 août 1991).
II – 2. – Conditions relatives au recours
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les requêtes sont enregistrées et numérotées selon un ordre chronologique sur un registre tenu à cet effet par le greffier en chef.
II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date de dépôt de la requête (contre récépissé) est celle prise en compte pour la suite des procédures.
II – 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Le recours doit être présenté sous forme d’une requête écrite sur papier libre, signé par le ou les requérants, contenir l’exposé des moyens invoqués et être accompagnée de deux (2) copies des textes attaqués.
II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ? Ces conditions n’ont connu aucune évolution
II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
118 Aucune procédure n’est prévue à cet effet.
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II – 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
La chambre constitutionnelle statue en formation plénière et à la majorité des voix sur la recevabilité du recours.
II – 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est elle susceptible de recours ?
Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours.
II – 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
La chambre statue en formation plénière après avoir entendu le rapport du conseiller désigné par le président de la cour suprême qui préside la chambre constitutionnelle.
II – 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit elle être motivée, prononcée, publiée ?
Toutes les décisions de la chambre constitutionnelle sont motivées, prononcées en audience publique et publiées au Journal officiel.
II – 3.5. – Les requérants abusifs sont ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Aucune amende n’est encourue pour un éventuel abus du droit d’agir.
II – 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évoluée ?
Cette procédure n’a pas connu d’évolution.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III – 1. – Principe du contradictoire
III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Lorsque le recours est exercé par le président du Faso ou par le Premier ministre, le greffier en chef de la Cour en donne avis sans délai au président de l’Assemblée nationale. Lorsque ce recours est exercé par le président de l’Assemblée nationale, le président de la Chambre des représentants, ou un nombre de députés égal au cinquième (1/5) au moins des membres de l’Assemblée nationale et par le Premier ministre, le greffier en chef de la Cour en donne avis sans délai au président du Faso.
III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
Les séances de la Chambre constitutionnelle ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à être entendus (art. 35 de l’Ordonnance n° 91 – 0051/PRES). Les parties n’ont en aucun moment accès au prétoire.
III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement, contradictoire ?
L’art. 34 de l’ordonnance précitée dispose que la procédure n’est pas contradictoire.
III – 2. – Égalité des armes
III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ?
Certaines pièces sont elles exclues de la procédure ? Les pièces constitutives de la procédure comprennent :
- la requête signée par le ou les requérants et contenant l’exposé des moyens invoqués ; 120
- deux copies des textes attaqués.
Cependant, tout autre document produit après le dépôt de la requête n’a pour la chambre constitutionnelle qu’une valeur de simple renseignement (art. 34 de l’ordonnance précitée).
III – 2.2. – Toutes les pièces sont elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Hormis les formalités à accomplir une fois que la cour se juge valablement saisie (II) aucune autre communication ou transmission de pièces n’est effectuée.
III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Conformément à l’art. 34 de l’ordonnance précitée, le rapporteur désigné par le président procède à toutes mesures d’instructions utiles prescrites par la Chambre et ce dans des délais fixés par elle.
III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés par le juge ?
L’article 35 de l’Ordonnance portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour suprême prévoit que « … si la Chambre constitutionnelle relève dans la loi attaquée une violation de la Constitution qui n’a pas été invoquée, elle doit la soulever d’office ». Aucune procédure n’est aménagée dans le sens de permettre aux requérants de se prononcer sur les griefs soulevés d’office.
III – 3. – Délai de jugement
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Lorsque la Chambre est saisie d’un recours tendant à faire constater l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un engagement international, elle doit se prononcer dans le délai de 15 jours à compter du dépôt du recours.
Le délai est d’un mois (réduit à huit jours quand le gouvernement déclare l’urgence) en matière de saisine obligatoire lorsque la Chambre doit se prononcer sur la conformité avec la constitution de la loi à laquelle est conféré le caractère organique et des règlements des Assemblées.
Les décisions sont rendues dans les délais.
III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
La clôture de l’instruction intervient sans autre formalité que par le dépôt de la note du rapporteur auprès du président de la Chambre.
Conclusion
L’accès au juge constitutionnel connaîtra dans les mois, voire les semaines à venir, une sensible évolution en raison de la récente adoption par l’Assemblée nationale d’une Loi organique instituant un Conseil constitutionnel. Cette loi non encore promulguée prévoit entre autres, la saisine par des personnes physiques ou morales de cette juridiction par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction.
Rapport de la cour constitutionnelle du Burundi
Mars 2000
Conformément à la Constitution du Burundi (l’Acte constitutionnel de Transition) et à la Loi organique sur la Cour constitutionnelle (Décret-Loi n° 001 du 15 juin 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle), la justice constitutionnelle est bien ouverte aux justiciables. Le modèle burundais admet une grande ouverture de la saisine du juge tant pour le contrôle de constitutionnalité que pour les autres compétences.
I. Le contrôle de constitutionnalité
En matière de contrôle de constitutionnalité, le modèle burundais prévoit la saisine par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, un quart des parlementaires, le Ministère Public, des particuliers.
Le président de la République saisit le juge constitutionnel pour le contrôle obligatoire des lois organiques (art. 145 de l’Acte constitutionnel de Transition, article 15 du Décret-Loi n° 001 du 15 juin 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle), mais aussi pour le contrôle (facultatif) des lois ordinaires, des actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi (art. 144 de l’Acte constitutionnel de Transition) et des engagements internationaux (art. 168 de l’Acte constitutionnel de Transition).
Le président de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour le contrôle obligatoire du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale (art. 145 de l’Acte constitutionnel de Transition, article 15 du Décret-Loi n° 001 du 15 juin 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle), mais aussi pour le contrôle facultatif des lois ordinaires, des actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi (art. 144 de l’Acte constitutionnel de Transition) et des engagements internationaux (art. 168 de l’Acte constitutionnel de Transition).
Le quart des parlementaires peut saisir le juge constitutionnel pour le contrôle des lois ordinaires et des actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi (art. 144 de l’Acte constitutionnel de Transition) mais aussi des engagements internationaux (art. 168 de l’Acte constitutionnel de Transition).
Le Ministère public et les particuliers (personne physique ou morale intéressée) peuvent saisir le juge constitutionnel pour le contrôle des lois ordinaires (art. 147 de l’Acte constitutionnel de Transition). Ils peuvent le faire soit directement par voie d’action, soit indirectement par la procédure d’exception.
II. Les autres compétences
Le juge constitutionnel peut aussi être saisi pour d’autres compétences. Mais ici, c’est le domaine réservé à la classe politique à savoir le président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le Premier vice-président ou le Deuxième vice-président de la République, un quart des parlementaires et le ministre de l’Intérieur.
Le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le quart des parlementaires peuvent saisir le juge constitutionnel pour l’interprétation de la constitution (art. 144 de l’Acte constitutionnel de Transition). Le président de la République doit consulter la Cour constitutionnelle avant la proclamation de l’état d’urgence (art. 76 de l’Acte constitutionnel de Transition). Le président de l’Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle en vue de constater le cas de force majeure empêchant l’Assemblée nationale de tenir ses délibérations au lieu ordinaire de ses sessions (art. 116 de l’Acte constitutionnel de Transition).
Le Premier vice-président ou en son absence le Deuxième vice-président de la République saisit la Cour constitutionnelle en vue de constater la vacance du poste de président de la République (art. 81 et 144 de l’Acte constitutionnel de Transition).
Le ministre de l’Intérieur saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle en vue de statuer sur la régularité de la procédure de désignation des membres de l’Assemblée nationale (art. 144 de l’Acte constitutionnel de Transition).
Enfin, c’est la Cour constitutionnelle qui reçoit le serment du président de la République et des vice-présidents (art. 66 et 144 de l’Acte constitutionnel de Transition).
III. Modalités et procédures
- La procédure devant la Cour constitutionnelle est toujours gratuite. Elle a un caractère écrit et oral.
- La saisine de la Cour constitutionnelle se fait par une simple lettre. L’autorité qui saisit la Cour en avise immédiatement les autres autorités ayant qualité pour saisir la Cour constitutionnelle. Si la Cour est saisie par un particulier ou le Ministère Public par voie d’action, ils doivent aussi informer les autorités susvisées. Le quart des parlementaires adresse à la Cour une lettre collective.
- Le contrôle de constitutionnalité se fait a priori, c’est-à-dire avant la promulgation des lois, avant la mise en application du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, des actes réglementaires et des engagements internationaux. Il se fait a posteriori, c’est-à-dire après la promulgation, pour les lois ordinaires si la Cour est saisie par le Ministère Public ou un particulier. Si le Ministère Public ou un particulier soulèvent l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi invoquée par une partie et applicable au litige dont une juridiction est saisie, celle-ci sursoit à statuer et saisit immédiatement la Cour constitutionnelle.
- La Cour constitutionnelle statue dans un délai de 30 jours sauf si il y a urgence, auquel cas ce délai est ramené à 15 jours.
- Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la majorité des voix, étant entendu que le siège est composé en nombre impair.
Rapport du conseil constitutionnel du Cambodge
Mars 2000
Le Conseil constitutionnel est institué par la Constitution de 1993 et mis en place effectivement depuis le 15 juin 1998, date de l’élection de son premier président par ses pairs.
Le Conseil constitutionnel est chargé d’assurer le respect de la Constitution, d’interpréter la Constitution et les lois adoptées par le Parlement.
Il est compétent pour examiner et décider sur la régularité des élections des députés et des sénateurs.
En matière de contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel est plutôt un organe régulateur interne « au jeu des pouvoirs » et non une véritable juridiction. Il exerce un contrôle objectif et limité aux problèmes de constitutionnalité. Les autres aspects du contrôle de la légalité relèvent de la compétence des tribunaux et des cours de la hiérarchie judiciaire.
I. L’ouverture du droit de saisine
Le droit de saisine est ouvert aux personnalités définies par la Constitution et la Loi organique sur le Conseil constitutionnel, aux personnes indiquées par la loi sur les partis politiques et aux personnes et organes définis par les lois sur les élections législatives.
Conformément aux instructions de l’ACCPUF nous ne relevons que les requérants définis par la Constitution et la Loi organique sur le Conseil constitutionnel.
I – 1. – Les requérants
I – 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant

I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Il n’y a pas de modification dans le temps.
I – 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
En principe le Conseil ne dispose pas d’auto-saisine.
I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
En principe oui, mais le cas ne s’est pas présenté.
- 12 députés demandent l’examen de la constitutionnalité de toutes les lois et décisions adoptées et prises jusqu’au mois d’août 1998. L’objet de la requête étant trop vaste, le Conseil Constitutionnel demande à ces députés de lui apporter les précisions sur les points considérés comme inconstitutionnels.
- Applicable seulement au cas où il y a une question préjudicielle. (a – f) Contrôle a priori et a posteriori.
I – 2. – Actes contrôlés
I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé
Les actes contrôlés par le Conseil constitutionnel à ce jour sont :

I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Nous n’avons pas encore de texte ou de jurisprudence concernant les normes et les actes hors contrôle. Dans la pratique, la Constitution et les actes de gouvernement ne sont pas contrôlables par le Conseil constitutionnel.
I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifié ?
Ne disposant pas d’auto-saisine, le Conseil constitutionnel ne peut examiner une loi autre que celle qui fait l’objet du recours.
I – 3. – Les délais
I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
En principe les recours sont recevables sans délai excepté ceux qui sont contre les lois organiques. Pour les lois organiques le recours doit être formé avant leur promulgation.
I – 3.2. – Tableau des conditions de délais

II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
La saisine n’a pas de conditions spéciales en raison de la qualité des personnalités énumérées dans la Constitution.
II – 2. – Conditions relatives au recours
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les requêtes sont numérotées dans le registre des affaires à examiner.
II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
C’est la date de réception qui fait foi pour la suite des procédures.
II – 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Conditions formelles
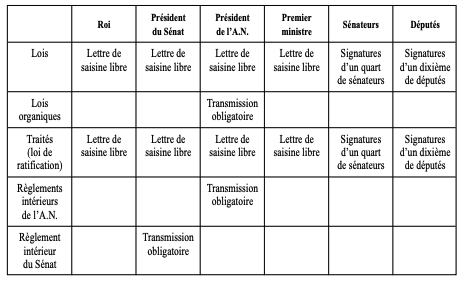
Conditions matérielles

II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Ces conditions n’ont pas évolué depuis le fonctionnement du Conseil constitutionnel.
II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Jusqu’à présent, il n’y a pas encore de procédure de régularisation de la requête.
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
Le Conseil constitutionnel statue en formation plénière sur la recevabilité des recours. Cette décision est motivée, publiée et notifiée au(x) requérant(s).
Cette procédure est encore en vigueur.
II – 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Jusqu’à présent le Conseil constitutionnel a rejeté pour manque d’identification de la norme contrôlée et pour incompétence de l’auteur de la saisine dont voici le tableau de synthèse :

III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III – 1. – Principe du contradictoire
N’étant pas une véritable en Cour en matière de contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel n’est pas soumis à la procédure du contradictoire.
III – 2. – Égalité des armes
S’agissant du contrôle des actes, la procédure en vigueur n’a pas prévu la présence des parties.
Donc il n’y a pas de problème de l’égalité des armes. Toutefois, le Conseil constitutionnel dispose de moyens propres d’investigation qui peuvent être de toute nature (document, investigation sur la personne et sur les lieux). Ne pouvant pas en principe se saisir d’office, le Conseil constitutionnel n’est pas habilité à soulever les moyens et dispositions non contestés 136 dans la requête.
III – 3. – Délai de jugement
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
En matière de contrôle de constitutionnalité des lois : le Conseil constitutionnel est tenu de rendre sa décision dans un délai de 30 jours sur toute affaire qui lui a été soumise. En cas d’urgence ce délai est ramené à 8 jours. Ces délais sont toujours bien respectés.
III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
Il n’y a pas de procédure formelle de clôture de l’instruction.
Rapport de la cour suprême du Cameroun
Septembre 2000
Introduction
L’accès au juge constitutionnel peut être considéré comme un indicateur de performance de l’État de droit et de démocratie dans un État.
C’est cet accès qui assure la mise en œuvre effective de la protection des droits fondamentaux affirmés dans les constitutions, le fonctionnement équilibré des institutions de l’État et la régulation de la vie politique.
La contestation d’ordre politique par la reconnaissance du multipartisme, de la concurrence électorale, a été suivie par la contestation sur les normes. Ainsi, par l’institutionnalisation du contrôle des normes, les majorités au pouvoir acceptent que soient contestées, discutées, voire annulées les expressions législatives de leur volonté politique.
Le Cameroun a adopté en 1996 les mécanismes juridictionnels de contrôle de la constitutionnalité des lois en s’inspirant du modèle français. Mais en raison de la situation économique défavorable, ces mécanismes demeurent à ce jour un habillage constitutionnel.
Bien qu’encore sur papier, le modèle camerounais de contrôle de la constitutionnalité des lois présente, quant à l’accès au juge, les caractéristiques suivantes : Seules les autorités publiques ont accès au juge constitutionnel ; le contrôle est de type préventif et facultatif, sauf en ce qui concerne les Règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat dont le contrôle est obligatoire avant leur mise en application ; la constitution a renvoyé aux lois le statut des membres du Conseil constitutionnel, l’organisation et le fonctionnement, les modalités de saisines, ainsi que la procédure. Ces lois sont encore attendues, les nouvelles institutions de la République prévues par la constitution étant, aux termes de son article 67, progressivement mises en place.
Cette solution de mise en œuvre progressive de la constitution peut trouver son fondement dans la situation économique morose. En attendant cette mise en place du Conseil constitutionnel, la cour suprême exerce ses attributions [1].
La saisine et la procédure à suivre, en attendant les lois annoncées dans la constitution, sont prévues par l’ordonnance 72/6 du 26 août 1972 sans l’organisation de la cour suprême et la Loi n° 75/16 du 8 décembre 1975, fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême.
I. L’ouverture du droit de saisine
I – 1. – Les requérants
I – 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
La saisine du Conseil constitutionnel, aux termes de l’article 47 de la constitution, est réservée aux autorités politiques ci-après :
- le président de la République ;
- le président du Sénat ;
- un tiers des députés ;
- un tiers de sénateurs ;
- les présidents des exécutifs régionaux. La saisine est ouverte parallèlement à chacune de ces autorités pour tous les actes susceptibles d’être déférés au Conseil constitutionnel, sauf en ce qui concerne les présidents des exécutifs régionaux dont la saisine est limitée à la défense des intérêts de leurs régions.
Il est à noter que la Cour suprême, statuant comme Conseil constitutionnel, n’a été à ce jour saisie que d’un seul cas émanant d’un tiers des députés demandant à la haute juridiction de décider qu’une proposition de loi soit inscrite à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale.
La constitution n’a pas ouvert le droit à la saisine du Conseil constitutionnel aux particuliers.
I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évoluées dans le temps ?
Oui, à la faveur de la modification de la constitution du 2 juin 1972. Aux termes de l’article 10 de cette constitution, le président de la République avait seule qualité pour saisir la Cour suprême en contrôle de constitutionnalité des lois.
La faculté de saisir la Cour suprême était partagée par le président de l’Assemblée nationale en ce qui concerne le contentieux de la recevabilité d’un texte.
La constitution du 18 janvier 1996 a étendu le nombre de requérants tel que visé ci-haut.
I – 1.3. – La Cour elle même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Non, aucun texte ne prévoit la possibilité d’auto-saisine du Conseil constitutionnel.
I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Les textes spécifiques organisant la procédure devant le Conseil constitutionnel ne sont pas encore élaborés. Cependant la procédure actuellement en vigueur devant la Cour suprême permet à tout requérant de se désister de sa saisine (art. 28 de la Loi n° 75/16/1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême).
Le requérant peut se désister à tout moment tant que la procédure est pendante devant le Conseil constitutionnel. Une seule simple lettre de désistement est suffisante en dehors de toute autre démarche. Ce désistement peut être partiel.
I – 2. – Actes contrôlés
I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé

I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Tout ce qui n’entre pas dans les compétences définies limitativement par l’article 47 de la constitution peut être considéré a contrario, comme placé hors contrôle ; il en est ainsi de la Constitution elle-même, du contrôle des libertés publiques et individuelles prévues dans le préambule de la Constitution, des actes de gouvernement.
I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi que celle, par exemple, qui fait l’objet, du recours modifie ?
Aucune disposition légale ne prévoit cette possibilité et la question n’a pas encore été posée à la Cour suprême.
I – 3. – Les délais
I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Non, la saisine du Conseil constitutionnel doit être faite avant la promulgation des lois ou avant la mise en application des règlements des assemblées.
I – 3.2. – Tableau des conditions de délai

I – 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Aucun changement n’est intervenu en la matière.
I – 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
La question n’a pas fait l’objet de débats.
II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Non. Le Code de l’enregistrement, du timbre et de la curatelle dispense, 144 d’une façon générale, les autorités publiques du paiement du droit de timbre.
II – 1.2. – La représentation du requérant par ministère d’avocat, ou par une autre personne est-elle possible ?
Oui. Elle est possible. Le chef de l’institution a également la possibilité de désigner un représentant de l’autorité publique requérante. Cette autre personne peut être un fonctionnaire, et dans le cas de saisine par les assemblées un député ou un sénateur.
II – 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Dans le contrôle normatif, cette condition n’est pas nécessaire. Il suffit d’avoir la qualité pour agir.
II – 2. – Conditions relatives au recours
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Soit la date d’enregistrement, soit la date d’envoi, le cachet de la poste faisant foi.
II – 2.3. – Quels sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Le recours doit être présenté soit par requête, soit par lettre ou par déclaration faite au secrétariat du Conseil.
Le recours peut être écrit ou oral. Lorsqu’il est écrit, il est rédigé sur papier libre signé par le ou les requérants.
La norme ou l’acte contesté doit toujours être produit. La question de savoir si des moyens nouveaux peuvent être soulevés en cours de procédure n’a pas encore été soulevée.
II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Non. Aucune révision constitutionnelle n’a eu lieu depuis la constitution du 18 janvier 1996.
II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Une telle situation ne s’est pas encore présentée.
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
La procédure suivie devant le Conseil constitutionnel est fixée par la loi (art. 52 de la Constitution). Cette loi n’est pas encore intervenue. La procédure en vigueur est celle applicable devant la Cour suprême.
II – 3.1. – La décision qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
La décision n’est pas susceptible de recours.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III – 1. – Principe du contradictoire
III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Chaque fois que la requête met en cause en plus de la norme, une autre partie, cette dernière est appelée à présenter ses moyens et observations.
III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions (oralement) les parties ont-elles accès au prétoire ?
Les moyens doivent être présentés par écrit ; les parties ne comparaissent pas elles mêmes ; cependant, leurs avocats ou représentants peuvent présenter oralement des observations à la suite de la lecture du rapport.
III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement, contradictoire ?
Le procès peut être définit comme partiellement contradictoire dans la mesure où la contestation peut porter uniquement sur la norme sans mettre en présence plus d’une partie.
III – 2. – Égalité des armes
III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
La procédure est constituée essentiellement de l’acte de saisine et de l’acte attaqué, des mémoires de la ou des parties le cas échéant, du rapport, des conclusions du procureur général.
En principe, aucune pièce n’est exclue d’office de la procédure.
III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ ou accessibles aux parties ?
Les doubles des pièces des dossiers sont, le cas échéant, l’objet de communication aux différentes parties.
III – 2.3. – Le juge constitutionnel, dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
La procédure actuellement suivie ne donne pas à la Cour suprême d’autres moyens propres d’instructions à l’exception de la communication des mémoires aux parties, s’il y a lieu.
III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-il la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
L’opportunité d’une saisine d’office ne s’est pas encore présentée devant la Cour suprême statuant en matière constitutionnelle.
III – 3. – Délai de jugement
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ? Si oui, lequel ?
Dans tous les cas de saisine, le Conseil constitutionnel statue dans un délai de 15 jours. Toutefois, à la demande du président de la République, ce délai peut être ramené à 8 jours (art. 49 de la Constitution).
III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction. Si oui, laquelle ?
Aucune disposition légale ne prévoit la clôture formelle de l’instruction.
III – 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen (par type de contrôle) que prend la Cour pour statuer ?
Le texte a prévu des délais, mais le délai moyen est difficilement déterminable en l’état, en l’absence de décisions rendues.
Conclusion
L’accès au juge constitutionnel, bien qu’ouvert à plusieurs autorités publiques, reste pour le moment peu ou pas du tout utilisé. La saisine, même lorsqu’elle est obligatoire (cas du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale) n’est pas observée. Aucune réforme pouvant permettre une plus grande ouverture du droit de saisine du juge constitutionnel n’est envisagée pour le moment.
-
[1]
Note du Secrétariat général de l’ACCPUF : Pour cette raison, le rapport ci-après reproduit fait allusion aux deux institutions. [Retour au contenu]
Rapport de la cour suprême du Canada
Mars 2000
Introduction
La Cour suprême du Canada est la juridiction de dernière instance en matière civile et pénale pour l’ensemble du Canada. Elle est une cour générale d’appel. Dans la très grande majorité des cas, les pourvois qui y sont entendus ont auparavant fait l’objet d’une décision d’une cour supérieure, puis d’une cour d’appel. Étant l’ultime instance générale d’appel, la Cour suprême est la dernière voie de recours judiciaire ouverte aux plaideurs, qu’il s’agisse de particuliers ou de gouvernements.
La plupart des questions constitutionnelles qui sont soulevées au Canada ont trait à la Charte canadienne des droits et libertés [1] ou au partage des compétences législatives entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales [2]. L’inconstitutionnalité d’un acte gouvernemental ou d’une loi peut être soulevée lors d’un litige civil ou criminel par la partie affectée défavorablement par l’acte ou la loi, de même que devant un tribunal administratif qui a le pouvoir d’examiner toute loi pertinente [3] . Elle peut également être soulevée par requête pour jugement déclaratoire dans une cour supérieure provinciale.
Les décisions constitutionnelles des tribunaux administratifs sont susceptibles de contrôle judiciaire et ne bénéficient pas de la déférence judiciaire qui est accordée aux décisions qui relèvent de leur expertise [4]. De plus, il est habituellement possible d’en appeler des décisions des cours de première instance sur des questions constitutionnelles à une cour d’appel. La Cour suprême n’est généralement saisie de questions de constitutionnalité qu’à titre de second niveau d’appel. Toutefois, la Cour suprême peut être directement saisie d’une question constitutionnelle par la voie d’un renvoi par le gouverneur en conseil (le processus du renvoi est décrit plus loin dans ce rapport).
À titre indicatif, nous incluons le tableau suivant qui indique, pour les onze dernières années, le nombre d’appels entendus par la Cour dans les domaines suivants : Charte (en matière civile) ; Charte (en matière criminelle) ; et Constitutionnel (question de partage des compétences la plupart du temps).

En 1999, 12 pour cent des appels entendus par la Cour étaient des affaires civiles ou criminelles qui soulevaient principalement des questions relatives à la Charte, et 4 pour cent soulevaient d’autres questions constitutionnelles.
En 1998, ces pourcentages étaient respectivement 21 % et 3 %. En 1997, ils étaient de 10 % et 5 %.
La Cour suprême est principalement régie par la Loi sur la Cour suprême [5] et les Règles de la Cour suprême du Canada [6]. Nous ferons donc référence aux dispositions de la Loi et des Règles à plusieurs reprises dans ce rapport. Nous avons tenté de suivre autant que possible l’ordre des questions proposé et de répondre à toutes les questions qui sont pertinentes dans le contexte canadien.
I. L’ouverture du droit de saisine
I – 1. – Les requérants
Les cours canadiennes ne disposent pas d’une possibilité d’auto-saisine. Elles peuvent être saisies d’une question constitutionnelle de trois façons :
- lors d’un litige criminel ou civil ;
- lors d’une requête pour jugement déclaratoire ; et
- lors d’un renvoi. Dans chacun de ces cas, le requérant doit avoir qualité pour agir ou pour contester la constitutionnalité d’une loi ou d’un acte gouvernemental.
Qualité pour agir :
La qualité pour agir est fonction de l’intérêt suffisant dans l’issue de l’affaire pour recourir au processus judiciaire 7[7] . La règle générale est que la personne dont les droits garantis par la Constitution sont violés a qualité de plein droit pour contester l’atteinte portée par l’État, dans une action intenté par elle ou contre elle 8[8].
Litige criminel ou civil
Dans une action civile fondée sur une mesure législative ou gouvernementale, le défendeur a normalement le droit de contester la constitutionnalité de cette mesure 9[9].
La même règle s’applique dans un litige criminel, mais avec encore plus de souplesse. Dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd. 10[10], la Cour suprême du Canada a statué que tout défendeur pouvait opposer comme moyen de défense à une accusation criminelle un défaut de la loi sur le plan constitutionnel, même s’il n’y avait pas eu atteinte à ses propres droits. Le juge Dickson a formulé ainsi le principe applicable 11[11]
L’article 52 énonce le principe fondamental du droit constitutionnel, savoir la suprématie de la Constitution. De ce principe il découle indubitablement que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à une loi inconstitutionnelle.
Par conséquent, tout accusé peut contester une accusation criminelle en faisant valoir que la loi en vertu de laquelle l’accusation est portée est inconstitutionnelle.
Dans l’affaire Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson [12], la Cour suprême du Canada a élargi cette exception afin de permettre aux défendeurs d’invoquer la Charte dans des poursuites civiles intentées par l’État ou un organisme de l’État conformément à un régime de réglementation. La Cour a décidé d’élargir cette exception afin de protéger les personnes qui cherchent à se défendre contre une règle de droit qu’on veut leur appliquer contre leur gré et qui portera directement atteinte à leur intérêt « privé ».
Requête pour jugement déclaratoire
Il est plus difficile d’établir la qualité pour agir d’une partie dans une requête pour jugement déclaratoire que dans des poursuites pénales, car celle-ci comparaît alors volontairement devant la cour. La question de la qualité pour agir se pose surtout lorsqu’une loi d’application générale est contestée ou lorsque le requérant invoque non pas la violation de ses propres droits, mais la violation des droits d’autrui.
Selon la règle énoncée en 1924 par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Smith c. P.G. Ontario [13] (la règle du « préjudice exceptionnel »), un demandeur devait, pour contester une loi d’application générale, établir que cette loi avait sur lui un effet plus grand ou autre que celui qu’elle avait sur le grand public. Les règles relatives à la qualité pour agir dans l’intérêt public ont été considérablement assouplies dans une trilogie d’arrêts [14], puis synthétisées récemment dans l’arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [15].
Pour que les tribunaux canadiens puissent exercer leur pouvoir discrétionnaire de reconnaître la qualité pour agir dans une affaire civile où la partie prétend qu’il y a eu non pas violation de ses propres droits en vertu de la Charte, mais violation des droits d’autrui :
- – il doit se poser une question sérieuse quant à la validité de la loi ;
- – la partie doit être directement touchée par la loi ou avoir un intérêt véritable dans sa validité ; et (3) il ne doit y avoir aucune autre manière raisonnable et efficace de soumettre aux tribunaux la question de la validité de la loi [16].
On dira qu’une partie a qualité pour agir dans l’intérêt public si ces trois éléments sont établis.
Dans l’arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) 17[17], la Cour suprême du Canada a fait remarquer que la reconnaissance grandissante de l’importance des droits publics dans notre société venait confirmer la nécessité d’élargir la reconnaissance du droit à la qualité pour agir par rapport à la tradition de droit privé qui ne reconnaissait la qualité pour agir qu’aux personnes subissant une atteinte à un intérêt privé. De plus, la Cour a expliqué quel était l’impact de l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés sur la question de la qualité pour agir 18[18] :
Le texte même de la Charte indique qu’il faut interpréter d’une façon souple et libérale la question de la qualité pour agir. Sinon, on ne pourrait assurer le respect des droits garantis par la Charte et on entraverait l’exercice des libertés prévues par la Charte.
La Cour a souligné que la reconnaissance de la qualité pour agir a pour objet d’empêcher que la loi ou les actes publics soient à l’abri des contestations et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire de reconnaître qualité pour agir dans l’intérêt public lorsque, selon une prépondérance des probabilités, on pouvait établir qu’un particulier contesterait la mesure 19[19].
Malgré toutes ces règles relatives à la question de la qualité pour agir, la Cour suprême du Canada peut toujours choisir d’entendre des arguments fondés sur la Charte qui sont présentés par des parties qui, normalement, n’auraient pas eu qualité pour invoquer la Charte, lorsqu’une affaire a été pleinement débattue au fond et si la question en cause est d’importance pour le public. La Cour conserve donc le pouvoir discrétionnaire de rendre jugement sur le fond même si le demandeur n’a pas qualité pour agir 20[20].
Renvoi
Par le gouverneur en conseil
En vertu de l’art. 53(1) de la Loi, le gouverneur en conseil peut soumettre au jugement de la Cour suprême toute question importante de droit ou de fait touchant :
a) l’interprétation des Lois constitutionnelles ;
b) la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatif fédéral ou provincial ;
c) la compétence d’appel en matière d’enseignement dévolue au gouverneur en conseil par la Loi constitutionnelle de 1867 ou une autre loi ; ou
d) les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur.
Les questions touchant ces matières sont d’office réputées être importantes quand elles sont ainsi déférées à la Cour par le gouverneur en conseil [21]. L’art. 53(4) précise que la Cour est tenue d’étudier tout renvoi fait aux termes de l’article 53 et de répondre à chaque question qui lui est ainsi déférée.
Depuis 1990, la Cour suprême a entendu cinq renvois par le gouverneur en conseil. L’exemple le plus récent d’une affaire où le gouverneur en conseil a soumis des questions à la Cour suprême du Canada est le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, entendu en février 1998.
Par le Sénat ou la Chambre des communes
Le Sénat et la Chambre des communes peuvent également soumettre des questions à la Cour suprême du Canada. L’article 54 de la Loi prévoit :
La Cour, composée d’au moins deux juges, examine, pour rapport, les projets de loi d’intérêt privé, ou les pétitions visant à leur adoption, présentés au Sénat ou à la Chambre des communes qui lui sont déférés en vertu des règlements de l’une ou l’autre chambre.
Ce recours est, à toutes fins pratiques, tombé en désuétude.
Par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province
En outre, en vertu de l’article 36 de la Loi, il peut être interjeté appel devant la Cour suprême du Canada d’un avis prononcé par le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province sur toute question déférée à ce tribunal par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province quand, aux termes de la législation provinciale, l’avis en cause est assimilé à un jugement ayant autorité de chose jugée mais susceptible d’appel au même titre qu’un jugement rendu dans une action.
Depuis 1990, quinze appels du lieutenant-gouverneur en conseil ont été entendus par la Cour suprême. Le plus récent est le Renvoi relatif au Firearms Act, L.C. 1995, c. 39, entendu les 21 et 22 février 2000.
I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
En vertu de l’art. 25(1) des Règles, un demandeur peut se désister d’une demande d’autorisation d’appel par signification d’un avis de désistement aux autres parties et dépôt de l’avis auprès du registraire.
De même, l’appelant peut se désister de son appel en signifiant un avis de désistement à l’intimé, aux autres parties à l’appel et au registraire de la Cour de juridiction inférieure, et en déposant l’avis auprès du registraire de la Cour suprême du Canada [22].
I – 2. – Actes contrôlés
I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé
I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Toute « règle de droit » est susceptible d’être contrôlée. Le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit :
52. (1) La Constitution du Canada est la Loi suprême du Canada ; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
L’expression « règle de droit » a reçu une interprétation large de la part des tribunaux. Dans l’arrêt Operation Dismantle c. R. [23], le juge Dickson a affirmé :
Je tiens à souligner que rien dans les présents motifs ne saurait être interprété comme l’adoption de l’opinion selon laquelle la référence faite à la « règle de droit » à l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 doit être confinée aux lois, aux règlements et à la common law. Il se peut fort bien que, si la suprématie de la Constitution, énoncée à l’art. 52, doit avoir un sens, tous les actes effectués selon des pouvoirs découlant d’une règle de droit relèveront de l’art. 52.
Ainsi, il a été jugé que l’expression « règle de droit » couvrait :
- les règlements municipaux [24] ; et
- l’ensemble de la common law [25]. Toutefois, la Cour suprême ne peut pas contrôler :
- une disposition de la Constitution : il existe une règle fondamentale selon laquelle une partie de la Constitution ne peut être abrogée ou atténuée par une autre partie de la Constitution [26] ;
- les traités : les traités conclus par l’exécutif n’ont pas un effet direct en droit canadien. Une loi doit généralement être adoptée afin de les mettre en œuvre. Une telle loi peut être contrôlée. En outre, comme il est précisé ci-dessous, les actes de l’exécutif sont assujettis au contrôle judiciaire en vertu de la Charte 27[27]
- un projet de loi : il s’agit d’une question purement théorique (voir la discussion relative au caractère théorique d’un appel ci-dessous). Cependant, la Cour peut se pencher sur la question de la constitutionnalité d’une loi qui n’a pas encore été adoptée dans le cadre d’un renvoi. Par ailleurs, il est possible pour le Parlement ou une législature provinciale de placer une disposition législative hors contrôle. En vertu de l’art. 33(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, le Parlement fédéral ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la Charte. Cette déclaration cesse d’avoir effet au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur [28]
- . Cependant, le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une déclaration identique [29].
La Cour suprême du Canada ne peut contrôler que les mesures législatives et gouvernementales. L’alinéa 32(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit :
- a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ; *
- b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
* La Charte s’applique également en ce qui concerne le territoire du Nunavut en vertu du paragraphe 29(4) de la Loi sur le Nunavut, L.C. 1993, c. 28.
Se fondant sur cet article, la Cour suprême du Canada a statué que l’application de la Charte se restreignait à l’action gouvernementale et que la Charte n’était pas destinée, en l’absence d’une action gouvernementale quelconque, à être appliquée aux litiges privés [30]
Par exemple, bien qu’il ait été jugé que l’expression « toute autre règle de droit » couvrait l’ensemble de la common law dans l’affaire Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 c. Dolphin
Delivery Ltd. 31[31], la Cour suprême a précisé que la Charte ne s’appliquait pas à la common law entre particuliers ; la Charte ne s’applique à la common law que dans la mesure où celle-ci constitue le fondement d’une action gouvernementale qui, allègue-t-on, porte atteinte à une liberté ou à un droit garantis 32[32] . Néanmoins, la Cour suprême a statué que dans le contexte d’un litige privé où aucune action gouvernementale n’était en cause, la common law devait être interprétée d’une manière qui soit conforme à la Charte. Cette exigence illustre simplement le pouvoir inhérent qu’ont les tribunaux de modifier ou d’élargir la common law de façon à ce qu’elle respecte les conditions et valeurs sociales contemporaines 33[33].
La Cour suprême a interprété l’art. 32(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 comme incluant d’autres entités gouvernementales que celles qui y sont expressément énumérées. Elle a décidé que cet article était de portée assez large pour englober toutes les entités qui sont essentiellement de nature gouvernementale.
Afin de conclure qu’une entité fait partie du gouvernement, il faut examiner si l’entité peut
- – de par sa nature même ; ou
- – à cause du degré de contrôle exercé par le gouvernement sur elle,être à juste titre considérée comme faisant partie du « gouvernement » au sens de l’art. 32(1). En pareil cas, toutes les activités de l’entité sont assujetties à la Charte, même si l’activité en cause pourrait être qualifiée de « privée » si elle était exercée par un acteur non gouvernemental [34]
De plus, la Cour suprême a affirmé qu’il était possible que des entités données soient assujetties à un examen fondé sur la Charte relativement à certaines fonctions gouvernementales qu’elles accomplissent, même si, intrinsèquement, ces entités ne peuvent être correctement décrites comme « gouvernementales »[35]. Pour que la Charte s’applique à une entité privée, il doit être établi que celle-ci met en œuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé [36]
Voici quelques exemples d’entités et d’actes qui, selon la jurisprudence, sont assujettis à la Charte :
– les décisions du cabinet fédéral [37]
- les municipalités et les règlements municipaux [38];
- l’ordonnance d’un tribunal judiciaire, lorsque la cour agit de sa propre initiative et non pas à la requête d’un particulier, pour des motifs de caractère entièrement « public » plutôt que « privé »[39] ;
- les ordonnances des tribunaux administratifs [40] ;
- les activités gouvernementales qui sont formellement des opérations « commerciales » ou « privées », car ces activités sont en réalité des expressions de la politique gouvernementale [41]
- les conventions collectives conclues par un mandataire du gouvernement [42] ;
- un collège sur lequel le gouvernement possède un pouvoir de contrôle routinier ou régulier [43]
- les hôpitaux publics, lorsqu’ils fournissent des services médicaux spécifiés dans la loi [44]. Voici maintenant quelques exemples d’entités et d’actes qui, selon la jurisprudence, ne sont pas assujettis à la Charte :
- les membres d’une assemblée législative lorsqu’ils exercent leurs privilèges inhérents (i.e. ceux qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme législatif) [45] ;
- l’ordonnance d’un tribunal judiciaire [46] ;
- les universités [47] ;
- les règlements de régie interne des hôpitaux publics [48].
I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Une partie ne peut pas contester la constitutionnalité d’une autre loi que celle qui fait l’objet du recours, à moins qu’elle n’amende son recours et respecte la procédure relative aux questions constitutionnelles.
En vertu de l’art. 32(1) des Règles, la partie qui entend soulever une question constitutionnelle doit, dans les soixante jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, s’adresser au juge en chef ou à un autre juge pour que soit formulée une question constitutionnelle lorsque :
- – la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements d’application est contestée ;
- – le caractère inopérant d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements d’application est plaidé
- – la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une règle de common law est contestée.
Le juge en chef ou un autre juge peut ensuite ordonner la signification de la question constitutionnelle au procureur général du Canada, aux procureurs généraux de toutes les provinces et aux ministres de la Justice des gouvernements des territoires, et leur donner avis du délai dans lequel ils doivent déposer un avis d’intervention s’ils veulent intervenir devant la Cour [49]
I – 3. – Les délais
Aucun délai de recevabilité n’est prescrit.
II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
En vertu du Tarif des honoraires payables au registraire de la Cour suprême du Canada (Annexe A des Règles de la Cour suprême du Canada), des honoraires de 50 $ sont exigibles pour le dépôt des documents suivants :
- avis de demande d’autorisation ;
- avis d’appel ; ou
- autre document introductif d’instance. Les honoraires exigibles sont les mêmes pour tous les types d’appel (constitutionnel, civil, pénal, etc.). Rien n’est exigible pour un avis de demande d’autorisation d’appel incident. Dans des circonstances spéciales, le registraire peut, à sa discrétion, exempter une personne du paiement de ces honoraires.
II – 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
En vertu de l’art. 12 des Règles, une partie aux procédures peut comparaître soit en personne, soit par avocat. La Cour ou un juge peut, en tout temps, désigner un avocat pour représenter une partie à une procédure lorsque, de l’avis de la Cour ou du juge, il paraît souhaitable dans l’intérêt de la justice que la partie bénéficie de l’aide d’un avocat et qu’il appert que la partie n’a pas les moyens de retenir les services d’un avocat [50].
En règle générale, les parties sont représentées par avocat. Toutefois, il est arrivé à quelques reprises au cours des dernières années que des parties se représentent seules devant la Cour. Chaque année, environ une centaine de demandes d’autorisation d’appel sont déposées par des personnes non représentées par avocat.
II – 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Le requérant doit avoir qualité pour agir. Voir question I-1.
II – 2. – Conditions relatives au recours
Les appels dont la Cour est saisie proviennent de trois sources.
Première source :
Dans la plupart des cas, une autorisation d’appel doit d’abord être obtenue d’une formation de trois juges de la Cour [51]. Les demandes d’autorisation d’appel sont présentées par écrit [52] et doivent être déposées dans les soixante jours suivant la date du jugement porté en appel [53].
La Cour accueille la demande d’autorisation d’appel s’il ressort des conclusions écrites, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou de son importance à tout autre égard, qu’elle devrait en être saisie [54]. Il n’est pas suffisant de démontrer que la cour d’appel a commis une erreur : il doit être démontré qu’il s’agit d’une question d’importance générale.
La Cour peut ordonner la tenue d’une audience pour décider du sort d’une demande en autorisation d’appel [55]. Cependant, cela se produit rarement.
La Cour suprême a pour politique de ne pas donner les motifs de sa décision d’accueillir ou de rejeter une demande d’autorisation d’appel.
En vertu des articles 37 et 37.1 de la Loi, l’autorisation d’en appeler d’un jugement peut, dans certains cas, être accordée par le plus haut tribunal de dernier ressort dans un province ou par la Cour d’Appel fédérale lorsque, suivant l’opinion du tribunal ou de la Cour d’Appel fédérale, la question en jeu dans l’appel en est une qui devrait être soumise à la Cour suprême du Canada. Toutefois, en pratique, les cours d’appel n’accordent des autorisations d’appel que rarement, par déférence pour la Cour suprême. La Cour suprême peut accueillir une demande d’autorisation d’appel qui a été rejetée par une cour d’appel [56].
Le tableau suivant indique, pour les onze dernières années, le nombre de demandes d’autorisation d’appel complètes soumises à la Cour dans les domaines suivants : Charte (en matière civile) ; Charte (en matière criminelle) ; et Constitutionnel (question de partage des compétences la plupart du temps). Le chiffre en italique dans chaque colonne indique le nombre de demandes d’autorisation d’appel accordées dans chaque catégorie.

En 1999, 15 pour cent des demandes d’autorisation d’appel soumises à la Cour étaient des affaires civiles ou criminelles qui soulevaient principalement des questions relatives à la Charte, et 2 pour cent des demandes soulevaient d’autres questions constitutionnelles. En 1998, ces pourcentages étaient respectivement 11 % et 2 %. En 1997, ils étaient de 9 % et 1 %.
Deuxième source :
Les affaires pour lesquelles une autorisation d’appel n’est pas requise constituent une deuxième source.
Les appels de plein droit incluent :
- – les appels des décisions rendues par la Cour d’Appel fédérale en matière de litige entre le Canada et une province, ou entre deux ou plusieurs provinces [57] ;
- – les appels en vertu de l’art. 64 de la Loi sur les élections fédérales contestées 58[58] ;
- – les appels en vertu de l’art. 34(3.1) de la Loi sur la concurrence 59[59]
- – les appels de questions déférées par les gouvernements provinciaux en vertu de l’art. 36 de la Loi ; et
- – les appels en vertu des art. 691(1)(a), 691(2)(a) et (b), 692(3) et 693(1) du Code criminel.
Les trois premiers types d’appel de plein droit sont peu courants et peu pertinents aux fins du présent rapport. Les appels en matière criminelle constituent la très vaste majorité des appels de plein droit. Il y a appel de plein droit à la Cour suprême en matière criminelle sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident et sur toute question de droit si la cour d’appel annule l’acquittement d’un accusé et consigne contre lui un verdict de culpabilité.
Troisième source :
La troisième source est le pouvoir de renvoi du gouvernement fédéral prévu à l’art. 53 de la Loi, en vertu duquel la Cour est appelée à donner un avis sur des questions que lui soumet le gouverneur en conseil.
Un avis d’appel doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les trente jours suivant la date du jugement porté en appel, s’il s’agit d’un appel de plein droit, et dans les trente jours suivant la date du jugement accordant l’autorisation d’appel, si une demande à cette fin a été présentée 60[60].
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les requêtes sont numérotées de façon consécutive.
II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date qui fait foi pour la suite des procédures est la date du dépôt au Greffe de la Cour [61].
II – 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
On retrouve dans les Règles et dans la Loi plusieurs dispositions relatives aux conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes. Ces dispositions portent principalement sur la présentation des documents imprimés, les mentions obligatoires, les pièces et documents obligatoires, le cautionnement et les délais de signification. Par exemple, l’art. 3(1) des Règles précise que tous les documents imprimés doivent être clairs et lisibles et présentés sur du papier blanc de bonne qualité de format 21,5 cm par 28 cm.
Les dispositions relatives aux demandes d’autorisation d’appel sont plus nombreuses que les dispositions relatives aux appels de plein droit, car les demandes d’autorisation d’appel nécessitent le dépôt de plusieurs documents. En ce qui concerne les demandes d’autorisation d’appel, nous vous référons aux articles suivants des Règles et de la Loi reproduits en annexe : art. 21, 23, 33 et 39(4) des Règles et art. 58(1)(a), 58(2) et 59 de la Loi. Ces articles spécifient, entre autres, quels sont les types de pièces annexes indispensables et les mentions obligatoires.
Pour ce qui est des conditions formelles et matérielles de recevabilité des appels de plein droit, nous vous référons aux articles suivants des Règles et de la Loi reproduits en annexe : art. 21 et 26 des Règles et art. 58(1)(b), 58(2), 59, 60 et 64 de la Loi. Ces articles portent principalement sur la signification de l’avis d’appel et le dépôt du cautionnement.
Des moyens nouveaux peuvent être soulevés en cours de procédure à la condition que la Cour accorde la permission d’amender les actes de procédure. Les amendements sont régis par l’art. 48 de la Loi qui prévoit :
48. 1. – À tout stade de l’appel porté devant elle, la Cour peut, même en l’absence de demande en ce sens par l’une des parties, procéder aux amendements nécessaires afin de lui permettre de se prononcer sur l’appel ou sur la véritable question ou contestation qui ressort des actes de procédure, de la preuve ou de l’ensemble des débats.
2. – L’amendement visé au paragraphe (1) peut être motivé ou non par la défaillance, l’erreur, l’action, le manquement ou la négligence de la partie qui le demande.
L’amendement s’effectue aux conditions que la Cour estime justes quand au paiement des frais, aux ajournements ou à tout autre facteur [62].
II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
En 1975, la Loi a été amendée afin d’exiger qu’une autorisation d’appel soit accordée dans toutes les affaires civiles. Les appels de plein droit dans les affaires portant sur des sommes de plus de 10 000 $ a été aboli et le critère de « l’importance de l’affaire pour le public » a été établi comme étant le critère pour accueillir une demande d’autorisation d’appel [63]. Pour la première fois dans son histoire, la Cour suprême devenait maître de son rôle en matière civile. Ce changement dans la loi avait pour but de permettre à la Cour de se consacrer aux affaires de plus grande importance et de réduire les inévitables délais causés par le nombre élevé d’appels.
Avant le 25 avril 1988, toutes les demandes d’autorisation d’appel devaient être entendues par une formation de trois juges lors d’une audience. Ces audiences prenaient beaucoup du temps de la Cour et menaçaient d’en prendre encore davantage puisque le nombre de demandes d’autorisation d’appel augmentait. En 1987, la Loi a été modifiée de façon à permettre que les demandes d’autorisation d’appel soient considérées par écrit [64]. Cet amendement est entré en vigueur le 25 avril 1988.
Depuis le 14 mai 1997, il n’y a plus d’appel de plein droit lorsqu’une cour d’appel annule à l’unanimité l’acquittement à l’égard d’un acte criminel et ordonne un nouveau procès. Un accusé qui aurait eu un appel de plein droit n’eût été de ces modifications doit demander une autorisation d’appel. Conformément à l’art. 43(1.2) de la Loi ajouté au moment de ces modifications, la Cour doit ordonner la tenue d’une audience pour décider de la demande d’autorisation d’appel du requérant.
II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
La procédure à suivre pour régulariser une requête est la même que celle pour soulever de nouveaux moyens, soit la procédure d’amendement. Nous vous référons donc à la discussion relative à la procédure d’amendement à la question II-2.3.
De plus, l’art. 4 des Règles prévoit que la Cour, un juge ou le registraire, lorsque les règles le lui permettent, peut exempter une partie de l’obligation de suivre les dispositions des Règles.
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
(II – 4. – Motifs de rejet. Synthèse)
La Cour a le pouvoir de casser des procédures [65]. La principale modalité de rejet pour irrecevabilité est la requête en annulation. En vertu de l’art. 28 des Règles, l’intimé peut, dans les soixante jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, demander à la Cour d’annuler l’appel par ordonnance. Ce délai peut être prorogé [66].
L’intimé doit présenter une requête à la Cour, conformément à l’art. 23.1 des Règles. La requête doit comprendre un avis de requête et la plupart des documents requis pour une demande d’autorisation d’appel (voir l’art. 23 des Règles reproduit en annexe), notamment un mémoire des arguments. Sauf ordonnance contraire de la Cour ou d’un juge, la signification de la requête en annulation entraîne la suspension de toutes les procédures jusqu’à ce qu’un jugement sur la requête soit prononcé [67]. Si l’appel est annulé, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner à l’appelant de payer la totalité ou une partie des dépens de l’appel [68].
Comme le tableau suivant le démontre, très peu de requêtes en annulation sont déposées chaque année (chiffre en gras) et encore moins sont accueillies (chiffre en italique) :

Les principaux motifs de rejet sont les suivants :
- Causes qui ne peuvent faire l’objet d’un appel [69] : par exemple, les pourvois qui ne rencontrent pas les conditions relatives à un appel de plein droit (e.g., dans une affaire criminelle, lorsqu’il n’y a pas de question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident).
- Procédures entachées de mauvaise foi [70].
- Le non-respect des délais. Dans les cas où le dossier et le mémoire de l’appelant ne sont pas déposés et signifiés dans les six mois qui suivent, selon le cas, l’octroi de l’autorisation d’appel par la Cour ou le dépôt de l’avis d’appel dans un appel de plein droit ou dans un appel autorisé par la juridiction inférieure, le registraire peut signifier aux parties un avis indiquant qu’il demandera à un juge de rejeter l’appel en tant qu’appel abandonné, à moins qu’un juge ne proroge par ordonnance, dans les 30 jours suivant la signification de l’avis, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire [71].
- De plus, si l’appelant tarde indûment à poursuivre son appel, ou omet de le présenter, une fois prêt pour l’audition, à la première session subséquente de la Cour, l’intimé peut, après avis donné à l’appelant, demander le rejet de l’appel à la Cour ou à l’un de ses juges siégeant en chambre [72]. L’intimé peut également demander le rejet de l’appel à la Cour ou à un juge si l’appelant ne signifie pas ni ne dépose son mémoire de la façon prescrite par les Règles [73]
- Le caractère théorique ou caduc d’un appel. Sauf dans le contexte d’un renvoi, la Cour peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite, notamment lorsque sa décision n’aura pas pour effet de régler un litige affectant ou pouvant affecter les droits des parties de façon concrète. Un tel litige doit exister non seulement quand les procédures sont engagées, mais aussi au moment où la Cour rend sa décision, sinon la cause est considérée comme théorique [74]
- Néanmoins, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’entendre une affaire, même si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. Lorsque vient le moment d’exercer son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit considérer les facteurs suivants :
a) la présence de débat contradictoire ;
b) l’économie des ressources judiciaires ; et
c) la fonction juridictionnelle de la Cour suprême dans la structure politique canadienne [75] - La « non-justiciabilité ». La Cour suprême peut refuser de répondre à une question si
1. – en répondant à la question, la Cour outrepasserait ce qu’elle estime être le rôle qui lui revient dans le cadre constitutionnel de la forme démocratique de gouvernement ; ou
2. – la Cour ne pourrait pas donner une réponse relevant de son champ d’expertise : l’interprétation du droit [76] - Question ambiguë soumise par renvoi. La Cour peut refuser de répondre à une question soumise par renvoi, qui est par ailleurs justiciable,
- – lorsque la question est trop imprécise ou ambiguë pour qu’il soit possible d’y apporter une réponse complète ou exacte ; ou
- – lorsque les parties n’ont pas fourni suffisamment d’information pour permettre à la Cour de donner des réponses complètes ou exactes [77] .
II – 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir.
S’il est convaincu qu’une partie agit de manière vexatoire, un juge peut ordonner la suspension de l’instance aux conditions qu’il estime appropriées [78]. En outre, une partie peut, par requête, demander qu’une telle ordonnance soit rendue [79]. De même, le registraire peut demander à un juge de rendre une telle ordonnance après avoir avisé les parties par écrit [80].
III. Traitement de la saisine recevable. Procédures de l’instance
III – 1. – Principe du contradictoire
III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Signification et divulgation
En règle générale, tout document déposé par une partie ou un intervenant doit être signifié et divulgué aux autres parties et intervenants.
Avis de question constitutionnelle
Dans les soixante jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, la partie qui entend soulever une question constitutionnelle doit s’adresser au juge en chef, ou à un autre juge, pour que soit formulée une question constitutionnelle lorsque :
a) la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements d’application est contestée ;
b) le caractère inopérant d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale ou de l’un de leurs règlements d’application est plaidé ; ou
c) la validité ou l’applicabilité constitutionnelle d’une règle de common law est contestée [81].
Le juge en chef, ou un autre juge, peut formuler la question et en ordonner la signification, dans le délai qu’il fixe, au procureur général du Canada, aux procureurs généraux de toutes les provinces et aux ministres de la Justice des gouvernements des territoires, avec avis que ceux qui veulent intervenir – qu’ils aient ou non l’intention de plaider – doivent déposer dans le délai précisé dans l’avis, non inférieur à quatre semaines suivant la date de l’avis, un avis d’intervention et signifier cet avis aux parties [82].
Il est également utile de noter que toutes les provinces canadiennes ont adopté une loi exigeant qu’un avis soit donné au procureur général de la province (et parfois au procureur général du Canada) lorsque la constitutionnalité d’une loi est en cause. L’objectif de ces lois a été décrit ainsi par le juge Sopinka dans l’affaire Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant [83] :
Dans notre démocratie constitutionnelle, ce sont les représentants élus du peuple qui adoptent les lois. Bien que les tribunaux aient reçu le pouvoir de déclarer invalides les lois qui contreviennent à la Charte et qui ne sont pas sauvegardées en vertu de l’article premier, c’est un pouvoir qui ne doit être exercé qu’après que le gouvernement a vraiment eu l’occasion d’en soutenir la validité. Annuler par défaut une disposition législative adoptée par le Parlement ou une législature causerait une injustice grave non seulement aux représentants élus qui l’ont adoptée mais également au peuple. En outre, devant notre Cour, qui a la responsabilité ultime de déterminer si une loi contestée est inconstitutionnelle, il est important que, pour rendre cette décision, nous disposions d’un dossier qui résulte d’un examen en profondeur des questions constitutionnelles soulevées devant les cours ou le tribunal dont les jugements sont portés en appel.
Bien que la Cour suprême ne se soit pas définitivement prononcé sur la question, il est possible que l’omission de donner l’avis requis invalide une décision rendue en son absence [84].
Dans les cas de renvois, si une question soumise par le gouverneur en conseil touche à la validité constitutionnelle d’une loi – ou de l’une quelconque de ses dispositions – adoptée par la législature d’une province, ou si, pour une raison quelconque, le gouvernement d’une province porte un intérêt particulier à cette question, le procureur général de cette province est obligatoirement avisé de la date d’audition afin qu’il puisse être entendu s’il le juge à propos [85].
De plus, la Cour a le pouvoir d’ordonner qu’une personne intéressée ou des représentants d’une catégorie de personnes intéressées soient avisées de l’audition de toute question déférée à la Cour dans le cadre d’un renvoi. Ces personnes ont le droit d’être entendues à ce sujet [86].
Amicus curiae
La Cour a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat, en l’absence de toute autre représentation, relativement à un intérêt auquel il est porté atteinte [87]. La Cour suprême a notamment exercé ce pouvoir dans l’affaire du Renvoi relatif à la sécession du Québec [88] en nommant un amicus curiae pour représenter les intérêts du gouvernement du Québec.
Intervention
En outre, en vertu de l’art. 18 des Règles, toute personne ayant un intérêt dans un appel ou un renvoi peut, par requête présentée à un juge, demander l’autorisation d’intervenir aux conditions fixées par celui-ci. Une partie à un litige analogue [89] et les groupes d’intérêt public constituent deux exemples de personnes ayant un intérêt dans un appel ou un renvoi. L’intérêt des groupes d’intérêt public dans un appel peut être démontré si, par les personnes qu’ils représentent ou par le mandat qu’ils cherchent à faire valoir, ils sont directement intéressés dans la question devant la Cour [90].
La requête en intervention doit être signifiée et déposée dans les soixante jours suivant le dépôt de l’avis d’appel ou de renvoi [91]. La requête en intervention doit exposer brièvement
a) l’identité de l’intervenant et l’intérêt qu’il a dans l’appel ou le renvoi ;
b) la position qu’il prendra dans l’appel ou le renvoi ; et
c) les arguments qu’il présentera, leur pertinence à l’appel ou au renvoi et les raisons qui l’amènent à croire qu’elles seront utiles à la Cour et différentes de celles des autres parties [92].
Le dernier critère est largement respecté lorsque le requérant fait face à la question et en a acquis une connaissance approfondie qui peut donc lui permettre d’apporter un point de vue nouveau ou de fournir des renseignements supplémentaires à son sujet. Toutefois, le statut d’intervenant n’est pas accordé pour permettre à l’intervenant de soulever des questions entièrement nouvelles, que les parties principales n’ont pas présentées [93].
Le besoin d’assurer un débat contradictoire est un des facteurs dont la Cour tient compte lorsqu’elle accorde le statut d’intervenant à un requérant [94]. Si la requête en intervention est accueillie, l’intervenant peut déposer un mémoire. Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’intervenant ne peut déposer un mémoire de plus de vingt pages, est limité au contenu du dossier, ne peut rien y ajouter et ne peut plaider [95].
Substitution et addition de parties
Dans toutes les procédures, la Cour ou un juge peut également ordonner l’addition ou la substitution d’une partie s’il l’estime nécessaire pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige [96]. Ainsi, la Cour peut ordonner l’addition ou la substitution d’une partie pour des fins d’équité ou pour assurer le débat contradictoire et empêcher que la question devienne purement théorique [97].
III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
Les parties présentent des arguments sous forme écrite et orale.
Arguments sous forme écrite
- Dans les quatre mois suivant la date de dépôt de l’avis d’appel, l’appelant doit signifier trois exemplaires de son mémoire aux autres parties et un exemplaire à chaque intervenant [98]
- Pour sa part, l’intimé doit signifier trois exemplaires de son mémoire aux autres parties et un exemplaire de son mémoire à chaque intervenant dans les huit semaines suivant la date de signification du mémoire de l’appelant [99]
- Tout intervenant doit signifier un exemplaire de son mémoire aux parties et à chaque autre intervenant dans les quatre semaines suivant la date de signification du mémoire de l’intimé [100]
- Vous trouverez les règles relatives à la présentation matérielle des mémoires, de même que d’autres règles concernant les mémoires, aux art. 37 à 42 et 33 des Règles, reproduits en annexe.
Arguments sous forme orale
- Après le dépôt du mémoire de l’intimé ou huit semaines après la signification du mémoire de l’appelant, selon le cas, le registraire inscrit l’appel pour audition [101]
- Au plus tard le huitième mardi précédant le premier jour de la session de la Cour, le registraire met au rôle tous les appels inscrits [102]
- Dans les dix jours de la mise au rôle, l’appelant doit signifier à toutes les parties un avis d’audition[103]
- Sauf ordonnance contraire, les appels sont entendus dans l’ordre de leur inscription au rôle [104]
- Le Greffe doit être avisé au moins une semaine avant l’audition de l’appel du nom des procureurs qui comparaîtront en Cour [105]
- Si une partie ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés, la Cour peut n’entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou elle peut ajourner l’audience aux conditions qu’elle juge nécessaires, notamment quant aux dépens [106]. Les règles relatives à la durée des plaidoiries sont précisées dans des avis de pratique. Les règles présentement en vigueur ont été précisées dans un Avis à la profession publié en août 1998.
- Appelants et intimés disposent chacun d’une heure pour la plaidoirie principale.
- Si l’appelant utilise toute l’heure qui lui est allouée pour sa plaidoirie principale, cinq minutes lui sont accordées pour sa réplique. Si l’appelant n’utilise pas toute l’heure allouée pour sa plaidoirie principale, il peut reporter un maximum de quinze minutes qui, avec les cinq minutes de réplique normalement attribuées, donnent au plus vingt minutes de réplique.
- Une partie qui estime avoir besoin de plus de temps peut faire une requête en ce sens au juge de service. La Cour peut accorder une période de temps supplémentaire, notamment aux avocats qui ont dû répondre à plusieurs questions pendant leur plaidoirie.
- Sauf permission de la Cour, le nombre de procureurs qui plaident à un appel est limité à deux par parties et à un seul par intervenant, et le nombre de procureurs qui plaident en réplique est limité à un seul par partie [107]
- Les intervenants n’ont pas le droit de réplique, sauf permission de la Cour [108]
- Les intervenants qui ont obtenu la permission de plaider disposent généralement de quinze minutes pour leur plaidoirie. Ils plaident après la partie dont ils soutiennent la position.
III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Le procès en constitutionnalité peut être défini comme pleinement contradictoire.
III – 2. – Égalité des armes
III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
- Dossier. Le dossier de l’appelant doit faire état du jugement contesté et des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour [109]. Le dossier de l’intimé fait état des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents que l’intimé estime nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et qui ne figurent pas dans le dossier de l’appelant [110].
- Recueil de jurisprudence et de doctrine. Chaque partie doit déposer auprès du registraire et signifier aux autres parties et intervenants un recueil de jurisprudence et de doctrine qui contient uniquement les extraits pertinents des arrêts et ouvrages sur lesquels elle entend s’appuyer [111].
- Mémoire exposant les questions en litige ainsi que les arguments présentés [112].
III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Toutes les pièces doivent être transmises ou accessibles aux parties.
III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
La Cour ne dispose pas de moyens propres d’instruction d’une affaire. Toutefois, la Cour peut prendre connaissance d’office du droit ainsi que de faits incontestables et notoires. De plus, dans le contexte constitutionnel, les règles traditionnelles de la connaissance d’office sont assouplies afin de permettre aux juges de prendre connaissance d’office d’études sociales et de données socio-économiques sérieuses [113].
III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
La Cour ne peut se saisir d’office de dispositions non contestées. Le principe général est que le débat judiciaire est défini par les parties. De plus, il existe une présomption de constitutionnalité [114]. Par conséquent, la Cour ne se prononce pas sur des questions constitutionnelles qui n’ont pas été soulevées par les parties.
Néanmoins, la Cour peut, dans certaines circonstances, soulever des moyens qui n’ont pas été soulevés par les parties. Par exemple, la Cour peut, à tout stade de l’appel porté devant elle, procéder aux amendements nécessaires afin de lui permettre de se prononcer sur l’appel ou sur la véritable question ou contestation qui ressort des actes de procédure, de la preuve ou de l’ensemble du débat, et ce, même en l’absence de demande en ce sens [115]. L’article 49 de la Loi prévoit que l’amendement s’effectue aux conditions que la Cour estime justes, entre autres quant aux ajournements ou à tout autre facteur. Lorsqu’un nouveau moyen est soulevé, la pratique de la Cour est d’en informer les parties et de leur permettre de présenter des arguments relativement à ce moyen.
III – 3. – Délai de jugement
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ? La Cour n’est pas tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini.
III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
À la fin d’une audience, la Cour peut rendre son jugement sur le banc ou prendre la cause en délibéré. Dans la plupart des cas, la cause est prise en délibéré.
En vertu de l’art. 26 de la Loi, la Cour peut rendre son jugement soit en audience publique (ce qui n’arrive pratiquement jamais), soit de la façon suivante : chaque juge ayant instruit l’affaire dépose auprès du registraire le texte de l’exposé de ses motifs, une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs d’un autre juge auquel il souscrit ou une attestation écrite de son accord avec ces motifs.
Lorsqu’une question a été mise en délibéré, le jugement est subséquemment déposé à une date annoncée et le registraire doit aviser de la date du prononcé du jugement les correspondants des parties et des intervenants, ou les procureurs des parties et des intervenants qui ne possèdent pas de correspondant [116]. Les procureurs inscrits au dossier, ou leur correspondant, sont également avisés du dépôt des motifs [117].
Dans les cas de renvois, la Cour transmet au gouverneur en conseil un avis certifié et motivé sur chacune des questions soumises, de la même manière que dans le cas d’un jugement rendu sur appel porté devant elle. Tout juge dont l’opinion diffère de celle de la majorité transmet pareillement son avis certifié et motivé [118].
Les jugements déposés sont immédiatement rendus publics et disponibles sur Internet.
III – 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
Le tableau suivant indique, pour les onze dernières années, les délais moyens (en mois) qui se sont écoulés
- – entre le dépôt d’une demande d’autorisation d’appel et la décision sur la demande ;
- – entre la date de l’autorisation d’appel ou du dépôt de l’avis d’appel de plein droit et l’audience ; et
- – entre l’audience et le jugement. Il est à noter que ces statistiques englobent l’ensemble des appels entendus par la Cour et non seulement les affaires constitutionnelles.


Conclusion
1. – L’accès au juge constitutionnel a-t-il conduit à des adaptations structurelles de la Cour ?
L’accès au juge constitutionnel est souvent fonction des ressources financières des requérants. Dans l’affaire Nouveau-Brunswick (ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G.(J.) [119], la Cour a statué que, dans certaines circonstances, l’État a l’obligation constitutionnelle de fournir des services d’avocats rémunérés.
Les dix provinces et les trois territoires canadiens ont des programmes en vertu desquels les personnes qui ont des droits légitimes à défendre ou à exercer se soumettent d’abord à une évaluation financière ; celles qui sont jugées admissibles reçoivent des services juridiques qui sont subventionnés en totalité ou en partie. Ces programmes offrent surtout des services touchant le droit de la famille, le droit criminel, le statut d’immigrant ou de réfugié et certaines affaires civiles [120]. Des questions constitutionnelles peuvent être soulevées dans le cadre de ces affaires.
Au niveau fédéral, le Programme de contestation judiciaire du Canada constitue une autre source de financement. Il s’agit d’un organisme national, sans but lucratif, créé en 1994 pour financer les actions en justice visant les droits à l’égalité et les droits linguistiques garantis par la Constitution canadienne. Le Programme finance les causes invoquant les droits linguistiques aux niveaux fédéral ou provincial, garantis par la Constitution du Canada. Sont également financées les causes contestant les lois, les politiques ou pratiques fédérales fondées sur l’article 15 (égalité) de la Charte. Les causes ne sont financées que si elles sont susceptibles de modifier une loi, une politique ou une pratique de manière à ce que celle-ci respecte les droits linguistiques ou les droits à l’égalité. Il existe cinq catégories de financement disponible : le financement pour l’élaboration d’une action, le financement d’une action en justice, le financement d’une étude d’impact, le financement pour les négociations et le financement pour la promotion et l’accès au Programme [121].
Pour ce qui est des adaptations structurelles de la Cour, la présence des recherchistes et des conseillers juridiques à la Cour suprême mérite d’être soulignée. À la fin des années soixante, les juges de la Cour ont commencé à embaucher des « clercs » ou « recherchistes » pour les assister dans leur travail. Au commencement, chaque juge avait un seul recherchiste à son service. Dans les années 80, le nombre de recherchistes est passé de un à deux, puis de deux à trois pour chaque juge. C’est aussi pendant les années 80 que la Cour s’est dotée d’un personnel juridique affecté à la production de précis destinés aux juges. Depuis 1994, ce personnel est également affecté à l’étude des demandes d’autorisation d’appel, tâche qui incombait auparavant aux recherchistes. La section des Services juridiques comprend maintenant quinze avocats.
De plus, le nombre de requêtes en nouvelle audition (ou demandes de réexamen) [122] ont considérablement augmenté au cours des dernières années. Le tableau suivant indique le nombre de demandes de ré-examen présentées à la Cour au cours des sept dernières années :

D’une façon plus générale, il est important de souligner que l’entrée en vigueur de la Charte en 1982 a eu un grand impact sur la Cour suprême. En effet, le rôle de la Cour en ce qui a trait au contrôle de constitutionnalité des lois et des actes des gouvernements a alors pris une plus grande envergure. Depuis 1982, la Cour fait face à des questions de plus en plus complexes. Dans les premières années suivant l’adoption de la Charte, les pourvois devant la Cour portaient principalement sur les droits judiciaires. En passant en revue les pourvois entendus récemment par la Cour, on peut constater que les questions portent maintenant de plus en plus sur le droit à l’égalité et les libertés individuelles. Ces pourvois soulèvent des questions quant aux choix sociaux et engendrent des débats au sein de la société. En conséquence, la Cour est l’objet d’un intérêt et d’une attention grandissants de la part des médias et du public.
2. – Existe-t-il une réforme en cours ou en projet relative à l’accès au juge constitutionnel ?
Non.
3. – Assiste-t-on à une professionnalisation des requêtes (et/ou des requérants) ?
Les requêtes ont, dans une très large mesure, toujours été « professionnalisées ». Toutefois, depuis l’arrivée de la Charte, on remarque que de plus en plus de personnes non représentées par avocat soulèvent des questions constitutionnelles fondées sur la Charte.
ANNEXES
Liste des législations, jurisprudences et textes de référence cités
1. – Législation
Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, c. 11 (R.-U.).
Loi constitutionnelle de 1867.
Loi constitutionnelle de 1982.
Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 1987, c. 42.
Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême et modifiant en conséquence la Loi sur la Cour fédérale, L.C. 1974-75-76, c. 18.
Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34 (3e Suppl.).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, c. S-26.
Loi sur les élections fédérales contestées, L.R.C. 1985, c. C-39. Règles de la Cour suprême du Canada, DORS / 83-74, mod. par DORS / 83-335, 83-930, 84-821, 87-60, 87-292, 88-247, 91-347, 92-674, 93-488, 94-748, 95-158, 95-325, 95-326, 95-573, 96-393, 97-210, 97-299, 97-476, 98-452, 98-489.
2. – Jurisprudence
Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143. British Columbia Government Employees’ Union c. P.G. ColombieBritannique, [1988] 2 R.C.S. 214.
Canada (ministre de la Justice) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 265. Conseil canadien des Églises c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236.
Cuddy Chicks Ltd. c. Commission des relations de travail de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 5.
Douglas College c. Douglas / Kwantlen Faculty Association, [1990] 3 R.C.S. 570.
Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241. 180 Eldridge c. P.G. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 624.
Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 844.
Harrison c. Université de Colombie-Britannique, [1990] 3 R.C.S. 451. Hill c. Église de scientologie, [1995] 2 R.C.S. 1130.
Hy and Zel’s Inc. c. P.G. Ontario, [1993] 3 R.C.S. 113.
Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367.
Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211.
McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 230.
New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319.
Nouveau-Brunswick (ministre de la Santé et des Services communautaires), [1999] A.C.S. no 47 (QL).
Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265.
Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157.
Operation Dismantle c. R., [1985] 1 R.C.S. 441.
Peterborough (Ville) c. Ramsden, [1993] 2 R.C.S. 1084.
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.
R. c. Finta, [1993] 1 R.C.S. 1138.
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217.
Renvoi relatif à la T.P.S., [1992] 2 R.C.S. 445.
Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148.
Renvoi : Workers’ Compensation Act, 1983 (T.-N.), [1989] 2 R.C.S. 335. Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038.
Smith c. P.G. Ontario, [1924] R.C.S. 331.
Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483.
Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573. Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1991] 2 R.C.S. 22.
Thorson c. P.G. Canada, [1975] 1 R.C.S. 138.
Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530.
Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670.
3. – Texte de référence
Centre canadien de la statistique juridique, L’aide juridique au Canada : Une description des opérations, Ottawa, Statistique Canada, 1999.
Loi sur la Cour suprême
58. 1. – Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles suivantes régissent les délais en matière d’appel :
a) l’avis de la demande d’autorisation d’appel, accompagné de tous les documents utiles, doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les soixante jours suivant la date du jugement porté en appel ;
b) l’avis d’appel doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les trente jours suivant la date du jugement porté en appel, s’il s’agit d’un appel de plein droit, et dans les trente jours suivant la date du jugement accordant l’autorisation d’appel, si une demande à cette fin a été présentée.
2. – Le mois de juillet est exclu du calcul des délais prévus par le paragraphe (1).
59. 1. – Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, le tribunal dont le jugement est attaqué, la Cour ou un juge de l’une ou l’autre juridiction peut, dans des circonstances déterminées, proroger tout délai fixé par l’article 58, même après son expiration.
2. – la juridiction ou le juge assortit alors la prorogation des conditions, en matière de cautionnement ou autre, qui lui paraissent indiquées dans les circonstances.
60. 1. – L’appel est formé dans le délai applicable aux termes de l’article 58 ou 59 par :
a) signification d’un avis à toutes les parties directement concernées ;
b) dépôt, auprès du registraire, d’un cautionnement de cinq cents dollars garantissant la poursuite effective de l’appel et le paiement, par l’appelant, des frais et dommages-intérêts éventuellement mis à sa charge par la Cour.
2. – Le cautionnement non déposé en numéraire est soumis à l’approbation du tribunal dont le jugement est attaqué, de la Cour ou d’un juge de l’une ou l’autre juridiction.
3. – L’appelant est tenu d’aviser les parties directement concernées du dépôt du cautionnement dans les sept jours qui suivent celui-ci ou, le cas échéant, l’approbation requise par le paragraphe (2) si celle-ci intervient après le dépôt.
4. – L’avis d’appel ainsi que la preuve de sa signification sont déposés au bureau du registraire de même qu’une copie de l’avis au bureau du greffier ou de tout autre fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans les vingt et un jours qui suivent l’expiration du délai applicable aux termes de l’article 58 ou 59.
64. Le dépôt d’un cautionnement n’est pas exigible dans le cas d’appels 182 interjetés par la Couronne ou en son nom, de contestations électorales, de causes devant la Cour fédérale, d’affaires pénales ou de procédures relatives à un bref d’habeas corpus.
Règles de la Cour suprême du Canada :
Présentation des documents imprimés.
3. 1. – Tous les documents doivent être clairs et lisibles et présentés sur du papier blanc de bonne qualité de format 21,5 cm par 28 cm.
2. – Le registraire peut refuser les documents qui ne sont pas conformes aux présentes règles.
3. – Sur ordonnance de la Cour ou d’un juge, les documents qui ne sont pas conformes aux présentes règles peuvent être exclus des dépens. DORS/91-347, art. 3.
Intitulé
21. 1. – L’intitulé figurant sur la couverture des documents suivants ne doit comporter aucun nom abrégé et doit être conforme aux paragraphes (2) à (6) :
a) tout document introductif d’instance ;
b) le dossier de l’appelant et celui de l’intimé ;
c) une demande d’autorisation ;
d) une requête devant la Cour.
2. – Le nom du requérant, du demandeur ou de l’appelant doit paraître en premier lieu avec la mention de sa qualité de « Requérant », de « Demandeur » ou d’« Appelant », selon le cas, suivie de la description de sa qualité devant le tribunal de première instance.
3. – Doit paraître ensuite le nom de chacune des parties visées par les procédures, suivi de leur qualité d’« Intimé », puis de leur qualité devant le tribunal de première instance.
4. – Le nom de toute autre partie ou intervenant aux procédures devant la Cour doit suivre, avec l’indication de sa qualité devant le tribunal de première instance, le cas échéant.
5. – L’indication de la qualité devant le tribunal de première instance exigée par le présent article doit être mise entre parenthèses.
6. – La qualité des parties en Cour d’Appel ne doit pas être mentionnée, à moins qu’elles n’aient pas été parties devant le tribunal de première instance ou que l’affaire ait débuté en Cour d’Appel.
Demandes d’autorisation
23. 1. – La demande d’autorisation est constituée des documents suivants, assemblés de la manière et dans l’ordre suivants :
a) une couverture sur laquelle figurent dans l’ordre suivant :
(i) l’en-tête « COUR SUPRÊME DU CANADA »,
(ii) la désignation, entre parenthèses, du tribunal de juridiction inférieure,
(iii) l’intitulé complet conforme à l’article 21,
(iv) la nature de la demande d’autorisation et les articles de la loi ou des présentes règles sur lesquels elle se fonde,
(v) en bas, à gauche, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur des procureurs respectifs des parties et, à droite, s’il y a lieu, les nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur de leurs correspondants respectifs ;
b) une table des matières complète dans laquelle sont indiqués chronologiquement la date de chaque document, y compris les annexes, et les numéros de page correspondants ;
c) les documents et annexes placés dans l’ordre suivant :
(i) l’avis de demande d’autorisation, rédigé selon la formule B.1,
(ii) tout affidavit à l’appui, s’il y a lieu,
(iii) les documents à l’appui, présentés dans l’ordre chronologique,
(iv) les dispositifs des jugements, chacun suivi des motifs respectifs, en commençant par le tribunal de première instance pour finir, dans l’ordre, par le dernier tribunal de juridiction inférieure ; toutefois, si un tribunal a rendu un jugement sans motifs écrits, il faut le mentionner dans la table des matières à la place du numéro de page, (v) un mémoire des arguments signé par le procureur qui l’a rédigé ou par la partie qui comparaît en personne, qui ne compte pas plus de 20 pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, et qui est divisé en cinq parties comme il suit :
Partie I : bref exposé des faits,
Partie II : énoncé concis des questions en litige,
Partie III : bref exposé des arguments,
Partie IV: nature de l’ordonnance demandée,
Partie V: table des arrêts et ouvrages, classés par ordre alphabétique, sur lesquels la partie entend se fonder, avec une indication des pages du mémoire où ils sont cités,
(vi) les extraits pertinents des textes législatifs sur lesquels la partie entend s’appuyer, reproduits en annexe de la demande d’autorisation.
2. – Les paragraphes des parties I à IV doivent être numérotés consécutivement.
3. – Lorsque les documents visés au sous-alinéa (1)c)(iii) comprennent des éléments de preuve, un exemplaire des seuls éléments de preuve, y compris les pièces, auxquels la partie entend faire référence doit être inclus.
4. – Sauf ordonnance contraire du registraire, lorsque les documents visés au sous-alinéa (1)c)(iii) figurent au dossier de la cour de juridiction inférieure, ce dossier peut être déposé auprès du registraire au lieu des documents.
5. – Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, les documents faisant partie de la demande d’autorisation doivent être conformes à l’article 33 et au paragraphe 39(4), compte tenu des adaptations de circonstance. 184
6. – L’intimé peut déposer auprès du registraire une réponse établie conformément aux paragraphes (1) à (5), compte tenu des adaptations de circonstance.
7. – Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, le demandeur peut déposer auprès du registraire une réplique à la réponse de l’intimé, qui ne doit compter plus de cinq pages.
8. – La couverture de la demande d’autorisation et de la réplique doit être de couleur grise et celle de la réponse, de couleur verte.
9. – Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, le demandeur doit déposer cinq exemplaires de la demande d’autorisation auprès du registraire ; toutefois, si un dossier est déposé en vertu du paragraphe (4), trois exemplaires de ce dossier suffisent.
10. – La demande d’autorisation doit être signifiée aux parties au litige devant le tribunal de juridiction inférieure et déposée auprès du registraire dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)a) et au paragraphe 58(2) de la Loi ou prorogé conformément au paragraphe 59(1) de la Loi.
11. – L’intimé doit, au plus tard 30 jours francs après la signification de la demande d’autorisation : a) signifier aux autres parties la réponse visée au paragraphe (6) ; b) en déposer cinq exemplaires auprès du registraire.
12. – Le demandeur doit, dans les sept jours francs suivant la signification de la réponse de l’intimé : a) signifier aux autres parties la réplique visée au paragraphe (7) ; b) en déposer cinq exemplaires auprès du registraire. Toutefois, si l’intimé a déposé une demande d’autorisation d’appel incident en vertu du paragraphe 29(1), le demandeur peut signifier et déposer la réplique prévue au paragraphe (7) dans le délai applicable à la signification et au dépôt de la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident.
13. – À l’expiration du délai prévu aux paragraphes (11) ou (12) ou après le dépôt de la réplique, le registraire doit soumettre la demande d’autorisation à la Cour pour qu’elle prenne les mesures voulues conformément à l’article 43 de la Loi.
14. – Le registraire doit inscrire au rôle toute demande d’autorisation à l’égard de laquelle la Cour a ordonné la tenue d’une audience conformément à l’alinéa 43(1)c) de la Loi.
15. – Sauf avec l’autorisation du registraire, aucun document ne peut être déposé après que la Cour a ordonné la tenue d’une audience conformément à l’alinéa 43(1)c) de la Loi.
16. – Le registraire peut proroger ou abréger les délais prévus aux paragraphes (11) et (12). DORS/88-247, art. 5 ; DORS/91-347, art. 11. DORS/94-748, art. 1 ; DORS/97-210, art. 3.
Avis d’appel
26. (1) L’avis d’appel doit être signifié aux autres parties et déposé auprès du registraire dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) et au paragraphe 58(2) de la Loi ou prorogé conformément au paragraphe 59(1) de la Loi ou par le registraire.
2. – Le cautionnement doit être déposé par l’appelant dans le délai fixé au paragraphe (1).
3. – Dans le cas d’un appel de plein droit, il est parfait par la signification à toutes les parties d’un avis d’appel et son dépôt dans le délai fixé par la loi applicable.
4. – Si les exigences des paragraphes (1), (2) ou (3) ne sont pas respectées, l’intimé peut s’adresser à la Cour ou à un juge pour obtenir le rejet de l’appel. DORS/88-247, art. 8 ; DORS/91-347, art. 15, 39.
Dossier de l’appelant et dossier de l’intimé
33. 1. – Le dossier de l’appelant fait état du jugement contesté et des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour ; il est relié de la façon suivante :
a) partie I : les actes de procédure, les ordonnances, les inscriptions ou les autres procédures et, le cas échéant, l’ordonnance accordant l’autorisation d’appel, le tout dans l’ordre chronologique ;
b) partie II : la preuve ;
c) partie III : les pièces, présentées dans l’ordre dans lequel elles ont été déposées en première instance ;
d) partie IV: tous les jugements rendus par les tribunaux d’instance inférieure ainsi que les motifs de jugement, le cas échéant ;
e) partie V: l’attestation du procureur, rédigée selon la formule E.
2. – Le dossier de l’intimé fait état des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents que l’intimé estime nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour et qui ne figurent pas dans le dossier de l’appelant ; il est relié de la façon suivante :
a) partie I : les actes de procédure, les ordonnances, les inscriptions ou les autres procédures, le tout dans l’ordre chronologique ;
b) partie II : la preuve ;
c) partie III : les pièces, présentées dans l’ordre dans lequel elles ont été déposées en première instance ;
d) partie IV: l’attestation du procureur, rédigée selon la formule E.
3. – Tout dossier est imprimé de la façon suivante :
a) un seul côté des feuilles est imprimé de façon que le texte se trouve toujours sur la page de gauche ;
b) les caractères utilisés sont d’une taille d’au moins 10 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm ;
c) il y a un numéro dans la marge de gauche toutes les 10 lignes, sans compter les titres ;
d) il y a au plus 50 lignes par page, à l’exclusion des titres ; 186
e) chaque page imprimée compte au plus 500 mots.
4. – La couverture du dossier de l’appelant est de couleur orange et celle du dossier de l’intimé de couleur grise.
5. – La couverture du dossier doit porter, dans l’ordre suivant :
a) l’en-tête « COUR SUPRÊME DU CANADA » en majuscules ;
b) entre parenthèses et en majuscules, la désignation de la juridiction inférieure ;
c) l’intitulé complet conforme à l’article 21 ;
d) le titre « DOSSIER DE L’APPELANT » ou « DOSSIER DE L’INTIMÉ », selon le cas, en majuscules et entre deux lignes horizontales parallèles ;
e) à gauche, les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro de télécopieur des procureurs des parties et, à droite, ceux de leurs correspondants.
6. – Chaque page doit porter un titre qui précise :
a) dans le cas d’un acte de procédure, la nature du document, sa date et le nom de la partie qui le dépose ;
b) dans le cas d’un affidavit, son lien avec l’instance ou les requêtes s’y rapportant, le nom du déclarant, la date de l’affidavit et le nom de la partie qui l’a présenté ;
c) dans le cas d’une ordonnance ou d’une autre procédure, sa date et l’autorité dont elle émane ;
d) dans le cas d’un témoignage, le nom du témoin, la partie qui l’a cité, avec la mention qu’il s’agit de l’interrogatoire, du contre-interrogatoire ou du réinterrogatoire, ou de l’interrogatoire de la cour ;
e) dans le cas d’une pièce, la cote sous laquelle elle a été déposée ;
f) dans le cas d’un jugement, les mots « Jugement de », suivis du nom du tribunal et de la date ;
g) dans le cas des motifs d’un jugement, les mots « Motifs de jugement du », suivis du nom du juge, du tribunal et de la date.
7. – Sauf si les témoignages sont déjà imprimés en la forme prescrite par la juridiction inférieure, quand les témoignages sont imprimés en français, les questions doivent être précédées de la lettre Q et les réponses de la lettre R et quand les témoignages sont imprimés en anglais, les questions doivent être précédées de la lettre Q et les réponses de la lettre A.
8. – Les actes de procédure, les jugements et autres documents doivent être imprimés intégralement.
9. – Si un dossier compte plus de 300 pages, il doit être relié en volumes distincts d’au plus 200 pages chacun.
10. – Si un dossier nécessite deux volumes ou plus, les pièces peuvent être reproduites dans le dernier volume si, de l’avis de la partie qui comparaît en personne ou de son procureur, le renvoi aux pièces s’en trouvera facilité ; le mot « Pièces » figure alors en caractères gras sur la couverture après le numéro du volume.
11. – Toutes les pages du dossier, y compris celles du volume des pièces, doivent être numérotées consécutivement.
12. – Si un dossier comprend plus d’un volume, le numéro du volume en chiffres romains avec, à sa suite ou en-dessous, le numéro de la première et de la dernière page de ce volume doit être indiqué sous le titre et à l’intérieur des deux lignes horizontales parallèles.
13. – Une table des matières doit être insérée au début de chaque volume d’un dossier et indiquer :
a) en détail, le contenu des quatre parties du dossier, avec les dates et une description du contenu conforme au paragraphe (6) ;
b) dans le cas des pièces, la page et le numéro du volume dans lequel il y est fait référence pour la première fois dans la preuve ;
c) dans le cas des jugements rendus sans motifs consignés, dans la colonne destinée aux numéros de page, « aucun motif consigné ».
14. – La table des matières doit être paginée consécutivement en chiffres romains minuscules centrés en haut de la page et le reste du dossier doit être paginé consécutivement en chiffres arabes centrés en haut de la page. Rien ne doit figurer au-dessus du numéro de la page.
15. – Le registraire peut exempter une partie de l’obligation de suivre toute disposition du présent article.
Contenu des mémoires
37. 1. – Un mémoire doit comporter les cinq parties suivantes :
Partie I – dans cette partie de leur mémoire respectif, l’appelant doit énoncer succinctement les faits et l’intimé doit énoncer succinctement sa position relativement aux faits énoncés par l’appelant et les faits additionnels qu’il estime pertinents.
Partie II – dans cette partie de leur mémoire respectif, l’appelant doit faire un énoncé concis des points en litige dans l’appel et l’intimé doit énoncer sa réponse aux points soulevés par l’appelant et qu’il estime pertinents de débattre.
Partie III – un résumé de l’argumentation énonçant succinctement les moyens de droit ou de fait à débattre, avec un renvoi à la page et à la ligne du dossier et aux arrêts et ouvrages invoqués à l’appui de chaque moyen. Lorsqu’une loi, un règlement, une règle, une ordonnance ou un décret est cité ou invoqué, l’extrait pertinent doit être reproduit en annexe au mémoire ou le texte intégral déposé en 10 exemplaires à l’intention de la Cour.
Partie IV – un énoncé concis de la nature de la décision recherchée et de toute disposition particulière relative aux dépens.
Partie V – une liste des arrêts et ouvrages que la partie qui comparaît en personne ou son procureur entend invoquer, en ordre alphabétique avec un renvoi à la page où ils sont cités. 188 2. – [Abrogé, DORS/97-476, art. 5]
2-1. – Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, les parties I à IV du mémoire ne peuvent compter plus de 40 pages.
3. – Les paragraphes des parties I à IV doivent être numérotés consécutivement. DORS/88-247, art. 14 ; DORS/91-347, art. 39.
Dépôt et signification des mémoires
38. 1. – Chaque partie doit signifier trois exemplaires de son mémoire aux autres parties et un exemplaire à chaque intervenant.
2. – Tout intervenant doit signifier un exemplaire de son mémoire aux parties et à chaque autre intervenant.
3. – Les mémoires doivent être signifiés :
a) dans le cas de l’appelant, dans les quatre mois suivant la date de dépôt de l’avis d’appel ;
b) dans le cas de l’intimé, dans les huit semaines suivant la date de signification du mémoire de l’appelant ;
c) dans le cas de l’intervenant, dans les quatre semaines suivant la date de signification du mémoire de l’intimé, sauf ordonnance contraire en application de l’article 18.
4. – Chaque partie et chaque intervenant doivent déposer auprès du registraire : a) dans le cas d’un appel, 24 exemplaires du mémoire ; b) dans le cas d’un renvoi, 31 exemplaires du mémoire. DORS/88-247, art. 15 ; DORS/91-347, art. 21.
5. – Le registraire peut proroger ou abréger les délais prévus au paragraphe (3). DORS/92-674, art. 3 ; DORS/95-325, art. 3.
Impression des mémoires
39. 1. – Sous réserve du paragraphe (4), les paragraphes 33(3), (5) et (11) à (14) s’appliquent au mémoire, avec les adaptations nécessaires.
2. – La couverture du mémoire de l’appelant doit être de couleur chamois, celle du mémoire de l’intimé, de couleur verte, celle du mémoire de l’intervenant, de couleur bleue.
3. – Sur la couverture du mémoire, le nom de la partie qui le dépose doit être indiqué. S’il y a plus d’un appelant ou d’un intimé, le nom de la partie doit être suivi de sa qualité d’« appelant » ou d’« intimé », selon le cas.
4. – Le mémoire doit être imprimé :
a) en caractères d’une taille de 12 points ;
b) à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations des arrêts et ouvrages qui doivent être à interligne simple et en retrait ; c) avec des marges d’au moins 2,5 cm ;
d) dans le cas du mémoire de l’appelant, avec l’avis suivant paraissant à la fin :
« AVIS À L’INTIMÉ : Conformément au paragraphe 44(1) des Règles de la Cour suprême du Canada, le présent appel sera inscrit par le registraire pour audition, dès le dépôt du mémoire de l’intimé ou à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 38(3)b) de ces règles, selon le cas. »
1. – Le registraire peut exempter une partie de l’obligation de suivre toute disposition du présent article. DORS/88-247, art. 16 ; DORS/91-347, art. 22 ;
DORS/97-476, art. 6 (1) et 6 (2).
Signature des mémoires
40. 1. – Les noms du procureur qui a rédigé le mémoire et de chaque partie qu’il représente doivent être dactylographiés à la fin de celui-ci.
2. – Le procureur qui a rédigé le mémoire, ou la partie qui comparaît en personne, doit signer l’original.
Mémoire relatif à l’appel incident
41. 1. – En cas d’appel incident, le mémoire de l’intimé doit comporter deux titres principaux, divisés chacun en cinq parties conformément à l’article 37, le premier intitulé « MÉMOIRE RELATIF À L’APPEL » en majuscules et le second, « MÉMOIRE RELATIF À L’APPEL INCIDENT » en majuscules.
2. – L’appelant peut, en réponse à l’appel incident, signifier et déposer un autre mémoire de la façon prescrite à l’article 38 pour l’intimé, dans les deux semaines suivant la signification du mémoire de l’intimé.
3. – Les mémoires sur appel incident ne peuvent compter plus de 20 pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire.
4. – Le registraire peut proroger ou abréger le délai prévu au paragraphe (2). DORS/91-347, art. 23.
Dépôt tardif des mémoires
42. 1. – Si l’appelant ne signifie pas ni ne dépose son mémoire de la façon prescrite à l’article 38, l’intimé peut demander le rejet de l’appel à la Cour ou à un juge.
2. – Si l’intimé ne dépose pas son mémoire dans le délai prescrit à l’article 38, l’appelant peut demander à un juge des directives relativement au dépôt du mémoire.
3. – Si l’intervenant visé au paragraphe 32(4) ne dépose pas son mémoire dans le délai prévu au paragraphe 38(3), l’appelant ou l’intimé peut présenter une requête à un juge pour obtenir des directives relativement au dépôt du mémoire. DORS/88-247, art. 17 ; DORS/91-347, art. 24, 39.
-
[1]
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, c. 11 (R.-U.) [ci-après la Charte]. [Retour au contenu] -
[2]
On retrouve la liste des principaux pouvoirs législatifs aux articles 91 (Parlement fédéral) et 92 (législatures provinciales) de la Loi constitutionnelle de 1867. [Retour au contenu] -
[3]
Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [1991] 2 R.C.S. 22 ; Douglas College c. Douglas / Kwantlen Faculty Association, [1990] 3 R.C.S. 570 ; Cuddy Chicks Ltd. c. Commission des relations de travail de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 5. [Retour au contenu] -
[4]
Douglas College c. Douglas / Kwantlen Faculty Association, [1990] 3 R.C.S. 570, à la p. 605 ; Cuddy Chicks Ltd. c. Commission des relations de travail de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 5, à la p. 17. [Retour au contenu] -
[5]
L.R.C. 1985, c. S-26 [ci-après la Loi]. [Retour au contenu] -
[6]
DORS / 83-74, mod. par DORS / 83-335, 83-930, 84-821, 87-60, 87-292, 88-247, 91-347, 92-674, 93-488, 94-748, 95-158, 95-325, 95-326, 95-573, 96-393, 97-210, 97-299, 97-476, 98-452, 98-489 [ci-après les Règles]. [Retour au contenu] -
[7]
Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, à la p. 185. [Retour au contenu] -
[8]
Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, à la p. 185. [Retour au contenu] -
[9]
Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, à la p. 188. [Retour au contenu] -
[10]
[1985] 1 R.C.S. 295. [Retour au contenu] -
[11]
À la p. 313. [Retour au contenu] -
[12]
[1998] 3 R.C.S. 157. [Retour au contenu] -
[13]
[1924] R.C.S. 331. [Retour au contenu] -
[14]
Thorson c. P.G. Canada, [1975] 1 R.C.S. 138 ; Nova Scotia Board of Censors c. McNeil, [1976] 2 R.C.S. 265 ; et Canada (ministre de la Justice) c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 265. [Retour au contenu] -
[15]
[1992] 1 R.C.S. 236. [Retour au contenu] -
[16]
Hy and Zel’s Inc. c. P.G. Ontario, [1993] 3 R.C.S. 113, au para. 13. [Retour au contenu] -
[17]
[1992] 1 R.C.S. 236, à la p. 252. [Retour au contenu] -
[18]
À la p. 250. [Retour au contenu] -
[19]
À la p. 252. [Retour au contenu] -
[20]
Institut professionnel de la Fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Commissaire), [1990] 2 R.C.S. 367, à la p. 400 ; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, [1998] 3 R.C.S. 157, aux pp.182-183. [Retour au contenu] -
[21]
Art. 53(3) de la Loi. [Retour au contenu] -
[22]
Article 43(1) des Règles. [Retour au contenu] -
[23]
[1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 459. [Retour au contenu] -
[24]
Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 R.C.S. 844, à la p. 880 ; Peterborough (Ville) c. Ramsden, [1993] 2 R.C.S. 1084. [Retour au contenu] -
[25]
Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 593. [Retour au contenu] -
[26]
Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, aux pp. 1196-1198. [Retour au contenu] -
[27]
Operation Dismantle c. R., [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 455. [Retour au contenu] -
[28]
Art. 33(3) de la Loi constitutionnelle de 1982. [Retour au contenu] -
[29]
Art. 33(4) de la Loi constitutionnelle de 1982. [Retour au contenu] -
[30]
Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 593 ; Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, à la p. 571. [Retour au contenu] -
[31]
[1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 593. [Retour au contenu] -
[32]
Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 599. [Retour au contenu] -
[33]
Hill c. Église de scientologie, [1995] 2 R.C.S. 1130, à la p. 1169. [Retour au contenu] -
[34]
Eldridge c. P.G. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 624, à la p. 661. [Retour au contenu] -
[35]
Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 S.C.R. 844, à la p. 878. [Retour au contenu] -
[36]
Eldridge c. P.G. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 624, à la p. 661. [Retour au contenu] -
[37]
Operation Dismantle c. R., [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 455. [Retour au contenu] -
[38]
Godbout c. Longueuil (Ville de), [1997] 3 S.C.R. 844, à la p. 880 ; Peterborough (Ville) c. Ramsden, [1993] 2 R.C.S. 1084 [Retour au contenu] -
[39]
British Columbia Government Employees’ Union c. P.G. Colombie-Britannique, [1988] 2 R.C.S. 214, aux pp. 243-244. [Retour au contenu] -
[40]
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la p. 1048. [Retour au contenu] -
[41]
Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, à la p. 314. [Retour au contenu] -
[42]
Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, à la p. 316 ; Douglas College c. Douglas/Kwantlen Faculty Association, [1990] 3 R.C.S. 570, à la p. 585. [Retour au contenu] -
[43]
Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211, aux pp. 311-312 ; Douglas College c. Douglas/Kwantlen Faculty Association, [1990] 3 R.C.S. 570, aux pp. 584-585. [Retour au contenu] -
[44]
Eldridge c. P.G. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 624, à la p. 665. [Retour au contenu] -
[45]
New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (président de l’Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319, aux pp. 392-394. [Retour au contenu] -
[46]
Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons, section locale 580 c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, à la p. 600. [Retour au contenu] -
[47]
McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 230, à la p. 275 ; Harrison c. Université de la Colombie-Britannique, [1990] 3 R.C.S. 451, à la p. 463 [Retour au contenu] -
[48]
Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483, à la p. 516. [Retour au contenu] -
[49]
Art. 32(4) des Règles. [Retour au contenu] -
[50]
Art. 13(1) des Règles. [Retour au contenu] -
[51]
Art. 40 et 43(3) de la Loi [Retour au contenu] -
[52]
Art. 43(1) de la Loi. [Retour au contenu] -
[53]
Art. 58(1)(a) de la Loi. [Retour au contenu] -
[54]
Art. 43(1)(a) de la Loi. [Retour au contenu] -
[55]
Art. 43(1)(c) de la Loi. [Retour au contenu] -
[56]
Art. 40(1) de la Loi. [Retour au contenu] -
[57]
Art. 35.1 de la Loi. [Retour au contenu] -
[58]
L.R.C. 1985, c. C-39. [Retour au contenu] -
[59]
L.R.C. 1985, c. C-34 (3e Suppl.), art. 8. [Retour au contenu] -
[60]
Art. 58(1)(b) de la Loi. [Retour au contenu] -
[61]
Art. 15(2) des Règles. [Retour au contenu] -
[62]
Art. 49 de la Loi. [Retour au contenu] -
[63]
Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême et modifiant en conséquence la Loi sur la Cour fédérale, L.C. 1974-75-76, c. 18, art. 5. [Retour au contenu] -
[64]
Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 1987, c. 42, art. 4. [Retour au contenu] -
[65]
Art. 44 de la Loi. [Retour au contenu] -
[66]
Art. 5 des Règles. [Retour au contenu] -
[67]
Art. 28(2) des Règles. [Retour au contenu] -
[68]
Art. 28(3) des Règles. [Retour au contenu] -
[69]
Art. 44 de la Loi. [Retour au contenu] -
[70]
Art. 44 de la Loi. [Retour au contenu] -
[71]
Art. 45 des Règles. [Retour au contenu] -
[72]
Art. 71(1) de la Loi. [Retour au contenu] -
[73]
Art. 42(1) des Règles. [Retour au contenu] -
[74]
Borowski c. P.G. Canada, [1989] 1 R.C.S. 342, à la p. 353. [Retour au contenu] -
[75]
Borowski c. P.G. Canada, [1989] 1 R.C.S. 342, aux pp. 358-363. [Retour au contenu] -
[76]
Operation Dismantle c. R., [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 472 ; Renvoi sur la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, à la p. 237. [Retour au contenu] -
[77]
Renvoi sur la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, à la p. 238. [Retour au contenu] -
[78]
Art. 51.1(1) des Règles. [Retour au contenu] -
[79]
Art. 51.1(3) des Règles. [Retour au contenu] -
[80]
Art. 51.1(4) des Règles. [Retour au contenu] -
[81]
Art. 32(1) des Règles. [Retour au contenu] -
[82]
Art. 32(4) des Règles. [Retour au contenu] -
[83]
[1997] 1 R.C.S. 241, aux pp. 264-265. [Retour au contenu] -
[84]
Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241, à la p. 267. [Retour au contenu] -
[85]
Art. 53(5) de la Loi. [Retour au contenu] -
[86]
Art. 53(6) de la Loi. [Retour au contenu] -
[87]
Art. 13(2) des Règles et art. 53(7) de la Loi. [Retour au contenu] -
[88]
[1998] 2 R.C.S. 217 [Retour au contenu] -
[89]
Renvoi : Workers’ Compensation Act, 1983 (T.-N.), [1989] 2 R.C.S. 335, à la p. 340. [Retour au contenu] -
[90]
R. c. Finta, [1993] 1 R.C.S. 1138, à la p. 1142. [Retour au contenu] -
[91]
Art. 18(2) des Règles. [Retour au contenu] -
[92]
Art. 18(3) des Règles. [Retour au contenu] -
[93]
Renvoi relatif à la T.P.S., [1992] 2 R.C.S. 445, à la p. 487. [Retour au contenu] -
[94]
Renvoi : Workers’ Compensation Act, 1983 (T.-N.), [1989] 2 R.C.S. 335, à la p. 341. [Retour au contenu] -
[95]
Art. 18(4) et 18(5) des Règles. [Retour au contenu] -
[96]
Art. 17(7) des Règles. [Retour au contenu] -
[97]
Voir par exemple Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143. [Retour au contenu] -
[98]
Art. 38(1) et 38(3)a) des Règles. [Retour au contenu] -
[99]
Art. 38(1) et 38(3)b) des Règles. [Retour au contenu] -
[100]
Art. 38(2) et 38(3)c) des Règles. [Retour au contenu] -
[101]
Art. 44(1) des Règles. [Retour au contenu] -
[102]
Art. 44(2) des Règles et art. 79(1) de la Loi. [Retour au contenu] -
[103]
Art. 46(2) des Règles. [Retour au contenu] -
[104]
Art. 46(1) des Règles et art. 79(1) de la Loi. [Retour au contenu] -
[105]
Art. 46(2) des Règles. [Retour au contenu] -
[106]
Art. 46(1) des Règles. [Retour au contenu] -
[107]
Art. 46(3) des Règles. [Retour au contenu] -
[108]
Art. 46(4) des Règles. [Retour au contenu] -
[109]
Art. 62(2) de la Loi et art. 33 (1) des Règles. [Retour au contenu] -
[110]
Art. 33(2) des Règles. [Retour au contenu] -
[111]
Art. 36 des Règles. [Retour au contenu] -
[112]
Art. 37 à 41 des Règles. [Retour au contenu] -
[113]
Voir les motifs du juge L’Heureux-Dubé dans Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, aux p. 700-705, pour une revue de la pratique de la Cour en ce qui a trait aux recherches en sciences sociales. [Retour au contenu] -
[114]
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, à la p. 1078. [Retour au contenu] -
[115]
Art. 48(1) de la Loi. [Retour au contenu] -
[116]
Art. 46(5) des Règles. [Retour au contenu] -
[117]
Art. 27(4) de la Loi. [Retour au contenu] -
[118]
Art. 53(4) de la Loi. [Retour au contenu] -
[119]
[1999] A.C.S. no 47 (QL). [Retour au contenu] -
[120]
Centre canadien de la statistique juridique, L’aide juridique au Canada : Une description des opérations, Ottawa, Statistique Canada, 1999. [Retour au contenu] -
[121]
Information disponible sur le site Internet du Programme de contestation judiciaire du Canada : ccppcj.ca. [Retour au contenu] -
[122]
Art. 51 des Règles. [Retour au contenu]
Rapport du tribunal suprême de justice du Cap-Vert
Octobre 2000
I. L’ouverture du droit de saisine
I – 1. – Les requérants
I – 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
Créé en 1994 par la Loi constitutionnelle n° 108/IV/94 du 24 octobre 1994, le Tribunal suprême de Justice dispose d’une expérience en matière de contrôle de constitutionnalité encore extrêmement réduite.
Le Tribunal suprême de Justice (en tant que tribunal constitutionnel) peut être saisi en contrôle concret par les parties ou par le représentant du ministère public auprès du Tribunal.
L’initiative du contrôle abstrait a posteriori revient à une des autorités suivantes :
- président de la République ;
- président de l’Assemblée nationale ;
- Premier ministre ;
- un quart des députés à l’Assemblée nationale ;
- procureur général de la République.
I – 1.1. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Sans objet.
I – 1.3. La Cour dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Non.
I – 1.4. Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Le requérant peut se désister de sa saisine jusqu’au moment de l’élaboration du projet de délibération par le juge rapporteur. Le désistement pourra être partiel.
I – 2. – Actes contrôlés
I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé
Il appartient au Tribunal suprême de Justice, en tant que tribunal constitutionnel, d’apprécier la constitutionnalité de toute loi ou règlement à caractère normatif émanant des organes de souveraineté. Dans la mesure où les accords et traités internationaux ont, une fois reçus dans l’ordre interne, force de loi et ont une valeur hiérarchique égale à celle de la source organique de leur approbation, ils sont aussi sujets au contrôle constitutionnel du Tribunal suprême de Justice.
Le contrôle préventif ne concerne que les traités et accords soumis à la ratification du président de la République et à la demande de cette autorité.
Le contrôle concret a posteriori (qui concerne tout type de norme, quelle que soit sa forme ou source organique) n’est recevable que si la question a été soulevée au cours de la procédure et ne peut être transmise qu’une fois épuisées toutes les voies de recours ordinaires.
Il existe aussi la possibilité de requêtes directes a posteriori et abstraites contre toute loi ou règlement à caractère normatif émanant des organes de souveraineté.
I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Non.
I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Oui, en matière de contrôle concret.
I – 3. – Les délais
I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Oui, en matière de contrôle abstrait.
I – 3.2. à I – 3.4.
Sans objet.
II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Non.
II – 1.2. – La représentation par ministère d’avocat est-elle obligatoire ?
Oui, la représentation par un avocat est obligatoire.
II – 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Oui, dans le cas du contrôle concret.
II – 2. – Conditions relatives au recours
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les recours sont numérotés selon leur espèce et par année civile.
II – 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes ?
- Les recours peuvent être déposés sur papier libre.
- Aucune annexe n’est obligatoire.
- Les mentions obligatoires sont :
- identification du requérant (nom, état civil, profession, résidence) ;
- date du dépôt de la requête ;
- signature de la requête par le requérant ;
- identification de la norme ou de la résolution contrôlée (autorité ayant édicté la norme, nomination, numérotation et date de publication dans le Bulletin officiel) ;
- motivation en fait et en droit.
II – 2.4. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Sans objet.
II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Oui, une telle procédure existe à l’initiative du Tribunal.
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II – 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
Le Tribunal suprême lui-même, sur la proposition du juge rapporteur.
II – 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Oui, un recours est possible devant le Tribunal suprême statuant en formation plénière.
II – 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ?
Le Tribunal statue en formation plénière avec un rapporteur choisi selon l’ordre de distribution des affaires.
Les requêtes sont enregistrées dans un livre approprié, par le secrétaire du tribunal, avec les pièces déposées.
Le président du Tribunal fait un examen préalable de la requête en cas de doutes formulés par le secrétaire.
II – 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
Toutes les décisions du Tribunal sont motivées et publiées.
II – 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Oui, ils sont passibles d’une amende de 1 000 à 100 000 escudos.
II – 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
Sans objet.
II – 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Sans objet.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III – 1. – Principe du contradictoire
III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Les autorités productrices de la norme ou de la résolution contestée sont avisées et les décisions sont notifiées aux parties ayant démontré un intérêt à agir.
III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
L’accès au prétoire se fait par un document écrit et signé par un avocat.
III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité peut-il être défini comme pleinement ou partiellement contradictoire ?
Il peut être défini comme pleinement contradictoire.
III – 2. – Égalité des armes
III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ?
Nulle pièce n’est exclue de la procédure.
III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ?
Oui.
III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Non.
III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non contestés dans la requête ?
Non.
III – 3. – Délai de jugement
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Oui.
En matière de contrôle préventif : le délai est de 20 jours à compter de la réception de la requête.
En matière de contrôle successif : Le rapporteur dispose d’un délai de 45 jours et la séance plénière du Tribunal suprême devra se réunir dans un délai de 20 jours à compter de la réception du projet de décision.
III – 3.2. à III – 3.3.
Sans objet.
Conclusion
La récente création du Tribunal constitutionnel – séparée du Tribunal suprême de Justice – va entraîner une restructuration de ces deux organes.
Cependant, l’installation du Tribunal constitutionnel requiert encore l’approbation d’une loi ordinaire par l’Assemblée nationale (article 289 de la Loi constitutionnelle) une fois les conditions matérielles et budgétaires remplies.
Rapport du conseil constitutionnel de Djibouti
Mars 2000
Rapport établi par Omar Chirdon Abass,
président du Conseil constitutionnel de Djibouti.
I. L’ouverture du droit de saisine
I – 1. – Les requérants
I – 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
Le Conseil constitutionnel qui n’est pas un organe politique mais une juridiction a pour principale mission d’assurer le respect de la hiérarchie des normes. Il est juge de la constitutionnalité du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, des lois organiques et ordinaires et des traités, accords et conventions.
Le contrôle de constitutionnalité des lois organiques et du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale présente un caractère obligatoire. Aux termes de l’article 78 de la Constitution, les lois organiques, avant leur promulgation et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Par contre celui exercé sur les lois ordinaires et les traités revêt un caractère facultatif. Le Conseil constitutionnel ne vérifie leur conformité à la Constitution que s’il en est saisi par une autorité habilitée à cet effet. L’article 79 de la Constitution dispose que les lois ordinaires peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale ou dix députés.
Qui sont les personnalité habilitées à saisir le Conseil constitutionnel pour examiner la constitutionnalité des lois ?
Ce sont :
- le président de la République ;
- le président de l’Assemblée nationale ;
- dix députés.
Le recours ne peut être introduit qu’entre l’adoption de la loi par l’Assemblée nationale et avant la promulgation par le président de la République. Après la promulgation, la loi devient inattaquable. Il s’agit donc d’un contrôle a priori.
Les traités, accords et conventions ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. L’article 63 de la Constitution souligne que « la ratification ou l’approbation d’un engagement international comportant une clause contraire aux dispositions de ladite Constitution ne peut intervenir que postérieurement à la révision de celle-ci ».

I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
En raison de la création récente du Conseil constitutionnel et aussi du volume peu important de contentieux soumis à son examen, il n’y a pas eu de modifications.
I – 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Les textes réglementant les conditions de saisine du Conseil constitutionnel n’ont pas prévu de dispositions qui permettent au Conseil constitutionnel de se saisir lui-même.
I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Rien n’empêche que les requérants puissent se désister de leur saisine selon la procédure habituelle de droit commun, dans tous les cas avant le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel.
Dans la limite du délai donné aux parties pour préparer et déposer leurs mémoires ampliatifs, en défense et en réplique, les requérants peuvent se désister en tout ou en partie de leur requête.
I – 2. – Actes contrôlés
I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé :
Le Conseil constitutionnel créé seulement en 1993 a traité essentiellement le contentieux électoral. Par contre les requêtes qui lui ont été déférées dans les autres domaines sont peu nombreuses.

I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Le rôle du Conseil constitutionnel se limite à vérifier la conformité des lois ordinaires ou organiques, du Règlement de l’Assemblée nationale et des traités à la Constitution. Le domaine réglementaire échappe à son contrôle et par là même tous les actes du gouvernement.
I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de constater la constitutionnalité d’une autre loi, que par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
À titre de rappel, il y a lieu de noter que le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel est un contrôle a priori c’est-à-dire qu’il ne s’exerce qu’avant la promulgation de la loi par le président de la République. Après la promulgation la loi devient inattaquable. Par conséquent, il n’est pas possible de contester une loi déjà promulguée par le biais d’un recours exercé contre une nouvelle loi.
Toutefois, les dispositions combinées de l’article 80 de la Constitution et de l’article 18 de la Loi organique n° 4/AN/93/3èL fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel prévoient que lorsque un plaideur soulève devant une juridiction l’exception d’inconstitutionnalité d’une disposition législative ou réglementaire relative aux droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution, la juridiction saisie surseoit à statuer et transmet immédiatement l’affaire à la Cour suprême qui dispose d’un délai d’un mois pour écarter l’exception si celle-ci n’est pas fondée sur un moyen sérieux ou, dans le cas contraire, si elle estime l’exception soulevée recevable, la Cour suprême saisit immédiatement le Conseil constitutionnel qui statue dans le délai d’un mois.
Une disposition jugée inconstitutionnelle cesse d’être applicable et ne peut plus être appliquée aux procédures.
I – 3. – Les délais
I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Les textes en vigueur relatifs à l’organisation, au fonctionnement et à la compétence du Conseil constitutionnel ne prévoient pas des recours recevables sans aucune limitation de délai sauf l’exception d’inconstitutionnalité qui peut être soulevée par tout plaideur à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction sur une question relative aux droits fondamentaux reconnus à toute personne.
I – 3.2. – Tableau des conditions de délais :

I – 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Les textes n’ont connu aucune modification sur ce point.
I – 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ? Les délais de recours sont courts et de ce fait les textes peuvent échapper à la vigilance de ceux qui sont habilités à contester leur conformité à la Constitution.
II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
La requête n’est soumise à aucun droit de timbre. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement.
II – 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
Les textes en vigueur n’imposent pas la représentation obligatoire par ministère d’avocat.
Le requérant peut, à son choix, se faire représenter soit par un avocat, soit par un représentant de son choix.
Il peut aussi plaider son affaire lui-même. Si le requérant fait choix d’une tierce personne pour le représenter ou l’assister dans les actes de la procédure, il doit l’indiquer expressément et par écrit.
II – 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Les textes n’imposent pas particulièrement l’intérêt à agir du requérant. Les personnes habilitées par la loi à saisir le Conseil constitutionnel sont limitées et leur domaine d’intervention est fixé avec précision.
II – 2. – Conditions relatives au recours
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Le Conseil constitutionnel a adopté une numérotation chronologique par année.
II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date de réception de la requête au secrétariat du Conseil constitutionnel fait foi.
II – 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Support :
La requête est écrite sur papier libre sans frais de timbre ou d’enregistrement.
Pièces annexes indispensables :
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Mentions obligatoires :
Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants ainsi que l’exposé des faits et moyens invoqués. Elles doivent être signées de leur auteur.
La norme ou l’acte contesté doit être clairement identifié et le requérant doit annexer à la requête les pièces utiles au soutien des moyens qu’il invoque.
Les mémoires produits au soutien des griefs soulevés ne peuvent contenir que le développement des moyens invoqués dans la requête, à l’exclusion de tout moyen nouveau.
Conditions formelles

Conditions matérielles

II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Non.
II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Exceptionnellement, le Conseil constitutionnel ou la section chargée de l’instruction de la requête peut accorder au requérant un délai supplémentaire pour la production d’une partie de ses pièces.
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II – 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
Sans objet.
II – 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Non.
II – 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
Lorsqu’il estime que le dossier est en état d’être jugé, le Conseil constitutionnel statue en formation plénière.
Un rapporteur désigné par le président du Conseil constitutionnel présente son rapport.
Le président du Conseil constitutionnel désigne un rapporteur qui peut être choisi soit parmi les membres titulaires du Conseil constitutionnel, soit parmi les rapporteurs adjoints.
Les requêtes sont enregistrées au Secrétariat général du Conseil constitutionnel dans l’ordre de leur réception ou de leur arrivée.
Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, adresses et qualité du ou des requérants ainsi que l’exposé des faits et moyens invoqués.
Il y a ensuite une simple vérification des pièces pour la constitution du dossier.
II – 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée et publiée ?
Oui. Elle est motivée, prononcée et publiée.
II – 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Non.
II – 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
Non.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III – 1. – Principe du contradictoire
III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à y être entendus sauf si le Conseil estime les auditions des parties nécessaires pour la manifestation de la vérité. La procédure est entièrement écrite. Les communications des pièces aux parties sont assurées par le soin du secrétariat du Conseil constitutionnel.
III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Le procès est défini comme pleinement contradictoire. Toutes les pièces sont communiquées aux parties qui peuvent aussi consulter les dossiers au siège du Conseil constitutionnel.
III – 2. – Égalité des armes
III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ?
La requête introductive, l’exposé des faits et les moyens invoqués, les mémoires ampliatifs, en défense et en réplique.
Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Toutes les pièces qui présentent un intérêt quelconque pour l’examen du dossier sont prises en compte.
III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ?
Oui, toutes les pièces produites sont communiquées aux parties par le soin du Conseil constitutionnel et les parties peuvent consulter les dossiers au siège du Conseil constitutionnel.
Il n’existe pas de pièces qui ne sont pas transmises et/ou accessibles.
III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Le Conseil constitutionnel peut ordonner, s’il l’estime utile, une enquête ou toute autre mesure d’instruction.
Il désigne un rapporteur chargé de recevoir sous serment, les dépositions des témoins et qui en dresse un procès-verbal qui sera communiqué aux parties qui peuvent déposer leurs observations écrites.
III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
Non.
III – 3. – Délai de jugement
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Oui. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Ce délai est ramené à 8 jours à la demande du président de la République, s’il y a urgence.
C’est le même dans tous les cas, sauf en ce qui concerne le contentieux électoral.
Les délais sont respectés.
III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
L’inscription d’une affaire à l’ordre du jour du Conseil est décidée par le président du Conseil constitutionnel.
III – 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
Le délai moyen qui s’écoule entre la fin de l’instruction et la tenue du délibéré ne pourra pas dépasser une semaine.
Le délai moyen qui s’écoule entre la tenue du délibéré et le prononcé de la décision ne pourra pas dépasser quarante-huit heures.
La notification de la décision est faite aussitôt qu’elle est rendue. Par contre, sa publication au Journal officiel dépend de la périodicité de la parution de celui-ci. Dans tous les cas, on peut estimer le délai moyen à un mois.
Conclusion
- – La mise en place du Conseil constitutionnel lui-même se trouve dans un stade de lent démarrage compte tenu du manque de moyen matériel et en personnel.
- – Il n’y a pas de réforme en cours ou en projet relative à l’accès au juge constitutionnel. Il n’existe pas de propositions d’amélioration, voire de transformation du système.
- – On n’assiste pas encore à une professionnalisation des requêtes.
Rapport de la Cour suprême constitutionnelle d’Égypte
Mars 2000
I. L’ouverture du droit de saisine
I – 1. – Les requérants
I – 1.1. – Tableau synthétique quantitatif des saisines

I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Les conditions d’ouverture du recours n’ont pas évolué dans le temps.
I – 1.3. – La Cour dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Oui, la Cour elle-même dispose d’une possibilité d’auto-saisine sur le texte de l’article 27 de la Loi sur la Cour qui prévoit que :
« Dans tous les cas, la Cour peut décider de l’inconstitutionnalité de tout texte législatif ou réglementaire qu’elle rencontre dans l’exercice de ses compétences et qui a un rapport avec le litige qui lui est soumis, après avoir suivi la procédure prescrite pour la mise en état des actions d’inconstitutionnalité. »
I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Oui, les requérants peuvent se désister de leur saisine soit totalement soit partiellement dans n’importe quels délais par une demande verbale ou écrite.
I – 2. – Actes contrôlés
I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’actes contrôlés :
Voir le tableau sous I-1.1. dans la mesure où nous n’avons pas les détails demandés.
I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Oui, les actes politiques sont placés par la jurisprudence hors contrôle.
I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Oui, à l’occasion d’un recours contre une loi, il est possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, soit par la voie prévue sous I-1.3. ci-dessus ou dans le cas des textes législatifs ou réglementaires détachables.
I – 3. – Les délais
I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Oui, il y a des recours recevables sans délai, ce sont les recours transmis directement par les tribunaux.
I – 3.2. – Tableau des conditions de délais :
Voir I-2.1.
I – 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Non.
I – 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
Non.
II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Selon l’article 53 de la Loi sur la Cour, les recours d’inconstitutionnalité sont soumis à un droit fixe, dont le montant est de vingt cinq livres égyptiennes.
En plus, le demandeur doit, au moment où il introduit le recours, déposer à la caisse de la Cour une caution d’un montant de vingt cinq livres égyptiennes.
II – 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
La représentation du requérant par un avocat, en introduisant le recours, est obligatoire.
II – 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Oui, le requérant doit démontrer son intérêt à agir.
II – 2. – Conditions relatives au recours
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les requêtes sont numérotées selon le moment où elles sont introduites.
II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date de réception qui est la même que la date de l’enregistrement est la date qui fait foi pour la suite des procédures.
II – 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Les requêtes doivent être signées par un avocat admis à plaider devant la Cour parmi les avocats devant la Cour de Cassation et la Haute Cour Administrative.
Les requêtes en inconstitutionnalité des lois et règlements doivent faire état du texte dont la constitutionnalité est en cause, de la disposition constitutionnelle qu’il est censé enfreindre et des modalités de cette infraction.
II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Non.
II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Non.
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II – 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
Il est statué sur la recevabilité par le jugement de la Cour.
II – 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Non.
II – 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
La Cour statue sur l’irrecevabilité en formation plénière.
II – 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle motivée, prononcée, publiée ?
Oui, la décision d’irrecevabilité doit être motivée, prononcée et publiée.
II – 3.5. – Les requérants abusifs sont-il passibles d’une amende pour abus de droit d’agir ?
Oui, selon l’article 53 de la Loi sur la Cour, alinéa 5, si la Cour juge le recours irrecevable ou le rejette, la Cour ordonne la confiscation de la caution ci-dessus mentionnée.
II – 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
Non.
II – 4. – Motifs de rejet.
Voir I-2.1.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III – 1. – Principe du contradictoire
III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Non.
III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
Les parties ont accès au prétoire dans toutes les étapes de la procédure et dans toutes les conditions soit oralement, par écrit et par ministère d’avocat.
III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Le procès en constitutionnalité devant la Cour peut être défini soit comme pleinement ou partiellement contradictoire.
III – 2. – Égalité des armes
III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
N’importe quelle pièce peut être constitutive de la procédure. Il n’y a pas de pièces exclues de la procédure.
III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Toutes les pièces sont accessibles aux parties.
III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Oui, ce sont les clarifications et les documents.
III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyen non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
Oui. Voir I-1.3. Les requérants ont la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge.
III – 3. – Délai de jugement
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Non. C’est le même dans tous les cas.
III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
Non.
III – 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
Le délai moyen qui s’écoule entre le prononcé de la décision en constitutionnalité et la publication est de quinze jours.
Conclusion
- – L’accès au juge constitutionnel n’a pas conduit à des adaptations structurelles de la Cour.
- – Il n’existe pas de réforme en cours ou en projet relative à l’accès au juge constitutionnel.
- – Non, on n’assiste pas à une professionnalisation des requêtes.
Rapport du conseil constitutionnel de France
Mars 2000
Le rapport français a été préparé en collaboration avec
Monsieur Pascal Jan,
Professeur à l’Université
de Bretagne-Occidentale (Brest).
Introduction
Les conditions d’accès au juge et l’observation des règles d’organisation des recours sont au cœur de la science du droit et de l’effectivité de la règle de droit. H. Kelsen, théoricien du modèle de justice constitutionnelle concentrée, l’avait bien compris qui écrivait en 1928 dans une contribution majeure que « la question du mode d’introduction de la procédure devant le tribunal constitutionnel a une importance primordiale : c’est de sa solution que dépend principalement la mesure dans laquelle le tribunal constitutionnel pourra remplir sa mission de garant de la Constitution »[1]. S’interroger sur les conditions d’accès au juge constitutionnel c’est bien davantage qu’exposer de simples techniques procédurales. C’est mesurer l’efficacité du contrôle du Conseil constitutionnel. L’analyse et l’insistance du professeur viennois sur le caractère fondamental des règles procédurales ont pu se nourrir des premières expériences françaises de contrôle de constitutionnalité des lois qui toutes échouèrent en raison notamment des modalités de recours retenues.
Le modèle français de justice constitutionnelle présente des particularités singulières dans le contrôle des normes. Seules les autorités politiques, dont les parlementaires, ont accès au juge, le contrôle – abstrait – est, sauf exception, de type préventif. Surtout, les modalités et les procédures d’accès au juge constitutionnel sont, pour l’essentiel, préétablies dans la Constitution (C) et précisées par l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant Loi organique relative au Conseil constitutionnel (ord.) qu’il s’agisse des titulaires du droit de saisine ou du moment de l’introduction du recours. Quant au déroulement du procès, il est très peu formalisé. Il n’existe pas de règlement intérieur de procédure. Enfin, à la différence des juges ordinaires, le juge constitutionnel intervient de façon marginale dans la définition de la recevabilité des recours.
I. L’ouverture du droit de saisine
I – 1. – Les requérants
L’une des spécificités du contentieux constitutionnel français normatif tient à la désignation a priori d’autorités politiques de saisine.
I – 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant


De toutes les compétences dévolues au Conseil constitutionnel par la Constitution, le contrôle de constitutionnalité de la loi suscite, depuis ses origines, de nombreux débats juridiques et politiques dès lors qu’est abordée la question de ses conditions d’ouverture. Les révisions constitutionnelles relatives au Conseil constitutionnel, qu’elles aient abouti ou non, ont d’ailleurs eu toutes pour objet non pas l’élargissement du champ de compétence du Conseil constitutionnel (hormis la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 qui soumet au contrôle du juge les lois du pays de Nouvelle-Calédonie -77C) mais l’extension des personnes habilitées à lui déférer un acte.
Requérants : En volume, les saisines parlementaires constituent l’essentiel des demandes juridictionnelles (93 %). Les lois financières et économiques font, le plus souvent, l’objet de saisines. Mais lorsqu’on rapporte le nombre de saisines à celui des textes votés dans un domaine donné, on s’aperçoit que les requérants sont particulièrement vigilants à l’égard de textes légiférant en matière de libertés publiques (droit des étrangers, circulation des biens et des personnes, communication et droit pénal).
L’article 61.2C permet à deux minorités, une minorité de députés et une minorité de sénateurs, de contester la loi [2] Si les députés s’adressent plus fréquemment à la Haute Juridiction, l’écart tend à se réduire, les sénateurs montrant un activisme comparable à leurs homologues de l’Assemblée nationale. De 1975 à 1985, les sénateurs sont à l’origine d’un peu plus du quart de l’activité du Conseil, mais ce chiffre atteint 40 % pour la période 1997-2000. La tendance est d’autant plus significative qu’elle se vérifie sur tous les bancs sénatoriaux. Par ailleurs, il est remarquable de constater que le nombre de saisines pour la période 1975-1985 est sensiblement égal à celui de la décade suivante 1986-1996 avec respectivement 159 et 157 demandes enregistrées. Ces données chiffrées signifient que les minorités parlementaires se tournent régulièrement vers le Conseil pour obtenir sur le terrain juridique ce qu’elles n’ont pu obtenir sur le terrain politique quelle que soit leur sensibilité politique.
Jusqu’à l’élargissement des autorités de saisine en 1974, les autorités de l’État n’ont agi qu’à neuf reprises (6 saisines du Premier ministre et 3 du président du Sénat). Plusieurs explications peuvent être données à ce faible débit. D’une part, le phénomène majoritaire limitait considérablement les désaccords entre le Premier ministre, qui dirige l’action du gouvernement, et le président de l’Assemblée nationale qui représentait la majorité de la chambre sur laquelle s’appuyait l’exécutif collégial. L’adéquation des majorités parlementaire et présidentielle rendait quant à elle inopérante la prérogative présidentielle, conçue en 1958 comme une prérogative attachée à la fonction d’arbitrage du chef de l’État (5C). Celui-ci préserve ainsi son autorité et évite de critiquer une loi initiée par le gouvernement dont il n’est pas certain qu’elle sera partiellement ou totalement invalidée. D’autre part, il n’y avait pas place pour les doutes ou contestations des dispositions de fond quant à leur conformité aux droits et principes fondamentaux consacrés par la Déclaration des droits de l’homme de 1789, confirmés et complétés par le Préambule de la Constitution de 1946, deux textes visés dans le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel affirme clairement leur valeur constitutionnelle. En effet, avant la décision Liberté d’association du 16 juillet 1971, les seules questions constitutionnelles soulevées avaient trait à la répartition des compétences entre le domaine de la loi et celui du règlement. C’est la raison pour laquelle le chef du gouvernement saisira le Conseil sur la constitutionnalité des dispositions législatives au seul regard des articles 34 et 37 de la Constitution. Dans ces conditions, le président du Sénat incarnait le seul pôle éventuel d’opposition à un texte approuvé par le gouvernement et la majorité des députés. Il saisit le Conseil constitutionnel à cette fin à plusieurs reprises et ses initiatives ont marqué la seconde naissance du Conseil. Elles traduisaient un sentiment partagé par la majorité des membres de la Chambre Haute : une fois le droit reconnu à une minorité de sénateurs de saisir le Conseil, le rôle du président s’effaça.
Objet du contrôle : L’ouverture du contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux aux parlementaires en 1992 (54C) n’a pas produit cet effet de « ruée » vers le juge observé pour les lois. Plusieurs explications peuvent être avancées. Primo, les engagements internationaux soulèvent rarement des enjeux politiques majeurs, seuls susceptibles d’intéresser les parlementaires dans leur stratégie de contestation du gouvernement. Deusio, lorsque de tels traités ont été négociés, le président de la République et/ou le Premier ministre se sont empressés de les déférer au contrôle du juge, conformément aux missions qui sont les leurs. Les recours présidentiels, six à ce jour [3] , obéissent à une fonction d’arbitrage qui fait du chef de l’État le gardien des institutions et de l’indépendance nationale mais également reposent sur sa capacité à soumettre à l’approbation populaire l’autorisation de ratifier un traité qui « sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » (11C). Quant au Premier ministre, son droit d’agir dont il a usé à trois reprises [4] découle de ses compétences constitutionnelles (20 et 21C) qui l’associent à la conduite des relations internationale. Tertio, il parait difficile pour les parlementaires, ainsi que pour les présidents des chambres, de contester ou de douter de la constitutionnalité d’un instrument international sans avoir eu connaissance de sa teneur précise avant que ne s’engage la procédure législative d’autorisation de ratification ou d’approbation. La seule saisine parlementaire (1992 sur le traité d’Union européenne) concerna un Traité dont les auteurs connaissaient le contenu en raison du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel (n° 92-308DC) et de la nécessité de réformer la Constitution afin d’en autoriser la ratification (révision du 25 juin 1992).
À ces raisons, il convient d’ajouter une explication plus technique : la circonstance que les traités sont soumis pour avis au Conseil d’État lequel en examine, notamment, la conformité à la Constitution. Les stipulations dont la constitutionnalité lui apparaît douteuse disparaissent donc le plus souvent, ex ante, du texte.
Le classement par périodes des autres saisines, obligatoires pour les Lois organiques et les Règlements des assemblées parlementaires (61.1C) ou facultatives pour l’examen des fins de non-recevoir (41C) ou des demandes de délégalisation (37.2C), deux procédures relatives au partage des compétences de la loi et du règlement, n’est pas significatif. En effet, non seulement les conditions de recours n’ont pas évolué mais surtout, la saisine du juge en ces matières dépend entièrement des nécessités et de l’opportunité de modifier des textes en vigueur ou de légiférer dans de nouveaux domaines.
On fera simplement observer, en premier lieu, la désuétude qui frappe les recours exercés en application de l’article 41 de la Constitution. Comme en ce qui concerne l’article 37.2, l’article 41 a pour seul objet de faire statuer le Conseil constitutionnel, au cours de la procédure parlementaire, sur la question de savoir si un texte d’initiative parlementaire peut ou non figurer dans une loi ou s’il relève du domaine réglementaire. Compte tenu de la perturbation que cette procédure crée dans l’ordre du jour parlementaire, de la possibilité pour le Premier ministre de faire usage de l’article 37.2C et de la perméabilité de la frontière séparant la loi du règlement [5] , les saisines de l’article 41 sont inexistantes depuis 1979. En revanche, les saisines du Premier ministre tendant au déclassement des textes en forme législative (37.2C) sont relativement nombreuses. Mais ce chiffre ne fait que traduire des demandes ponctuelles des ministères ou du Premier ministre à la suite de la consultation de la commission de codification.
En second lieu, si les députés et les sénateurs ont, dans les premières années de la Ve République mais également plus récemment, modifié à de nombreuses reprises leur règlement, les 29 saisines des présidents de chambre (qui agissent comme les représentants de leur assemblée au nom de la protection imposée de la stabilité institutionnelle) [6] , traduisent une prise de conscience et une volonté réelle de moderniser la procédure législative en perfectionnant le contrôle du gouvernement et en permettant une participation plus effective du Parlement national à l’élaboration de la législation communautaire. S’agissant des deux saisines du président de l’Assemblée nationale portant sur les règlements du Congrès [7] , réunion de l’Assemblée nationale et du Sénat pour voter un projet de loi de révision constitutionnelle, elles traduisent une conception extensive de la notion même d’assemblée parlementaire.
Quant à l’unique recours enregistré à ce jour contre une loi du pays de Nouvelle-Calédonie (n° 2000-1 LP du 27 janvier 2000), il a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Cette première saisine portait sur une loi financière qui n’est que la troisième votée par le congrès.
I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
L’une des particularités du fonctionnement de la juridiction constitutionnelle tient, pour les aspects essentiels, à ce qu’elle trouve sa source dans la Constitution : la détermination des autorités et personnes habilitées à la saisir ainsi que le moment de la saisine sont en effet fixés par le texte constitutionnel. Dès lors, l’évolution éventuelle des conditions d’ouverture des recours exige une révision constitutionnelle.
À ce jour, deux réformes constitutionnelles ont élargi le droit de recours, à chaque fois au profit de la minorité parlementaire.
Jusqu’à la Loi constitutionnelle du 29 octobre 1974, seules les quatre plus hautes autorités de l’État avaient le droit de déférer au Conseil une loi définitivement adoptée par le Parlement : le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. La révision de l’article 61C initiée par le président de la République nouvellement élu brisa ce monopole en étendant cette prérogative à 60 députés ou 60 sénateurs. Cette modification constitutionnelle a transformé le Conseil constitutionnel, sur le plan de son activité et de sa place dans les institutions de la Ve République. Plus de 97 % des décisions du Conseil sont postérieures à l’acte constituant du 29 octobre 1974. Depuis cette date, le juge constitutionnel statue en moyenne plus de dix fois par an sur la constitutionnalité d’un texte législatif soit autant qu’entre 1958 et 1974 ! La pratique parlementaire de la saisine est bien le moteur de la garantie effective des règles constitutionnelles. Par ailleurs, l’extension du droit de saisine a donné son plein effet à la décision fondatrice du 16 juillet 1971 (n° 71-44 DC, Rec. 29) par laquelle le juge conféra valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution de 1958, lequel renvoie à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Les saisissants invoquent en effet régulièrement, bien que de façon inégale, ces éléments du bloc de constitutionnalité à l’appui d’un recours contre une loi.
Par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 qui modifia la Constitution afin de permettre que s’engage la procédure d’autorisation de ratifier du traité d’Union européenne déclaré partiellement contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel (n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Rec. 55), les parlementaires obtinrent une nouvelle rédaction de l’article 54 de la Constitution leur permettant de saisir le Conseil d’un engagement international avant sa ratification dans les conditions requises pour déférer
une loi ordinaire. Cette faculté, ouverte dès 1958 aux autorités déjà habilitées à déférer une loi ordinaire, a été utilisée immédiatement par les sénateurs (n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Rec. 76). Depuis lors, les parlementaires se sont abstenus d’agir en partie en raison des saisines effectuées conjointement par le président de la République et le Premier ministre (n° 97-394 DC du 31 décembre 1997 et n° 99-408 DC du 22 janvier 1999) ou à la seule initiative du chef de l’État (n° 99-412 DC du 15 juin 1999) s’agissant de traités internationaux portant atteinte à la souveraineté nationale.
Dans une certaine mesure, la révision constitutionnelle de 1992 élargit en la parachevant la jurisprudence constitutionnelle qui admît, dès 1976, la possibilité pour un groupe de parlementaires de critiquer la constitutionnalité d’un traité ou d’un accord international à l’occasion de l’examen de constitutionnalité d’une loi de ratification ou d’approbation (n° 76-71 des 30-31 décembre 1976, Rec.15. Pour une première application, n° 80-116 DC du 16 juillet 1980, Rec.36).
I – 1.3. – La Cour elle-même dispose t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Conformément à la tradition juridictionnelle française, seules sont recevables les saisines des personnes et autorités extérieures à la juridiction constitutionnelle.
Des propositions et projets attribuant un pouvoir d’auto-saisine au juge constitutionnel ont pourtant été soutenus publiquement. Outre une réforme en ce sens réclamée en 1960 par l’ancien président de la République et membre du Conseil constitutionnel, Vincent Auriol, il importe de mentionner la tentative d’introduction d’un droit de saisine proprio motu au Conseil pour examiner les lois qui lui « paraîtraient porter atteinte aux libertés publiques garanties par la Constitution » lors de la discussion du projet de loi constitutionnelle étendant le droit de recours au Conseil (1974). En raison du refus presque unanime des parlementaires, en l’état actuel des textes, les pouvoirs du juge constitutionnel ne s’exercent jamais spontanément. Ce débat n’est plus d’actualité.
En revanche, lorsqu’il est saisi d’un texte dans les conditions prévues par l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, le juge constitutionnel peut soulever d’office des griefs qui n’ont pas été invoqués par les requérants.
I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Le Conseil constitutionnel a tranché cette question à l’occasion du contrôle de constitutionnalité d’une loi dans le sens de la négative par sa décision n° 96-386 DC du 30 décembre 1996 (Rec.154). Il y a sans doute lieu d’étendre cette jurisprudence au contrôle des engagements internationaux. La question reste entière pour les autres chefs de compétence du Conseil.
Une fois la saisine déposée en application de l’article 61.2C, tout désistement est impossible, quel que soit son auteur. Le Conseil a considéré en effet « qu’aucun des textes fixant la procédure applicable devant lui n’habilite les autorités de saisine à [le] dessaisir ». La saisine est collective, elle résulte indivisiblement de l’ensemble des signataires et déclenche un processus de contrôle qui échappe aux saisissants. Ce qui est applicable à l’acte de procédure vaut a fortiori pour les moyens développés à son appui, d’autant que la recevabilité du recours n’est en aucune façon tributaire de leur existence (n° 86-211 DC du 26 août 1986, Rec. 120 et n° 95-360 DC du 2 février 1995, Rec. 195). Une fois introduite, la saisine dépasse l’initiative du requérant pour assurer le respect inconditionné et supérieur de la constitutionnalité.
La décision, confirmée depuis lors (n° 99-421 DC du 16 décembre 1999), n’admet le désistement d’instance qu’en cas d’erreur matérielle, de fraude ou de vice du consentement. Dans l’affaire précitée, le juge n’a pas regardé comme constitutive d’un vice ou d’une erreur matérielle la confusion qui aurait accompagné la signature d’une saisine. Il convient de noter que l’authenticité de la signature de chaque requérant est vérifiée : en cas de doute, le signataire n’est pas compté au nombre des auteurs de la saisine.
Le raisonnement du Conseil repose sur deux arguments. Le premier d’ordre procédural découle d’une interprétation littérale du texte constitutionnel (art 61.2 C) et de l’ordonnance organique relative au Conseil (art. 18). À lui seul, l’argument peut paraître fragile dans la mesure où le Conseil admet le désistement dans le contentieux des élections parlementaires alors même que l’ordonnance et le règlement de procédure applicable au contentieux des élections législatives et sénatoriales sont silencieux sur ce point. D’où le recours à un critère décisif au terme duquel aucune disposition constitutionnelle ou organique n’autorise les autorités habilitées à le saisir à « faire obstacle à la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité engagé ». Par cette formulation, le Conseil signifie que la saisine est assimilable à un recours d’ordre public qui fait obligation au juge, une fois saisi valablement, de statuer sur la demande indépendamment de la volonté ou de la situation juridique de son ou ses auteurs.
I – 2. – Actes contrôlés
Déterminés à contenir le Parlement, les constituants ont décidé de soumettre au contrôle du Conseil constitutionnel les principaux actes adoptés par les assemblées : lois et résolutions réglementaires. Dans le même esprit, le gouvernement s’est vu reconnaître le droit de saisir le juge afin d’obtenir le déclassement des textes de forme législative qui empiéteraient dans le domaine réglementaire. Enfin, le contrôle des engagements internationaux répond à une volonté des rédacteurs du texte constitutionnel : préserver la souveraineté nationale au moment où s’affirme une entité communautaire.
I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé

I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
La Constitution de 1958 délimite strictement la compétence du Conseil constitutionnel. Elle ne peut être précisée et complétée par voie de Loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. En conséquence, le juge constitutionnel ne saurait se prononcer au titre d’autres chefs de compétence que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la Loi organique. C’est en application de ces principes rappelés dans une décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992 (Rec.94) que le Conseil constitutionnel a expressément dégagé les actes insusceptibles de contrôle.
Entrent dans cette catégorie les lois référendaires (n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 Rec. 27 et n° 92-313 DC du 23 septembre 1992 Rec. 94). L’impunité juridictionnelle de l’œuvre normative du peuple s’applique quelle que soit sa fonction, constituante ou législative. Le Conseil constitutionnel la soustrait à tout contrôle, quel qu’en soit le fondement (11C ou 89C). La Haute instance en a ainsi jugé à deux reprises à propos de lois soumises à l’approbation populaire sur le fondement de l’article 11 de la Constitution. En 1962, la déclaration d’incompétence concernait la loi référendaire de nature constitutionnelle qui instituait l’élection du président de la République au suffrage universel direct. Trente ans plus tard, en septembre 1992, le Conseil réaffirme sa position à l’occasion de la loi autorisant la ratification du Traité de l’Union européenne.
Ces deux décisions d’incompétence s’appuient autant sur les sources formelles (Constitution et ordonnance du 7 novembre 1958 portant Loi organique relative au Conseil constitutionnel) que sur le rôle de la juridiction constitutionnelle. Selon le Conseil constitutionnel, le terme « lois » visé à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution ne concerne que les lois parlementaires, seules susceptibles de porter atteinte à l’équilibre des pouvoirs établi en 1958 et dont le Conseil est le garant. L’incompétence qui repose essentiellement sur un critère organique ne contredit pas pour autant l’article 3 de la Constitution française qui place au même rang l’exercice de la souveraineté nationale par le peuple ou ses représentants puisque le juge admet la modification d’une loi référendaire par une loi parlementaire (n° 76-65 DC du 14 juin 1976, Rec.28 et n° 89-265 DC du 9 janvier 1990, Rec.12).
Le Conseil a jugé également qu’échappaient à l’examen de constitutionnalité les ordonnances de l’article 92 de la Constitution portant Loi organique dont l’objet consistait à mettre en place les institutions (n° 60-6 DC du 15 janvier 1960, Rec. 21). Or, en application de l’article 61.1C, les lois organiques sont transmises obligatoirement au Conseil avant leur promulgation. La question d’une remise en cause de cette solution en vertu de la jurisprudence du contrôle limité d’une loi promulguée (n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, cf. infra) n’a pas été posée. La doctrine est partagée. On remarquera simplement qu’il ne s’agit pas de textes promulgués, donc susceptibles de rentrer dans le cadre de la jurisprudence dite « État d’urgence de Nouvelle-Calédonie » (se reporter au point I-2.3. ci-après).
Par ailleurs, statuant toujours sur la constitutionnalité d’une loi, le Conseil a précisé en 1985 qu’en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, le contrôle de constitutionnalité ne peut porter sur les ordonnances prévues par l’article 38 de la Constitution (qui autorisent provisoirement le gouvernement à intervenir dans le domaine législatif) lorsqu’elles n’ont pas été ratifiées. Le Conseil d’État n’exerce pas moins un contrôle de légalité sur de tels textes en l’absence d’une intervention législative explicite ou implicite (n° 85-196 DC du 8 août 1985, Rec. 63).
Enfin, la question de la justiciabilité des lois parlementaires constitutionnelles reste ouverte. Saisi pour la seconde fois de la constitutionnalité du traité d’Union européenne par plus de soixante sénateurs eu égard à la Constitution modifiée (révision du 25 juin 1992 qui tirait les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1992 déclarant partiellement contraire l’engagement international soumis à son examen), le Conseil constitutionnel pose comme principe que le pouvoir constituant est souverain sous réserve des limitations formelles touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut être engagée ou poursuivie et des limitations matérielles (la forme républicaine du gouvernement). La doctrine interprète diversement le raisonnement du juge.
I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi que celle, par exemple, qui fait l’objet du recours modifie ?
L’article 61, alinéa 2, de la Constitution institue un contrôle a priori et abstrait sur une loi. Cette spécificité du contrôle de constitutionnalité français n’a pas empêché le Conseil constitutionnel d’admettre un contrôle limité des lois déjà promulguées par une décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 (décision précitée, Rec. 43).
Aux termes du dixième considérant de cette décision, il est indiqué que « si la régularité au regard de la Constitution des termes de la loi promulguée peut être utilement contestée à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine, il ne saurait en être de même lorsqu’il s’agit de la simple mise en application d’une telle loi ».
Cette jurisprudence ouvre une brèche, sous certaines conditions, dans le principe selon lequel le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de lois non promulguées. Toutefois, les affaires soumises à l’appréciation du Conseil constitutionnel sont rarement l’occasion d’une mise en œuvre de cette jurisprudence. Depuis 1985, le Conseil constitutionnel ne s’est livré à l’examen approfondi de la constitutionnalité de dispositions législatives promulguées qu’à quatre reprises. Par trois fois (n° 89-256 DC du 29 juillet 1989 / n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 et n° 97-388 du 20 mars 1997) le résultat s’est traduit par un constat de non-contrariété. En revanche, la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 concernant une Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie est la première application positive de cette jurisprudence, le juge déclarant « contraires à la Constitution » deux articles d’une loi en vigueur. La particularité de cette décision tient aussi à ce que ces dispositions étaient contenues dans une loi qui avait déjà été déférée. Il en résulte que l’autorité de la chose jugée (art. 62 C) n’est pas opposable au Conseil constitutionnel, position logique sauf à figer la jurisprudence et empêcher toute évolution et adaptation de la jurisprudence constitutionnelle. Enfin, pour conclure sur cette question, le Conseil constitutionnel refuse d’étendre la jurisprudence État d’urgence en Nouvelle-Calédonie à l’appréciation de la validité des engagements internationaux lorsqu’il en est saisi à titre préventif (art. 54 C, décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992 précitée).
I – 3. – Les délais
Les délais de procédure enferment dans une durée plus ou moins longue l’exercice d’une action en justice pour réduire l’incertitude juridique pesant sur un acte. Le problème de la fixation des délais (ou de leur absence) relève soit de la loi constitutionnelle, soit de l’ordonnance organique relative au Conseil constitutionnel.
I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Par dérogation au droit commun des recours, le droit constitutionnel juridictionnel connaît plusieurs situations de contrôle dont le déclenchement n’est subordonné à aucun délai.
À commencer, en premier lieu, pour certains recours obligatoires. L’article 61, alinéa 1, de la Constitution dispose que les règlements des assemblées parlementaires sont examinés obligatoirement par le Conseil avant leur mise en application. La date d’application de la résolution parlementaire n’étant jamais arrêtée, aucun délai ne s’impose au président d’une Chambre pour la transmettre au juge constitutionnel. L’absence de délai-limite n’a pas eu de répercussion sur la pratique de la saisine puisque, à l’exception des règlements définitifs, jamais le président du Sénat ou celui de l’Assemblée nationale n’ont saisi tardivement le juge [8] . Des études statistiques montrent que le président de l’Assemblée nationale tarde moins que son homologue du Sénat à déférer les résolutions portant modification du Règlement au Conseil. Mais, dans l’ensemble, ces autorités accomplissent leur mission avec diligence. Depuis l’application des règlements définitifs et pour un nombre équivalent de recours (29), le délai moyen de saisine s’établit à 2,9 jours pour le président de l’Assemblée nationale contre 2,3 jours pour celui du Sénat.
En matière de recours facultatifs, les deux procédures de l’examen de fins de non-recevoir (41 C) et de l’appréciation de la nature juridique d’un texte de forme législative (37, alinéa 2 C) n’obéissent à aucun délai. Dans la première hypothèse, sur les onze demandes enregistrées au Conseil, toutes l’ont été le jour même de la suspension de séance. Dans la seconde hypothèse qui donne lieu à un contentieux plus étoffé, la demande dépend d’une appréciation discrétionnaire des ministères et des actions qu’entend mener le gouvernement. Aucun délai butoir n’est donc susceptible d’être établi. Ainsi, le gouvernement peut saisir le Conseil d’un texte plus d’une dizaine d’années après sa promulgation (par exemple : n° 99-185 L du 18 mars 1999) comme moins d’une année après son entrée en vigueur (n° 77-100 L du 16 novembre 1977).
I – 3.2. – Tableau des conditions de délais

Ce tableau conduit aux précisions suivantes :
- – Aux termes de l’article 10 de la Constitution, le président de la République dispose des quinze jours qui suivent la transmission de la loi au gouvernement pour promulguer le texte définitivement adopté par le Parlement. La loi promulguée s’entend de la loi signée par le chef de l’État, laquelle signature précède matériellement la publication de la loi au Journal Officiel. La promulgation se distingue donc de la publication. La loi promulguée qui est datée du jour de sa signature par le chef de l’État ne peut plus être directement contestée par voie d’action a priori devant le Conseil constitutionnel (n° 96-392 DC du 7 novembre 1997). Par cette décision et cette distinction établie entre promulgation et publication, le Conseil a précisé implicitement mais nécessairement le délai exact dont disposaient les saisissants pour déférer une loi ordinaire au Conseil. La computation des délais inclut le dies a quo (le point de départ du délai commence à courir dans l’instant qui suit l’adoption définitive de la loi) mais exclut le dies ad quem (le terme du délai s’achève la veille du jour de la promulgation).
- – S’agissant des lois organiques, pour être obligatoire, le contrôle n’est pas automatique. Même si jusqu’ici le Premier ministre a saisi le Conseil dans un délai moyen de six jours, il lui est toujours loisible de faire obstacle momentanément à la promulgation de la loi en refusant de saisir le juge comme le lui en font l’obligation les articles 61.1C et 46.5C. Cette circonstance très improbable se rencontrerait si le Parlement parvenait à imposer au gouvernement un texte ou des dispositions que celui-ci réprouverait fermement et totalement. Depuis la fixation d’un ordre du jour fixé par les parlementaires (révision constitutionnelle du 4 août 1995 modifiant l’article 48 de la Constitution) ce cas de figure extrême ne peut être exclu en dépit de son caractère très improbable.
- – S’agissant du contrôle des engagements internationaux, aucune disposition n’indique avec précision le moment de l’examen préventif de non-contrariété à la Constitution. C’est par une décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992 que le juge précise qu’« un engagement international peut être soumis au Conseil constitutionnel (…) dès lors qu’il a été signé au nom de la République française ». De même, le juge rappelle dans la même décision que les autorités de saisine peuvent saisir le Conseil constitutionnel jusqu’à l’adoption dans l’ordre juridique interne du texte qui en autorise la ratification ou l’approbation. Ainsi, la saisine peut intervenir avant l’engagement de la procédure législative, comme au cours de celle-ci. Jusqu’à présent, à l’exception du premier recours intervenu en 1970 (n° 70-39 DC du 19 juin 1970, Rec.15), toutes les saisines ont devancé l’ouverture du débat parlementaire afin d’en clarifier les termes et accélérer la procédure en la débarrassant des questions constitutionnelles.
I – 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Les différentes révisions constitutionnelles intervenues quant à la procédure devant le Conseil constitutionnel (révisions des 29 octobre 1974 et 25 juin 1992) n’ont abouti à aucune modification des délais de recours.
I – 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
Comme il a été indiqué au point I.3.2., ce problème ne se pose pas pour les textes soumis à recours obligatoire (lois organiques ou règlements des assemblées parlementaires) puisque leur promulgation ou leur mise en application dépend de leur conformité à la Constitution.
Pour les actes contrôlés à titre facultatif, les critiques portent essentiellement sur les délais applicables aux recours contre les lois ordinaires (art. 61.2C) et ce, depuis l’accès des parlementaires au juge constitutionnel. Elles se justifient par le caractère incontestable de la loi promulguée (sous réserve de l’application de la jurisprudence État d’urgence en Nouvelle-Calédonie, voir infra I.2.3.). Si, avec le temps, la dénonciation des imperfections procédurales perdirent de leur intensité, une décision n° 97-392 DC du 7 novembre 1997 relança momentanément le débat. En effet, dans cette affaire qui portait sur une loi mettant fin à la forme traditionnelle du service national, les requérants saisirent le juge constitutionnel huit jours après l’adoption définitive du texte législatif par les assemblées parlementaires mais se heurtèrent à une fin de non-recevoir, le chef de l’État ayant déjà promulgué la loi au moment de l’introduction du recours.
En réalité, ce n’est pas tant la brièveté du délai de recours que dénoncent les parlementaires que l’absence d’un délai incompressible pendant lequel la saisine pourrait intervenir sans que l’on puisse craindre l’empressement du président de la République à promulguer la loi. Il faut rappeler que, lié au délai de promulgation, le délai de saisine dépend étroitement de la bienveillance du chef de l’État (et en amont du Secrétariat général du gouvernement) vis-à-vis des saisissants. Depuis 1958, on ne dénombre qu’un seul cas manifeste de forclusion (décision précitée du 7 novembre 1997). L’absence de contentieux à ce sujet résulte d’une convention de la Constitution au terme de laquelle le président de la République mais surtout le Secrétariat général du gouvernement s’assurent, préalablement à la promulgation de la loi, qu’aucune action devant le juge constitutionnel n’est envisagée. Une circulaire du 31 janvier 1997 relative au travail gouvernemental insiste sur le respect de cette procédure. Destinataire de la loi et en charge d’engager matériellement le processus de promulgation, le Secrétariat général du gouvernement est informé officieusement de l’imminence d’un recours par le Secrétariat général du Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, les autorités parlementaires de saisine soulignent parfois les difficultés matérielles qu’elles rencontrent dans la récolte des signatures et la motivation (toujours facultative) des recours. Dans la pratique, les parlementaires-saisissants dont l’attitude est, dans la quasi-totalité des cas, celle arrêtée par le groupe auquel ils appartiennent contournent ces obstacles en signant la lettre de saisine avant même la fin de la procédure parlementaire législative et, pour certains d’entre eux, en préparant en amont les arguments d’inconstitutionnalité présentés par la suite au Conseil constitutionnel. Enfin, la Haute juridiction a toujours admis la recevabilité de saisines dites « blanches » (qui enclenchent la procédure de contrôle et interrompent le processus de promulgation de l’acte déféré), laissant aux saisissants le soin de mieux motiver leur demande dans un mémoire remis ultérieurement.
Eu égard à la nature des critiques, l’institution d’un délai minimum pendant lequel la promulgation ne pourrait intervenir semblerait la solution idéale. Cette modification qui nécessiterait une révision de la Constitution rassurerait certes les saisissants, notamment lorsque, minoritaires dans leur formation de rattachement, ils ne bénéficient d’aucun soutien logistique, mais bloquerait une compétence essentielle du chef de l’État. De surcroît, la fixation d’un délai incompressible méconnaîtrait l’urgence de l’entrée en vigueur de certains textes. Aussi, les propositions établissant un délai de deux voire de trois jours sont-elles les plus réalistes et donc les plus à même d’aboutir.
II. Recevabilité de la saisine
L’exercice efficace d’une action juridictionnelle oblige son auteur à observer les conditions de recevabilité du recours. Devant le Conseil constitutionnel, elles sont fixées objectivement ce qui limite considérablement les pouvoirs du juge pour définir une politique jurisprudentielle de recevabilité des saisines. Si les règles relatives à l’introduction des saisines ne sont pas respectées, le juge constitutionnel refuse d’examiner au fond la saisine. Ainsi présentées, les règles de recevabilité s’étendent aux questions liées à la compétence de la juridiction.
II – 1. – Conditions relatives au requérant
À titre liminaire, on rappellera que la qualité pour agir devant le Conseil constitutionnel trouve sa source dans la Constitution et l’ordonnance organique du 7 novembre 1958.
II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Conformément au principe de la gratuité des actes de justice en matière civile et administrative que consacrait la Loi du 30 décembre 1977 et sur lequel est revenu le législateur en 1993 pour les requêtes introductives d’instance introduites devant les juridictions administratives, aucun texte applicable à la procédure devant le Conseil constitutionnel n’exige le paiement d’un droit de timbre. Dans le contentieux électoral où le nombre des recours est très supérieur à celui des recours constitutionnels, l’article 35 in fine précise même que la « requête est dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement ». Le caractère inquisitoire de la procédure suivie devant le Conseil commande cet aspect du fonctionnement de la justice constitutionnelle, perçu comme son corollaire.
II – 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
Les textes applicables aux procédures suivies devant le Conseil constitutionnel sont muets sur cet aspect traditionnel des procès. C’est dans leur silence que le Conseil constitutionnel a implicitement fixé les usages en la matière.
Dans le contentieux de constitutionnalité des lois, la représentation du requérant par un ministère d’avocat est exclue. Saisi en 1976 de la constitutionnalité d’une loi modifiant le statut des fonctionnaires, le juge constitutionnel tait, dans sa décision, la désignation par les parlementaires-saisissants d’un avocat au Conseil pour diligenter la procédure (n° 76-67 DC du 15 juillet 1976, Rec. 35). En refusant de faire état de la représentation des députés, le juge constitutionnel a très certainement entendu ne pas créer un précèdent. La clarté du message du juge semble avoir bien été perçue. On ne recense depuis cette date aucun autre exemple de ce type, y compris dans les autres contentieux normatifs. La solution retenue par le juge tient évidemment compte de la nature purement objective du contentieux de constitutionnalité. Les requêtes n’ont pas pour objet de défendre les droits subjectifs des requérants. Le parallèle peut être établi ici avec le recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives, recours en annulation exercé au service du droit et dispensé, à ce titre, de ministère d’avocat.
Cela étant, lorsque le Premier ministre saisit le Conseil constitutionnel d’une demande de délégalisation (37.2C), il peut arriver à un représentant du Secrétariat général du gouvernement de répondre par écrit ou oral à une demande d’informations complémentaires émanant du conseiller-rapporteur.
II – 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
L’auteur d’une saisine est désigné a priori par un texte, soit la Constitution, soit la Loi organique relative au Conseil constitutionnel. L’intérêt se confond avec la qualité pour agir. En conséquence, le juge constitutionnel s’assure simplement de la qualité de celui qui le saisit. Contrairement aux juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire, la notion d’intérêt pour agir, pourtant si essentielle dans l’élaboration d’une politique jurisprudentielle, libérale ou restrictive, de recevabilité des recours ne trouve pas à s’appliquer devant le Conseil constitutionnel.
Cette spécificité résulte de plusieurs facteurs. D’une part, l’inutilité de démontrer un quelconque intérêt à agir provient de la volonté des constituants de limiter les autorités de saisines en vue d’assurer la stabilité du contentieux constitutionnel intéressant les actions et les compétences normatives du gouvernement. La démonstration d’un intérêt pour agir ne présente un réel intérêt qu’en présence d’un contentieux largement ouvert. Or, aucune procédure de contrôle des normes devant le Conseil constitutionnel n’est accessible aux particuliers [9] .
Le principe de la gratuité des recours (pas de frais de timbre, pas de représentation par un avocat) devant le Conseil constitutionnel rend sans objet l’application de la législation relative aux aides juridictionnelles. L’éventualité d’une extension de l’assistance financière à l’exercice d’une action en justice supposerait au demeurant une modification de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958. Les questions de procédure relèvent en effet, selon l’article 63 de la Constitution, de la compétence du législateur organique.
II – 2. – Conditions relatives au recours
N’obéissant à aucun formalisme prédéterminé, les saisines sont adressées au président du Conseil constitutionnel ou à son secrétaire général par voie postale ou par porteur spécial.
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Parvenues au Conseil constitutionnel, les saisines sont enregistrées. Les lettres de saisine (ainsi que les mémoires qui y sont joints éventuellement) sont identifiées par :
- la date d’enregistrement ;
- un numéro qui sera celui de la décision. Celui-ci se compose de trois éléments. En premier lieu figure l’année de la saisine, puis le numéro de la saisine qui va croissant depuis l’origine du contentieux et enfin les lettres d’identification de la nature du contrôle engagé (DC pour décision de conformité [art.54 et 61 de la Constitution], FNR pour les fins de non recevoir de l’article 41 de la Constitution, L pour les demandes de délégalisation de l’article 37.2 de la Constitution et LP pour les « lois du pays »). Ce travail de Greffe est placé sous la responsabilité du Secrétariat général du Conseil, plus particulièrement de son service juridique.
II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
Ni la Constitution, ni l’ordonnance organique relative au Conseil n’indiquent avec précision le point de départ du délai, duquel découlera la suite de la procédure et notamment le délai dont dispose le Conseil constitutionnel pour statuer. De fait, le point de départ du délai est la date d’enregistrement du recours original. Lorsque le juge constitutionnel est destinataire d’un fax, son seul effet est d’interrompre de facto la promulgation de la loi déférée. La saisine présentée en bonne et due forme (c’est-à-dire comportant les signatures manuscrites des requérants afin de permettre au Conseil de les authentifier en les comparant à un registre des signatures établi à chaque début de législature et tenu à jour, puis de les dénombrer) devra alors dans les délais les plus brefs être transmise au Secrétariat général du Conseil pour y être enregistrée. En pratique, la date d’enregistrement coïncide avec celle de la réception.
Une saisine peut être prématurée : saisi d’une loi après son adoption définitive, le Conseil a jugé irrecevable une demande de plus de soixante parlementaires au motif que les signatures apposées sur les lettres de saisine l’avaient été avant l’adoption de la loi déférée (n° 76-69 DC du 8 novembre 1976, Rec. 37). Le recours doit être daté au plus tôt du jour de l’adoption de la loi. Il est à signaler que cette solution qui se démarque des règles suivies devant les juges ordinaires (appréciation de la requête au moment de son dépôt) s’explique par le caractère a priori du contrôle.
Est au contraire tardive la saisine introduite devant le Conseil constitutionnel après la signature du décret de promulgation par le président de la République : « Une loi promulguée, même non encore publiée, ne peut être déférée devant le Conseil constitutionnel » (n° 97-392 DC du 7/11/1997, Rec. p. 235). Comme il a déjà été indiqué, c’est la promulgation et non la publication de la loi qui clôt le délai de recours.
II – 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Conditions formelles

Quels que soient les actes contrôlés, les saisines partagent des caractéristiques communes :
- Le recours est matérialisé par une simple lettre datée (dite de saisine) comportant l’identification de son ou ses auteurs (signature manuscrite), leur qualité (pour les parlementaires indication de la circonscription de rattachement) et l’identification de la norme soumise au contrôle. Accessoirement, sont joints à la demande initiale des documents annexes ou des observations particulières.
- La motivation des saisines n’est pas requise. Inutile pour les recours obligatoires (des notes peuvent néanmoins les accompagner, elle demeure facultative pour les autres recours (n° 86-211 DC du 26 août 1986, Rec. 120). En règle générale, les autorités individuelles de saisine motivent rarement leur saisine alors que les saisines parlementaires soulèvent des griefs précis à l’encontre de dispositions particulières du texte déféré.
Dans ce contexte, que deviennent les conclusions et moyens nouveaux ?
Tous les actes déférés au Conseil constitutionnel sont contrôlés intégralement. Il en est ainsi des lois organiques et des résolutions modifiant les règlements des assemblées parlementaires (contrôle obligatoire), mais également des engagements internationaux et des lois ordinaires (n° 96-386 DC du 30 décembre 1996). Il reste, que s’agissant de cette dernière catégorie d’actes, s’est développé progressivement un usage consistant, pour les auteurs des recours, à soulever des griefs d’inconstitutionnalité.
Le contentieux constitutionnel est un contentieux d’ordre public ce qui explique le grand libéralisme de la jurisprudence en ce domaine. Saisi de la totalité des dispositions de la loi, les observations précisant ou complétant un recours primitif sont recevables jusqu’à la veille de la séance. Elles sont en quelque sorte indissociables de l’argumentation principale. Elles la prolongent,
1. La saisine peut être échelonnée en lettres successives. Le Conseil fut ainsi saisi de six lettres étalées sur 12 jours (n° 98-403 DC du 29 juillet 1998). Dans pareille situation lorsque la première lettre ne contient pas le nombre nécessaire de signataires (ce qui n’était pas le cas en l’espèce), la procédure ne commence qu’à compter de l’enregistrement de la soixantième signature. À peu près toujours cependant, la lettre de saisine, signée par le ou les présidents des groupes parlementaires, est accompagnée de la liste des signataires comportant leur signature manuscrite. 2. En pratique, la lettre de transmission est signée par le secrétaire général du Gouvernement qui agit par délégation du Premier ministre. Il est arrivé par ailleurs, à deux reprises, que le Garde des sceaux, ministre de la justice (toujours sur délégation) assure l’acte de transmission (n° 67-33 DC et n° 67-34 DC du 12 juillet 1967, Rec. 21-22).
3. Abordant la question des textes de forme législative intervenus après l’entrée en vigueur de la Constitution et dont le Gouvernement demande la reconnaissance du caractère réglementaire (37C), la circulaire du 30 janvier 1997 relative au règles d’élaboration et de rédaction des textes (J.O. 1-2-1997 annexe) rappelle que le « Conseil constitutionnel attache un prix à ce que [le projet de décret] soit joint à la demande de la saisine ». Il s’agit donc d’une pièce produite à la demande du juge. Non obligatoire, ce document est très utile à l’examen de la demande.
la complètent même puisque les observations complémentaires peuvent développer des conclusions et des moyens nouveaux (ex : n° 94-345 29 juillet 1994, loi sur la langue française). Le dépôt de telles conclusions ou de tels moyens se justifie doublement : d’une part, leur production est une réplique à l’argumentaire en défense établi par le gouvernement (illustration du principe de la contradiction) ; d’autre part, la rédaction précipitée d’un recours peut laisser échapper des éléments apparus dans le dernier état de la procédure législative.
Les délais pendant lesquels une telle initiative est recevable sont ceux de l’instruction. Tant que celle-ci n’est pas close, le rapporteur pourra prendre en considération les arguments nouveaux portés à sa connaissance. La même règle est observée devant les juridictions administratives pour les moyens nouveaux recevables. La difficulté tient à ce que les auteurs de la saisine ignorent la date de clôture de l’instruction. Il arrive que ces mémoires complémentaires soient produits in extremis (n° 94-351 DC du 29 décembre 1994 où le Conseil a été saisi la veille d’un mémoire ampliatif).
Admettant implicitement leur recevabilité en lisant les observations en réplique (il faut attendre la décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 pour que mention des mémoires ampliatifs apparaisse dans les visas des décisions), le juge constitutionnel fut contraint de définir les conditions de leur présentation, notamment au regard du principe du parallélisme des formes, particulièrement épineux pour les recours signés par plus de soixante députés ou soixante sénateurs. Initialement le Conseil s’est montré d’une extrême sévérité en exigeant que les observations complémentaires répondent aux mêmes conditions de recevabilité que le recours introductif d’instance. Ainsi, à propos d’une simple demande de rectification d’erreur matérielle, le juge considéra la requête recevable au motif qu’elle était présentée par soixante parlementaires. La condition constitutionnelle était remplie (n° 76-73 DC du 28 décembre 1976, Rec. 41). Cette décision annonçait une conception stricte de la recevabilité des conclusions et moyens nouveaux à laquelle se sont heurtés un an plus tard des parlementaires-requérants qui critiquaient dans un mémoire ampliatif d’autres dispositions que celles figurant dans le recours initial dont ils étaient les auteurs (n° 77-89 DC du 30 décembre 1977, Rec.46). De la sorte, le juge pensait prévenir l’encombrement de son activité et dissuader les parlementaires d’abuser de la procédure de contrôle de constitutionnalité des lois. On peut considérer cette jurisprudence comme un réflexe d’auto-protection vis-à-vis d’une procédure nouvelle.
Les craintes s’étant dissipées avec la pratique régulière mais raisonnable du contrôle juridictionnel de la loi non promulguée, le Conseil constitutionnel admet désormais que le président du ou des groupes parlementaires saisissants agisse au nom des autres signataires. Le mémoire est alors attribué aux « auteurs de la saisine ». En revanche, un parlementaire qui agit isolément verra inexorablement ses prétentions rejetées comme étant irrecevables (Pour une illustration récente, voir la décision n° 99-419 DC du 30 décembre 1999 par laquelle le Conseil constate que le député cosignataire d’une saisine a « fait parvenir sous sa seule signature, un mémoire par lequel il soulève de nouveaux griefs à l’encontre de dispositions critiquées… ». voir aussi n° 81-133 DC du 30 décembre 1981, Rec.41).
Conditions matérielles

II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Elles sont demeurées ce qu’elles étaient en 1958. La jurisprudence constitutionnelle a simplement apporté certaines précisions au fur et à mesure que les difficultés se présentaient à lui. Il en fut particulièrement ainsi pour les conditions relatives à la motivation des requêtes (conditions formelles) et celles relatives au moment de la saisine (conditions matérielles).
II – 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
À la différence de ce que l’on observe dans le contentieux des élections parlementaires depuis 1997 (n° 97-2236 du 28 octobre 1997, AN. Gers, Rec. 47), il n’existe aucune procédure formelle de régularisation de la requête dans le contentieux constitutionnel des normes. Cela participe de l’absence d’un formalisme poussé des conditions d’introduction et d’instruction des recours.
Le silence des textes est gage d’une grande souplesse dans le traitement des requêtes. Aussi, lors de la réception d’une saisine, les vérifications effectuées par le Secrétariat général du Conseil le conduisent, le cas échéant, à intervenir auprès des autorités de saisine afin qu’elles procèdent dans les plus brefs délais aux régularisations nécessaires à l’examen du bienfondé de la demande.
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
Les décisions d’irrecevabilité ne présentent aucune particularité quant à leur régime d’édiction. Les textes applicables valent pour l’ensemble des décisions, y compris d’irrecevabilité.
II – 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
Convoqué par le président du Conseil constitutionnel ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le plus âgé de ses membres (art. 13 de l’ordonnance du 7 novembre 1958), le Conseil rend sa décision en séance plénière. La présence d’au moins sept membres est exigée sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal (art. 14, ord.).
II – 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
L’article 62 de la Constitution est parfaitement clair sur cet aspect de l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel : les décisions, quelles qu’elles soient, ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles ont l’autorité de la chose jugée selon les propres termes employés par la juridiction constitutionnelle (n° 88-1127 DC du 29 avril 1989, Rec. 32). Cette autorité est absolue. Les décisions « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».
S’il ressort de la jurisprudence constitutionnelle que l’autorité absolue de la chose jugée des décisions du Conseil est limitée à l’objet du texte examiné, plus précisément au dispositif et aux « motifs qui en sont le soutien nécessaire et le fondement même » (n° 62-18 L, 16 janvier 1962, Rec. 31), il est loisible au(x) requérant(s) qui se heurtent à une fin de non-recevoir de saisir de nouveau le Conseil constitutionnel si les délais le permettent.
II – 3.3. – La Cour statue t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
Le Conseil constitutionnel ne siège qu’en séance plénière (voir point 258 II – 3.4.1). Comme il a été indiqué ci-dessus, les décisions sont rendues par au moins sept conseillers constitutionnels sauf cas de force majeure. Mention en est alors faite au procès verbal de la séance.
La décision est prise sur le rapport d’un membre du Conseil (art. 19, ord.) et non d’un rapporteur-adjoint issu du Conseil d’État ou de la Cour des comptes dont l’intervention se limite au contentieux de l’élection des députés et des sénateurs. Le rapport du conseiller-rapporteur présente l’affaire soumise au Conseil et s’accompagne d’un projet de décision qui fera l’objet d’une délibération. Celle-ci est secrète.
Il est arrivé que le Conseil constitutionnel statue au vu de deux rapports (n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Rec. 55). Cet exemple, isolé, manifeste une interprétation particulièrement souple des termes de l’ordonnance organique relative au Conseil constitutionnel (art. 19 : « L’appréciation de la conformité à la Constitution est faite sur le rapport d’un membre du Conseil… »). L’importance de l’acte déféré (le Traité d’Union européenne) et la complexité des questions juridiques légitiment cette lecture de l’ordonnance.
Le rapporteur est désigné de façon discrétionnaire par le président du Conseil. Il s’agit là d’un usage. Aucune disposition n’attribue, en effet, explicitement cette compétence au chef de la juridiction constitutionnelle. De même il est de coutume que le président du Conseil ne s’auto-désigne pas rapporteur mais cette pratique connaît quelques rares tempéraments. Le secret sur l’identité du rapporteur est motivé par le souci de le soustraire aux pressions et sollicitations diverses qui pourraient nuire à la sérénité de son instruction. Compte tenu du développement de la procédure contradictoire, certains membres de la doctrine s’interrogent cependant sur cette règle. Par comparaison, le nom du rapporteur dans le contentieux administratif est rendu public.
Enfin, en règle générale et toujours selon une pratique établie, le président désigne les rapporteurs en fonction de leurs centres d’intérêts et de leur spécialité.
II – 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
Comme l’ensemble des décisions juridictionnelles, les décisions d’irrecevabilité sont motivées (art. 20, ord.). Elles contiennent les motifs du rejet de la requête. Les requérants, lorsque les textes organisant la procédure le permettent, sont alors en mesure de corriger leur demande initiale et de soumettre de nouveau à l’examen du Conseil leurs prétentions. En 1976, saisissant le juge prématurément, les parlementaires ont pu de nouveau exercer leur droit de recours dès le lendemain du prononcé de la décision d’irrecevabilité, le délai de promulgation courant toujours (on rappellera que la saisine suspend le délai de promulgation).
Notifiée aux autorités de saisines compétentes, la décision est successivement publiée au Journal Officiel de la République française (Fascicule « Lois et décrets ») conformément à l’article 19 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et au Recueil annuel des décisions du Conseil constitutionnel publié sous le haut patronage du Conseil. On trouve les décisions relatives à la conformité des textes législatifs ordinaires et organiques sous la rubrique « Lois », les autres décisions figurant sous la rubrique « Conseil constitutionnel ». Depuis 1983, à l’initiative du président Daniel Mayer, les saisines effectuées en application de l’article 61.2C sont également publiées au Journal Officiel et depuis 1994 sont accompagnées des observations du gouvernement. Pour une meilleure visibilité et intelligibilité des lois, ces documents suivent désormais la décision, elle-même précédée du texte de loi promulguée.
II – 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
L’objet de telles amendes est de dissuader, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les procéduriers ainsi que tous ceux qui se livreraient à un acharnement procédural. En matière administrative mais surtout civile, la sanction de tels comportements est largement répandue. Dans le contentieux constitutionnel, elle est inexistante. Cela tient à plusieurs raisons. D’une part, il est peu vraisemblable que des autorités constitutionnelles qui ont en charge de lourdes responsabilités publiques et politiques se signalent par des attitudes d’obstruction. D’autre part, le contentieux des normes est quantitativement peu important. La production des lois ou des engagements internationaux n’est pas comparable à celle des actes administratifs ou encore au nombre de contrats conclus. Le risque d’encombrement du prétoire ne guette pas le juge constitutionnel français qui statue dans un temps limité et antérieurement à l’entrée en vigueur des actes. Par ailleurs et surtout, alimentant des contentieux d’ordre public, les recours ont pour unique objet de déclencher une procédure de contrôle dans l’intérêt du droit et non dans celui de leurs auteurs. Enfin, saisi de plusieurs demandes relatives à un même acte, le juge constitutionnel joint les requêtes pour qu’il y soit statué en une seule fois.
Il n’est pas inintéressant de relever qu’en matière électorale, où le nombre de requêtes instruites est plus de six fois supérieur à celui des recours normatifs (plus de 2 500 recours électoraux depuis 1958 contre plus de 400 pour les lois et les règlements des assemblées), le gouvernement a considéré en réponse écrite à un parlementaire que toute contrainte financière (droit de timbre ou amende pour recours abusif) irait à l’encontre du principe essentiel dans un État de droit qui veut « que l’accès au juge électoral soit le plus ouvert possible » (J.O.R.F. (Q), 31 octobre 1996, p. 2838).
Notons au passage que l’institution d’une telle sanction ne serait pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, sous réserve qu’elle ne constitue pas par son montant une entrave réelle à l’accès des tri260 bunaux (Comm EDH, 2 juillet 1991, Soc. les travaux du Midi).
II – 3.6. – La procédure conduisant à la déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
Les conditions dans lesquelles sont prononcées les décisions d’irrecevabilité n’ont subi aucune évolution, ni même suscité la moindre interrogation à ce sujet.
Les raisons de cette stabilité sont à rechercher dans la restriction des autorités et des personnes habilitées à saisir le juge constitutionnel (exclusion des citoyens) ainsi que dans la simplicité et l’absence de formalisme des règles applicables à l’introduction et à l’instruction des recours. En revanche, en matière électorale, la jurisprudence du Conseil a évolué puisque désormais l’auteur d’un recours est informé du caractère irrecevable de sa requête lorsque celle-ci est entachée d’une erreur vénielle (n° 97-2236 du 28 octobre 1997, AN Gers 2e, Rec. 247).
II – 4. – Motifs de rejet. Synthèse
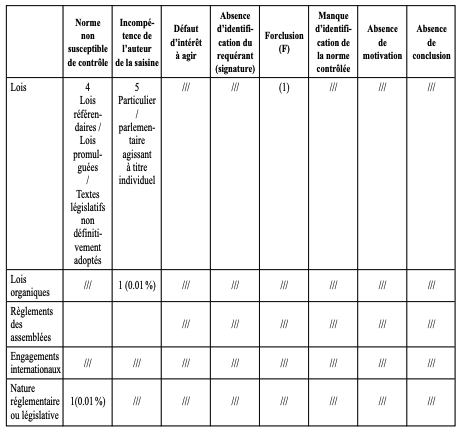
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III – 1. – Principe du contradictoire
Expressément mentionnée par les textes applicables à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel, juge électoral, la contradiction n’est nulle part inscrite dans les dispositions réglementant le contrôle de constitutionnalité des normes. Elle n’a pas à l’être pour les actes transmis obligatoirement au Conseil (lois organiques et règlements des assemblées parlementaires). De même, lorsque le gouvernement sollicite la reconnaissance du caractère réglementaire d’une disposition en forme législative, il n’est prévu aucun contradicteur (37.2C). Pour les autres procédures de contrôle, l’ordonnance organique précitée fait simplement mention d’une information des autorités de saisine. C’est sur ce fondement que s’est développée de manière empirique une procédure contradictoire.
III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Il importe de distinguer les chefs de compétences du Conseil constitutionnel.
Lorsque la Haute juridiction, saisie conformément aux articles 61, alinéa 2, et 54 de la Constitution, juge la constitutionnalité des lois parlementaires ordinaires et des engagements internationaux, notification de la saisine (et de la liste des signataires s’agissant de saisines parlementaires) est faite sans délai aux autres autorités de saisine : président de la République, Premier ministre et présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces derniers en informent les membres des assemblées (art. 18 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant Loi organique relative au Conseil constitutionnel).
La nécessité d’aviser le chef de l’État et le Premier ministre s’explique par leur implication dans le processus de promulgation des lois (le Secrétariat général du gouvernement prépare le dossier de promulgation transmis au président de la République qui authentifie la loi par sa signature) et pour le premier d’entre eux par son pouvoir de ratifier les traités (art. 52C). En raison de la forte proportion de lois issues de projets gouvernementaux, le Conseil transmet les saisines au gouvernement (plus précisément au secrétaire général du gouvernement). En pratique, le Secrétariat général du gouvernement joue le rôle de « défendeur » de la loi. Ses observations sont communiquées aux saisissants. Ainsi s’engage la contradiction qui sera rendue publique par la publication au Journal Officiel des échanges d’arguments pour ou contre 262 la constitutionnalité du texte déféré au contrôle du juge.
S’agissant du contentieux relatif au partage des domaines de la loi et du règlement, il convient de distinguer l’examen des fins de non-recevoir et l’examen d’une demande de délégalisation.
- Invité à statuer sur la question de savoir si une initiative parlementaire en cours de discussion (proposition ou amendement) est du domaine de la loi (art. 41C), le Conseil n’a à accomplir aucune formalité. C’est à l’auteur du recours d’en aviser aussitôt l’autre autorité de saisine (art. 27.2, ord.). Il peut en résulter une production d’observations écrites contradictoires. Depuis 1959, sur les onze recours dont fut saisi à ce titre le juge constitutionnel, seuls les présidents des assemblées parlementaires ont sollicité son intervention, en majorité d’ailleurs le président du Sénat (à sept reprises).
- Quant au contrôle a posteriori des textes de forme législative (37.2C), la contradiction est inexistante. Non seulement le Premier ministre est l’unique autorité de saisine (absence de communication de la saisine à d’autres autorités) mais encore aucun parlementaire ne vient défendre le caractère législatif du texte. Toutefois, il arrive exceptionnellement que le rapporteur auditionne les représentants du gouvernement.
III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au juge ?
Compte tenu des développements précédents, la question ne présente un intérêt que s’agissant de la procédure de contrôle des lois ordinaires, et par extension celle des engagements internationaux.
Une observation préalable : la notion de « parties » stricto sensu est étrangère au contentieux de constitutionnalité des normes tel qu’il est pratiqué en France. Les saisissants ne défendent aucun droit subjectif. La contestation d’un tel droit n’est pas une condition de l’action juridictionnelle.
Concrètement la plupart des saisines – parlementaires – soulèvent des griefs d’inconstitutionnalité. Aussi, au sens des principes généraux de la procédure, le contentieux de la loi non promulguée et des engagements internationaux ne met en œuvre aucune procédure contradictoire. Cela étant, la généralisation des saisines motivées et l’obligation qui est faite au juge d’en aviser les autres autorités de saisine lui ont permis d’organiser la contradiction entre les auteurs des recours et le gouvernement à l’origine de la plupart des dispositions législatives contestées. On trouve trace d’ailleurs de l’existence d’une procédure contradictoire dès la décision n° 68-35 du 30 janvier 1968 (Rec. 23) où le président du Sénat est intervenu en adressant des observations écrites au Conseil pour défendre une loi relative aux collectivités locales que critiquait le Premier ministre.
Les acteurs du « procès constitutionnel » interviennent au moyen de productions écrites déposées au cours de la phase d’instruction, ce dont rend compte la publication officielle des saisines depuis 1983 (n° 83-160 DC du 19 juillet 1983) et des observations du gouvernement depuis 1994 (n° 94-350 DC 20 décembre 1994) inscrites dans les visas, au même titre que les mémoires des saisissants (n° 94-351 DC du 29 décembre 1994). La publicité de ces pièces pallie le caractère secret de la procédure, s’agissant du moins du contrôle des lois. Le contrôle des traités qui intervient sur le fondement de l’article 54 de la Constitution donne lieu à des productions informelles du gouvernement qui ne sont pas publiées. Seule est publiée, le cas échéant, la saisine des parlementaires (cf. décision 92-312 DC précitée, Traité de Maastricht).
Le Conseil n’admet pas l’intervention d’avocats pour représenter les saisissants dans le cours des affaires qui lui sont soumises (cf. ci-dessus § II.1.2). Des raisons de fond justifient aussi la position retenue par le juge. L’avocat défend l’intérêt de celui ou de ceux qu’il représente. Or, une loi ne porte nullement atteinte aux droits des requérants, lesquels n’agissent qu’en tant que « procureurs ». À cela s’ajoute que le recours contre une loi n’est pas assimilable à un recours contentieux ordinaire. La motivation des saisines reste facultative (n° 86-211 DC du 26 août 1986, Rec.120).
Cependant, à l’initiative du conseiller-rapporteur, certains intervenants sont entendus oralement. À commencer et à titre principal par les représentants du gouvernement. C’est ainsi qu’une réunion non publique se déroule toujours après l’introduction de la saisine et avant que le gouvernement présente ses observations écrites. Elle rassemble d’une part le conseiller-rapporteur, qui assure la présidence, le secrétaire général du Conseil et ses collaborateurs proches et, d’autre part, les représentants du Secrétariat général du gouvernement, dont le conseiller technique chargé des questions constitutionnelles, et les représentants (membres des cabinets, chefs de service) des départements ministériels concernés par le texte déféré. C’est au cours de ces séances qu’un premier débat contradictoire a lieu par échanges d’arguments de constitutionnalité à propos de dispositions législatives contestées ou soulevées d’office par le rapporteur.
Ainsi, le particularisme de la contradiction dans le contentieux de la loi tient principalement à son aspect informel, coutumier. La codification de ces usages est régulièrement réclamée. Elle n’a jamais abouti à une quelconque initiative du Conseil constitutionnel, seul compétent pour réglementer la procédure applicable devant lui (art. 56, ord : « Le Conseil constitutionnel complétera par son Règlement intérieur les règles de procédure édictées par le titre II de la présente ordonnance. »).
III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Rappelons que, s’agissant de l’examen obligatoire et préventif de constitutionnalité des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires ainsi que du contrôle a posteriori de la répartition des compétences entre le domaine législatif et le domaine réglementaire (dite procédure de déclassement ou de délégalisation), le principe du contradictoire n’est pas consacré. Cette solution se justifie pour les actes transmis obligatoirement au juge. Elle peut paraître plus discutable pour la procédure de délégalisation dans la mesure où la décision peut restreindre la compétence législative. En revanche, la procédure peut être contradictoire lorsque le Conseil constitutionnel intervient pour le même objet au cours de la procédure législative (41C).
En ce qui concerne le contrôle des lois ordinaires, le procès revêt un caractère contradictoire. Le débat met en présence les saisissants et le gouvernement par le truchement de son Secrétariat général. Placé en position de « défendeur » de la loi, le gouvernement est ainsi en mesure d’intervenir non seulement sur des lois ou des dispositions législatives d’initiative gouvernementale mais également d’origine parlementaire. Pour instaurer une contradiction avec les assemblées parlementaires, le président Robert Badinter (1986-1995) proposa que le conseiller-rapporteur du Conseil constitutionnel prenne l’attache tant du rapporteur de la Commission qui dans chaque assemblée a été saisie au fond du texte de loi, que d’un représentant des auteurs de la saisine, afin qu’ils puissent éventuellement communiquer toutes observations complémentaires qu’ils jugeraient utiles à l’appui du rapport ou de la saisine. Les présidents des assemblées opposèrent en 1986 une fin de non-recevoir à l’institutionnalisation de telles relations informelles entre le rapporteur du Conseil et les rapporteurs parlementaires. En outre, le délai d’un mois imparti au juge pour statuer peut apparaître peu propice à un tel débat contradictoire.
III – 2. – Égalité des armes
III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Comme pour le principe du contradictoire, la procédure n’obéit à aucun formalisme rigoureux. Le dossier de procédure constitué par le service juridique du Conseil constitutionnel comprend :
- la lettre de saisine. Elle peut être complétée par un mémoire ampliatif des saisissants, en réponse aux observations du gouvernement (circuit uniquement observable pour le contentieux des lois de l’article 61.2C). Ces productions sont facultatives. Le Conseil constitutionnel déclare par ailleurs recevable un recours vierge de tout grief d’inconstitutionnalité (« saisine en blanc »). En réalité, lorsqu’il émane des parlementaires, ceux-ci sont plutôt prolixes qu’économes d’arguments ;
- l’acte soumis à examen de constitutionnalité. Pour les engagements internationaux, ceux-ci s’entendent du traité et de ses éventuels protocoles annexes (n° 92-308 DC du 9 avril 1992) ;
- les observations du gouvernement. En complément de ce « dossier de procédure » est constitué par le service de documentation un « dossier de travail » qui contient :
- les documents parlementaires : Les projets et propositions de loi (ou d’amendement pour l’article 41C), les rapports parlementaires (Assemblée nationale et Sénat), leurs annexes ainsi que les débats parlementaires ;
- les décisions de justice en relation avec les questions abordées : jurisprudences constitutionnelle et comparée (administrative, judiciaire et étrangère). Lorsque le traitement d’une question le commande, sont jointes au dossier les décisions des cours européennes (Cour de Justice des Communautés Européennes / Cour Européenne des Droits de l’Homme) et des autres cours constitutionnelles (européennes et nord-américaines) ;
- les références doctrinales ;
- autres documents : leur présence dépend de l’objet de la demande et de l’acte. Il peut s’agir d’instruments internationaux ou de textes législatifs et réglementaires en rapport avec le texte déféré. Ce dernier peut être complété par des documents annexes tels des rapports, des mémoires émanant d’institutions, de particuliers ou d’associations ainsi que des « portes étroites 10[10]» ou mémoires informatifs qui critiquent des dispositions législatives d’une loi déférée. Enfin le Secrétariat général du Conseil peut établir des notes sur les questions en débat.
III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Les pièces de procédure (saisine, observations en réponse du gouvernement, mémoires ampliatifs) font, dans les conditions qui viennent d’être décrites, l’objet d’un échange contradictoire écrit analogue à celui qui se déroule devant les juridictions administratives. En revanche, les fiches techniques qui apportent des précisions sur des éléments non évoqués dans la saisine, à la demande du conseiller-rapporteur lors de la réunion de travail avec les représentants du Secrétariat général du gouvernement ou ultérieurement, ne sont pas communiquées.
III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Devant le Conseil constitutionnel, la procédure est inquisitoriale. Cela signifie que le membre du Conseil désigné comme rapporteur de l’affaire dirige librement l’instruction. Il lui revient de prendre toutes les initiatives nécessaires à l’instruction de la saisine et dispose, à cette fin, des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.
À ce titre, il lui revient d’organiser le « débat contradictoire » entre les auteurs d’une saisine et le gouvernement lorsqu’il examine la conformité d’une loi ordinaire. Il lui est loisible de convoquer et d’interroger des membres des ministères intéressés par un texte soumis à contrôle, de même que toute personnalité ou tout spécialiste susceptible d’éclairer sa réflexion. Par ailleurs, le rapporteur peut entendre des experts ou prendre les contacts informels qui lui semblent utiles à son information.
III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés par le juge ?
Quelle que soit la norme contrôlée, l’examen de constitutionnalité porte sur l’ensemble de l’acte déféré. La possibilité pour le juge de soulever d’office des moyens ou dispositions ne nécessite donc aucune base textuelle. Le contentieux des normes, particulièrement de la loi, est un contentieux d’ordre public qui autorise le Conseil à statuer sur toutes questions, y compris celles non évoquées par l’auteur d’une saisine. On rappellera que s’agissant du contrôle obligatoire des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires, les lettres de saisine ne sont pas motivées. Il en est de même des saisines relatives aux traités présentées sur le fondement de l’article 54 de la Constitution par le président de la République ou le Premier ministre. En réalité, la question d’un dépassement des termes d’une requête ne s’est présentée que pour l’examen facultatif des lois ordinaires, en raison de l’habitude prise par les parlementaires d’argumenter les recours.
Le principe de l’étendue du contrôle de constitutionnalité des lois a été rappelé avec solennité par une décision n° 96-386 DC du 30 décembre 1996 (Rec.154). Le considérant essentiel est ainsi rédigé : l’effet d’une saisine est « de mettre en œuvre, avant la clôture de la procédure législative, la vérification par le Conseil constitutionnel de toutes les dispositions de la loi déférée y compris de celles qui n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part de ses auteurs ». L’affirmation du contrôle indivisible de la loi conduit à considérer que le juge ne statue pas ultra petita lorsqu’il soulève d’office l’inconstitutionnalité de dispositions non critiquées. Les termes d’une requête ne lient pas le juge. Dès lors, il entre dans la mission constitutionnelle du juge de s’interroger de sa propre initiative sur toute disposition qu’il suspecte d’inconstitutionnalité ou tout moyen susceptible d’entraîner son invalidation.
Ce pouvoir de substituer des moyens d’inconstitutionnalité à ceux des saisissants et d’élargir l’objet de l’instance trouve sa traduction depuis 1977 (décision n° 77-89 DC du 30 décembre 1977, Rec.46) dans un considérant final (dit « considérant-balai ») des motifs de la décision rédigé en ces termes :
« Considérant qu’en l’espèce il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d’office aucune question (ou aucune autre question si ce pouvoir s’est exercé et matérialisé dans la décision) de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen. »
Pour autant, la loi contrôlée n’est pas revêtue d’un brevet de constitutionnalité irréfragable. Depuis la décision n° 93-220 DC du 29 décembre 1993 sur la loi de finances pour 1994, le dispositif des décisions auquel s’attache l’autorité de la chose jugée (et les moyens qui en sont le soutien nécessaire) ne se réfère qu’aux dispositions expressément contrôlées, parce que contestées ou soulevées d’office, qu’elles soient conformes ou contraires à la Constitution. Cette jurisprudence s’applique même lorsque le juge contrôle une loi au vu de laquelle l’auteur du recours n’a soulevé aucun grief particulier (n° 99-409 du 15 mars 1999). D’autre part, comme l’indique la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 concernant la Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, une loi examinée peut contenir des dispositions devenues inconstitutionnelles eu égard à l’évolution de la jurisprudence.
Aucune condition particulière ne s’impose donc au juge dans son pouvoir d’évocation d’office. La mise en œuvre de ce pouvoir demeure modérée en raison de la brièveté du délai imparti au Conseil constitutionnel. Elle s’exerce principalement à l’encontre de quatre catégories de griefs, les plus nombreuses intéressant les inconstitutionnalités formelles.
- Parmi les violations formelles de la Constitution, le juge est particulièrement attentif aux :
– dispositions qui n’ont pas leur place dans une loi de finances (cavaliers budgétaires) ;
– dispositions qui ne respectent pas la règle de non-affectation des ressources aux dépenses ;
– dispositions organiques contenues dans une loi ordinaire ;
– dispositions introduites par voie d’amendement après la réunion de la commission mixte paritaire (organe de conciliation entre les deux assemblées) qui ne sont pas en relation directe avec le texte en discussion ou qui ne sont pas rendues nécessaires par la coordination avec d’autres textes législatifs. - Au nombre des violations substantielles des dispositions constitutionnelles, on peut relever le non-respect du principe de libre administration des collectivités locales (n° 92-316 DC du 20 janvier 1993) ou encore le non respect d’une liberté fondamentale.
Selon quelle fréquence procède-t-il à l’évocation d’office ? L’évocation d’office par le juge constitutionnel d’une conclusion ou d’un moyen se repère dans les décisions au moyen de formulations spécifiques. Lorsque le Conseil examine d’office une disposition législative, il n’est fait aucune mention des arguments des saisissants. Surtout, le « considérant balai » des motifs de la décision est ainsi rédigé : « Considérant qu’en l’espèce, il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d’office aucune autre question de conformité à la loi soumise à son examen. » Quant aux moyens soulevés d’office, le juge use parfois de cette formule-indice empruntée à la juridiction administrative lorsqu’il effectue une substitution de motif : « sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués ». Mais, bien souvent, la rédaction de la décision fait l’économie de tout renvoi à la motivation du recours ce qui rend leur repérage plus délicat. L’analyse de la saisine publiée permet, seule, d’en faire état.
S’il use de son pouvoir d’évoquer d’office une conclusion ou un moyen, le Conseil constitutionnel n’en abuse assurément pas. Selon une étude statistique [11]portant sur la période 1974-1997, on relève que le juge a soulevé 57 conclusions et 48 moyens de sa propre initiative. Le procédé conduit le plus souvent le juge à interpréter une disposition afin de la faire échapper à l’invalidation, énonçant ce qu’il est convenu d’appeler une « réserve d’interprétation » ou une « interprétation neutralisante ».
Pour donner la mesure de la propension du Conseil constitutionnel à se prononcer d’office, il faut comparer ces 57 dispositions et 48 moyens examinés d’office aux 1118 dispositions législatives déférées au Conseil et aux 2184 moyens développés à l’appui des recours, dont près de la moitié est postérieure à 1988 ce qui souligne une motivation de plus en plus abondante des saisines.
Surtout, il est remarquable de constater que les déclarations d’inconstitutionnalité sont, pour plus d’un tiers, le fait de l’initiative proprio motu du juge. Cependant, sous l’effet d’un recours plus fréquent aux réserves d’interprétation, la proportion tend à décroître.
L’absence d’un règlement de procédure n’empêche pas que s’établissent des contacts informels entre le rapporteur et les rédacteurs d’une saisine. Le caractère inquisitoire de la procédure donne en effet toute latitude au membre du Conseil désigné pour rapporter l’affaire de choisir ses interlocuteurs.
La question ne présente, à dire vrai, un réel intérêt que pour le « défendeur » de la loi, à savoir concrètement le Secrétariat général du gouvernement. Les conventions sont là également bien établies et assurent une contradiction minimum. Lors d’une réunion préparatoire avec des représentants du gouvernement, le conseiller-rapporteur peut faire part de ses interrogations et de ses doutes sur la constitutionnalité d’une disposition non critiquée par les saisissants. Le Secrétariat général du gouvernement y répond d’abord oralement puis sous forme de fiches techniques, non communiquées aux auteurs de la saisine. Il s’agit là d’une pratique informelle destinée à sauvegarder le principe du contradictoire pour les questions soulevées d’office. De la même façon, depuis un décret du 22 juillet 1992, le juge administratif est en effet tenu de communiquer aux parties les moyens d’ordre public qu’il entend soulever.
III – 3. – Délai de jugement
Devant le Conseil constitutionnel, le délai de jugement est rapide. Il ne saurait en aller autrement pour un contrôle abstrait exercé a priori.
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
La question appelle une réponse positive. Le juge constitutionnel français est tenu de statuer par une décision explicite et motivée sur la saisine dont il est saisi dans un délai préfix d’un mois en règle générale. Toutefois, en cas d’urgence demandée par le gouvernement pour les lois (art. 61.3C repris par l’article 19 de l’ordonnance du 7 novembre 1958) et l’examen des demandes de délégalisation (37.2C) ou lorsque le Conseil statue sur le caractère réglementaire ou législatif d’une initiative parlementaire en cours de discussion (41C ; il s’agit ici de perturber le moins possible le déroulement de la procédure législative), ce délai est ramené à huit jours. À la suite de la décision n° 92-308 DC du 9 avril 1992 portant sur la non-contrariété du traité de Maastricht, le Conseil a confirmé à plusieurs reprises l’application à l’examen de compatibilité des engagements internationaux (art. 54C) des délais applicables aux lois ordinaires : un mois ramené à huit jours en cas d’urgence déclarée par le gouvernement. Les décisions n° 97-394 DC du 31 décembre 1997, Rec. 344 (Traité d’Amsterdam), n° 99-408 DC du 22 janvier 1999 (Cour pénale internationale) et n° 99-412 DC du 15 juin 1999 (Charte européenne sur les langues régionales) visent toutes l’article 19 de l’ordonnance organique relative au Conseil constitutionnel. Cette jurisprudence entérine une pratique observée jusqu’alors. Le délai de jugement le plus bref est enregistré à l’occasion de la première mise en œuvre de ce type de contrôle, soit 8 jours pour examiner le traité de Luxembourg (n° 70-39 DC), tandis que le délai le plus long, 29 jours, est observé pour les décisions rendues sur la conformité du Traité d’Union européenne (n° 92-308 DC) et du Traité portant statut de la Cour pénale internationale (n° 99-408 DC).
À ce jour, le recours à la procédure d’urgence demeure exceptionnel. Sans que le Conseil ait tranché explicitement la question de savoir si la demande lie le juge ou non, il importe d’observer que toutes les décisions sur lesquelles le Premier ministre a déclaré l’urgence ont été prononcées dans un délai inférieur à huit jours. La pratique accrédite la thèse d’une compétence liée à ce sujet. En pratique, après concertation entre les secrétaires généraux du gouvernement et du Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel adapte le délai d’examen aux circonstances. Il lui arrive d’épuiser totalement le délai constitutionnel d’un mois (n° 99-420 DC du 16 décembre 1999, Loi organique relative à l’inéligibilité du Médiateur des 270 enfants) comme de statuer en quelques heures lorsque le gouvernement insiste sur l’urgence de son application (n° 85-187 DC du 25 janvier 1985, État d’urgence en Nouvelle-Calédonie, Rec. 43). Par ailleurs, le délai d’examen des lois de finances et des lois de financement de la Sécurité sociale, qui doivent être promulguées avant le 1er janvier est toujours, dans la pratique, inférieur à un mois.
Les délais de jugement sont toujours respectés. Ce constat ne doit pas, néanmoins, dissimuler une augmentation tendancielle du nombre de jours séparant l’enregistrement d’une saisine de la date de réunion des conseillers en séance, tout particulièrement pour le contrôle des lois ordinaires. Plusieurs raisons à ce phénomène qui connaît ces dernières années une accalmie. D’une part, l’argumentation soignée et fournie des requêtes allonge inévitablement le temps d’instruction en raison de la procédure contradictoire aujourd’hui observée entre les auteurs d’une saisine et le gouvernement. D’autre part, les requérants contestent un plus grand nombre de dispositions, conséquence du volume croissant des lois.
Délais de jugement : tableau de synthèse pour les décisions de conformité

III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
Dans les délais qui lui sont impartis pour juger, le Conseil est libre d’organiser la procédure d’instruction. Aucun texte n’institue une quelconque procédure formelle de clôture de l’instruction. Il incombe à ce dernier de convoquer les membres. La procédure est close la veille du jour où le Conseil statue.
III – 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen que prend la Cour pour statuer ?
La question est sans objet s’agissant de la procédure devant le Conseil constitutionnel (se reporter au point III-3.1.)
Conclusion
La multiplication des recours a bouleversé une tradition séculaire d’hostilité au contrôle de constitutionnalité en France. Pour le Conseil constitutionnel, la multiplication des saisines d’origine parlementaire s’est traduite par une juridictionnalisation croissante de la procédure et des adaptations structurelles qui, pour ne pas être décisives du point de vue de son fonctionnement, n’en révèlent pas moins la position acquise par le Conseil constitutionnel au sein des institutions de la Ve République.
Ainsi la régularité de la saisine du juge constitutionnel a conduit à étoffer le service juridique du Conseil constitutionnel qui comprend désormais un juge administratif, un juge judiciaire et un fonctionnaire de l’Assemblée nationale. Le service de la bibliothèque, de la documentation et de l’informatique dirigé actuellement par un agent contractuel a également été considérablement renforcé. La maîtrise des dossiers passe par celle des sources d’informations. Les priorités actuelles du Secrétariat général du Conseil constitutionnel consistent à enrichir le fonds documentaire de références étrangères mais surtout à renforcer l’informatisation des services afin d’améliorer l’accès aux ressources documentaires. Par ailleurs, un Greffe a été créé pour le traitement du contentieux électoral.
Enfin, l’impact grandissant des décisions du Conseil constitutionnel auprès de l’opinion publique et la multiplication de ses activités internationales a conduit à la mise en place d’un service des relations extérieures, à la tenue de conférences de presse ainsi qu’à la création d’un site Internet (http ://www.conseil-constitutionnel.fr).
Actuellement, aucun projet de loi constitutionnelle n’est débattu au Parlement quant à l’élargissement des autorités de saisine en matière de contrôle de constitutionnalité des lois (61.2C). Cependant, dans le passé et par deux fois (en 1990 et 1993), les parlementaires ont été saisis de textes visant à instaurer une question préjudicielle de constitutionnalité (improprement dénommée exception d’inconstitutionnalité) qui ajoutait au contrôle préventif et par voie d’action déclenché par des autorités politiques un contrôle a posteriori et par voie d’exception à l’initiative des acteurs d’un procès (juge ou justiciable). Il s’agissait de donner la possibilité à toute personne de contester une disposition législative attentatoire à ses droits fondamentaux à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction. Ces propositions n’ayant pu être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées conformément à la procédure de révision constitutionnelle (art. 89C), le gouvernement les retira de l’ordre du jour des assemblées.
La procédure reposait sur un système de double filtrage. Dans un premier temps, les juges du fond s’assuraient que la disposition contestée commandait l’issue du litige ou constituait le fondement des poursuites. Ils recherchaient par la suite si la demande n’était pas manifestement infondée. Si les 272 magistrats estimaient qu’un doute raisonnable pesait sur la conformité à la Constitution de la disposition législative litigieuse, ils transmettaient la demande à la juridiction placée à la tête de l’ordre juridictionnel dont ils dépendaient (Conseil d’État pour les juridictions administratives et Cour de Cassation pour les juridictions judiciaires). Les juges du fond sursoyaient à statuer sauf urgence pendant un délai de trois mois, délai de jugement imparti aux juridictions suprêmes pour se déterminer sur le critère sérieux de la demande. Dans l’affirmative, ces dernières saisissaient la juridiction constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel n’était donc saisi que sur renvoi du Conseil d’État, de la Cour de Cassation ou de toute autre juridiction de dernière instance (Haute Cour de justice Cour de Justice de la République et Tribunal des conflits).
À coté de cette procédure ouvrant aux particuliers le contrôle de la loi promulguée, il importe de mentionner les propositions d’amélioration du contrôle préventif de la loi. Parfois interprètes de la Constitution à l’occasion des litiges qui leur sont soumis et seulement pour résoudre un conflit, les juridictions suprêmes ordinaires sont susceptibles de dégager des interprétations et de rendre des décisions dans des domaines inexplorés par le Conseil constitutionnel. Ainsi, le Conseil d’État a reconnu qu’avait valeur constitutionnelle en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République le principe selon lequel il ne peut y avoir d’extradition pour des motifs politiques (arrêt Koné, 3 juillet 1996). Or, en devançant le juge constitutionnel qui ne s’est jamais prononcé sur la valeur ce principe, le Conseil d’État prend le risque d’une contradiction. Pour pallier ces difficultés, des membres de la doctrine proposèrent déjà dans les années soixante (L. Hamon, C. Eisenmann et L. Favoreu) l’institution d’un renvoi préjudiciel permettant au Conseil d’État et à la Cour de Cassation de saisir d’une question de constitutionnalité le Conseil constitutionnel.
Depuis l’ouverture du contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires aux parlementaires, la motivation des saisines, lorsqu’elles émanent des parlementaires, est de règle. La soumission régulière des lois les plus importantes à l’examen de constitutionnalité, à commencer par les lois de finances, a inévitablement entraîné des standards dans la rédaction des saisines.
Pour commencer, les saisines commencent par évoquer des griefs formels et procéduraux, à l’instar des requêtes portées devant les juridictions administratives. Elles portent essentiellement sur la procédure législative. Un argument sur quatre leur est en moyenne consacré. La tendance se maintient depuis 1974. Ensuite, les saisissants abordent les moyens de droit matériel, notamment ceux relatifs aux droits fondamentaux contenus dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946.
Surtout les saisissants-parlementaires sont de plus en plus prolixes. Si l’on ne retient que les recours parlementaires qui sont, sur le plan quantitatif, les plus représentatifs mais également ceux qui développent presque systématiquement une argumentation juridique, le Conseil a examiné entre 1974 et 1998, 2 184 moyens dont près de la moitié est postérieure à 1988. La motivation de certaines saisines est exceptionnelle par le nombre de griefs soulevés. Saisi de la constitutionnalité de la loi sur la maîtrise de l’immigration (n° 93-325 DC du 13 août 1993), le juge examina plus de soixante-dix-huit moyens. Dans ces conditions, les décisions du Conseil constitutionnel ont tendance, elles aussi, à croître en volume.
Comment expliquer ces tendances inflationnistes ? On constate tout d’abord une corrélation étroite entre l’importance politique d’une loi et la teneur d’une saisine. Plus l’opposition politique a été vive, plus la motivation d’un recours sera abondante. Par ailleurs, depuis le milieu des années 1980, les saisissants fondent non seulement leur appréciation sur leur interprétation des dispositions et principes à valeur constitutionnelle qui leur sont propre mais encore se réfèrent de plus en plus constamment et abondamment aux décisions du Conseil constitutionnel. Plus nombreux, les moyens sont aussi par ces références jurisprudentielles de meilleure qualité, même si, en dernière instance, seul le Conseil en est l’interprète authentique. De plus, les saisines comportent de plus en plus souvent des invitations à faire évoluer une jurisprudence, à reconnaître une valeur constitutionnelle à un nouveau principe, à se rapprocher de telle ou telle jurisprudence étrangère. Ces développements alourdissent les saisines de considérations dont leurs auteurs espèrent qu’elles trouveront, sinon dans l’immédiat, au moins à terme, une reconnaissance jurisprudentielle. Enfin, il n’est pas possible de nier l’intervention des professionnels du droit ou encore des universitaires dans la rédaction des recours.
-
[1]
« La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle) », RDP, 1928, p. 245, n° 9. [Retour au contenu] -
[2]
À neuf reprises depuis 1974, une minorité parlementaire appartenant à des groupes soutenant l’action gouvernementale a saisi le Conseil constitutionnel de lois ou de dispositions législatives symboliques ou à forte connotation morale dont ils réprouvaient l’adoption. Par exemple, telle fut l’hypothèse de la première saisine de ce genre dirigée contre la loi légalisant l’interruption volontaire de grossesse n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 ou encore du recours contre les lois bioéthique n° 94-343/344 du 27 juillet 1994. [Retour au contenu] -
[3]
N° 76-71 DC des 29-30 décembre 1976 (élection du Parlement européen au suffrage universel direct), n° 85-188 DC du 22 mai 1985 (protocole sur l’interdiction de la peine de mort), n° 92-308 DC du 9 avril 1992 (Traité d’Union européenne), n° 97-394 DC du 31 décembre 1997 (Traité d’Amsterdam), n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 (Cour pénale internationale) et n° 99-412 DC du 15 juin 1999 (Charte européenne des langues régionales ou minoritaires). [Retour au contenu] -
[4]
N° 70-39 DC du 19 juin 1970 (Ressources propres aux Communautés européennes), et n° 97-394 DC du 31 décembre 1997 Traité d’Amsterdam, n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 Cour pénale internationale (deux décisions rendues sur saisine conjointe avec le président de la République). [Retour au contenu] -
[5]
N° 82-143 DC du 30 juillet 1982 : décision par laquelle le Conseil, juge de la constitutionnalité de la loi, considère que n’est pas susceptible d’être déclarée contraire à la Constitution une méconnaissance du partage de la loi et du règlement tel qu’il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution. [Retour au contenu] -
[6]
En raison de l’importance des règlements des chambres dans tout ce qui intéresse la procédure législative ou des rapports des assemblées et du Gouvernement. [Retour au contenu] -
[7]
N° 63-24 DC du 20 décembre 1963 et n° 99-415 DC du 28 juin 1999. [Retour au contenu] -
[8]
La résistance du Sénat au début de la mise en place des institutions a révélé son hostilité, du moins sa méfiance, à l’égard de ce nouvel organe concurrent, mais surtout a retardé l’avancement de ses travaux. [Retour au contenu] -
[9]
Se reporter à la conclusion du présent rapport. [Retour au contenu] -
[10]
Une « porte étroite » est un document adressé spontanément au Conseil constitutionnel par des personnes ou groupements de personnes intéressés à la défense ou à la critique de la loi. Ce document ne fait pas partie du dossier de procédure. [Retour au contenu] -
[11]
Pascal JAN, La saisine du Conseil constitutionnel, LGDJ, 1999. [Retour au contenu]
Rapport de la Cour constitutionnelle du Gabon
Mars 2000
I. L’ouverture du droit de saisine
De manière générale, la saisine de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité des normes est ouverte aux autorités publiques et aux personnes physiques ou morales. Plus spécifiquement, selon le type de normes contrôlées, la saisine de la Cour est réservée à certaines autorités plutôt qu’à d’autres. Pour les personnes physiques ou morales, elle ne porte que sur les lois et les actes réglementaires.
I – 1. – Les requérants
I – 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant

N.B. : Toute personne physique ou morale, y compris les non-nationaux, bénéficie du droit de saisir la Cour constitutionnelle.
I – 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Elles n’ont pas évolué pour ce qui concerne le recours par voie d’action. Mais on peut répondre par l’affirmative pour ce qui est du recours par voie d’exception S’agissant de celui-ci, il faut dire que jusqu’à une date récente, il était ouvert à tout justiciable à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, mais soumis à l’appréciation de son bien-fondé et de son sérieux par le juge du fond. Ce filtrage a été supprimé à la faveur d’une révision constitutionnelle.
Dorénavant, le juge du fond, une fois l’exception soulevée par le justiciable, se borne à saisir la Cour par voie d’exception préjudicielle.
I – 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Non.
I – 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Les requérants ont effectivement la possibilité de se désister de leur saisine. Aucun délai n’est imposé pour cela, il suffit de déposer une lettre au Greffe de la Cour. Le désistement peut aussi être partiel, c’est le cas si le requérant décide d’abandonner un moyen soulevé dans sa requête.
I – 2. – Actes contrôlés
I – 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé

I – 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
La Constitution et la Loi organique sur la Cour constitutionnelle précisent 278 de façon explicite les actes soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle.
I – 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Oui.
I – 3. – Les délais
I – 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Non, sauf en ce qui concerne la conformité à la Constitution de la question posée aux citoyens dans le cadre du référendum et pour ce qui est des recours par voie d’exception.
I – 3.2. – Tableau des conditions de délais

I – 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Non.
Quels problèmes spécifiques posent-ils ? Comment ceux-ci sont-ils résolus ?
Cf. Réponse à la question I-3.4.
I – 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
Des critiques ont été effectivement émises par la Cour elle-même, notamment en ce qui concerne le délai imparti aux particuliers pour saisir la Cour d’une loi ordinaire qui méconnaîtrait leurs droits fondamentaux.
Aux termes de l’article 35, alinéa 2, de la Loi organique sur la Cour constitutionnelle, la saisine de la Cour par les particuliers doit intervenir dans le délai de promulgation fixé à l’article 17 de la Constitution, c’est-à-dire vingt cinq jours (ramenés à dix jours en cas d’urgence), et en tout cas avant la promulgation.
Or, les particuliers rencontrent quelquefois des difficultés pour se procurer un texte de loi avant sa promulgation. Par ailleurs, le président de la République peut promulguer une loi dès qu’il la reçoit du Parlement, ce qui place le particulier dans une situation de forclusion, faute de délai.
Aussi la Cour a-t-elle suggéré qu’un délai soit aménagé, avant lequel la promulgation de la loi ne peut intervenir.
II. Recevabilité de la saisine
II – 1. – Conditions relatives au requérant
II – 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Non, car aux termes de l’article 25 de la Loi organique sur la Cour constitutionnelle, la procédure devant celle-ci est gratuite.
II – 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
La représentation du requérant par ministère d’avocat est possible mais non obligatoire. En effet, toujours aux termes de l’article 25 de la Loi organique sur la Cour constitutionnelle, « les parties peuvent se faire assister par un conseil de leur choix ».
II – 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Pour les autorités habilitées à saisir la Cour, leur intérêt est présumé. En 280 revanche, pour les personnes physiques ou morales, elles doivent démontrer que l’acte attaqué lèse leurs droits. Ceci résulte des articles 36 et 37 de la Loi organique précitée.
II – 2. – Conditions relatives au recours
II – 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Le Greffe de la Cour constitutionnelle dispose d’un registre dans lequel les requêtes sont enregistrées et numérotées selon l’ordre d’arrivée.
II – 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date faisant foi pour la suite des procédures est la date d’enregistrement de la requête. L’article 37, alinéa 4, de la Loi organique sur la Cour dispose à cet effet que l’enregistrement au Greffe de la requête fait courir le délai prévu pour rendre la décision.
II – 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Conditions formelles et matérielles



II – 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Non.
II – 2.5. – Existe-il une procédure de régularisation de la requête ?
Une requête n’est enregistrée que lorsqu’elle est complète c’est-à-dire lorsqu’elle est accompagnée des pièces justificatives exigées par la loi.
II – 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
Il s’agit, dans cette partie, de décrire la procédure actuelle par laquelle la Cour déclare l’irrecevabilité d’une requête.
II – 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
La Cour constitutionnelle statue en formation plénière sur la recevabilité des recours.
II – 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Non, dans la mesure où la Cour constitutionnelle ne dispose pas d’une instance de filtrage des recours.
II – 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
La Cour constitutionnelle statue effectivement en formation plénière sur la base d’un rapport. En effet, aux termes de l’article 26 de la Loi organique, aucune décision ne peut être rendue, aucun avis ne peut être émis si la requête ou la demande n’a fait au préalable l’objet d’une instruction, diligentée par un rapporteur désigné par ordonnance du président de la Cour constitutionnelle parmi les membres de celle-ci.
Comment sont enregistrées les requêtes ?
Les requêtes sont enregistrées au Greffe de la Cour constitutionnelle par un greffier, selon l’ordre d’arrivée, dans un registre dit « des entrées ». Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives, à savoir l’acte ou les actes attaqués et, éventuellement, des documents annexes à même d’éclairer la religion de la Cour.
Les requêtes ne remplissant pas cette condition ne sont pas enregistrées.
II – 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
La décision d’irrecevabilité est à la fois motivée, prononcée et publiée.
II – 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Non, sauf en matière de contentieux électoral.
II – 3.6. – La procédure conduisant à une déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
Non, cette procédure est restée la même.
II – 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Nombre de requêtes examinées et jugées irrecevables, par norme contrôlée :

Pourcentage d’irrecevabilités par norme contrôlée et par motif :

III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III – 1. – Principe du contradictoire
III – 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Lorsque la Cour se juge valablement saisie, certaines formalités comme celle d’aviser les autorités ou parties potentielles au procès sont obligatoires.
L’article 35, alinéa 1, de la Loi organique sur la Cour dispose à cet effet que les autres catégories de lois en instance de promulgation, à l’exception de la loi référendaire, les ordonnances et les actes réglementaires peuvent être également déférés à la Cour constitutionnelle qui en avise sans délai le président de la République, le Premier ministre et les présidents des chambres du Parlement. Ceux-ci en informent les membres de leur chambre.
III – 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
C’est durant l’instruction, si le rapporteur le juge utile, que les parties ont accès au prétoire. À cet effet, le rapporteur peut les entendre oralement, solliciter leurs observations par écrit ou par ministère d’avocat interposé. Exceptionnellement, et par dérogation au caractère écrit de la procédure, le président de la Cour peut, après lecture du rapport à l’audience, et s’il le juge opportun, convoquer les parties ou toute autre personne intéressée et les inviter à présenter verbalement leurs observations.
III – 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Tout procès devant la Cour est contradictoire. Il ne saurait en être autrement pour le procès en constitutionnalité.
III – 2. – Égalité des armes
III – 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ?
Les pièces constitutives de la procédure sont : la requête, le texte attaqué et, le cas échéant, les documents attestant de la qualité de l’auteur de la saisine et de son intérêt à agir.
Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Oui, celles que la Cour ne juge pas nécessaires pour éclairer sa religion.
III – 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ?
Comme déjà dit plus haut, la procédure devant la Cour est contradictoire. Cela sous-entend effectivement la transmission et l’accessibilité de toutes les pièces aux parties.
Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Le rapport du rapporteur.
III – 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Aux termes de l’article 26 de la Loi organique sur la Cour constitutionnelle, le rapporteur instructeur désigné par le président de la Cour a la possibilité d’entendre les parties ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît opportune. Il peut aussi solliciter par écrit des avis qu’il juge nécessaires. Il impartit des délais et ordonne au besoin des enquêtes.
III – 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ?
En principe, la Cour statue uniquement sur l’ensemble des moyens soulevés par le requérant.
Elle ne peut soulever de moyens d’office, sauf cas de violation manifeste de la Constitution ou de principes à valeur constitutionnelle. De manière générale, la Cour le fait chaque fois que nécessaire (art. 40 de la Loi organique sur la Cour).
Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
Non.
III – 3. – Délai de jugement
III – 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
En matière de contrôle de constitutionnalité, la Cour est effectivement tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini. Celui-ci n’est pas le 286 même dans tous les cas.
La Cour statue dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête au Greffe. Ce délai est ramené à huit jours en cas d’urgence invoquée par le gouvernement.
Il est de quarante-huit heures maximum en ce qui concerne le contrôle des ordonnances prises par le président de la République conformément aux dispositions de l’article 26 de la Constitution. Les délais sont toujours respectés.
III – 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
De façon formelle, la clôture de l’instruction se fait par le dépôt du rapport au Greffe de la Cour.
III – 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
Cf. réponse à la question III-3.1.
Conclusion
- – L’accès au juge constitutionnel n’a conduit à aucune adaptation structurelle du Greffe de la Cour si ce n’est son renforcement en moyens humains. En revanche, il a conduit à une restructuration du Centre d’Études et des Recherches Constitutionnelles et Législatives de la Cour constitutionnelle. Ce Centre existe depuis 1993. Sa mission est de procéder à toutes études et recherches à caractère constitutionnel, législatif et de droit comparé nécessaires à l’information des membres de la Cour. Pour ce faire, il reçoit en son sein, à titre permanent ou temporaire, des praticiens de droit ou des chercheurs de haut niveau dans les domaines constitutionnel, législatif et de droit comparé. L’élargissement du domaine d’intervention de la Cour constitutionnelle a amené celle-ci à proposer le renforcement de l’action du Centre en lui permettant d’accueillir, à titre permanent, des magistrats et des professeurs de droit selon les critères retenus et dont le rôle sera d’assister les membres de la Cour dans l’accomplissement de leur mission.
- Il existe effectivement une proposition d’amélioration du système de l’accès au juge constitutionnel. Suite à la critique émise en réponse à la question I-3.4., et en vue justement d’améliorer l’accès des particuliers au juge constitutionnel, la Cour a suggéré que soit aménagé un délai raisonnable au cours duquel la promulgation de la loi ne peut intervenir.
- On n’assiste pas à une professionnalisation des requêtes.
Rapport de la cour suprême de Guinée
Mars 2000
Rapport établi par Chaïkou Yaya Balde,
Conseiller à la Cour suprême de Guinée.
I. L’ouverture du droit de saisine
I 1. – Les requérants
I 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
En République de Guinée, en dehors de contentieux électoral exclu du thème, il y a seulement le président de la République, un groupe de députés égal au moins à un dixième de ses membres ou un député qui ont qualité pour saisir la Cour suprême en recours pour faire constater l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’un traité international (art. 40 de la Loi organique n° 91/08/C T.R.N. du 23 décembre 1991, articles 60 et 78 de la Loi fondamentale).

Il faut souligner qu’un seul député peut saisir la Cour suprême quand il s’agit du recours pour faire constater l’inconstitutionnalité d’un engagement international (art. 78 de la Loi fondamentale).
I 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Pour le moment il n’y a pas eu de modification des textes au point de vue ouverture du recours.
I 1.3. – La Cour dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Cela n’est pas prévu par la loi.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
En fait non, car il est légalement reconnu que tout document fourni après dépôt de la requête, n’a pour la Cour qu’une valeur de simple renseignement.
I 2. – Actes contrôlés
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’actes contrôlés
Les actes susceptibles d’être contrôlés sont :
- les lois organiques ;
- les lois ;
- les engagements internationaux.

Il faut rappeler que notre institution n’étant créée qu’en 1992, seule la période 1994-2000 nous intéresse pour les tableaux.
I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle, par les textes, par la jurisprudence ?
La loi place les engagements internationaux hors contrôle dès qu’ils sont ratifiés, quant à la jurisprudence elle n’existe pas en la matière.
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Quant à savoir si la Cour peut contester la constitutionnalité d’une loi autre que celle dont elle est saisie, nous répondons qu’elle ne se prononce que sur la loi objet du recours.
I 3. – Les délais
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Il n’y a pas de recours recevable sans délai. Il est souligné qu’il faut saisir la Cour avant promulgation (saisine obligatoire seulement sur les lois organiques).
I 3.2. – Tableau des conditions de délais

I 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ? I 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
Sur les questions de savoir si les délais ont changé sur la période d’ensemble ou s’ils sont l’objet de critiques, nous répondons par la négative.
II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives au requérant
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Le requérant n’a aucun droit de timbre à payer.
II 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
Le requérant peut être assisté par un avocat, mais cela n’est pas obligatoire.
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Le requérant donne les motifs de sa requête mais n’a pas d’intérêt personnel à défendre.
II 2. – Conditions relatives au recours
II 2.1. – Comment sont numérotés les recours ?
Les requêtes sont numérotées par ordre chronologique de leur dépôt au Greffe.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date de dépôt du recours au Greffe fait foi (art. 47 alinéa 4 de la Loi organique n° 91/008/CTRN du 23/12/91).
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des recours actuellement en vigueur ?
Aucune forme de papier n’est exigée par la loi. Pièces annexées :
- deux copies du texte de la loi attaquée ;
- contenir un exposé des moyens invoqués ;
- signé par le président de la République ou par chacun des députés (art. 40 Loi n° 91/008/CTRN) ;
- aucun moyen nouveau ne peut être pris en compte : article 46 Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91. Tout document produit après dépôt de la requête n’a pour la Cour qu’une valeur de simple renseignement.
Tableau des conditions formelles

II 2.4. – Les conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Non.
II 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Non.
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
C’est la Cour suprême qui statue sur la recevabilité des recours.
II 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Non.
N.B. : le tableau sur les conditions matérielles est sans objet.
II 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
Non, c’est la chambre constitutionnelle et administrative composée d’un président (Premier président de la Cour suprême), de quatre conseillers, du Ministère Public représenté par le procureur général et des avocats généraux avec l’assistance du greffier en chef qui statue sur la recevabilité.
Toutes les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef au vu de la simple requête et il en délivre récépissé (art. 41 alinéa 1 de la Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91).
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
Les décisions d’irrecevabilité doivent être motivées, prononcées en audience publique et publiées au Journal officiel comme les autres arrêts rendus en matière constitutionnelle.
II 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passible d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Non.
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Le rejet au point de vue forme peut être prononcé pour le fait que le requérant n’a pas qualité ou au motif qu’ayant la qualité il n’a pas respecté les prescriptions légales notamment les dispositions de l’article 41 de la Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91.

Ce tableau indique que la Cour n’a pas prononcé des rejets pour les motifs indiqués.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
III 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Il faut rappeler ici que la procédure d’une saisine recevable ou irrecevable suit le même cheminement car comme dit plus haut, ce n’est que la composition compétente qui peut déclarer une requête irrecevable ou non.
Si c’est le président de la République qui est auteur du recours, le greffier en chef de la Cour suprême donne avis sans délai au président de l’Assemblée nationale.
Lorsque le recours est exercé par les députés, le greffier en chef de la Cour en donne avis sans délai au président de la République et au président de l’Assemblée nationale. Dans tous les cas il délivre un récépissé de dépôt au requérant (art. 41 de la Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91).
Après ces formalités la requête est transmise sans délai par le greffier en chef au Premier président (président de la Chambre constitutionnelle) qui désigne un rapporteur à qui les documents sont communiqués.
Le conseiller rapporteur réunit les informations, fait les enquêtes, dresse un rapport en y évoquant tous les moyens soulevés par le requérant mais ne donne pas un avis écrit dans le rapport.
La procédure n’est pas contradictoire, la Cour suprême prescrit toutes mesures d’instruction qui lui paraissent utiles et fixe les délais dans lesquels ces mesures seront exécutées (art. 46 de la Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91). Dans notre législation, dès que le recours est déposé au Greffe, la Cour est aussitôt saisie.
III 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
Le requérant dépose un mémoire mais n’a pas accès au prétoire, les séances de la Cour suprême en matière constitutionnelle ne sont pas publiques (art. 47, de la Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91).
III 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Il n’est pas contradictoire tel que prévu dans notre législation (art. 46 alinéa 1 de la Loi organique).
III 2. – Égalité des armes
III 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Les pièces sont : la requête, l’acte soumis à l’appréciation du juge Constitutionnel, les moyens invoqués et l’acte d’instruction du conseiller rapporteur, les observations du Ministère Public.
Les pièces communiquées par les parties après dépôt du recours sont exclues car elles n’ont valeur pour la Cour que de simples renseignements.
III 2.2. – Toutes les pièces transmises sont-elles accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Il n’y a pas deux parties au procès, il n’y a que le requérant qui dépose des pièces et les autorités à informer ne sont pas destinataires des pièces (avis seulement).
III 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Le conseiller rapporteur dispose de tous les moyens pour procéder à l’instruction du dossier dont il est saisi (art. 46 alinéa 3, Loi organique n° 91/008/CTRN du 23/12/91).
III 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ?
Oui.
Dans le cadre de la loi attaquée, si la Cour relève une violation de la loi fondamentale qui n’a pas été invoquée, elle doit la soulever d’office (art. 47 alinéa 3 de la Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91).
Toutefois la Cour suprême ne s’est pas trouvée dans ce cas.
III 3. – Délai de jugement
III 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Lorsque le président de la République saisit la Cour suprême pour constater que la loi votée relève du domaine réglementaire, le délai pour se prononcer est de un (1) mois ; quand le gouvernement déclare l’urgence ce délai est réduit à huit jours (art. 60 de la Loi Fondamentale et article 53 de la Loi n° 91/008/CTRN du 23/12/91).
En matière constitutionnelle, la Cour suprême se prononce dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter du dépôt des recours (art. 47 Loi organique).
Des délais prédéfinis existent : quinze (15) jours, un (1) mois et exceptionnellement huit (8) jours et ils sont respectés.
Rapport de l’assemblée nationale populaire de Guinée Bissau
Septembre 2000
Éléments de réponse
1. Il n’existe pas en République de Guinée Bissau de tribunal spécifique, autonome, dénommé « Tribunal constitutionnel ».
Aux termes de l’article 121 de la Constitution du 4 décembre 1996 en effet :
« 1. – Est interdite l’existence de tribunaux exclusivement destinés au jugement de certaines catégories de crimes.
2. – Par exception à l’alinéa précédent, peuvent être créés :
a) des tribunaux militaires compétents pour juger des crimes militaires définis par la loi ;
b) des tribunaux administratifs, fiscaux et des comptes ». L’article 122 de la Constitution dispose quant à lui :
« Des tribunaux compétents pour trancher des litiges à caractère social, civil ou pénal, peuvent être créés par la loi. »
2. Le 7 juin 1999, l’Assemblée nationale populaire a adopté une loi de révision constitutionnelle qui n’est cependant à ce jour pas en vigueur. Elle prévoit en son article 234/3 la possibilité de création par une loi ordinaire de l’Assemblée nationale populaire, d’un tribunal constitutionnel dans la mesure où elle dispose : « la loi pourra créer des tribunaux spéciaux en raison de la matière ».
Cependant, comme mentionné ci-dessus, cette loi n’est pas en vigueur faute de promulgation.
3. En matière de contrôle de la constitutionnalité des lois, est prévu un contrôle concret qui relève de la compétence du Tribunal suprême de Justice, alors que l’article 85/0 de la constitution n’accorde à l’Assemblée nationale populaire qu’une compétence de contrôle abstrait des lois.
Aux termes de l’article 126 de la Constitution :
« 1. – Ne peuvent servir de fondement à un jugement ni être appliquées par les tribunaux, les lois qui violent les dispositions constitutionnelles ou les principes qui y sont garantis.
2. – La question de l’inconstitutionnalité peut être soulevée d’office par le tribunal, par le ministère public ou par toutes parties au procès.
3. – Le Tribunal suprême de Justice tranchera la question de constitutionnalité en séance plénière.
4. – Les décisions prises en matière de contrôle de constitutionnalité par la plénière du Tribunal suprême de Justice ont force obligatoire et sont publiées au Bulletin officiel.»
Cette compétence, propre aux tribunaux constitutionnels, devrait évoluer avec la révision constitutionnelle en cours. Le contrôle concret de constitutionnalité ne devrait pas être maintenu au titre de la compétence du Tribunal suprême de Justice.
Rapport du tribunal constitutionnel de Guinée Équatoriale
Mars 2000
I. L’ouverture du droit de saisine
Il existe en droit interne deux types de recours constitutionnels, à savoir le recours d’inconstitutionnalité des lois, dispositions normatives et actes ayant valeur légale et le recours d’amparo constitutionnel, lequel vise à protéger tous les citoyens des violations des droits et libertés reconnus par la Loi fondamentale de Guinée Équatoriale du fait des actes juridiques émanant des pouvoirs publics.
I 1. – Les requérants
Le recours d’inconstitutionnalité peut émaner du chef de l’État, du Premier ministre, du Parlement et du procureur de la République.
Le recours d’amparo constitutionnel peut émaner de toute personne physique ou morale dont une liberté ou un droit fondamental définis à l’article 13 de la Constitution aurait été violé.
I 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
Le Tribunal constitutionnel n’a été saisi d’aucun recours d’inconstitutionnalité depuis l’année 1995, date de sa création.
Le Tribunal constitutionnel a été saisi le vingt-sept recours d’amparo constitutionnel de 1995 à juin 2000.
Parmi les requérants on dénombre vingt-cinq personnes physiques et deux partis politiques.
Le droit de saisine est reconnu aux étrangers en matière de recours d’amparo constitutionnel dans les mêmes conditions que pour les nationaux ; le Tribunal constitutionnel a déjà été saisi en l’espèce par des ressortissants Syriens, Espagnols, Hindous.
I 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Les conditions de saisine n’ont pas été modifiées depuis la création du Tribunal constitutionnel.
I 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Le Tribunal constitutionnel ne peut pas se saisir d’office.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Les requérants peuvent se désister de leurs saisines.
I 2. – Actes contrôlés
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé :
Les actes susceptibles d’être contrôlés en matière de recours d’inconstitutionnalité sont les lois et tous autres actes ayant valeur de loi.
Les actes susceptibles d’être contrôlés en matière de recours d’amparo constitutionnel sont tous les actes juridiques émanant des pouvoirs publics et pris en violation des droits fondamentaux et des libertés définis à l’article 13 de la Constitution, dont les lois, lois organiques, règlements, etc.
I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Il n’y a pas de normes ou d’actes placés hors contrôle, ni par les textes, ni par la jurisprudence.
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
À l’occasion d’un recours contre une loi, il n’est pas possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi.
I 3. – Les délais
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Il n’y a pas de recours recevable sans délai.
I 3.2. – Tableau des conditions de délais

I 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Les délais n’ont pas changé sur la période d’ensemble.
I 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
Ils ne posent aucun problème spécifique et ne font l’objet d’aucune critique.
II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives au requérant
A – Pour le recours d’inconstitutionnalité :
a) identification du requérant ;
b) identification de la norme ou de l’acte contesté ;
c) identification de la Loi ou de la disposition contestée ;
d) identification du principe constitutionnel violé.
B – Pour le recours d’amparo constitutionnel :
a) identification du requérant ;
b) fondements du recours ;
c) identification du principe constitutionnel violé ;
d) identification de la protection sollicitée.
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Le requérant ne doit s’acquitter d’aucun droit de timbre, la justice constitutionnelle est gratuite.
II 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
Le requérant doit être obligatoirement représenté par ministère d’avocat.
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Le requérant ne doit pas démontrer son intérêt à agir.
II 2. – Conditions relatives au recours
II 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Selon l’ordre d’entrée au registre et la date.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date de l’enregistrement.
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Le recours sera rédigé sur papier libre exclusivement vendu par l’Administration (efecto timbrado), en autant de copies que de parties, dont une pour le Ministère Public.
Il contiendra nécessairement toutes pièces justifiant la qualité à agir du requérant.
Il sera accompagné des pièces annexes indispensables.
Les mentions obligatoires sont l’identification du requérant, l’identification de la norme ou de l’acte contesté.
Pour le recours d’amparo, certaines mentions obligatoires sont par ailleurs nécessaires, telles que :
- l’exposé des faits ;
- l’identification du principe constitutionnel violé, avec précision de la protection sollicitée pour rétablir les droits et libertés violés.
Pour le recours d’inconstitutionnalité et la déclaration d’inconstitutionnalité des traités internationaux, certaines mentions sont également nécessaires, telles que :
- l’identification du requérant ;
- l’identification de la norme ou de l’acte contesté ;
- l’identification du principe constitutionnel violé.
II 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Ces conditions n’ont pas évolué dans le temps. Toutefois, il faut préciser qu’une nouvelle Loi organique est en cours d’étude, or elle introduit des changements substantiels des règles de fonctionnement du Tribunal constitutionnel.
II 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Il n’existe pas de procédure de régularisation de la requête.
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
Pour le recours d’inconstitutionnalité, il existe un seul cas possible de rejet : lorsque le Tribunal aurait à l’occasion d’un précédent recours substantiellement identique, conclu sur un rejet pour irrecevabilité.
Pour le recours d’amparo, il existe plusieurs cas possibles de rejet :
a) lorsque le recours a été présenté hors délai ;
b) lorsque le recours ne remplit pas les conditions légales d’admissibilité ;
c) lorsque le recours est fondé sur des droits et des libertés non protégés par le mécanisme de l’amparo constitutionnel ;
d) lorsque le recours n’est pas fondé en droit ;
e) lorsque le Tribunal a, à l’occasion d’un précédent recours substantiellement identique, conclu sur un rejet pour irrecevabilité.
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
C’est le Tribunal qui statue sur la recevabilité des recours.
II 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible d’appel ?
La décision du tribunal statuant sur la recevabilité n’est susceptible d’aucun recours.
II 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
Le Tribunal siège en formation plénière lorsqu’il statue sur la recevabilité des recours après audition du requérant et du Ministère Public pendant un délai commun de dix jours.
Le rapporteur est choisi parmi les magistrats suivant un ordre rotatoire. Les requêtes sont enregistrées au Greffe, au vu des pièces fournies.
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
La décision d’irrecevabilité doit être motivée, prononcée et publiée.
II 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Les requérants abusifs sont passibles d’une amende pour abus du droit d’agir pouvant aller de 25 000 F CFA à 200 000 F CFA.
II 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
La procédure conduisant à la déclaration d’irrecevabilité n’a pas évolué.
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Les motifs de rejet ont déjà été exposés précédemment au point II-3.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
III 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Dans le cadre du recours d’inconstitutionnalité, le Tribunal transfère la requête au Parlement aux fins de comparution et en vue de formuler toutes les allégations pertinentes.
Pour le recours d’amparo constitutionnel, le Tribunal requiert l’organe ou l’autorité auteur de la décision ou de l’acte, ou le juge ou tribunal qui a rendu la décision en cause pour qu’il lui remette ledit dossier ou sa copie.
III 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
Une fois que les documents susvisés sont transmis au tribunal, les parties sont requises aux fins de formuler toutes leurs allégations par écrit, par ministère d’avocat, ou pour la tenue d’une audience si les parties le souhaitent, ceci dans un délai de vingt jours.
III 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Le procès en constitutionnalité peut être défini comme pleinement contradictoire.
III 2. – Égalité des armes
III 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Les pièces constitutives de la procédure sont :
- Pour le recours d’inconstitutionnalité :
- la requête ;
- la providence d’admission ;
- l’acte de comparution du Parlement ;
- l’acte d’allégations du Parlement.
- Pour le recours d’amparo :
- la requête ;
- la providence d’admission ;
- le dossier remis par l’organe ou l’autorité auteur de la décision ou de l’acte, ou le juge ou tribunal qui a rendu la décision en cause ;
- l’acte d’allégations des parties, ou le procès-verbal d’audience.
III 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont les pièces qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Toutes les pièces sont transmises et accessibles aux parties.
III 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Le juge constitutionnel ne dispose pas de moyens propres d’instruction d’une affaire.
III 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
Le juge ne peut pas se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ni de dispositions non contestées dans la requête.
III 3. – Délai de jugement
III 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Aussi bien pour le recours d’inconstitutionnalité que pour le recours d’amparo, le Tribunal doit rendre son jugement dix jours après la formulation des allégations.
Les délais sont respectés.
III 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
Le Tribunal doit délibérer pendant le délai susvisé de dix jours après la présentation des allégations ou de la tenue de l’audience. Au terme de ce délai, le tribunal prononce son jugement, lequel est notifié aux parties et publié sous la charge du greffier en chef.
Conclusion
1. – Un renforcement des attributions du Tribunal constitutionnel est actuellement en cours.
2. – Une étude est actuellement en cours, visant à la révision de la Loi organique régissant le fonctionnement du Tribunal constitutionnel, afin de lui assurer le plein exercice de ses attributions et la primauté sur les tribunaux ordinaires.
3. – On n’assiste pas à une professionnalisation des requêtes.
Rapport de la cour de cassation de Haïti
Mars 2000
Éléments de réponse
Historique
Au lendemain de la proclamation de l’Indépendance d’Haïti en 1804 les décisions de justice sur recours en Cassation étaient rendues selon les modalités suivantes.
La Constitution impériale de 1805 en son article 48 attribuait à l’Empereur le droit de se prononcer sur les demandes en Cassation contre les jugements rendus par les Conseils militaires.
Tandis qu’aux prescrits de la Charte de décembre 1806 c’est le Sénat qui remplissait les fonctions du Tribunal Suprême dont les attributions ont été définies par la Loi du 24 août 1808.
Sous le gouvernement du président Alexandre Petion, le Tribunal de Cassation était fondé par la Constitution de 1816 et installé le 23 octobre 1817. Les lois organiques du 28 juillet 1817 et du 15 mai 1819 en ont fixé les attributions.
Ses membres étaient nommés à vie. Il se composait d’un doyen, de six juges, d’un commissaire, d’un substitut, d’un greffier, d’un greffier adjoint, d’un huissier audiencier et d’un huissier exploitant.
Suite aux amendements apportés en 1843 et en 1867 à la Constitution le titre de doyen du Tribunal de Cassation est remplacé par le titre de président dudit Tribunal.
Selon la Loi organique du 16 mars 1928 le Tribunal de Cassation comprenait un président, un vice-président, dix juges, un commissaire, trois substituts, un greffier, six commis-greffiers, trois huissiers audienciers et quatre huissiers exploitants.
Après la promulgation de la Constitution de 1950 le Tribunal de Cassation a changé de dénomination et est devenu la Cour de Cassation. Le nombre de ses membres est resté le même, son fonctionnement a été assuré par la Constitution de 1964 amendée en janvier 1971 et les lois organiques du 17 septembre 1963 et du 18 septembre 1985.
Actuellement elle est régie par la Constitution de 1987 et le Décret du 22 août 1995.
La Cour de Cassation aujourd’hui
Ses attributions sont fixées aux articles 178, 182 de la Constitution et aux articles 138, 139, 140, 141, 142 et suivants de ce dit décret sur l’organisation judiciaire.
Aux termes de l’article 412 du Code de procédure civile, la Cour de Cassation connaît des pourvois exercés contre les arrêts des Cours d’Appel et contre les jugements rendus en dernier ressort soit en matière civile, soit en matière de commerce, par les Tribunaux civils pour vice de forme, pour cause de violation, d’incompétence, d’excès de pouvoir, de fausse interprétation, de fausse application de la loi.
La Cour de Cassation statue aussi en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police sur le recours en Cassation selon les prescrits de l’article 332 du Code d’instruction criminelle.
Cette constitution rapporte aussi en son article 183 que la Cour de Cassation, à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en sections réunies sur l’inconstitutionnalité des lois.
Enfin, il n’est pas dans les attributions de la Cour de Cassation d’apporter des corrections aux textes législatifs.
Il est évident que la Cour de Cassation occupe le plus haut niveau dans le système judiciaire de la République d’Haïti.
La composition, l’organisation et la compétence de la Cour de Cassation sont établies dans la Constitution de 1987, le décret du 22 août 1995 et le Code de procédure civile.
En son article 174, la Constitution de la République d’Haïti prescrit que les juges de la Cour de Cassation sont nommés pour dix ans et en son Article 175 qu’ils sont nommés par le président de la République.
Selon le dernier décret du 24 août 1995 nul ne peut être juge à la Cour de Cassation s’il ne remplit l’une des conditions suivantes :
1. – Avoir occupé, pendant sept ans au moins les fonctions de juge ou d’officier du Parquet dans une Cour d’Appel ;
2. – Avoir exercé la profession d’avocat pendant dix ans au moins.
La nature et les effets des arrêts de la Cour de Cassation sont traités dans le Code de procédure civile.
Pour ce qui concerne la publication des décisions de la Cour de Cassation, elle est faite grâce à la bienveillance du greffier en chef de la Cour. Il n’y a pas de publication officielle.
Rapport de la cour suprême de L’Île Maurice
Septembre 2000
I. L’ouverture du droit de saisine
I 1. – Les requérants
La Cour suprême ne dispose pas d’une possibilité d’auto-saisine mais elle possède une compétence très vaste et exclusive en matière constitutionnelle. Les articles 17, 83, 84 donnent trois moyens à la Cour suprême pour statuer en matière constitutionnelle :
- mise en œuvre des garanties des droits fondamentaux et des libertés individuelles (art. 17) ;
- établissement d’une juridiction de première instance de la Cour suprême en matière constitutionnelle (art. 83) ;
- renvoi obligatoire de toute question constitutionnelle à la Cour suprême par les cours inférieures (art. 84).
Il est à noter que la compétence de la Cour suprême est sauvegardée pour apprécier si la personne ou l’autorité qui, en vertu de la Constitution, n’est soumise au contrôle d’aucune autre personne ou autorité dans l’exercice de ses fonctions, a en effet exercé ses fonctions en conformité avec la Constitution ou toute autre loi (art. 119).
Le requérant peut être une personne physique ou morale.
Le texte des articles 17, 83, et 84 de la Constitution :
Article 17. – Mise en œuvre des garanties
- Quiconque allègue que l’une quelconque des dispositions des articles 3 à 16 sur les droits fondamentaux et les libertées individuelles a été, est ou est susceptible d’être violée à son encontre, pourra, indépendamment de tout autre recours légalement possible, s’adresser à la Cour suprême pour faire respecter ses droits.
- La Cour suprême sera compétente, comme juridiction de première instance, pour statuer sur toute demande faite en application de l’alinéa 1 du présent article. Elle pourra faire telles injonctions et délivrer telles ordonnances qui lui semblent appropriées pour faire respecter ou assurer le respect des dispositions des articles 3 à 16, à la protection desquelles la personne concernée a droit :
- Étant entendu que la Cour suprême n’exercera pas les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent alinéa, si elle est d’avis que la personne alléguant la violation dispose ou disposait de moyens adéquats prévus par une loi pour mettre fin à la violation.
- Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article, la Cour suprême jouira de tous les pouvoirs qui pourront être prescrits afin qu’elle exerce plus efficacement la compétence qui lui est attribuée par le présent article.
Article 83. – La Cour suprême, juridiction de première instance en matière constitutionnelle
- Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 41, de l’alinéa 5 de l’article 64 et de l’alinéa 1 de l’article 101, lorsqu’une personne prétend qu’une disposition quelconque de la Constitution (autre que le Chapitre II) a été violée et que ses intérêts ont été ou sont susceptibles d’être affectés par une telle violation, elle peut, sans préjudice de toute autre action légalement disponible à propos de la même question, saisir la Cour suprême pour obtenir une declaration à cet effet et réparation en vertu du présent article.
- La Cour suprême est compétente pour connaître de toute requête faite en vertu de l’alinéa 1 du présent article ou de toute procédure légalement entamée devant elle, afin de déterminer si une disposition quelconque de la Constitution (autre que le Chapitre II) a été violée et faire une declaration à cet effet : Etant entendu que la Cour suprême ne peut faire une declaration en vertu des pouvoirs conférés par le présent alinéa sauf s’il est établi que les intérêts de la personne qui a fait la requête en vertu de l’alinéa 1 du présent article ou, s’il y a d’autres procédures entamées devant la cour, ceux d’une partie à ces procédures, sont affectés ou sont susceptibles de l’être.
- Lorsqu’en application de l’alinéa 2 du présent article, la Cour suprême fait une declaration à l’effet qu’une disposition de la Constitution a été violée et que celui qui a fait une requête en vertu de l’alinéa 1 du présent article – ou en cas d’autres procédures entamées devant la Cour, une partie à celles-ci – demande satisfaction à la Cour suprême, celle-ci peut lui accorder satisfaction par les moyens qu’elle considère appropriés. Le moyen par lequel la Cour donne satisfaction à cette personne, au détriment d’une autre, doit être permis lors de toutes les procédures devant la Cour suprême, en vertu d’une loi en vigueur à Maurice.
(…)
Article 84. – Renvoi des questions constitutionnelles à la Cour suprême
- Lorsqu’une question concernant l’interprétation de la Constitution est soulevée devant une cour de justice à Maurice (autre que la Cour d’Appel, la Cour suprême ou une cour martiale) et que la cour estime que la question touche un point de droit important, la cour renvoie cette question à la Cour suprême.
- Lorsqu’une question est renvoyée à la Cour suprême conformément aux dispositions du présent article, la Cour suprême rendra sa décision et la cour devant laquelle la question aura été soulevée devra juger le cas en tenant compte de la décision de la Cour suprême. Si cette décision est l’objet d’un appel devant la Cour d’Appel ou devant le Judicial Committee du Conseil Privé, la cour tiendra alors compte de la décision de la Cour d’Appel ou éventuellement de celle du Judicial Committee.
I 1.2. – Les conditions d’ouvertures du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Non.
I 1.3. – La Cour elle-même dispose t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Non, La Cour suprême ne dispose pas d’une possibilité d’auto-saisine.
Voir question I-1.1.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Oui, simplement par un retrait total ou partiel.
I 2. – Actes contrôlés
L’article 1 de la Constitution de Maurice stipule que Maurice est un État souverain et démocratique. L’article 2 stipule que la Constitution de Maurice est la loi suprême de Maurice et toute loi non-conforme à la Constitution est, dans la mesure de sa non-conformité nulle et non-avenue. À titre d’exemple, dans l’affaire Noordally v. Attorney General & Anor (1986) MR 204) la Cour suprême a statué qu’en vertu de l’Article 5 de la Constitution, la règle générale est qu’un prévenu a droit à une liberté conditionnelle et que c’est à la Cour et non pas à l’éxécutif de décider s’il doit être gardé en détention préventive en attendant d’être jugé. En conséquence la Cour suprême a annulé les dispositions du S. 46 (2) de la « Dangerous Drugs Act 1986 » qui imposaient une détention préventive obligatoire.
I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle par les textes ?
Par la jurisprudence ?
Certains actes sont placés hors contrôle, viz :
- la question de savoir si le Commissaire Électoral a agi conformément à un avis ou à une décision de l’Electoral Supervisory Commission ne peut être soulevée devant une cour de justice (art. 41(5) de la Constitution) ;
- sous réserve de certaines dispositions, lorsque le président est requis par la Constitution d’agir conformément à l’avis ou après consultation d’une personne ou autorité, la question de savoir s’il a agi ainsi ne peut être soulevée devant une cour de justice (art. 64(5) de la Constitution) ;
- dans l’accomplissement de ses fonctions, l’Ombudsman n’est soumis aux directives ou au contrôle de nulle autre personne ou autorité et aucune des procédures engagées devant l’Ombudsman ne peut être mise en cause devant une Cour de justice (art. 101(1) de la Constitution).
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie.
La question ne s’est pas posée jusqu’ici. Toutefois il est envisageable que la Cour donne une interprétation élargie à toute action visant à contester toute loi qui serait contraire à toute disposition de la Constitution.
I 3. – Les délais
Toute demande sous l’article 17 (1) ou de l’article 83 (1) précités de la Constitution doit être faite dans un délai de trois mois à compter des griefs sur lesquels la demande est fondée. Toutefois la Cour peut étendre ce délai si elle considère qu’il existe des raisons valables.
II. Recevabilité de la saisine
Le tribunal est saisi en vertu de ces mêmes articles par la voie d’une introduction d’instance (plaint with summons) où le requérant doit préciser toute disposition de la Constitution qui a été ou qui est susceptible d’être transgressée. Il devra aussi spécifier la nature de la réparation recherchée.
Une copie de cette demande doit être délivrée à la partie adverse et à l’Attorney-General, si ce dernier ou le governement n’est déjà été mis en cause. Cette sommation devrait se faire huit jours au moins avant que l’affaire soit appelée en cour [rule 2(3) Supreme Court (Constitutional Relief) Rules].
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre
Non, mais il existe des frais de dépôt de plainte devant le tribunal.
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Oui, il indique sa qualité pour agir. Voir les articles 17 et 83 précités.
II 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Inscription dans un registre par ordre numérique et chronologique.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures (date d’envoi, date de réception, date de l’enregistrement) ?
Date d’enregistrement au Greffe de la Cour (date of lodging).
II 2.3. – Par type de normes contrôlées et par type d’initiateur, les cours sont invitée à indiquer les conditions formelles et matérielles, de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur [1] :
Le type de support
Papier libre.
Le type de pièces annexes indispensables
La plainte doit être accompagnée d’une notice décrivant les pièces de preuve que compte apporter le plaignant, avec indication du lieu où ceux-ci pourraient être examinés.
Les mentions obligatoires, par exemple :
- Identification du requérant :
La plainte exige que les données suivantes soient spécifiées :
- nom ;
- profession ; et
- adresse du réquerant et de la partie adverse.
Le défendeur est sommé de comparaître devant la Cour à une période déterminée. La requête doit obligatoirement porter le sceau de la Cour dûment certifié par le Master and Registrar.
- Identification de la norme ou de l’acte contesté
Voir Recevabilité de la Saisine.
- Moyens et conclusions : en particulier, des moyens nouveaux peuvent-ils être soulevés en cours de procédure ?
Si oui, dans quel délais et selon quelles modalités ?
La Cour a un pouvoir discrétionnaire.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
Des dispositions procédurales spéciales sont établies par les « Supreme Court (Constitutional Relief) Rules » et les « Rules of the Supreme Court ». Tout procès est entendu sur le fonds contradictoirement.
La représentation du requérant se fait obligatoirement par ministère d’avocat.
Il est à noter qu’il est loisible au juge de désigner un avocat d’office pour représenter tout requérant, y compris le défendeur, sur preuve que la demande ou la défense est fondée dans son principe, et que le requérant satisfait les dispositions financières du « Legal Aid Act ».
La Cour n’est pas tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini. En principe toute question constitutionnelle est décidée dans le plus bref délai.

-
[1]
Il s’agit des règlements faits par le chef juge de la Cour suprême de l’Île Maurice entrés en vigueur le 30 juin 2000. [Retour au contenu]
Rapport du conseil constitutionnel du Liban
Mars 2000
Après une longue évolution, une grande partie des démocraties modernes a fini par adopter le principe du contrôle de la constitutionnalité des lois en dépassant les problèmes inhérents aux risques de mettre sous tutelle (juridictionnelle ou autre) le titulaire de la souveraineté nationale : le pouvoir législatif. Demeuraient cependant entières les questions relevant de l’étendue de l’accès au juge constitutionnel avec les modalités pouvant régir la saisine pour aboutir au résultat attendu.
Pour la saisine, certains auteurs de droit constitutionnel trouvent que trois solutions demeurent possibles : le droit de saisir l’organe de contrôle peut être réservé à des autorités politiques ; il peut aussi être confié à des juridictions (notamment lorsque l’organe de contrôle est une Cour constitutionnelle) ; il peut enfin être accordé aux citoyens [1].
Lorsque l’organe de contrôle est un organe politique comme en France ou au Liban (même si le statut du Conseil constitutionnel libanais fait ressortir son caractère juridictionnel) la saisine est généralement réservée à des autorités politiques, vu que c’est un contrôle par voie d’action, l’accès des citoyens au juge constitutionnel demeurant généralement l’apanage du contrôle par voie d’exception.
Cela ne veut nullement dire qu’il s’agit là nécessairement d’un contrôle tronqué, comme certains le laissent entendre, le contrôle par voie d’action, en dépit de ses difficultés pratiques, ayant le mérite d’aboutir à une situation claire : la loi constitutionnelle est purement et simplement éliminée de l’ordre juridique [2].
*
Au Liban, le problème de la saisine a été réglé, d’emblée, par le texte de l’article 19 de la Constitution libanaise (après sa dernière modification par la loi constitutionnelle du 21 septembre 1990) qui instituait, pour la première fois, un contrôle de la constitutionnalité des lois :
« Un Conseil constitutionnel sera institué pour contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au président de la République, au président du Conseil des ministres ou à dix membres de la chambre des députés, ainsi qu’aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux.
Les règles concernant l’organisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une loi. »
Il s’agit donc d’un système inspiré du droit constitutionnel français, après la révision de 1974, et qui accorde aux trois présidents (le Liban ne connaissant pas actuellement de Sénat) le droit de saisine ainsi qu’à dix députés au moins (sur 128 composant la chambre, chez nous), ce qui équivaut à peu près à la même proportion des 60 députés ou 60 sénateurs français par rapport au total des effectifs dans les deux assemblées.
Il faut cependant ajouter, concernant le Liban, que le droit de saisir le Conseil constitutionnel, en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois, est accordé aux chefs des communautés religieuses, particularité essentiellement libanaise, étendant pratiquement ce droit de saisine à dix-huit personnes supplémentaires coiffant les dix huit communautés religieuses officiellement reconnues, uniquement en ce qui concerne ce qu’on appelle, au Liban, les « intérêts religieux » au nom desquels ces mêmes communautés ont été érigées, pour ainsi dire, en personnes morales de droit public jouissant, en matière de statut personnel, d’un double droit de législation et de juridiction et ce depuis l’époque ottomane et sa politique des « Tanzimats » au XIXe siècle.
Ces droits des communautés ont toujours été religieusement respectés au Liban, les divers organes de l’État ne les touchant, pour aussi dire, qu’avec des pincettes.
Dans le seul recours introduit auprès du Conseil constitutionnel libanais par un chef religieux, le Cheikh Akl druze, en l’occurrence, nous voyons le Conseil traiter de la question de la recevabilité avec beaucoup de délicatesse et de minutie afin de ne pas priver la communauté en question de son droit de saisine, son chef religieux ayant été initialement désigné d’une manière apparemment peu régulière :
« Considérant qu’il faudrait ainsi déterminer si l’auteur de la saisine jouit de la qualité de Cheikh Akl de la communauté druze et par conséquent de la qualité de chef spirituel de cette communauté.
Considérant qu’il résulte des documents annexés au dossier et des faits établis que le Cheikh Bahjat Ghaith a pris en charge et de manière effective le poste de Cheikh Akl à partir du 23-10-1991, qu’il a exercé et continue d’exercer cette fonction et que c’est en cette qualité que l’État, les autorités religieuses et civiles ainsi que les fidèles de la communauté druze ont traité avec lui sans contestation ni réserve.
Considérant qu’indépendamment de la question de la légitimité de la nomination du Cheikh Bahjat Ghaith au poste de Cheikh Akl ou de la légalité de la délégation en date du 23-10-1991 faite par le Cheikh Akl Mohammed Abou Chacra lui confiant les tâches attenantes à ce poste, le Cheikh Bahjat Ghaith a exercé pratiquement et de manière effective ces tâches et assuré la continuité du service religieux et des wakfs druzes…
… Considérant qu’ainsi le Cheikh Bahjat Ghaith a qualité pour saisir le Conseil constitutionnel. »
(Décision du Conseil constitutionnel libanais n° 1/99 du 23 novembre 1999.)
Ainsi remarque-t-on nettement le souci du Conseil de ne pas priver la communauté druze de son droit de saisine l’emporter sur les autres motifs de recevabilité pour des raisons qui sautent aux yeux.
*
Les autres recours que le Conseil constitutionnel du Liban a accueillis, depuis qu’il a commencé effectivement à fonctionner en 1994, ont été l’objet de la saisine parlementaire bien que l’opposition, au Liban, n’ait pas pu organiser ses rangs comme en France pour laisser à la haute instance constitutionnelle le loisir de prendre sa vitesse de croisière et mettre à l’épreuve l’affirmation qu’on peut avoir juridiquement raison lorsqu’on est minoritaire, même si politiquement, on avait tort suite au vote d’une majorité faisant prévaloir arithmétiquement un autre avis, contrairement à ce qu’aurait déclaré un député de la majorité socialiste, grisé par la victoire de son camp, au lendemain des législatives de 1981.
Dans cet ordre d’idées, le Conseil a eu à trancher la question de savoir si les députés qui auraient signé au bas d’un recours pour le saisir de l’inconstitutionnalité d’une loi pouvaient, par la suite, se rétracter.
Il dut répondre par la négative dans une décision ainsi argumentée :
« Considérant que les titulaires de la saisine devant le Conseil constitutionnel, limitativement énumérés à l’article 19 de la Constitution, quand ils demandent l’annulation d’une loi inconstitutionnelle, exercent une prérogative que la Constitution leur confère dans l’intérêt général, et qui se trouve ainsi dépourvue de tout caractère litigieux personnel ;
Qu’un tel recours issu d’un pouvoir constitutionnel devient définitif lors de son inscription auprès du Conseil constitutionnel et ne peut être postérieurement rétracté… »
(Décision du Conseil constitutionnel libanais n° 2/95 du 25 février 1995.) En France, la question d’un possible désistement de l’action des parlementaires devant le Conseil constitutionnel n’a, pendant longtemps, pas été évoquée et ce jusqu’en 1996 lorsque le Conseil français refusa toute rétraction en soulignant le caractère nécessairement indivisible de la saisine, l’intérêt à agir étant la seule défense de la Constitution, ce qui justifie également que le Conseil exerce son contrôle sur l’ensemble de la loi soumise à son examen [3].
On ne peut pas, ajoute le professeur Guillaume Drago, vraiment utiliser la notion de parties à propos des requérants en contentieux constitutionnel, ce qui rejoint (nous ne pouvons que nous en réjouir !) la position du Conseil libanais.
Cette terminologie est même récusée par l’un des acteurs de la procédure de contrôle en France qui est le secrétaire général du gouvernement (v. lettre de M.Renaud Denoix de Saint-Marc, actuel vice-président du Conseil d’État, citée par O. Gobin dans son ouvrage, « La contradiction dans la procédure administrative contentieuse », LGDJ, 1988, p. 425).
Tout cela concerne évidemment la saisine, et ses auteurs comme le précise l’article 19 de notre constitution dans son texte remanié en 1990.
Pour le reste, la constitution se réfère à la loi et plus précisément en ce qui concerne les modalités et la procédure dont les détails furent établis par la Loi n° 250 du 14 juillet 1993 modifiée sur certains points par la Loi n° 149 du 30 octobre 1999.
*
Ayant collaborés aux travaux des deux commissions qui ont eu la difficile tâche de préparer le projet de loi présenté par le gouvernement : l’une nommée en avril 1991 par le ministre de la Justice d’alors le regretté Khatchig Babikian, l’autre en décembre 1992 par le ministre Bahige Tabbarah, nous avons assisté aux longs débats qui s’instaurèrent notamment à propos de l’institution d’un contrôle a priori ou a posteriori, et du délai qui devait être imparti pour la présentation, par les autorités compétentes, du recours en inconstitutionnalité.
Devait enfin l’emporter l’argumentation prônant le recours a posteriori pour ne pas permettre aux autorités chargées de la promulgation d’interrompre le délai, le cas échéant, et vu, qu’au Liban, les autorités religieuses investies du droit de saisine, ne peuvent normalement être notifiées de la promulgation de la loi que par le Journal officiel.
Ainsi la Loi du 14 juillet 1993 a accordé aux auteurs de la saisine un délai de quinze jours à compter de la parution du texte de la loi au Journal officiel. L’habitude était cependant, à l’époque, de faire paraître des numéros annexes du Journal officiel qui portaient le même numéro et la même date de parution que le numéro principal auquel ils étaient joints, ce qui portait
Les députés qui auraient présenté un recours contre la loi du budget en 1996 s’en sont très bien aperçus et demandèrent au Conseil constitutionnel de trancher.
Ce qui fut fait par la décision n° 1/96 du 3 avril 1996 qui s’est permise de contrôler matériellement la date exacte et effective de la parution de la loi au Journal officiel, rétablissant une vérité évidente et mettant un terme à une mauvaise habitude qui a disparu heureusement depuis, les numéros annexes du Journal officiel portant dorénavant la mention exacte du jour de leur parution.
*
D’autre part et du fait d’avoir établi un contrôle a posteriori, la loi de 1993 a donné droit au Conseil constitutionnel libanais de se réunir immédiatement pour se prononcer sur un éventuel sursis à exécution de la loi incriminée afin que ne se constituent pas entre temps des droits acquis en faveur de telle ou de telle partie.
À la même occasion, le président est supposé nommer, parmi les membres du Conseil, un rapporteur qui est tenu de présenter son rapport dans les dix jours, après quoi le Conseil doit obligatoirement prendre sa décision dans les quinze jours qui suivent, faute de quoi la loi incriminée sera mise en vigueur.
Précisions ici que le législateur libanais, en ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité des lois, a impérativement imposé une majorité qualifiée de sept voix et un quorum de huit membres au moins des dix dont le Conseil est habituellement composé. La loi de 1999 a tempéré cependant ces vigueurs en ce qui concerne le contentieux électoral en se suffisant, en la matière, de la majorité simple des membres présents et en reconnaissant une voix prépondérante au président du Conseil en cas de partage, cela ne rentre pas cependant dans notre propos ainsi que tous les autres détails qui dépassent le cadre du contrôle de la constitutionnalité strictement entendu.
*
« Le régime du Conseil constitutionnel suivi en France et au Liban est plus simple (par rapport aux autres régimes appliqués à travers le monde) et la simplicité dans le domaine du droit est une grande vertu, aux dires de notre excellent collègue le Professeur Pierre Gannagé [4]. Il offre sans doute moins de garanties du fait que la porte du Conseil constitutionnel est étroite et demeure interdite aux particuliers.
L’efficacité de la mission du Conseil constitutionnel va ainsi dépendre de la conscience de la classe politique dont l’inertie au Liban, plus encore que les recours inappropriés, pourra être redoutée. »
Nous y ajouterons ces quelques mots, à paraître dans une introduction à la Constitution libanaise encore inédite, écrite pour le recueil des Constitutions des pays arabes :
« Cette institution (le Conseil constitutionnel) qui a déjà effectué un bon démarrage sera toujours tributaire du choix judicieux des membres qui, par leur caractère et leur compétence, continueront à lui assurer une indispensable indépendance [5].»
-
[1]
Pierre Paclet, Institutions Politiques – Droit Constitutionnel, 17e édition, Paris, Armand Colin, 1998 p.80. [Retour au contenu] -
[2]
Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, 11e édition, Paris, LGDJ, 1999, p.112. [Retour au contenu] -
[3]
Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français, Paris, PUF, Collection Thémis, 1998, p. 283. [Retour au contenu] -
[4]
Pierre Gannage, Le Conseil constitutionnel libanais et les Constitutions des pays arabes, colloque du Cedroma à Beyrouth 1998, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 261. [Retour au contenu] -
[5]
Antoine Khair, Introduction à la Constitution Libanaise, in Recueil des Constitutions des pays du monde arabe. Cedroma (à paraître incessamment chez Bruylant, Bruxelles). [Retour au contenu]
Rapport de la haute cour constitutionnelle de Madagascar
Mars 2000
I. L’ouverture du droit de saisine
I 1. – Les requérants
I 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant

Pour le président de la République il s’agit essentiellement de saisines pour contrôle de constitutionnalité des lois et de demandes d’avis sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles ou législatives.
Le nombre des saisines ne cessait d’augmenter à partir de l’année 1994 eu égard aux différentes opérations électorales et surtout aux conséquences de la libéralisation de l’économie et par le biais du désengagement de l’État du secteur privé devant entraîner un certain nombre de réformes législatives. Les demandes d’avis auprès de la Haute Cour constitutionnelle, pour les mêmes causes que ci-dessus, sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires, affluaient aussi du côté du Premier ministre et de l’Assemblée nationale.
Quant aux personnes physiques, elles soumettaient à une juridiction quelconque le cas d’exception d’inconstitutionnalité à une loi prise en 1998 qui instituait une procédure spéciale de recouvrement de créances bancaires. Il faut remarquer que les débiteurs utilisaient le moyen d’exception d’inconstitutionnalité comme un moyen dilatoire devant les juridictions dans l’espoir de retarder les échéances de paiement.
I 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Les conditions d’ouverture du recours ont évolué dans le temps à la suite de la révision de la Constitution. La Constitution du 18 septembre 1992 a été révisée à Madagascar en 1998 à la suite d’une consultation populaire directe. À partir de cette révision, des changements structurels importants sont prévus telle la création de provinces autonomes pour l’effectivité des principes de décentralisation.
De là, d’ici peu, la saisine de la Cour constitutionnelle va s’étendre sur divers points relatifs à son objet et à la qualité des requérants.
(1) Le président de la République soumet à la Haute Cour constitutionnelle et avant leur promulgation, pour contrôle de constitutionnalité, les lois organiques et les ordonnances.
(2) Tout chef d’Institution (Président de la République, Premier ministre, président de l’Assemblée nationale, président du Sénat) peut déférer à la Cour constitutionnelle les lois ordinaires avant leur promulgation pour contrôle de constitutionnalité. Ce pouvoir est aussi reconnu au (3) quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires (Assemblée nationale, Sénat).
Un chef d’Institution ou le quart des membres composant l’une des Assemblées parlementaires ou (4) les organes des provinces autonomes peuvent déférer à la Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité, tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de leur compétence.
Tout chef d’Institution et tout organe des provinces autonomes peut consulter la Cour constitutionnelle pour donner son avis sur la constitutionnalité de tout projet d’acte ou sur l’interprétation de dispositions constitutionnelles.
(5) Enfin, en plus de l’exception d’inconstitutionnalité, toute personne physique peut soulever devant une juridiction quelconque l’inconstitutionnalité d’une disposition législative ou réglementaire qu’elle estime pouvant porter atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution.
I 1.3. – La Cour dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
La Constitution ne prévoit pas de cas d’auto-saisine de la Cour constitutionnelle.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
De même, la Constitution ne prescrit aucune procédure de désistement des requérants de leur saisine. Qu’ainsi, si le cas se présentait, la solution serait prise du côté purement jurisprudentiel.
I 2. – Actes contrôlés
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé :
Aux termes des dispositions de la Constitution révisée, ils peuvent être classés comme suit :
- A. – les traités ;
- les lois organiques ;
- les lois et ordonnances ;
- les règlements autonomes édictés par le pouvoir central.
- B. – les conventions interprovinciales ;
- les lois statutaires et les lois adoptées par les provinces autonomes ;
- tout texte à valeur législative ou réglementaire ainsi que toutes matières relevant de la compétence des provinces autonomes.
- C. – le Règlement intérieur de chaque Assemblée (Assemblée nationale et Sénat).
Les provinces autonomes à Madagascar ne seront mises en place que vers la fin de l’an 2000, qu’ainsi, le tableau suivant ne reflète que les cas relatifs aux actes contrôlés relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle selon la Constitution du 18 septembre 1992.

I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
En principe, il n’y a pas de normes ou d’actes placés hors contrôle par les textes ou par la jurisprudence. Seulement, il importe de signaler qu’il existe des actes pour lesquels la saisine de la Cour constitutionnelle est facultative, c’est-à-dire que l’autorité concernée a la faculté de déférer ou non lesdits actes à la Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité. Il s’agit là des lois ordinaires ou encore de tout texte à valeur législative ou réglementaire relevant de la compétence des provinces autonomes.
Par ailleurs, la même faculté est reconnue à tout chef d’Institution ou à tout organe des provinces autonomes sur les cas d’interprétation de tout projet d’acte ou sur l’interprétation de dispositions de la Constitution.
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Les dispositions constitutionnelles n’offrent pas de précision quant à la question de savoir s’il est possible ou non de contester la constitutionnalité d’une autre loi à l’occasion d’un recours contre une loi. Les dispositions légales se limitaient toujours à prescrire que la requête en inconstitutionnalité doit être appuyée de faits ou titres lui donnant un fondement suffisant. D’ailleurs, sur le plan jurisprudentiel, la pratique n’a pas encore eu lieu.
I 3. – Les délais
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Sauf pour le cas de demande d’avis sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle ou législative, tous les recours sont soumis à des conditions de délai.
I – 3.2. – Tableau des conditions de délai

I 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Lesdits délais n’ont pas changé sur la période d’ensemble.
Un problème se pose spécifiquement sur le cas des lois statutaires et des lois adoptées par les provinces autonomes telles que prévues à l’article 127 de la Constitution. Si l’article 118 de la Constitution donne compétence à la Cour constitutionnelle pour statuer sur leur conformité ou non à la Constitution, la même Constitution ne précise pas quelle autorité sera chargée de les promulguer et à quel moment cette promulgation doit avoir lieu.
II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives au requérant
Les conditions relatives au requérant sont déjà explicitées à la partie I-1.2.
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Il ne s’acquitte pas de droit de timbre.
II 1.1. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
La représentation du requérant par ministère d’avocat n’est pas obligatoire mais elle est toujours possible.
II 1.1. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
La jurisprudence constitutionnelle a toujours spécifié que le requérant doit démontrer sont intérêt à agir.
II 2. – Conditions relatives au recours
Essentiellement, les conditions relatives au recours se rapportent aux conditions de délai et à l’appui de la requête par des faits ou titres pouvant constituer des fondements suffisants.
II 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les requêtes sont numérotées selon un ordre chronologique et retenues dans un registre des requêtes par les soins du greffier en chef de la Cour constitutionnelle.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date faisant foi pour la suite des procédures est celle de la réception et celle de l’arrivée de la requête au siège de la Cour.
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Les conditions d’ouverture de saisine ayant été étendues par la Constitution révisée, les conditions formelles et matérielles correspondant à cette extension devront encore attendre la promulgation, dans un avenir proche, des lois organiques s’y référant. En conséquence, il ne nous paraît pas opportun dès maintenant de remplir les tableaux indiqués à la partie II-2.3.
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
En attente des lois organiques, il n’est pas encore possible de décrire par exemple la procédure à suivre relative aux modalités de rejet pour inconstitutionnalité pour le cas des requêtes présentées par les organes des provinces autonomes.
Pour le cas d’exception en inconstitutionnalité, en l’état actuel des textes notamment aux termes des dispositions de l’ordonnance n° 92-018 du 8 juillet 1992 relative à la Haute Cour constitutionnelle, la requête n’est recevable qu’à l’accomplissement des conditions suivantes :
- dépôt de la requête, en double exemplaire, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans le délai d’un mois à compter de la décision de la juridiction qui sursoit à statuer ;
- requête appuyée de faits ou titres lui donnant un fondement suffisant.
Pour le cas de saisine par l’Assemblée, la jurisprudence constitutionnelle n’a toujours reconnu que la requête présentée par le président de l’Assemblée nationale et non celle établie par un ou plusieurs membres du bureau de ladite Assemblée.
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
C’est l’Assemblée plénière de la Haute Cour constitutionnelle dirigée par son président qui statue sur la recevabilité des recours.
II 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
La décision statuant sur la recevabilité n’est pas susceptible de recours.
II 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
La Cour statue en formation plénière sur le rapport d’un Haut conseiller rapporteur préalablement désigné par le président.
Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef par ordre chronologique dans un registre des requêtes au vu de la requête et des pièces produites à l’appui de ladite requête.
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
La décision d’irrecevabilité a toujours été motivée et elle est notifiée aux parties et autorités directement concernées. Ces décisions sont publiées au Journal officiel de la République.
II 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur ne prescrivent pas d’amende ou d’autre sanction pour abus du droit d’agir.
II 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
Le contenu des lois organiques à venir fera ressortir les nouvelles dispositions sur la procédure d’irrecevabilité.
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Les motifs, dans leur ensemble, des rejets jusqu’à présent se présentent comme suit :
- non respect des délais prescrits par la Constitution ou par des lois spécifiques ;
- impossibilité d’identification du requérant ;
- absence d’intérêt à agir ;
- incompétence de l’auteur de la saisine ;
- domaine, objet de la requête, en dehors des actes contrôlés.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
III 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
- La requête est d’abord enregistrée par le greffier en chef dans un registre des requêtes ;
- La requête obtient un numéro d’ordre chronologique ;
- Le président désigne le Haut conseiller rapporteur ;
- La requête est notifiée à l’autorité concernée dans un délai déterminé et ladite autorité est invitée à présenter ses conclusions ;
- Le président, à la réception des conclusions, inscrit au rôle le dossier et fixe le jour d’audience.
III 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
La procédure devant la Cour est essentiellement écrite, toutefois l’avocat peut demander à plaider oralement devant la Cour à condition qu’il en informe d’avance la Cour.
III 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Le procès en constitutionnalité est pleinement contradictoire par le moyen surtout des échanges de mémoires entre les parties concernées.
III 2. – Égalité des armes
III 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
En matière d’exception d’inconstitutionnalité, par exemple, sont essentiellement requises :
- la requête en double exemplaire ;
- le texte de loi attaqué ;
- la décision de la juridiction devant laquelle a été présentée l’exception d’inconstitutionnalité.
III 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Toutes les pièces sont transmises et accessibles aux parties au procès.
III 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Le juge constitutionnel dispose de moyens propres d’instruction d’une affaire, soit en convoquant des organes techniques compétents dans l’affaire, soit par des décisions avant-dire-droit enjoignant la production d’autres pièces ou confiant l’enquête à un organe déterminé avant la décision au fond.
III 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
Le juge ne se saisit pas d’office de moyens non soulevés dans la requête et de dispositions non contestées dans la requête.
III 3. – Délai de jugement
III 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Jusqu’à présent, dans l’ensemble des cas présentés, la Cour statue généralement dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Toutefois, le président, pour des circonstances motivées, peut décider de proroger ce délai.
III 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
Il n’y a pas encore de procédure formelle de clôture de l’instruction.
III 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la cour pour statuer ?
Si aucun texte ne définit de délai, le délai moyen que prend la Cour pour statuer est toujours d’un mois à compter de la date de sa saisine.
Conclusion
- L’accès au juge constitutionnel a conduit à des adaptations structurelles au sein de la Cour constitutionnelle. Il s’agit de la création de nouvelles directions : direction de l’informatique, direction des affaires protocolaires. La direction de l’informatique est confiée au greffier en chef qui doit non seulement veiller à la bonne marche du service informatique mais aussi et surtout au renforcement de la capacité technique et organisationnelle du personnel.
- Les projets de réforme au sein de la Cour seront initiés au vu des travaux menés avec la l’ACCPUF. C’est pourquoi la Cour attache la plus grande importance à ces travaux pour concevoir des changements quantitatifs au niveau technique et organisationnel.
- En dehors des parties qui se font représenter par ministère d’avocat, il n’y a pas encore à proprement parler de professionnalisation des requêtes ou des requérants. Ces derniers, pour le moment, doivent se référer aux conditions particulières édictées spécifiquement par les dispositions législatives sur chaque cas.
Rapport de la cour constitutionnelle du Mali
Mars 2000
I. L’ouverture du droit de saisine
I 1. – Les requérants
La Cour constitutionnelle peut être saisie par :
le président de la République ;
le chef du gouvernement ;
le président de l’Assemblée nationale ;
un dixième des députés ;
le président du Haut Conseil des collectivités territoriales ;
un dixième des conseillers nationaux ;
le président de la Cour suprême ;
le président du Conseil économique social et culturel.
S’agissant exclusivement du contrôle en constitutionnalité des normes (traités, lois, règlements (décrets, arrêtés…), la Cour constitutionnelle du Mali, de sa mise en place (mars 1994) à la date d’élaboration de ce rapport (janvier 2000), a été saisie par :
Le président de la République : 0 saisine. Le Premier ministre : 7 saisines.
Le président de l’Assemblée nationale : 2 saisines. Les députés : 2 saisines.
Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales : 0 saisine (non encore installé).
Les conseillers nationaux : 0 saisine (non encore installés). Le président de la Cour suprême : 0 saisine.
Le président du Conseil économique social et culturel : 1 saisine en 2 passages.
Conseillers de village : 1 saisine.
Les sept (7) saisines du Premier ministre s’étalent dans le temps ainsi qu’il suit :
1re saisine : objet de la lettre n° 001/PRM – SG du 13 octobre 1996 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 10 le 15 octobre 1996. Elle est relative
au contrôle de constitutionnalité de la Loi n° 96-50/AN-RM du 27 septembre 1996 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle ; le contrôle fait l’objet de l’arrêt n° 96-004 en date du 11 novembre 1996 qui déclare certains articles contraires à la Constitution et non séparables du reste de ladite Loi organique.
2e saisine : objet même lettre n° 001/PRM-SGG du 13 octobre 1996 enregistrée au Greffe de la Cour sous le même n° 10 du 15 octobre 1996. Cette saisine concerne le contrôle de constitutionnalité des lois organiques n° 9647 et 96-48/AN-RM adoptées le 27 septembre 1996. Elles fixent le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités des membres de l’Assemblée nationale, les conditions de remplacement des députés à l’Assemblée nationale en cas de vacance. La Cour a déclaré contraires à la constitution les deux lois déférées par son arrêt 96-005 du 11 novembre 1991.
3e saisine : objet de la lettre n° 002/PRM-SGG du 15 octobre 1996 enregistrée au Greffe de la Cour constitutionnelle sous le n° 12 du 18 octobre 1996. Par cette saisine le Premier ministre demande le contrôle de constitutionnalité de la Loi 96-18/AN-RM du 13 juin 1996 portant Loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle. L’arrêt n° 96-006 du 14 novembre 1996 a sanctionné ce contrôle. La Cour a déclaré contraires à la Constitution les alinéas 1 et 2 de l’article 43 de la Loi 96-15 AN-RM.
4e saisine : objet de la lettre n° 001/PRM-SGG du 13 janvier 1997 enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 01. Par cette saisine le Premier ministre défère la Loi 97-002/AN-RM en date du 8 janvier 1997 portant Loi organique sur le nombre, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, et leurs indemnités.
Il s’agit d’une seconde présentation après l’arrêt n° 96-005 du 11 novembre 1996 qui a déclaré non conforme à la Constitution les Lois n° 96-47 et 96-48 ayant le même objet que la loi ci-dessus déférée.
La Loi n° 97-002/AN-RM du 8 janvier 1997 a elle aussi été sanctionnée. Les articles 1 et 9 et un alinéa de l’article 2 ont été déclarés contraires à la constitution par arrêt n° 97-007 du 17 janvier 1997.
5e saisine : objet de la lettre n° 004/PRM-SGG du 30 janvier 1997 enregistrée au Greffe de la cour sous le n° 4 le 31 janvier 1997. Par cette saisine le Premier ministre soumet à l’examen de la Cour constitutionnelle la Loi n° 9703/AN-RM du 16 janvier 1997 portant Loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle. Il s’agit d’une 2e présentation après l’arrêt n° 96-004 du 11 novembre 1996. La loi déférée vise cet arrêt. La Cour déclare ladite loi conforme à la Constitution (cf. arrêt n° 97-008 du 3 février 1997).
6e saisine : objet de la lettre n° 010/PRM-SGG du 11 février 1997 enregistrée au Greffe de la Cour sous n° 10 le 11 février 1997. Par cette saisine le Premier ministre demande le contrôle en constitutionnalité de la Loi organique n° 97-10/AN-RM fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités, les incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote. C’est la 2e présentation de la loi ayant le même objet que les Lois 96-47 et 96-48. Elle vise l’arrêt n° 96-005. Ainsi dans son arrêt n° 97-10 du 11 février 1997, la Loi n° 97-10 du 11 février 1997 est déclarée conforme à la Constitution.
7e saisine : objet de la lettre n° 006/PRM-SGG du 22 février 1999 enregistrée le 23 février 1999 sous le n° 003 au Greffe de la Cour constitutionnelle. Par cette saisine le Premier ministre demande le contrôle en constitutionnalité de la Loi n° 99-003/AN-RM du 28 janvier 1999 portant modification de la Loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote.
Par son arrêt n° 99-119 du 26 février 1999 la Cour déclare conforme à la constitution la loi déférée.
Les deux (2) saisines du président de l’Assemblée nationale se présentent ainsi qu’il suit :
1re saisine : objet de la lettre du président de l’Assemblée nationale enregistrée le 8 septembre 1997 sous le n° 332. Par cette saisine le président de l’Assemblée nationale soumet à l’examen de la Cour constitutionnelle le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Par son arrêt n° 97-58 la Cour a censuré comme contraire à la constitution l’intitulé du Règlement intérieur ainsi que plusieurs passages dudit Règlement.
2e saisine : objet de la lettre de transmission n° 171 du président de l’Assemblée.
Par cette saisine le président de l’Assemblée nationale informe la Cour de ce qu’il a pris en compte les dispositions de l’Arrêt n° 97-058 et qu’il a réexaminé son Règlement intérieur, en procédant aux modifications et corrections jugées nécessaires. Après vérification la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Les deux (2) saisines des députés :
1re saisine en date du 11 juin 1996 enregistrée le 12 juin 1996 au Greffe sous le n° 102.
Les députés par cette saisine demandent à la Cour un avis entre autres sur le statut du député, l’annulation de la levée de l’immunité parlementaire. À cet égard les députés disent se fonder sur l’article 88 alinéa 2 de la Constitution.
La Cour par son arrêt n° 96-002 des 23, 24 et 25 juillet 1996 a déclaré irrecevables les saisissants sur le fondement de l’article 88 alinéa 2 de la Constitution à demander un avis à la Cour. Ils ont en outre été déclarés irrecevables à demander l’annulation de la levée de l’immunité parlementaire devant la Cour constitutionnelle.
2e saisine en date du 1er octobre 1996 enregistrée au Greffe de la Cour à la même date sous le n° 09. La saisine des députés concerne le contrôle en constitutionnalité de certaines dispositions de la loi portant Code électoral notamment : le mode de scrutin et la composition de la Commission électorale nationale indépendante (C.E.N.I.).
La Cour quant à elle a entendu examiner la dite loi dans toutes ses dispositions conformément à l’article 88 alinéa 2 de la Constitution et l’article 31 alinéa 1 de la Loi organique n° 92-028 du 5 octobre 1992.
Ainsi la Cour par son arrêt n° 96-003 du 25 octobre 1996 a déclaré plus de quinze (15) articles de la loi déférée contraires à la Constitution. Ces articles en outre ont été déclarés non séparables de l’ensemble de la loi.
La saisine du président du Conseil économique social et culturel (PCESC) :
Le président du Conseil économique social et culturel a saisi la Cour le 10 juin 1994 aux fins de contrôle de constitutionnalité du Règlement intérieur de son Institution. Par son arrêt n° 001 en date du 1er février 1995 la Cour a déclaré non conformes à la Constitution certaines dispositions dudit Règlement intérieur en ce que ces dispositions violent notamment les articles 70 et 111 de la Constitution. Après mise en conformité et vérification, le Règlement intérieur est déclaré conforme à la Constitution.
La saisine de conseillers de village :
Cette saisine est relative à la mise en œuvre de la politique de la décentralisation (création de communes). Cette saisine est déclarée irrecevable (cf. arrêt n° 97-011 du 12-2-1997). En effet ni la Constitution ni la Loi organique régissant la Cour constitutionnelle ni un autre texte législatif ou réglementaire n’ont donné la possibilité de saisine à cette catégorie d’autorité.
I 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
Tableau synthétique des saisines quantitatif Type de saisine et période

I 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Les conditions d’ouverture des recours n’ont subi aucune évolution dans le temps.
I 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
La Cour constitutionnelle elle même ne dispose d’aucune possibilité d’auto-saisine.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Les requérants n’ont aucune possibilité juridique de se désister de leur saisine.
I 2. – Actes contrôlés
La Cour constitutionnelle intervient en contrôle de Constitutionnalité des Lois organiques, des lois ordinaires, des engagements internationaux, des Règlements Intérieurs (de l’Assemblée nationale, du Conseil économique social et culturel, du Haut Conseil des collectivités territoriales) et sur la question de la nature législative ou réglementaire d’une disposition d’un texte en discussion devant les députés. (Cf. art 86, 88 de la Constitution, art 51 et 53 de la Loi organique sur la Cour constitutionnelle.)
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé
Classement des actes ou normes par catégorie, par période chronologique et mention du nombre de saisines dont la Cour a été valablement saisie :

I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Il y a pas de normes ou d’actes placés hors contrôle par les textes ni par la jurisprudence.
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Il n’est pas possible à l’occasion d’un recours contre une loi, de contrôler celle que la loi contrôlée a modifiée.
I 3. – Les délais
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Il y a des recours sans délai. Il s’agit de ceux relatifs à l’examen des fins de non recevoir, ou ceux relatifs à la nature législative ou réglementaire d’une disposition d’un texte en discussion devant les députés.
I 3.2. – Tableau des conditions de délais :
Les conditions de délais et la référence des textes fixant ces conditions :

I 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Les délais des recours n’ont pas changé sur la période 1992-2000.
I 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
Aucun débat tendant à critiquer ces délais n’a encore été ouvert.
II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives au requérant
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Le requérant n’est astreint à l’acquittement d’aucun droit de timbre. La procédure est écrite et gratuite (cf. art. 25 de la Loi n° 97-10 du 11-2-97 relative à la Cour constitutionnelle).
II 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
La représentation du requérant par ministère d’avocat est possible (art. 25 de la Loi organique n° 97-10 du 11-2-97 relative à la Cour constitutionnelle). Cette représentation n’est pas obligatoire.
II 2. – Conditions relatives au recours
II 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les requêtes sont numérotées par ordre d’arrivée et par année.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date de réception fait foi pour la suite des procédures.
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Les conditions formelles et matérielles de recevabilité actuellement en vigueur :
Conditions formelles

Conditions matérielles
II 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Les conditions formelles et matérielles n’ont pas encore évolué.
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
La Cour n’a déclaré l’irrecevabilité d’une saisine au cours de la période concernée (1992 – janvier 2000) que deux fois. Il s’agit de celle émanant des conseillers de village et de celle déposée par des députés (Il s’agissait de cas d’incapacité à saisir la Cour). Sur les 14 saisines, 2 ont été déclarées irrecevables soit environ 14 % des requêtes.
Il n’y a pas une procédure spéciale par laquelle la Cour déclare l’irrecevabilité d’une requête.
Les conditions formelles et matérielles ci-dessus décrites déterminent la recevabilité d’une requête. Le non respect de ces conditions commande le rejet pour irrecevabilité.
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
La Cour statue en formation plénière.
Quand la Cour est saisie d’une requête, après enregistrement par le greffier en chef de la Cour, le président désigne un rapporteur qui établit son rapport. La Cour se réunit sur ce rapport et amende, adopte ou rejette ledit rapport.
II 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
La Cour statue donc en formation plénière et sur rapport.
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
Toutes les décisions de la Cour sont motivées. Elles sont publiées au Journal officiel.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
Une fois que la Cour se juge valablement saisie par le président de l’Assemblée nationale, ou un dixième des députés, par le président du Conseil des collectivités territoriales ou un dixième des conseillers Nationaux aux fins de contrôle de constitutionnalité d’une loi, la Cour transmet une copie de la requête au chef du gouvernement en l’invitant à lui faire parvenir dans le délai qu’elle fixe, les observations du gouvernement en réponse aux griefs d’inconstitutionnalité soulevés par les requérants (art. 45 de la Loi organique n° 97-10 du 11-2-1997 sur la Cour constitutionnelle). De même lorsque la Cour est saisie dans le cadre de l’examen de la nature législative ou réglementaire d’une disposition elle donne avis de la requête au président de l’Assemblée nationale, au chef du gouvernement selon que l’exception est soulevée par le gouvernement ou l’Assemblée nationale.
Le délai de jugement est d’un mois maximum ; ce délai en cas d’urgence signalée est ramené à huit (8) jours. Ce délai est de 15 jours quand il s’agit de l’examen de la nature législative ou réglementaire d’une disposition.
Par contre, s’agissant du contrôle des lois organiques et des règlements de l’Assemblée nationale, du Conseil économique social et culturel et du Haut Conseil des Collectivités, le principe du contradictoire n’existe pas.
Conclusion
Comme on peut le constater à travers cette évaluation, le contrôle de constitutionnalité s’est quasiment limité aux lois organiques et aux Règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Conseil économique social et culturel, objets de saisine obligatoire comme les engagements internationaux. Il nous paraît important eu égard à l’incorporation de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans la Constitution de la République du Mali, mais aussi des dispositions très pertinentes de l’article 85 de ladite Constitution, que des propositions d’amélioration, voire des adaptations structurelles de la cour puissent intervenir dans le cadre d’une réforme relative à l’accès au juge constitutionnel.
En effet l’article 85 de la Constitution ne dispose-t-il pas que : « la Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des Pouvoirs publics ».
Quant à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, n’indique-t-elle pas en son article 7 que :
1. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur… »
Rapport du conseil constitutionnel du Maroc
Mars 2000
Dans les domaines relevant du contrôle en constitutionnalité des normes, les conditions d’accès au juge constitutionnel sont définies par les dispositions constitutionnelles relatives au Conseil constitutionnel (voir notamment les articles 80, premier paragraphe, 81, 48 et 53) et par les lois organiques prises pour leur application (voir notamment les articles 18 à 28 de la Loi organique n° 29-93 modifiée ou complétée s/n° 8-98 et l’article 20 de la Loi organique n° 5-95 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquêtes parlementaires). Il convient de préciser que le contrôle de la loi ordinaire n’en fait partie que depuis la création du Conseil constitutionnel, substitué à l’ex-Chambre constitutionnelle de la Cour suprême dans le cadre de la révision constitutionnelle de 1992.
I. L’ouverture du droit de saisine
I 1. – Les requérants
Pour l’accès au juge constitutionnel marocain, le droit de saisine appartient exclusivement à des personnes publiques : organes de l’État et groupes de députés ou conseillers.
I 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
Tableau synthétique quantitatif des saisines, classées selon le type de saisine et par période :

Dans ce tableau, le découpage chronologique repose sur trois dates-clefs : 1962, 1972 et 1992. La première est celle de la première Constitution en vertu de laquelle fut créée l’ex-Chambre constitutionnelle de la Cour suprême ; la seconde est celle de sa révision, intervenue après la fin de l’état d’exception proclamé au mois d’août 1965 ; et la dernière est celle de la création du Conseil constitutionnel en remplacement de ladite Chambre.
À titre de commentaire, il y a lieu de remarquer que les saisines les plus nombreuses, et qui sont en augmentation continue jusqu’à 1992, émanent du Premier ministre. Dans les périodes considérées, elles portent essentiellement sur les lois organiques et, surtout, sur l’appréciation de la nature réglementaire ou législative des textes en vigueur pris en forme de lois (délégalisation). On relève par ailleurs que le recours portant sur la loi ordinaire, recevable depuis la Constitution de 1992, n’a été utilisé en fait que par les groupes de députés ou conseillers (minorité parlementaire).
I 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Jusqu’à la révision constitutionnelle de 1992, ces conditions d’ouverture du recours n’ont pas changé. Toutefois, à la faveur de cette révision et de celle de 1996, l’évolution a porté sur deux points : la nature des actes contrôlés et les bénéficiaires du droit de saisine.
C’est ainsi que, depuis 1992, l’action de contrôle peut s’exercer sur la loi ordinaire avant sa promulgation. D’autre part, aux titulaires du droit de saisine en ce domaine, prévus habituellement, s’ajoutent deux autres, compte tenu du retour en 1996 au système parlementaire bicaméral, le président de la Chambre des conseillers et la minorité au sein de celle-ci, égale au moins au quart de ses membres comme pour la minorité au sein de la Chambre des représentants.
I 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité l’auto-saisine ?
Les dispositions applicables ne prévoient pas l’auto-saisine.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Le désistement n’est pas prévu non plus, et il ne peut évidemment en être question dans les cas de saisine obligatoire (lois organiques, règlement intérieur de chaque chambre parlementaire). Il pourrait éventuellement émaner des parlementaires requérants, une telle situation cependant ne s’est jamais présentée jusqu’ici.
I 2. – Actes contrôlés
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’actes contrôlés
Les actes ou normes susceptibles d’être contrôlés, par catégorie et par période ainsi que le nombre de saisines dont le Conseil constitutionnel a été valablement saisi, sont indiqués au tableau suivant :

I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Il existe deux sortes d’actes qui sont exclus de l’action de contrôle en constitutionnalité. Il s’agit des traités internationaux et des actes Royaux (dahirs) portant loi ou Loi organique, pris pendant les périodes de transition interparlementaire.
L’article 81 de la Constitution définissant les attributions du Conseil constitutionnel ne mentionne pas les traités internationaux parmi les actes susceptible d’être contrôlés par ce dernier.
Dans les périodes de transition interparlementaire, le Roi exerce, outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par la Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative (C. art. 72). Les dahirs (ou décrets royaux) pris en ce domaine ne peuvent faire l’objet de contrôle en constitutionnalité car seules les lois ou lois organiques d’origine parlementaire relèvent du contrôle ou peuvent en relever avant leur promulgation par le Roi.
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
La Constitution ne prévoit pas la possibilité de contester la constitutionnalité d’une loi déjà promulguée, à l’occasion de l’examen d’une nouvelle loi. Jusqu’à ce jour, le Conseil constitutionnel n’a pas eu à connaître une telle situation.
I 3. – Les délais
Pour les lois organiques et les lois, la saisine doit avoir lieu avant la promulgation ; c’est-à-dire dans les trente jours qui suivent leur transmission au gouvernement par le Parlement (C. art. 26).
Pour le règlement de chaque chambre parlementaire, il doit être procédé à sa communication, à fin de contrôle, avant sa mise en application. La seule précision de délai est celle indiquée dans la Loi organique relative au Conseil constitutionnel : c’est la transmission du règlement immédiatement après son adoption (comme la transmission immédiate de la Loi organique après son vote).
En matière de délégalisaton, il n’y a pas de délai de saisine mais, pour aboutir, cette procédure reste subordonnée à la décision conforme du Conseil constitutionnel. Quant au litige portant sur l’irrecevabilité législative opposée par le gouvernement, il n’y a pas non plus de délai mais la saisine est tout de même enfermée dans le cadre de la procédure législative ayant donné lieu à ce litige.
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Ainsi qu’on vient de le voir, il n’y a pas de délai en dehors des actes pouvant faire l’objet du contrôle de la conformité à la Constitution.
I 3.2. – Tableau des conditions de saisine
Catégories d’actes contrôlés, conditions de délais et référence des textes fixant ces conditions :

I 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Les délais de saisine n’ont pas changé sur toute la période. Cependant, avant la Constitution de 1992, qui a permis le recours contre la loi ordinaire, il n’y a pas de délai de promulgation.
I 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
Les délais de recours contre la loi sont suffisants et, jusqu’ici, ils n’ont pas fait l’objet de critiques.
II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives au requérant
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Aucune procédure devant le Conseil constitutionnel ne donne lieu au paiement de taxes ou de droit de timbre. C’est la même gratuité que pour le recours devant le juge pour l’excès de pouvoir.
II 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
Dans les divers domaines du contrôle en constitutionnalité des normes, la représentation par ministère d’avocat ou par une autre personne n’est pas prévue. La saisine est faite directement par les titulaires du droit de saisine.
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Le requérant n’a pas à démontrer son intérêt à agir.
II 2. – Conditions relatives au recours
II 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les requêtes sont enregistrées dans l’ordre de leur arrivée, dans le registre du Greffe, sans distinction suivant les domaines de compétence du Conseil constitutionnel.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date qui fait foi pour la suite de la procédure est celle de la réception, qui coïncide en fait avec la date d’enregistrement.
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Conditions formelles et matérielles, de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur :

- X = sans sujet
II 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Ces conditions formelles et matérielles ont évolué étant donné que le recours contre la loi est devenu possible à partir de la révision constitutionnelle de 1992.
II 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Il n’existe pas de procédure de régularisation de la requête.
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité du recours ?
C’est le Conseil constitutionnel en formation plénière qui statue sur la recevabilité des recours.
II 3.1. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
La décision d’irrecevabilité est insusceptible de recours, comme toute décision du Conseil constitutionnel.
II 3.1. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
La seule formation est la formation plénière. Le Conseil constitutionnel statue sur le rapport du rapporteur. Ce rapporteur est désigné par le président sur la base d’une répartition équilibrée des tâches entre les membres du Conseil.
Les requêtes sont enregistrées par le Service du Greffe immédiatement après leur réception. Cet enregistrement s’appuie sur la lettre de saisine, éventuellement accompagnée d’une requête.
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
Les décisions d’irrecevabilité sont, comme toutes les décisions du Conseil, motivées et donnent lieu à publication au Bulletin officiel.
II 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Il n’est pas prévu de sanction à l’encontre du requérant abusif.
II 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
Le juge constitutionnel marocain n’ayant eu à examiner que deux cas, on ne peut parler d’évolution de la procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité dans le domaine du contrôle en constitutionnalité des normes.
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Principaux motifs d’irrecevabilité

- X = sans sujet
Devant l’ex-Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, un seul cas est à relever, celui de certains membres de la Chambre des représentants qui l’avaient saisie à fin de déclarer la non conformité à la Constitution de certains articles du Règlement intérieur de la Chambre.
Un autre cas plus récent est celui d’une saisine formulée par des parlementaires pour obtenir du Conseil constitutionnel le contrôle de constitutionnalité d’une disposition d’un Règlement intérieur déjà contrôlé et mis en application.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
III 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Lorsqu’une loi est déférée au Conseil constitutionnel dans les cas prévus au 3e alinéa de l’article 81 de la Constitution (diverses autorités de saisine et groupes de parlementaires), celui-ci avise immédiatement ces autorités et les présidents des chambres parlementaires en informent les membres de leurs chambres. Certaines de ces autorités peuvent lui présenter des observations au sujet de la question dont il est saisi.
Par ailleurs, en matière d’irrecevabilité législative, l’autorité qui saisit le Conseil en avise aussitôt celles qui ont également compétence à cet effet, et l’autorité ainsi avisée peut présenter toutes observations qu’elle jugera utiles à propos pendant le délai fixé par le Conseil constitutionnel.
III 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
Dans aucune étape de la procédure, les parties n’ont accès au prétoire.
III 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Le recours en constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel n’est pas contradictoire en ce sens que la demande des requérants et la réponse de l’autre partie ne font pas l’objet de communication aux intéressés.
III 2. – Égalité des armes
III 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Les pièces constitutives de la procédure comprennent la lettre de saisine, les textes applicables, la requête en cas de recours contre la loi et la décision du président du Conseil constitutionnel portant désignation du rapporteur. Aucune pièce du dossier de l’affaire constitué par le Service du Greffe n’est exclue de la procédure.
III 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Les pièces de la procédure ne sont pas communicables aux parties.
III 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Le juge constitutionnel dispose de moyens propres d’instruction d’une affaire. Il peut notamment se faire communiquer, par toute autorité, des documents ou des informations nécessaires à l’instruction.
III 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés par le juge ?
Dans le contrôle de la conformité à la Constitution, le juge constitutionnel peut se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête. Il n’y a pas de conditions particulières en ce domaine, il suffit qu’il relève dans le texte soumis à son examen une disposition non conforme à la Constitution. En fait, cette évocation d’office n’a été appliquée que dans un seul cas.
Devant le juge constitutionnel, les requérants n’ont pas la possibilité de se prononcer sur les griefs qu’il soulève d’office.
III 3. – Délai de jugement
III 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Le Conseil constitutionnel est tenu de rendre sa décision dans le délai d’un mois, sauf cas d’urgence où ce délai est réduit à huit jours. Toutefois lorsqu’il est saisi d’une irrecevabilité législative, il se prononce dans le délai de huit jours et sa décision est notifiée aux parties dans un délai n’excédant pas trois jours suivant la date où elle a été rendue.
III 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
Il n’existe pas de procédure formelle de clôture de l’instruction. L’instruction achevée, le rapporteur en informe le président et lui soumet un rapport lequel est communiqué aux autres membres du Conseil. En possession du projet, le président procède à l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour du Conseil.
III 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
Les délais sont toujours respectés. Le délai qui s’écoule entre la fin de l’instruction et la tenue du délibéré dépend de l’urgence signalée par le requérant et de l’ordre du jour du Conseil. Ce délai est en général très bref. La décision du Conseil est prononcée sitôt le délibéré terminé, sauf prolongation de la procédure pour complément d’instruction. Cette décision est publiée au Bulletin officiel dans le mois qui suit la date où elle a été rendue.
Conclusion
L’accès au juge constitutionnel, depuis que la Constitution a rendu possible le recours en constitutionnalité des lois, a conduit à quelques adaptations structurelles : création d’un Service d’études et renforcement du Service du Greffe et du Service de documentation.
Il n’y a pas de réforme en cours, mais des adaptations font l’objet de propositions émanant de certains secteurs sans qu’elles fassent l’objet à ce jour de mise en forme officielle.
Liste des textes de référence et des jurisprudences citées
I. – Textes
Constitution promulguée par le dahir n° 1-96-157 du 7 octobre 1996 (B.O. n° 4420 bis du 10 octobre 1996, page 643).
Loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel, modifiée et complétée par la Loi organique n° 8-98 (la première promulguée le 25 février 1994, B.O. n° 4244 du 2 mars 1994 et la seconde promulguée le 28 septembre 1998, B.O. n° 4627 du 5 octobre 1998).
Loi organique n° 5-95 du 29 novembre 1995 relative aux modalités de fonctionnement des commissions d’enquêtes parlementaires.
II. – Jurisprudence citée (irrecevabilité des recours)
Décision de l’ex-Chambre constitutionnelle de la Cour suprême n° 415/77.
Décision du Conseil constitutionnel n° 215/98.
Rapport du conseil constitutionnel de Mauritanie
Mars 2000
I. L’ouverture du droit de saisine
Remarques introductives
En matière de contrôle de constitutionnalité les requérants sont :
Le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l’Assemblé Nationale, 1/3 des sénateurs ou 1/3 des députés. Seules ces autorités ou personnalités peuvent saisir le Conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité.
Les actes contrôlés peuvent être : les lois organiques, les règlements de l’Assemblé et du Sénat, les lois ordinaires, les engagements internationaux.
Les délais sont de deux sortes : 8 jours quand il y a urgence et un mois s’il n y a pas urgence.
En matière de contrôle de constitutionnalité des lois, le conseil a examiné 6 (six) lois organiques, 4 (quatre) règlements intérieurs du Sénat et de l’Assemblé nationale. Bien que la constitution prévoit qu’il peut être saisi pour le contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires et des engagements internationaux, il n’a pas jusqu’ici été saisi au sujet de ces deux genres de lois.
I 1. – Les requérants
I 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant

Donc de 1992 à 1995, le Conseil constitutionnel a été saisi par le président du Sénat 2 fois, le président de l’Assemblée nationale 2 fois et le premier ministre 6 fois. Il n’a jamais été saisi par le président de la République, ni par le 1/3 des députés ou des sénateurs.
I 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Les conditions d’ouverture du recours n’ont pas évolués dans le temps.
I 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Le conseil n’a pas une possibilité d’auto-saisine. Toutefois lorsqu’il est saisi, il a compétence pour connaître de toute question et exception à l’occasion de la requête (art. 44 de l’ordonnance n° 92.04 du 18 février 1992 portant Loi organique relative au Conseil constitutionnel).
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Les requérants ne peuvent pas se désister de leur saisine. Toutefois ils peuvent ne pas poursuivre le reste de la procédure, mais une décision sera prise et notifiée à la partie qui se désiste.
I 2. – Actes contrôlés
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’actes contrôlés :
Nous avons précisé plus haut que les lois organiques, règlements des assemblées, lois ordinaires et engagements internationaux peuvent être contrôlés.
Le tableau suivant précise le nombre de saisine de 1992 à nos jours :

I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Il n’existe pas de loi placée hors contrôle.
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Cette possibilité n’existe pas et n’a jamais été posée.
I 3. – Les délais
Les délais sont de deux sortes : s’il y a urgence, le délai est de 8 jours, s’il n’y a pas urgence il est de 1 mois.
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Non, il n’y a pas de recours recevable sans délai.
I 3.2. – Tableau des conditions de délais :
Le tableau suivant précisera les délais fixés pour chaque catégorie de lois ou de règlements des assemblées devant le Conseil constitutionnel :

Sur les dix textes dont le conseil a été saisi, les délais étaient toujours de 1 mois, car l’urgence n’a jamais été mise en application.
I 3.3. – Les délais ont-ils changés sur la période d’ensemble ?
Non, les délais n’ont pas changé depuis 1992.
I 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
Les délais sont convenables étant donné que les lois organiques sont rares et difficilement rectifiables.
De fait, le Conseil constitutionnel n’a jamais été saisi au sujet des lois ordinaires.
II. Recevabilité de la saisine
Remarques introductives
Le recours ne peut être valable que lorsqu’il s’agit de lois organiques, lois ordinaires, règlements des assemblées et engagements internationaux et formulés par des personnes habilitées à saisir le Conseil constitutionnel et citées plus haut.
Lorsque le recours est formulé par des personnes non habilitées il est d’office rejeté, comme il peut être rejeté lorsqu’il est fait dans des matières autres que la Loi organique, la loi ordinaire, les règlements des assemblées et les engagements internationaux.
Il est à souligner que tous les recours parvenus au Conseil constitutionnel ont été tous déclarés recevables et ont fait l’objet de décisions du Conseil déclarant, soit leur constitutionnalité, soit leur non constitutionnalité, soit leur constitutionnalité partielle.
II 1. – Conditions relatives au requérant
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Non, le requérant ne s’acquitte pas de droit de timbre parce qu’il est une personne publique.
II 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
Oui, la représentation par ministère d’avocat est possible.
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
La requête doit être motivée
II 2. – Conditions relatives au recours
II 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Par ordre d’arrivée au secrétariat général du Conseil constitutionnel.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date d’arrivée et le numéro d’enregistrement au secrétariat général du Conseil (date de réception).
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Il s’agit ici des autorités publiques (président de la République, premier ministre, président du Sénat, président de l’Assemblée nationale, 1/3 du Sénat et 1/3 des députés.
Pour les lois organiques et les règlements des assemblées, ils doivent obligatoirement être soumis, avant leur promulgation, au contrôle du Conseil.
Pour les autres lois et engagements internationaux la requête doit être motivée, la loi contestée doit être jointe. Le requérant doit être identifié.
Pas de moyens nouveaux, mais le Conseil, une fois saisi peut d’office soulever tout cas d’inconstitutionnalité.
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
Dès lors que les requêtes ne sont pas rédigées par les personnes compétentes (président de la République, premier ministre, présidents des Assemblés, 1/3 des sénateurs ou 1/3 des députés), elles sont d’office déclarées irrecevables.
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
Le Conseil constitutionnel.
II 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Pas de recours.
II 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
Le Conseil statue si la majorité simple est présente étant entendu que la voix du président est prépondérante.
Il existe 3 sections au sein du Conseil, le rapporteur est choisi parmi ces sections.
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
La décision doit être motivée, prononcée et publiée.
II 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Non, pas d’amende.
II 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
La procédure d’irrecevabilité n’a jamais été posée au conseil.
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Sans objet.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
III 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Si le contrôle est demandé par l’autorité : président de la République, premier ministre, président du Sénat, président de l’Assemblée nationale, il n’y a personne à aviser.
Par contre, si le contrôle est demandé par le 1/3 du Sénat ou le 1/3 de l’Assemblée, il y a lieu d’aviser les présidents des assemblées d’une part et le président de la République et le premier ministre d’autre part.
III 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
Le principe du contradictoire en matière de contrôle de constitutionnalité n’existe pas.
III 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Le procès en constitutionnalité n’est pas contradictoire.
III 2. – Égalité des armes
Sans objet.
III 3. – Délai de jugement
III 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Le délai pour rendre une décision en matière de contrôle de constitutionnalité est de 1 mois s’il n’y a pas urgence, il est de 8 jours s’il y a urgence (art. 86 de la Constitution).
Les délais sont toujours respectés étant donné que les textes dont le Conseil est saisi ne sont pas nombreux en pratique.
III 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
Quand la section et le rapporteur désignés auront fini leur travail, l’instruction est terminée et le Conseil peut recourir à la majorité simple.
III 3.3. – Si aucun texte ne défini de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
Sans objet.
Conclusion
On peut dire que de 1992 à 2000, le conseil n’a été saisi que de 4 règlements internes des assemblées et 6 lois organiques. Les lois ordinaires et engagements internationaux n’ont pas été déférés au Conseil.
Avec cette saisine limitée, vous comprendrez qu’il n’y a pas d’évolution. L’évolution aurait été mieux ressentie si le Conseil était saisi des lois ordinaires et engagements internationaux.
Rapport de la cour constitutionnelle de Moldavie
Mars 2000
Rapport établi par Pavel Barbalat,
président de la Cour constitutionnelle de Moldavie.
I. L’ouverture du droit de saisine
Le 23 février 2000 correspond au cinquième anniversaire de la création de la Cour constitutionnelle de la République de Moldavie, l’unique autorité de juridiction constitutionnelle de l’État qui garantit la suprématie de la Constitution, assure la réalisation du principe de la séparation des pouvoirs de l’État (législatif, exécutif et judiciaire), et garantit la responsabilité de l’État devant le citoyen et du citoyen devant l’État.
La Cour constitutionnelle est composée de 6 juges, qui sont nommés pour un mandat de 6 ans. Deux juges sont nommés par le Parlement, deux par le président de la République, et deux par le Conseil supérieur de la magistrature.
Conformément à l’article 135 de la Constitution la Cour a les attributions suivantes :
a) exerce sur saisine le contrôle de constitutionnalité des lois, des règlements et des arrêtés du Parlement, des décrets du président de la République, des arrêtés et des dispositions du gouvernement, ainsi que des traités internationaux auxquels la République de Moldavie est partie ;
b) interprète la Constitution ;
c) se prononce sur l’initiative de la révision de la Constitution ;
d) confirme les résultats des référendums républicains ;
e) confirme les résultats des élections du Parlement et du président de la République ;
f) constate les circonstances justifiant la dissolution du Parlement, la suspension du président de la République de sa fonction ou l’intérim dans l’exercice de la fonction du président de la République ;
g) résout les cas exceptionnels d’inconstitutionnalité des actes juridiques, sur saisine de la Cour suprême de Justice ;
h) décide sur les problèmes ayant comme objet la constitutionnalité d’un parti.
L’analyse des dispositions de l’article 135 de la Constitution nous permet de conclure que les attributions de la Cour constitutionnelle, prévues à l’alinéa (1), lettres a), b), d), e), et g), sont exercées sur saisine dans le cadre du système du contrôle a posteriori alors que les attributions prévues aux lettres c), f), et h), relèvent du système du contrôle a priori.
Analyse quantitative et qualitative des actes déférés

I 1. – Les requérants
En République de Moldavie, selon l’article 25 de la Loi relative à la Cour constitutionnelle, ont le droit de saisir la Cour :
a) le président de la République ;
b) le gouvernement ;
c) le ministre de la Justice ;
d) la Cour suprême de Justice ;
e) la Cour économique ;
f) le procureur général ;
g) le député du Parlement ;
h) le groupe parlementaire ;
i) l’avocat parlementaire ;
j) l’Assemblée populaire de Gagaousie (Gagaouse-Yéri).
I 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
Saisines parvenues à la Cour émanant des personnes ayant le droit de saisir la Cour :


I 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
On n’a modifié ni la Loi relative à la Cour constitutionnelle, ni la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et les conditions d’ouvertures du recours n’ont pas évolué dans le temps.
I 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Selon le Code de la juridiction constitutionnelle la Cour ne dispose pas d’une possibilité d’auto-saisine, mais conformément à l’article 6, alinéa (3) du même Code, en contrôlant la constitutionnalité de l’acte contesté, la Cour peut prononcer une décision concernant d’autres actes normatifs dont la constitutionnalité dépend, en tout ou en partie, de la constitutionnalité de l’acte contesté.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Les requérants peuvent se désister de leur saisine à n’importe quelle étape de l’examen de la cause. La saisine incluse à l’ordre du jour est restituée par décision de la Cour constitutionnelle. Au cas où la Cour constitutionnelle aurait prononcé une décision concernant un acte normatif (partiellement ou entièrement), une saisine répétée n’est pas admise. On admet une saisine répétée seulement après 9 mois (art. 41 et 42 du Code de la juridiction constitutionnelle).
I 2. – Actes contrôlés
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé :
La Cour a été saisie pour le contrôle de constitutionnalité :

I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Conformément à l’article 135 de la Constitution la Cour constitutionnelle exerce sur saisine le contrôle de constitutionnalité des lois, des règlements et des arrêtés du Parlement, des décrets du président de la République, des arrêtés et des dispositions du gouvernement, ainsi que des traités internationaux auxquels la République de Moldavie est partie, en respectant les conditions suivantes :
a) on ne soumet au contrôle de constitutionnalité que les actes normatifs adoptés après l’entrée en vigueur de la Constitution – le 27 août 1994 ;
b) la Cour examine en exclusivité les problèmes de droit.
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
En contrôlant la constitutionnalité d’un acte contesté, la Cour peut prononcer un arrêt concernant d’autres actes normatifs, dont la constitutionnalité dépend, en tout ou en partie, de la constitutionnalité de l’acte contesté (art. 6, alinéa (3), du Code de la juridiction constitutionnelle).
I 3. – Les délais
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Il n’y a pas de recours sans délai.
I 3.2. – Tableau des conditions de délai :
La Cour doit solutionner la saisine dans un délai de 6 mois à partir de la date de la réception de la saisine. Après la décision de la Cour d’examiner la saisine et de l’inclure à l’ordre de jour, le président de la Cour désigne un juge en qualité de rapporteur, détermine le délai de l’examen de la saisine et de la présentation du rapport, qui ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date de l’enregistrement. S’il est nécessaire de faire des investigations complémentaires ce délai peut être prolongé de 30 jours (art. 32 de la Loi relative à la Cour constitutionnelle, article 19 du Code de la juridiction constitutionnelle).
I 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
On peut changer le délai fixé de 6 mois.
I 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
On n’a pas modifié le délai de la solution de la saisine au cours de l’activité de la Cour constitutionnelle (5 ans).
II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives au requérant
Les personnes ayant le droit de saisir la Cour, prévues à l’article 38, alinéa (1) du Code de la juridiction constitutionnelle, peuvent saisir la Cour sur des problèmes étant de leur compétence, à l’exception :
a) de la révision de la Constitution. La révision de la Constitution peut être engagée, selon l’article 141 de la Constitution, à l’initiative :
- d’un nombre d’au moins 200 000 citoyens ayant le droit de vote. Les citoyens qui prennent l’initiative de la révision de la Constitution doivent provenir de la moitié des départements et des municipes et, dans chacun de ces départements ou municipes 5 000 signatures au moins doivent être enregistrées à l’appui de cette initiative ;
- d’un tiers au moins du nombre des députés du Parlement ;
- du président de la République ;
- du gouvernement.
Les projets de lois constitutionnelles ne seront présentés au Parlement qu’avec l’avis de la Cour constitutionnelle, adopté par le vote d’au moins 4 juges ;
b) de la constatation des circonstances justifiant la dissolution du Parlement
– c’est le président de la République qui peut saisir la Cour sur ce problème ;
c) de la constatation des circonstances justifiant la suspension du président de la République de sa fonction ou l’intérim dans l’exercice de la fonction du président – seul le Parlement en adoptant un arrêté signé par le président de la République peut saisir la Cour sur ce problème ;
d) de la constitutionnalité d’un parti – seulement le président de la République, le président du Parlement, le gouvernement, le ministre de la Justice ou le procureur général peuvent saisir la Cour sur ce problème. Le Parlement peut saisir la Cour seulement sur la base de l’arrêté du Parlement, le procureur général – sur la base de la décision du collège du Parquet général, le ministre de la Justice – sur la base de la décision du collège du ministère de la Justice. Les résultats des référendums républicains, des élections du président de la République et du Parlement, après examen du rapport de la Commission républicaine pour l’organisation du référendum républicain ou de la Commission électorale centrale, sont confirmés par la Cour. Les pièces concernant la déclaration du candidat suppléant en qualité de député du Parlement sont présentées à la Cour constitutionnelle avec la décision du parti dont le mandat d’un député est devenu vacant.
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Conformément à la législation en vigueur, le requérant ne doit pas acquitter un droit de timbre.
II 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
On considère comme participants au procès : les parties, leurs représentants, les experts et les interprètes. En qualité de représentants des parties peuvent participer, sur la base d’un mandat, des avocats, des spécialistes compétents du domaine et d’autres personnes. Au nom d’une partie peuvent participer quelques représentants. Les pouvoirs et les droits des représentants sont indiqués dans le mandat (art. 28, 29 et 30 du Code de la juridiction constitutionnelle).
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Le requérant est obligé de motiver la nécessité de soumettre au contrôle de constitutionnalité l’acte saisi. La non indication des motifs entraînerait le rejet de la saisine.
II 2. – Conditions relatives au recours
La saisine parvenue à la Cour constitutionnelle doit correspondre aux conditions déterminées à l’article 39 du Code de la juridiction constitutionnelle :
- La saisine est présentée par écrit en langue officielle.
- La saisine doit être motivée et doit comprendre :
- la dénomination de la Cour constitutionnelle comme instance saisie ;
- la dénomination et l’adresse de l’auteur de la saisine ;
- l’objet de la saisine ;
- les circonstances fondant les exigences du requérant ;
- les exigences de la saisine ;
- d’autres renseignements concernant l’objet de la saisine ;
- la liste des documents annexés ;
- la signature du requérant.
II 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les saisines sont numérotées avec le nombre correspondant au jour de l’enregistrement en lui appliquant l’indice selon les attributions de la Cour constitutionnelle spécifiées à l’article 135 de la Constitution. Par exemple dans la saisine enregistrée à la date 14 décembre 1999, n° 135a, l’indice « a » indique qu’on soumet au contrôle de constitutionnalité certaines dispositions du Règlement du Parlement.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date de l’enregistrement de la saisine fait foi pour la suite des procédures.
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Toutes les saisines sont présentées par écrit en langue officielle ; elles doivent être motivées et correspondre aux conditions suivantes :
- la dénomination de la Cour constitutionnelle comme instance saisie ;
- la dénomination et l’adresse de l’auteur de la saisine ;
- l’objet de la saisine ;
- les circonstances fondant les exigences du requérant ;
- les exigences de la saisine ;
- d’autres renseignements concernant l’objet de la saisine ;
- la liste des documents annexés ;
- la signature, le code et l’estampille du requérant.
II 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Les conditions indiquées et déterminées par l’article 39 du Code de la juridiction constitutionnelle n’ont pas évolué dans le temps.
II 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Après le dépôt de la saisine par les personnes prévues à la Loi relative à la Cour constitutionnelle (art. 25), le président de la Cour transmet la saisine pour examen préliminaire dans le délai prévu :
- à un ou plusieurs juges de la Cour ;
- à un département du Secrétariat ou à un juge assistant.
Le délai de l’examen ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date de l’enregistrement. S’il est nécessaire de faire des investigations complémentaires ce délai peut être prolongé de 30 jours. Généralement le délai d’examen des saisines est de 6 mois.
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
La saisine parvenue à la Cour constitutionnelle est enregistrée puis elle est présentée au président de la Cour. Au cas où la saisine contreviendrait à l’article 39, le président de la Cour reçoit la saisine en proposant au requérant de liquider les défauts ou la rejette. La Cour constitutionnelle décide de la suspension du procès au cas où :
- la saisine est retirée ;
- la saisine n’est pas de la compétence des organes et des personnes qui ont saisi la Cour ;
- la solution de la saisine n’est pas de la compétence de la Cour constitutionnelle ;
- l’exception d’inconstitutionnalité de l’acte normatif contesté est solutionnée ;
- la Cour a déjà statué sur le problème en cause.
La saisine est rejetée par décision de la Cour constitutionnelle.
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
Après le dépôt de la saisine par les personnes prévues dans la Loi relative à la Cour constitutionnelle, le président de la Cour transmet la saisine pour examen préliminaire à un ou plusieurs juges de la Cour ou à un juge assistant.
En recevant la décision de la Cour d’examiner la saisine et de l’inclure à l’ordre de jour, le juge rapporteur entreprend les actions suivantes :
- remet à l’autre partie la copie de la saisine et les pièces annexées ;
- examine les objections possibles de l’autre partie concernant la saisine ;
- sollicite des organes compétents les pièces concernant l’affaire ;
- sollicite l’exécution des expertises ;
- entreprend toute autre action pour le règlement de l’affaire.
Après la préparation préliminaire de l’affaire pour l’examen dans un département du Secrétariat sous le contrôle du juge rapporteur, on prépare le dossier.
II 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
La décision de la Cour concernant le rejet de la saisine est définitive et ne peut pas être attaquée.
II 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
La solution des saisines se fait en séance plénière publique. L’examen de l’affaire commence avec l’information du juge rapporteur sur l’essence de l’affaire, le fondement de l’examen, les pièces étudiées pendant le procès de préparation de l’affaire pour l’examen.
Le juge rapporteur ou les juges rapporteurs sont nommés par le président de la Cour. Le quorum de la séance plénière de la Cour constitutionnelle est de deux tiers du nombre de juges.
Les saisines parvenues à la Cour sont enregistrées au Secrétariat, en tenant compte de leur contenu ; elles sont préalablement examinées par le juge rapporteur et sont admises à l’examen au fond.
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
La décision d’irrecevabilité est motivée et est prononcée en séance plénière mais, de règle, n’est pas publiée au Journal officiel.
II 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Pour protéger la dignité des juges de la Cour constitutionnelle, des participants au procès et afin d’assurer l’exercice de la juridiction constitutionnelle on prévoit, selon l’article 82 du Code de la juridiction constitutionnelle, une amende d’un montant de 25 fois le salaire minimum pour :
- des déclarations inconstitutionnelles indifféremment de la manière de s’exprimer ;
- l’immixtion dans l’activité de procédure des juges de la Cour, la tentative d’exercer une influence sur les juges en appliquant des méthodes contrevenant à la procédure ;
- le non accomplissement immotivé, selon les modalités et les délais déterminés, des exigences des juges de la Cour, la non exécution des arrêts et des avis de la Cour ;
- la violation du serment judiciaire ;
- la manifestation du manque de respect pour la Cour constitutionnelle en transgressant les dispositions prises par le président de la séance, ainsi que les autres faits prouvant la déconsidération manifeste de la Cour ou de la procédure de la juridiction constitutionnelle.
Des mesures peuvent être prises afin d’assurer les conditions normales pour exercer la juridiction constitutionnelle par décision du président de la séance en dressant un procès-verbal ou en rédigeant une annexe.
II 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
La procédure conduisant à la déclaration d’irrecevabilité n’a pas évolué.
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Saisines parvenues à la Cour, déclarées irrecevables :

La procédure conduisant à la déclaration d’irrecevabilité est réglementée par le Code de la juridiction constitutionnelle et jusqu’à présent n’a pas évolué. La jurisprudence constitutionnelle concernant ce problème reste invariable.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
Exemple
Le 5 octobre 1999 à la Cour constitutionnelle est parvenue la saisine de l’avocat parlementaire Constantin LAZARI concernant le contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi n° 558-XIV du 29 juillet 1999 pour modifier la Loi relative au notariat. Le président a transmis le dossier le même jour.
Le 19 octobre a eu lieu la séance plénière de la Cour constitutionnelle concernant le résultat de l’examen préliminaire de la saisine afin de l’accepter ou non pour examen au fond.
Le juge rapporteur Mihai COTOROBAI a présenté le rapport concernant les pièces du dossier inscrit au rôle. Après l’examen préliminaire on a constaté que la saisine a été déposée conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de la Loi relative à la Cour constitutionnelle et aux articles 38 et 39 du Code de la juridiction constitutionnelle, que le problème abordé a un caractère juridique et que son examen est de la compétence de la Cour constitutionnelle. La saisine a été admise pour examen et a été incluse à l’ordre du jour de la Cour, conformément à la décision adoptée par la chambre du conseil.
Le 22 octobre 1999, selon l’article 9 de la Loi relative à la Cour constitutionnelle, on a sollicité les points de vue visant les problèmes abordés en saisine :
- du président de la République ;
- du président du Parlement ;
- de l’Union des notaires de la République de Moldavie ;
- du ministère des Finances.
Le 2 décembre 1999 a eu lieu la séance plénière de la Cour constitutionnelle ayant comme ordre de jour : la saisine de l’avocat parlementaire concernant le contrôle de constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi relative au notariat n° 1153-XIII du 11 avril 1997, ultérieurement modifiée.
Le président de la séance constate la présence des participants au procès :
- M. C. LAZARI, avocat parlementaire ;
- Mme T. UNGUREANU, président de l’Union des notaires ;
- M. I. CREANCAˇ , chef du secteur relations avec les autorités publiques, Direction juridique de l’Appareil du Parlement.
Le président de la séance explique aux participants au procès leurs droits et obligations de procédure.
Conformément à l’article 51 du Code de la juridiction constitutionnelle, le juge rapporteur Mihai COTOROBAI présente le rapport sur l’essence de la cause, le fondement sur lequel se base la Cour, les pièces et l’état du dossier.
Après la présentation de l’information par le juge rapporteur, le président de la séance propose aux parties d’exposer leurs positions. Exposent leurs positions : M. C. LAZARI, avocat parlementaire ; M. I. CREANCAˇ , chef du secteur relations avec les autorités publiques, Direction juridique de l’Appareil du Parlement, et l’expert pour le problème Mme T. UNGUREANU, président de l’Union des notaires.
Après les conclusions des parties, selon l’article 55 du Code de la juridiction constitutionnelle, la Cour délibère dans la chambre du conseil.
Revenant dans la salle des séances après la délibération, la Cour prononce l’arrêt adopté.
III 1. – Principe du contradictoire
La Cour constitutionnelle déploie son activité en conformité avec les principes suivants :
a) l’indépendance ;
b) la collégialité ;
c) la légalité ;
d) la publicité.
Le principe du contradictoire n’est pas fixé dans la Loi relative à la Cour constitutionnelle. Ce principe est admis en effet dans le procès de l’exercice de la juridiction constitutionnelle.
III 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Conformément à la décision de la Cour constitutionnelle d’accepter pour examen la saisine et de l’inclure à l’ordre de jour, le juge rapporteur entreprend les actions suivantes :
a) remet à l’autre partie la copie de la saisine et des pièces annexées ;
b) examine les objections possibles de l’autre partie concernant la saisine ;
c) sollicite des organes compétents les pièces concernant l’affaire ;
d) sollicite l’exécution des expertises ;
e) entreprend toute autre action pour le règlement de l’affaire.
III 1.2. – À quelles étapes de la procédures et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
La juridiction constitutionnelle est exercée sur le fondement du principe d’égalité des parties et des autres participants au procès devant la Constitution et la Cour constitutionnelle. La Cour écoute seulement les explications des parties, les conclusions des experts, elle lit les documents se rapportant à l’examen de la cause. Les parties au procès devant la juridiction constitutionnelle ont libre accès aux pièces du dossier, elles peuvent présenter des arguments et participer à leur examen, poser des questions à d’autres participants au procès, faire des déclarations, présenter des explications orales ou par écrit, faire des objections contre les déclarations, les arguments et les points de vue d’autres participants au procès.
III 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
La réponse à cette question est donnée au III-1.
III 2. – Égalité des armes
III 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Après la préparation préliminaire de l’affaire pour l’examen par le département respectif du Secrétariat sous le contrôle du juge rapporteur, on prépare le dossier qui comprend :
a) la décision de la Cour d’examiner la saisine et de l’inclure à l’ordre de jour ;
b) l’avis sur l’examen préliminaire de la saisine ;
c) la saisine et les pièces annexées ;
d) la demande d’effectuer les expertises ;
e) les notes informatives et les rapports faits pendant l’examen préliminaire de la saisine ;
f) les rapports de l’expertise et autres pièces.
Les documents n’ayant pas d’intérêt pour l’examen de la cause sont exclus du dossier.
III 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Après la mise en état de l’affaire, le juge rapporteur prend des mesures au plus tard 10 jours avant la séance de la Cour afin de remettre les copies de la saisine aux parties.
Les autres pièces nécessaires pour l’examen de la cause sont dans le dossier et sont accessibles aux parties.
La Cour constitutionnelle peut décider d’envoyer les pièces du dossier aux participants au procès, au président de la République, au président du Parlement, au Premier ministre, au président de la Cour suprême de Justice, au procureur général.
III 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Le juge constitutionnel dispose de moyens propres pour l’examen préliminaire de la cause. À l’étape de la mise en état de l’affaire, il sollicite des organes compétents les pièces concernant l’affaire, demande les points de vue des autorités publiques centrales, décide l’exécution des expertises, entreprend toute autre action pour le règlement de l’affaire.
III 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
En contrôlant la constitutionnalité de l’acte contesté et en constatant des faits qui ne sont pas abordés ou contestés dans la saisine, la Cour constitutionnelle (et non le juge constitutionnel) peut prononcer une décision visant les actes normatifs dont la constitutionnalité dépend, en tout ou en partie, de la constitutionnalité de l’acte contesté. Dans ce cas les personnes ayant le droit de saisir la Cour n’ont pas le droit de se prononcer sur les aspects dont la Cour constitutionnelle s’est saisie d’office.
III 3. – Délai de jugement
III 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Le délai maximal est de six mois à compter de la date de l’enregistrement de la saisine.
III 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
En cas de solution au fond de la saisine on prononce un arrêt, on émet un avis ou on adopte une décision en séance plénière.
III 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
L’arrêt et l’avis se prononcent, en règle générale, à la même séance, après la délibération des juges de la Cour. La Cour constitutionnelle peut ajourner
la rédaction de l’arrêt ou de l’avis, mais pas plus de 5 jours. La partie de la résolution de l’acte adopté peut être rédigée par écrit, prononcée à la même séance et est jointe au dossier. Après le parachèvement de l’arrêt et de l’avis, la Cour constitutionnelle en informe les participants au procès. Les arrêts et les avis de la Cour constitutionnelle sont publiés au « Monitorul Oficial al Republicii Moldova » dans les 10 jours qui suivent leur adoption, ils peuvent être publiés par d’autres moyens de presse.
Conclusion
La Cour constitutionnelle relève les faits suivants :
Conformément à l’article 10 de la Loi relative à la Cour constitutionnelle et à l’article 80 du Code de la juridiction constitutionnelle, la Cour élabore le rapport annuel sur l’exercice de la juridiction constitutionnelle qui comprend une analyse minutieuse des pièces examinées au cours de l’année, les circonstances élucidées au cours de l’examen des pièces, des conclusions et recommandations. Selon les conclusions comprises dans le Rapport annuel on fait des propositions pour modifier la législation concernant la Cour constitutionnelle afin d’assurer l’accès à la juridiction constitutionnelle.
Selon l’article 135, alinéa (1) lettre g), de la Constitution, l’article 4, alinéa (1), lettre g), de la Loi relative à la Cour constitutionnelle et l’article 4, alinéa (1), lettre g), du Code de la juridiction constitutionnelle, la Cour constitutionnelle résout les cas exceptionnels d’inconstitutionnalité des actes juridiques, sur saisine de la Cour suprême de Justice, en limitant l’accès libre à la Cour constitutionnelle des autres instances judiciaires. C’est pourquoi la Cour constitutionnelle a présenté au Parlement la proposition de modifier les actes législatifs mentionnés pour que toute instance judiciaire puisse saisir la Cour. En avançant cette proposition, la Cour est partie du fait que les instances judiciaires, à l’exception de la Cour suprême de Justice, n’ont pas le droit de saisir la Cour constitutionnelle au cours de l’examen de certains cas concrets, ce que restreint l’indépendance des juges et qui contrevient à l’article 116, alinéa (1), de la Constitution.
Vu la nécessité de garantir l’accès à la juridiction constitutionnelle, conformément à l’article 34, alinéa (3), de la Loi relative à la Cour constitutionnelle, la Cour approuve l’organigramme et l’état du personnel du Secrétariat de la Cour.
Selon les conclusions comprises dans le Rapport annuel de la Cour constitutionnelle on a modifié l’article 25 de la Loi relative à la Cour constitutionnelle : on a ajouté à l’alinéa (1) les lettres j) et i). Le 11 juillet 1996 par la Loi n° 917-XIII on a introduit une nouvelle catégorie de personnes ayant le droit de saisir la Cour – l’Assemblée populaire de Gagaousie (GagaouseYéri). Le 14 mai 1998 par la Loi n° 18-XIV on a accordé la qualité de personne ayant le droit de saisir la Cour à l’avocat parlementaire.
Rapport de la cour constitutionnelle de Centrafrique
Mars 2000
La Cour constitutionnelle instituée par la Constitution du 14 janvier 1995 ouvre largement la possibilité à tout citoyen d’exiger le respect de la Constitution et ce, pour permettre à tout justiciable d’être directement associé à la protection juridique de ses droits fondamentaux.
Pour ce faire, une procédure des plus simplifiées a été prévue par la Constitution elle-même et par les textes organiques subséquents.
Relativement au thème du présent congrès à savoir : « L’accès au juge Constitutionnel : modalités et procédures », et plus spécialement quant au contrôle en constitutionnalité des normes, cette volonté sans équivoque de l’ouverture la plus large de la saisine de la Cour constitutionnelle se manifeste par l’inexistence pratiquement d’aucune contrainte spéciale mise à la charge du citoyen de la République Centrafricaine, lui simplifiant ainsi à l’extrême l’accès au juge Constitutionnel.
Il en découle qu’en dehors de la Constitution des traités, des lois organiques en voie de promulgation et du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le justiciable en République Centrafricaine n’a à déférer à aucune obligation particulière quant à sa qualité, au délai d’introduction de son recours et à sa représentation devant l’institution.
Cependant, celle-ci, bien au contraire est tenue dans des délais prédéfinis pour rendre sa décision.
La Cour constitutionnelle de Centrafrique étant de création récente, et par ailleurs, l’usage à ce jour encore limité de la possibilité de saisine de la Haute Juridiction comme ci-dessus évoqué, il ne sera possible à celle-ci, en raison de son jeune âge, de répondre à des questions qu’elle ne peut maîtriser et à certains points abstraits et inadaptés du questionnaire.
Aussi apportera-t-elle sa modeste contribution en évoquant tous les cas et conditions d’ouverture du recours, de recevabilité de la saisine, de son traitement et de la procédure y relative.
I. L’ouverture du droit de saisine
La Constitution Centrafricaine du 14 janvier 1995 pose en son article 70 alinéa 3 le principe de l’ouverture de la saisine en ces termes : « Toute personne qui s’estime lésée peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. La Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d’un mois. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours. »
Ce principe est repris par la Loi 95.006 du 15 août 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui détermine les règles de procédure devant la Haute Juridiction en son chapitre V suivant la nature de ses attributions.
Ainsi en est-il :
a) du contrôle de la constitutionnalité :
1. – par voie d’action des lois organiques, des lois ordinaires, des ordonnances prévues aux articles 28 à 42 ;
2. – par voie d’exception des lois organiques, des lois ordinaires et des ordonnances prévues aux articles 43 à 47.
b) du contrôle de conformité à la Constitution :
1. – des lois de ratification des engagements internationaux prévus aux articles 51 à 53 ;
2. – du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévu aux articles 48 à 50.
I 1. – Les requérants
I 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
Il ressort des dispositions des textes ci-dessus rapportés, qu’en principe toute personne vivant sur le territoire centrafricain a le droit de saisir la Cour constitutionnelle si elle « s’estime lésée ».
Cependant, la loi réserve cette opportunité :
- au président de la République, et à lui seul en cas de vérification de la conformité à la Constitution des lois organiques avant leur promulgation ;
- au président de la République, au président de l’Assemblée nationale, à un tiers des députés en cas de vérification de la conformité à la Constitution des lois de ratification des engagements internationaux ;
- enfin au président de l’Assemblée nationale en cas de vérification de la conformité du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale à la Constitution.
Tableau synthétique quantitatif des saisines :

I 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Non. La Cour constitutionnelle ayant été instituée récemment (1995) il n’est pas encore intervenu un texte modifiant la procédure applicable devant elle, et plus spécifiquement les conditions de saisine en matière de vérification de la conformité des normes à la Constitution.
I 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Non. Aux termes de l’article 23 de la Loi 95.006 du 15 août 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci ne peut rendre une décision ou un avis que sur la base d’une requête ayant fait l’objet au préalable d’une instruction diligentée par un rapporteur désigné par Ordonnance du président de la Cour constitutionnelle parmi les membres de la Cour.
De même l’article 39 de la même dite loi ne donne à la Cour, la latitude de ne statuer uniquement que sur l’ensemble des moyens soulevés par les requérants.
En outre la Cour ne peut, hormis les cas de violation de la Constitution ou de principe à valeur constitutionnelle, soulever des moyens d’office. Elle statue en constitutionnalité et non en opportunité.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
En ce qui concerne le désistement des requérants de leur saisine, la Juridiction constitutionnelle de Centrafrique, à défaut de dispositions légales propres, fait application d’une jurisprudence établie en la matière : le désistement intervient jusqu’à l’audience de la Cour.
La juridiction constitutionnelle centrafricaine n’a pas encore été saisie d’un cas de désistement partiel.
I 2. – Actes contrôlés
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’actes contrôlés

I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Par les textes ? Non.
Par la jurisprudence ? Oui, la Loi référendaire et la Constitution sont placées hors contrôle.
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Un tel cas ne s’est pas encore posé devant la Cour constitutionnelle de la République Centrafricaine.
I 3. – Les délais
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Pour les recours par voie d’exception contre les lois promulguées, aucun délai n’est imposé quant à leur recevabilité.
I 3.2. – Tableau des conditions de délais
I 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Non.
I 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
Non.
II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives au requérant
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Non. L’article 22 alinéa 1er de la Loi 95.006 précitée pose que : « La procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite, écrite et contradictoire. »
Il en découle qu’aucun droit de timbre n’est imposé au requérant.
II 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
La représentation du requérant par ministère d’avocat ou par une autre personne dûment mandatée est possible (art. 22 alinéa 3 de la Loi 95.006) mais non obligatoire.
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Le requérant n’a pas à démontrer outre mesure son intérêt à agir. Il lui suffit de s’estimer lésé par un texte (art. 70 alinéa 3 C).
II 2. – Conditions relatives au recours
II 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les requêtes sont enregistrées selon l’ordre d’arrivée.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date de réception fait foi pour la suite de la procédure.
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
La requête est rédigée sur papier libre. Elle énonce les noms, adresse et signature du requérant, identifie la norme dont la vérification de la constitutionnalité est demandée. Elle énonce également les moyens et points de droit soulevés et les textes afférents.
Des moyens nouveaux peuvent être soulevés en cours de procédure et cela jusqu’au dépôt du rapport.
II 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Ces conditions sont les mêmes depuis l’institution de la Cour et n’ont pas évolué depuis lors.
II 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Non. L’état actuel de la législation centrafricaine ne prévoit pas une telle procédure.
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité du recours ?
La Cour elle-même doit statuer sur la recevabilité des recours et cela au vu du rapport d’un conseiller rapporteur.
II 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Les décisions de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours (art. 74 alinéa 1er de la Constitution, article 4 alinéa 2 de la Loi 95.006 du 15 août 1995).
II 3.3. – La cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
La Cour statue toujours en formation plénière (art. 17 de la Loi 95.006) sur un rapport établi par un rapporteur désigné par ordonnance du président de la Cour constitutionnelle parmi les membres de la Cour (art. 23 de la Loi 95.006).
Les requêtes sont enregistrées par ordre d’arrivée au Greffe de la Cour par le greffier en chef au moment de leur dépôt.
Il n’y a pas de tri préalable.
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
Les décisions de la Cour sont motivées. Elles sont rendues en audience publique.
Elles sont publiées au Journal officiel (art. 4 de la Loi 95.006).
II 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit à agir ?
Il n’existe pas de sanction à l’encontre des requérants abusifs.
II 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
La Cour constitutionnelle de Centrafrique étant de création récente la procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité n’a pas évolué.
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Sans objet.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
III 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
La cour est tenue à l’obligation d’aviser sans délai le président de la République et le président de l’Assemblée nationale qui en informe les députés, lorsque la saisine n’émane pas d’eux (art. 34 alinéa 3 de la Loi 95.006).
Le greffier en chef notifie les actes et avis d’audience à toutes les parties concernées.
III 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
Les parties, les avocats et les représentants des parties ont accès au prétoire le jour de l’audience publique.
Les parties, les avocats ou les représentants des parties qui en ont fait la demande sont autorisés à prendre la parole le jour de l’audience (art. 38 L.O.).
III 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Le procès en constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle est défini comme pleinement contradictoire (art. 22 L.O.).
III 2. – Égalité des armes
III 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Les conclusions échangées entre les parties sont constitutives de la procédure.
III 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ?
Oui.
III 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Le juge constitutionnel dispose de moyens propres d’instruction d’une affaire :
1. – La désignation d’un rapporteur ;
2. – Au cours du jugement la Cour peut par décision avant dire droit ordonner une enquête (art. 23 L.O.).
III 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
L’article 39 de la Loi organique prévoit en son alinéa 1er que : « La Cour statue uniquement sur l’ensemble des moyens soulevés par les requérants. »
Cependant le même article ajoute en son alinéa 2 que : « La Cour constitutionnelle ne peut hormis les cas de violation de la Constitution ou de principes à valeur constitutionnelle, soulever des moyens d’office. Elle statue en constitutionnalité et non point en opportunité. »
Oui, les requérants ont la possibilité à l’audience de se prononcer sur les griefs soulevés d’office, soit oralement, soit en versant des notes en délibéré.
III 3. – Délai de jugement
III 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
La Cour est tenue en matière de conformité à la Constitution de statuer dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. Ce délai est ramené à huit (8) jours en cas d’urgence invoquée dans l’acte de saisine (art. 70 alinéa 5 C, art. 30 et 35 L.O.). En ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, la Cour statue dans un délai d’un mois (art. 70 alinéa 48 L.O.).
Compte tenu des difficultés d’ordre matériel rencontrées par la Cour, parfois ces délais ne sont pas respectés.
La décision revêtue de la signature du président et du greffier en chef est notifiée aux parties concernées, et publiée au Journal officiel.
III 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
Non, Il n’y a pas une procédure formelle de clôture de l’instruction, sinon, seul le dépôt du rapport clôture l’instruction (art. 23 alinéa 3 L.O.).
III 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen que prend la Cour pour statuer ?
Sans objet.
Rapport de la cour constitutionnelle de Roumanie
Mars 2000
Rapport établi par Dr. Ioan Muraru,
professeur universitaire, juge ;
Dr. Gheorge Iancu,
chargé de cours, secrétaire général ;
Doina Suliman,
magistrat assistant ;
et Monica Ionescu,
pour la traduction en français.
Explications préliminaires
I. La Cour constitutionnelle de la Roumanie est organisée et fonctionne en vertu des dispositions de la Constitution de 1991 et de la Loi n° 47/1992 relative à son organisation et à son fonctionnement, modifiée, complétée et republiée en 1997.
Les attributions de la Cour constitutionnelle, établies exclusivement et limitativement par l’article 144 de la Constitution, peuvent être groupées dans deux grandes catégories, notamment :
1. – des attributions relatives au contrôle de la constitutionnalité de certaines normes juridiques ;
2. – des attributions relatives au contrôle de la constitutionnalité de certaines activités, comportements ou situations.
Dans le cadre de la première catégorie d’attributions, il convient de distinguer le contrôle de la constitutionnalité des :
a) initiatives de révision de la Constitution ;
b) lois, avant leur promulgation a priori ;
c) lois en vigueur a posteriori ;
d) initiatives législatives civiques ;
e) règlements du Parlement ;
f) ordonnances du gouvernement.
Dans la deuxième catégorie d’attributions, il incombe à la Cour constitutionnelle de :
a) veiller au respect de la procédure concernant l’élection du président de la Roumanie et confirmer les résultats du suffrage ;
b) constater l’existence des circonstances qui justifient l’intérim dans l’exercice de la fonction de président de la Roumanie et communiquer ses constatations au Parlement et au gouvernement ;
c) donner un avis consultatif sur la proposition de suspension de sa fonction du président de la Roumanie ;
d) veiller au respect de la procédure concernant l’organisation et le déroulement du référendum et en confirmer les résultats ;
e) trancher des contestations ayant pour objet la constitutionnalité d’un parti politique.
Le questionnaire, rédigé en vue du Congrès, ne porte que sur la première catégorie d’attributions. C’est la raison pour laquelle toutes les références à l’activité de la justice constitutionnelle en Roumanie auront pour point de renvoi ces éclaircissements préalables.
II. La Loi n° 47/1992 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle a été modifiée et complétée en 1997, par la Loi n° 138, publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, n° 170 du 25 juillet 1997.
Les modifications qui concernent le thème du Congrès sont les suivantes : la suppression des deux degrés de juridiction (le fond et le recours) et la réglementation des jugements des exceptions d’inconstitutionnalité par le Plénum de la Cour ; l’établissement des conditions d’irrecevabilité des exceptions d’inconstitutionnalité, ainsi que la possibilité pour les Tribunaux de vérifier eux-mêmes l’existence de celles-ci. (voir, pour des explications supplémentaires, l’Annuaire international de Justice constitutionnelle, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1997, p. 809 et suiv.)
III. Pour pouvoir comparer plus facilement les données par années, le présent rapport entreprend de se référer à l’activité de la Cour entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999. Nous ne prenons pas en compte l’activité de la seconde partie de l’année 1992, année de la création de la Cour constitutionnelle de la Roumanie.
I. L’ouverture du droit de saisine
I 1. – Les requérants
Ils sont : le président de la Roumanie, le président de la Chambre des députés, le président du Sénat, le gouvernement, la Cour suprême de Justice, 50 députés, 25 sénateurs, le groupe parlementaire, les tribunaux d’office ou à la sollicitation des parties en procès.
I 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
Tableau synthétique (1) des saisines reçues par la Cour constitutionnelle dans la période 1993-1999 conformément à l’article 144 lettres a), b), c) et h) de la Constitution

Voir le tableau n° 2, annexe I, page 467.
a) Très rarement, les saisines proviennent du président de la Roumanie, des présidents des Chambres du Parlement, de la Cour suprême de Justice, du gouvernement.
b) La plupart des saisines proviennent des tribunaux, à la suite des exceptions d’inconstitutionnalité.
c) C’est la catégorie parties du procès pénal qui comporte des discussions, au cas des exceptions d’inconstitutionnalité.
I-1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps?
Voir Explications préliminaires, II
I 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’autosaisine ?
La Cour ne peut pas se saisir d’office, à l’exception de cas d’initiatives de révision de la Constitution.
Ainsi, avant que le Parlement soit saisi de la procédure de révision de la Constitution, le projet de loi ou la proposition législative est déposé à la Cour constitutionnelle, qui doit se prononcer sur sa constitutionnalité, dans un délai de 10 jours. Le projet de loi ou la proposition législative ne peuvent être présentés au Parlement qu’accompagnés de la décision de la Cour constitutionnelle.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ? Si oui, dans quels délais et selon quelles procédures ?
Il y a eu des cas où les auteurs de la saisine, dans les exceptions d’inconstitutionnalité, ont spécifié à la Cour qu’ils se désistaient de leur saisine. Mais, selon l’article 25 du Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle (publié au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, n° 308 du 12 novembre 1997), une fois légalement saisie, la Cour procède à l’examen de la constitutionnalité. Ne sont pas applicables les dispositions relatives à la suspension, à l’interruption ou à l’extinction de l’instance.
I 2. – Actes contrôlés
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé :
Voir le tableau n° 3, annexe II, page 467.
I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
La Cour constitutionnelle vérifie la constitutionnalité seulement des actes normatifs précités dans les explications préliminaires de ce questionnaire. Le système juridique roumain contient en effet aussi d’autres actes normatifs, tels : les arrêtés gouvernementaux, les ordres et les instructions des ministres, les règlements, les actes normatifs des autorités locales (maires, conseils locaux). Ces actes normatifs sont soumis à un contrôle de constitutionnalité et de légalité accompli par les Tribunaux chargés du contentieux administratif.
Il y a eu, certainement, des cas où la Cour constitutionnelle a été saisie du contrôle de constitutionnalité de certains actes normatifs autres que ceux mentionnés à l’article 144 de la Constitution.
Dans de tels cas, la Cour a :
a) rejeté les exceptions d’inconstitutionnalité ayant pour objet des arrêtés du gouvernement. Dans une première décision (n° 5/1994), la Cour a présenté, à ce sujet, les motivations suivantes : les attributions de la Cour sont expressément et limitativement précisées dans la Constitution ; par rapport aux dispositions constitutionnelles, il est à remarquer que la solution des exceptions relatives aux arrêtés du gouvernement n’incombe pas à la compétence de la Cour constitutionnelle, mais est du ressort des Tribunaux ordinaires ; le terme loi est utilisé dans la Constitution au sens restreint d’acte adopté par le Parlement ; considérer que les arrêtés du gouvernement tombent sous l’incidence du contrôle de la Cour constitutionnelle, ajoute au texte de la Constitution, ce qui est interdit ; la loi fondamentale a entendu soumettre au contentieux constitutionnel uniquement ces actes normatifs qui, d’une façon ou d’une autre, sont soumis aux débats et à l’approbation finale du Parlement, laissant de côté les actes de l’exécutif, pris pour exécuter la loi qui ne sont plus soumis à ce for ; en tant qu’actes administratifs, les arrêtés du gouvernement peuvent être attaqués uniquement par la voie du contentieux administratif, devant les Tribunaux ordinaires, circonstance dans laquelle est également vérifiée leur conformité à la loi, en vertu de laquelle ils ont été émis.
Nous devons mentionner qu’il y a eu, ultérieurement, plusieurs décisions qui ont repris ces considérants ;
b) rejeté les exceptions d’inconstitutionnalité ayant pour objet des ordres des ministres. (Il s’agit d’ordres à caractère normatif).
Dans une première décision (n° 7/1994), la Cour a motivé sa décision de la façon suivante : l’exception est manifestement mal fondée ; n’incombe pas à la compétence de la Cour constitutionnelle la solution des exceptions d’inconstitutionnalité relatives aux ordres émis par un ministre ; admettre la thèse selon laquelle l’ordre du ministre peut aussi être examiné par la Cour au regard de sa constitutionnalité. Cela signifie ajouter au texte de la loi fondamentale, ce qui est interdit parce que nous nous trouvons devant une disposition d’interprétation stricte ; l’ordre du ministre, étant un acte administratif, peut être attaqué uniquement par la voie du contentieux administratif devant le Tribunal, circonstance dans laquelle est également vérifiée sa conformité avec la loi en vertu de laquelle il a été émis.
Mais, nous mentionnons qu’il y a eu, ultérieurement, plusieurs décisions qui ont repris ces considérants ;
c) rejeté comme irrecevables, des exceptions d’inconstitutionnalité ayant pour objet des arrêtés des conseils locaux (décision n° 185/1999).
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Nous considérons que deux situations peuvent répondre à cette question :
a) La situation dans laquelle il s’agit d’une loi d’approbation ou de rejet d’une Ordonnance du gouvernement.
Si à l’égard de celle-ci sont invoquées des objections d’inconstitutionnalité (contrôle a priori), le contrôle peut être élargi même sur le contenu de l’Ordonnance gouvernementale, parce que celle-ci sera transformée en loi.
b) La situation dans laquelle l’article de loi invoqué dans la saisine a posteriori de la Cour a été, entre temps, modifié. Dans cette situation, il a été établi que, si dans sa nouvelle rédaction, la disposition légale maintient la solution législative de principe antérieure à la modification, les motifs d’inconstitutionnalité étant les mêmes, la Cour peut se prononcer, une nouvelle saisine n’étant pas nécessaire. (Les Décisions du Plénum de la Cour constitutionnelle n° III/1995 ; n° 7/1996 ; n° 713/1997.)
I 3. – Les délais
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ? Si oui, lesquels ?
Pour ce qui est des délais dans lesquels la Cour constitutionnelle peut être saisie, nous signalons que de tels délais ne sont établis ni par la Constitution, ni par la Loi d’organisation et de fonctionnement.
Quelques règles pourraient, quand même, être identifiées :
a) Quant aux objections d’inconstitutionnalité (le contrôle a priori), elles peuvent être déposées dès le lendemain de la date du dépôt de la Loi votée et jusqu’à la promulgation par le président de la Roumanie aux secrétaires généraux des Chambres du parlement. À mentionner, le délai de protection pour les sujets pouvant saisir, dans la mesure où la loi est conservée par les secrétaires généraux des Chambres 5 jours, ou 2 jours pour les lois adoptées en procédure d’urgence. Ce n’est qu’une fois ces délais écoulés que la loi est transmise pour promulgation.
Le président de la Roumanie a l’obligation constitutionnelle de promulguer la loi, dans un délai de 20 jours suivant la réception.
b) Quant aux exceptions d’inconstitutionnalité (le contrôle a posteriori), celles-ci peuvent être soulevées n’importe quand en cours d’instance et quelque soit le degré de juridiction où l’affaire est jugé (il s’agit des lois et des ordonnances).
c) Les objections relatives aux règlements parlementaires peuvent être déposées n’importe quand.
I 3.2. – Tableau des conditions de délais
Voir le tableau n° 4, annexe III, page 468.
I 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Aucune modification relative aux délais dans lesquels la Cour peut être saisie n’est intervenue.
II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives au requérant
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Conformément à l’article 15 de la Loi n° 47/1992 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les requêtes adressées à celle-ci sont exemptes de taxe de timbre.
II 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
Selon l’article 24(5) de la Loi n° 47/1992, lors de la solution des exceptions d’inconstitutionnalité, les parties peuvent être représentées par des avocats étant autorisés à plaider à la Cour suprême de Justice.
La représentation par avocat, est, donc, possible, mais elle n’est pas obligatoire.
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
L’auteur de l’exception d’inconstitutionnalité est naturellement intéressé à agir. Comme nous l’avons déjà mentionné, les exceptions d’inconstitutionnalité peuvent être invoquées uniquement devant un tribunal, dans le cadre d’un procès concret. Et selon l’article 21 de la Constitution, toute personne peut s’adresser à la justice pour la défense de ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes.
En ce qui concerne les auteurs des objections d’inconstitutionnalité ou de celles relatives aux règlements parlementaires, ici l’intérêt résulte des obligations de ceux-ci de protéger les intérêts généraux.
II 2. – Conditions relatives au recours
II 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les actes de saisine de la Cour constitutionnelle, qui visent les cas spécifiés à l’article 144 lettres a), b), c) et h) de la Constitution, sont reçus au Service d’enregistrements, y apportés soit par la poste, soit par porteur. Ils sont immédiatement inscrits dans le Registre d’entrées-sorties de la correspondance, acquérant un numéro d’ordre et une date certaine.
Après l’enregistrement, l’acte de saisine, y compris l’enveloppe (s’il est arrivé par la poste), est remis au magistrat-assistant en chef, qui le présente immédiatement au président de la Cour.
En recevant l’acte dont la Cour est saisie, le président de la Cour vérifie si les conditions formelles sont respectées, après quoi il désigne un juge comme rapporteur et ordonne l’inscription de l’acte de saisine dans le Registre de dossiers du rôle de la Cour.
L’acte de saisine, ainsi que les autres pièces qui le concernent est restitué par le magistrat-assistant en chef au Service d’enregistrements, où, le même jour, il reçoit le numéro d’ordre du Registre de dossiers, auquel est ajoutée une lettre de A à I, selon le type de la saisine (correspondant aux types d’attributions mentionnées à l’article 144 de la Constitution). Il est à mentionner que, sous le même numéro, seront aussi enregistrées, toutes les requêtes ultérieurement déposées ou les pièces ayant trait à l’affaire envoyées par la Cour.
Ensuite, le numéro du dossier nouvellement créé sera inscrit au Registre informatif, dans lequel seront mentionnés : le premier délai de jugement et les délais suivants accordés par la Cour, le numéro et la date de la décision ou de l’arrêt rendus, ainsi que, brièvement, la solution.
Le nom de l’organe ou de la personne qui a fait la saisine et le numéro du dossier seront également inscrits, dans un Opus alphabétique, pour être facilement retrouvés par les magistrats et les justiciables. Dans le cas où la saisine provient d’un groupe de députés ou de sénateurs, dans l’opus alphabétique ne sera inscrit que le nom du premier député ou du premier sénateur.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
C’est la date d’enregistrement dans le Registre des dossiers qui atteste du déclenchement des procédures.
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Voir les tableaux nos 5 et 6, annexes IV et V, pages 470 et 472.
II 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Non.
II 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ? À l’initiative du requérant ou de la Cour elle-même ? Cette possibilité de régularisation est-elle encadrée dans des délais ?
La procédure se déroule à partir du moment de l’enregistrement de la saisine. Il n’y a pas de procédures de correction de celle-ci. La Cour juge in limine litis.
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
Il n’existe pas de procédure préalable de rejet d’une saisine, parce qu’elle ne réunirait pas les conditions de forme et de contenu adéquates. Il est vrai que, selon l’article 12 de la Loi n° 47/1992, les saisines doivent être faites sous la forme écrite et motivées. En ce qui concerne la forme écrite, elle est obligatoire pour que la saisine soit enregistrée (donc, reçue). Concernant la motivation, ici les problèmes sont plus compliqués et c’est très rarement qu’une exception a été rejetée du fait de l’absence de la motivation.
C’est pourquoi, une fois enregistrée, la saisine parcourt la procédure et cette procédure est close avec le prononcé de la décision. Ce n’est que par cette décision que l’on statue également sur une irrecevabilité de la saisine.
Les cas d’irrecevabilité peuvent regarder : le sujet de la saisine, l’objet de la saisine, le bien-fondé constitutionnel invoqué pour la contestation de la conformité constitutionnelle de la loi.
La recevabilité pour les exceptions d’inconstitutionnalité est expressément mentionnée à l’article 23 de la Loi n° 47/1992. Ainsi, une exception est recevable si : elle est soulevée devant un Tribunal ; elle regarde l’inconstitutionnalité d’une loi ou d’une ordonnance en vigueur ; elle concerne un texte de loi dont dépend la solution de l’affaire ; elle est soulevée par l’une des parties du procès ou d’office par le Tribunal ; la constitutionnalité n’avait pas été établie antérieurement selon l’article 145 alinéa (1er) de la Constitution (notamment par le Parlement, dans le cadre du contrôle a priori) ; le texte de loi n’avait pas été déclaré inconstitutionnel dans une décision antérieure de la Cour constitutionnelle. Dans ces cas, le Tribunal lui même est légalement tenu à constater l’irrecevabilité. Si le Tribunal n’agit pas de cette manière, l’obligation en incombe à la Cour constitutionnelle qui rend une décision.
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
Ce n’est que la Cour constitutionnelle, à l’exception des cas précités.
II 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Il n’y pas de voie de recours contre la décision de la Cour constitutionnelle. La décision est définitive et obligatoire.
II 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
a) La Cour constitutionnelle délibère en Plénum et les actes de la Cour sont adoptés à la majorité des juges.
b) Le quorum nécessaire au Plénum de la Cour constitutionnelle est de deux tiers du nombre des juges de la Cour.
c) La décision de la Cour constitutionnelle relative à la vérification de l’initiative de révision de la Constitution requiert une majorité des deux tiers des juges de la Cour.
d) Toute affaire est débattue sur la base d’un rapport rédigé par un jugerapporteur.
e) Le rapporteur est désigné par le président de la Cour constitutionnelle, parmi les juges de la Cour, après l’enregistrement de la saisine.
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
Toutes les décisions de la Cour constitutionnelle sont prononcées, motivées et publiées au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire.
II 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Conformément à la Loi n° 47/1992, lorsque la Cour constitutionnelle constate que l’exception d’inconstitutionnalité est mal fondée et qu’elle a été soulevée de mauvaise foi, afin que la solution du procès soit retardée, elle peut infliger à la partie qui a invoqué l’exception, une amende de 10 000100 000 lei (valant 0,50-5 dollars US).
Les amendes sont appliquées par le président de la Cour constitutionnelle dans un jugement avant-dire-droit motivé.
Contre ce jugement, il est possible de porter plainte dans un délai de 30 jours à compter de sa communication et elle est jugée par l’organe qui a appliqué l’amende.
Le jugement est définitif est obligatoire.
Les sommes d’argent sont versées au budget d’État.
II 3.6. – La procédure conduisant à la déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
Non.
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Voir le tableau n° 7, annexe VI, page 473.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
III 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Ces formalités dépendent de l’objet du contrôle de constitutionnalité, notamment :
a) Dans le cas du contrôle a priori, si la saisine a été faite par l’un des présidents des deux Chambres du Parlement, par des parlementaires, par le gouvernement ou par la Cour suprême de Justice, la Cour la communiquera au président de la Roumanie le jour de son enregistrement ;
au cas où la saisine a été faite par le président de la Roumanie, par des parlementaires ou par la Cour suprême de Justice, la Cour la communiquera, dans un délai de 24 heures depuis son enregistrement, aux présidents des deux Chambres du Parlement et du gouvernement, précisant aussi la date à laquelle les débats auront lieu ;
au cas ou la saisine a été faite par le président de l’une des Chambres du Parlement, la Cour constitutionnelle la communiquera au président de l’autre Chambre, de même qu’au gouvernement ;
et si la saisine a été faite par le gouvernement, la Cour la communiquera aux présidents des deux Chambres du Parlement ; jusqu’à la date des débats, les présidents des deux Chambres du Parlement et le gouvernement peuvent présenter, par écrit, leur point de vue.
b) Dans le cas du contrôle de la constitutionnalité des règlements parlementaires, lorsque la saisine est faite par les parlementaires, la Cour la communiquera, dans un délai de 24 heures à partir de l’enregistrement, aux présidents des deux Chambres, en précisant la date à laquelle les débats auront lieu. Jusqu’à la date des débats, les présidents des Chambres peuvent communiquer le point de vue des bureaux permanents.
c) Dans le cas de la solution des exceptions d’inconstitutionnalité, le président de la Cour constitutionnelle communiquera le jugement avant dire droit par lequel la Cour a été saisie, aux présidents des deux Chambres du Parlement et au gouvernement, en leur indiquant la date jusqu’à laquelle ils peuvent transmettre leur point de vue. Jusqu’à la date des débats, les présidents des deux Chambres du Parlement et le gouvernement peuvent présenter, par écrit, leur point de vue.
III 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
Les parties ont accès à la salle d’audience par des mémoires écrits, aussi bien que par des interventions orales seulement lors des jugements des exceptions d’inconstitutionnalité. Les parties peuvent être assistées et représentées par les avocats.
III 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Le jugement des exceptions d’inconstitutionnalité peut être défini comme une procédure qui réalise pleinement le principe du caractère contradictoire.
III 2. – Égalité des armes
III 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
– Lors du contrôle a priori, l’article 20 de la Loi n° 47/1992 prévoit que :
1. – Le débat a lieu en Assemblée Plénière de la Cour constitutionnelle, avec la participation des juges de la Cour, sur la base de la saisine, des documents et des points de vue reçus qui porteront tant sur les dispositions mentionnées dans la saisine que sur celles dont, nécessairement et évidemment, elles ne peuvent être dissociées.
2. – Par suite des délibérations, la décision est prononcée à la voix de la majorité des juges et elle est communiquée au président de la Roumanie. La décision constatant l’inconstitutionnalité de la loi est également communiquée aux présidents des deux Chambres du Parlement, en vue de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 145, alinéa (1er), de la Constitution.
3. – La décision est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie.
– Quant aux exceptions d’inconstitutionnalité et conformément aux règles de la procédure civile, sont prévus : l’établissement de la date de l’audience publique ; la citation des parties et du Ministère Public ; le déroulement de l’audience selon toutes les règles du procès civil ; le délibéré et le prononcé de la décision ; la motivation de la décision ; la publication de la décision au Moniteur officiel.
III 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ?
Les parties ont accès aux actes du dossier et, certainement, à toutes les procédures.
III 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Le juge constitutionnel ne dispose pas de moyens propres d’instruction, ceux-ci n’étant pas nécessaires, car la Cour constitutionnelle décide seulement des problèmes de droit. Bien sûr, pour résoudre certaines affaires, on peut aussi solliciter des consultations écrites ou des points de vue de la part de certaines personnalités de la vie juridique (professeurs universitaires, chercheurs scientifiques). De même, en vertu de l’article 14 du Règlement de la Cour, le juge rapporteur peut demander au tribunal qui a fait la saisine de compléter l’acte de saisine, en lui établissant aussi un délai.
III 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ?
Ainsi que rappelé ci-dessous, le seul cas où la Cour fait une saisine d’office est le contrôle de la constitutionnalité des initiatives de révision de la Constitution.
III 3. – Délai de jugement
III 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Ici, il est possible de différencier plusieurs situations :
a) la Constitution n’établit aucun délai ;
b) les délais pour juger les saisines (les affaires) sont établis soit dans la Loi n° 47/1992, soit dans le Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ;
c) il n’y a pas de délais établis pour toutes les circonstances ;
d) la Cour est obligée de se prononcer dans un délai de 10 jours sur la constitutionnalité de l’initiative de révision de la Constitution (art. 36 alinéa 1er de la loi). La procédure est déclenchée par un jugement avant dire droit du Plénum ;
e) au cas de l’exception d’inconstitutionnalité, le terme de jugement est fixé par le président de la Cour, à la date marquant la remise du rapport (art. 24 alinéa 3 de la loi) ;
f) le délai du dépôt du rapport ne peut pas dépasser, de règle, 60 jours à partir de la date de l’enregistrement de la saisine (art. 13 du Règlement) ;
g) le délai de jugement est établi par le président de la Cour, à la date du dépôt du rapport, sans que cela puisse dépasser 30 jours (art. 14 du Règlement) ;
h) la décision est prononcée sur place ou dans un autre jour fixé et annoncé. L’ajournement du prononcé ne peut pas dépasser 30 jours (art. 27 du Règlement) ;
i) le délai de rédaction de la décision est de 30 jours, tout au plus à partir de la date du prononcé (art. 31 du Règlement).
Note. Le respect des délais est une obligation normale et la Cour constitutionnelle n’y renonce pas.
III 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
Par le prononcé de la décision.
III 3.3. – Si aucun texte ne définit le délai, quel est le délai moyen (par type de contrôle) que prend la Cour pour statuer ?
La réponse a été formulée au point III-3.1.
Conclusion
1. – Étant une institution récente (1992), la Cour a créé sa propre structure d’organisation qui contient : le secrétaire général de la Cour, la Direction économique dont font partie le Service financier-comptable, de même que le Service d’approvisionnement et administratif ; le Service de documentation, recherche et informatique, formé de l’Office de recherche documentation, de l’Office de rédaction par ordinateur et le service des relations extérieures ; le Service de préparation des travaux et secrétariat dont font partie les greffiers et les huissiers.
2. – Il n’y a aucune réforme en cours.
3. – Les requêtes adressées à la Cour gagnant en professionnalisme est un processus qui se déroule lentement.
Annexes
Tableau n° 1
Liste des articles de la Constitution, des Lois et des codes faisant l’objet des décisions dans la période 1er mars 1993 31 décembre 1999

















































Tableau n° 2
Annexe I
Tableau analytique relatif aux saisines reçues par la Cour constitutionnelle de la part de la Cour suprême de Justice

Tableau n° 3
Annexe II
Tableau synthétique des actes contrôlés sous le rapport de la constitutionnalité

Tableau n° 4
Annexe III
relatif aux conditions de délais et aux textes de nature constitutionnelle, législative ou réglementaire établissant ces délais


* La Loi n° 189/1999 relative à l’exercice de l’initiative législative par les citoyens, est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, n° 611 du 14 décembre 1999.
** La Loi n° 47/1992 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle, modifiée et complétée par la Loi n° 138/1997, est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, n° 170 du 25 juillet 1997 et republiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Partie Ire, n° 187 du 7 août 1997.
Tableau n° 5
Annexe IV
Tableau contenant les conditions formelles relatives à la saisine


Tableau n° 6
Annexe V
Tableau contenant les conditions matérielles relatives à la saisine

Tableau n° 7
Annexe VI



|pdf]https://cdn.accf-francophonie.org/2019/04/rapport_rwa.pdf[/pdf]
Rapport de la cour constitutionnelle du Rwanda
Mars 2000
Liminaire
Le contrôle de constitutionnalité au Rwanda présente trois caractéristiques particulières qu’il convient de garder constamment à l’esprit :
1. – La Cour constitutionnelle ne peut être saisie que par une personne publique : l’Assemblée nationale (lois) et plus rarement par le gouvernement (décret-loi).
2. – Le contrôle de constitutionnalité fait par la Cour est un contrôle a priori, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de lois, et systématique. L’article 75 alinéa 1er de la Constitution énonce en effet : « avant leur promulgation, les lois et décrets-lois sont obligatoirement transmis à la Cour constitutionnelle qui se prononce dans la huitaine ou, en cas d’urgence, dans les quatre jours, sur leur constitutionnalité ».
3. – Il ne peut y avoir, en conséquence, aucun recours contre une loi ou un décret-loi régulièrement promulgué.
Les différentes réponses au questionnaire à nous transmis s’inscrivent dans ce contexte.
I. L’ouverture du droit de saisine
Ainsi que renseigné plus haut, la Cour est saisie par une lettre émanant de l’Assemblée nationale ou du Premier ministre demandant à la Cour de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi ou d’un décret-loi avant qu’ils ne puissent être promulgués.
Cette lettre est accompagnée de l’exposé des motifs de la loi ou du décret-loi ainsi que des rapports des commissions parlementaires qui ont eu à discuter sur cette loi.
Le tableau ci-dessous renseigne quelques données chiffrées sur le nombre de saisines, par type, durant les dix dernières années.

1. Il y a lieu de noter que les traités sont soumis au contrôle de constitutionnalité sous forme de lois.
2. Les décrets-lois sont les actes pris par l’Exécutif lorsque l’Assemblée nationale est dans l’impossibilité de siéger ou lorsqu’il y a urgence.
Quant à la question de savoir s’il y a des voies de recours ou des problèmes spécifiques, il suffit de rappeler que les décisions de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours. En effet, l’article 45 de la Loi organique portant organisation de la Cour suprême précise les avis de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
II. Recevabilité de la saisine
Rappelons encore une fois que la saisine de la Cour se fait sur la base d’une simple formalité administrative, en l’occurrence, d’une lettre émanant soit du président de l’Assemblée nationale, soit du Premier ministre, suivant qu’il s’agit de contrôler la constitutionnalité d’une loi ou d’un décret-loi.
Cette saisine ne donne donc pas lieu à un droit de timbre quelconque, le requérant ne peut être représenté et sa qualité se présume du fait que par définition, il ne peut agir que dans l’intérêt général.
Les conditions relatives au recours, les modalités de rejet pour irrecevabilité, les motifs de rejet ne sont pas repris dans notre Droit, compte tenu des spécificités énoncées dans le « liminaire ».
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
Les renseignements recherchés sous cette rubrique (principe du contradictoire, égalité des armes, délai du jugement, …) ne se conçoivent que dans le cadre d’un « procès » devant la Cour constitutionnelle ce qui n’est pas prévu dans notre système juridique.
Cela dit, il existe d’autres voies de recours, ouvertes aux personnes qui s’estimeraient lésées par certaines décisions judiciaires ou administratives.
C’est ainsi que la section « Cour de Cassation » de la Cour suprême statue sur les pourvois en Cassation et sur les demandes en renvoi, tandis que la section « Conseil d’État » statue sur les recours en annulation formés contre les règlements, arrêtés et décisions des autorités administratives.
Rapport du conseil constitutionnel du Sénégal
Mars 2000
I. L’ouverture du droit de saisine
Ne pouvant agir d’office, le Conseil constitutionnel du Sénégal n’exerce ses attributions que s’il est saisi à cet effet.
I 1. – Les requérants


Saisine émanant d’une personne publique :
Organes législatifs :
Le président de l’assemblée nationale en ce qui concerne la recevabilité des propositions de loi ou des amendements d’origine parlementaire ;
Le président de l’Assemblée nationale ou l’un de ses vice-présidents dans l’ordre de préséance, en cas de décès ou d’empêchement du président de la République ;
Le Bureau de l’Assemblée nationale pour la constatation de la déchéance d’un député dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats du scrutin et à l’expiration du délai de recours ou qui est devenu inéligible au cours de son mandat ;
Groupe de députés :
Un dixième (1/10) des membres de l’Assemblée nationale dans le cadre de la constitutionnalité des lois et engagements internationaux ;
Organes exécutifs :
Le président de la République dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois et engagements internationaux ;
Le président de la République en ce qui concerne la recevabilité des propositions de lois ou des amendements d’origine parlementaire ;
Le président de la République a la possibilité de modifier par décret les textes de forme législative ayant un caractère législatif ;
Le président de la République en cas de recours aux pouvoirs exceptionnels prévus par l’article 47 de la Constitution (menace sur les institutions) ;
Le président de la République en matière de référendum ; Le président de la République en cas de démission ;
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, à la demande de toute partie intéressée, en cas de conflit de compétence entre le Conseil d’État et la Cour de Cassation ;
Juridictions :
Le Conseil d’État et la Cour de Cassation lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée devant eux ;
Le Ministère Public pour la constatation de la déchéance d’un député en cas de condamnation postérieure à son élection ;
Saisine émanant d’une personne ou de groupement privé : Personne(s) physique(s) :
Le citoyen sénégalais (fût-t-il un avocat) ne peut saisir directement le Conseil constitutionnel, à plus forte raison les non nationaux, à moins qu’à l’occasion d’un procès devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation, ceux-ci ne soulèvent l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi ;
Partis politiques :
Tout parti politique ou toute coalition de partis politiques légalement constitués.

I 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Les conditions d’ouverture du recours n’ont pas évolué dans le temps.
I 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Le Conseil constitutionnel ne peut agir d’office et n’exerce ses attributions que s’il est saisi à cet effet.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur recours ?
Les deux cas de désistement rencontrés jusqu’à présent concernent l’un le retrait de la candidature d’un candidat à l’élection présidentielle du 21 février 1993, qui a eu à le faire après la publication de la liste des candidats à ladite élection, l’autre celui d’un candidat mais avant la publication de la liste des candidats à la prochaine élection présidentielle du 27 février 2000.
I 2. – Actes contrôlés
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé

I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
En effet, il existe des actes placés hors contrôle par les textes : la Constitution norme de référence du contrôle.
Il y a aussi toutes les questions qui échappent à la compétence du Conseil (demande de sursis, demande de rectification d’erreur matérielle sur des chiffres, etc.).
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Le Conseil constitutionnel n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur cette question.
I 3. – Les délais
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Il n’y pas de recours recevable sans délai.
I 3.2. – Tableau des conditions de délais

I 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Les délais n’ont pas changé sur la période d’ensemble.
Ils posent le problème de la forclusion du requérant. Dans un tel cas, le Conseil décide de l’irrecevabilité du recours pour forclusion (décision n° 3/E/93 = Abdou Diouf candidat à l’élection présidentielle du 21 février 1993 introduit un recours parce que le Parti Africain des Écologistes du Sénégal a choisi pour l’impression de ses bulletins la couleur verte que le Parti socialiste a toujours utilisée et avant lui.
Le Conseil constitutionnel conformément à l’article 25 de la Constitution arrête et publie la liste des candidats 29 jours francs avant le premier tour du scrutin, donc le 22 janvier 1993. Le droit de réclamation (LO 116 du Code électoral) est ouvert à tout candidat et s’exerce avant l’expiration du jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats au Greffe du Conseil. D’où la requête de Abdou Doiuf datée du 27 janvier 1993 était tardive, le délai de réclamation expirant le lundi 25 janvier 1993 à minuit, les 2 jours suivant l’affichage étant le premier un samedi, jour chômé et le deuxième un dimanche ; c’est aussi le cas entre autres des décisions n° 19/E/93 et 1/C/98).
II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives au requérant
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
La procédure devant le Conseil constitutionnel est sans frais.
II 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
La représentation du requérant par ministère d’avocat, ou par une autre personne n’est pas possible, la procédure devant le Conseil constitutionnel n’étant pas contradictoire et les intéressés ne pouvant être entendus.
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête qui, pour être recevable, doit remplir certaines conditions de forme (identité du requérant, objet de la requête, moyens invoqués) et être accompagnée des pièces et documents justificatifs.
II 2. – Conditions relatives au recours
II 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Toutes les pièces relatives à l’exercice des compétences du Conseil constitutionnel sont déposées au Greffe. À ce titre différents registres y sont ouverts et consacrés respectivement à l’enregistrement des affaires constitutionnelles, des affaires relatives aux élections présidentielle, législatives et sénatoriales et à leur contentieux et enfin des affaires liées aux conflits de compétence entre le Conseil d’État et la Cour de Cassation. Chaque affaire reçoit un numéro d’ordre à la suite dans chaque registre précédé de la lettre «C» pour le premier registre, de la lettre «E» pour le second registre, de la lettre «J» pour le troisième registre et suivi des deux derniers chiffres du millésime.
À la case concernant chaque affaire, sont enregistrés toutes les pièces et mémoires relatifs à cette affaire.
Mention est faite au registre de tous les actes de procédure, y compris de la date et de l’analyse sommaire de la décision rendue dans cette affaire.
Le numéro d’enregistrement de la case du registre est porté sur toutes les pièces et mémoires qui y sont mentionnés.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date de réception est aussi celle de l’enregistrement car si la requête est adressée au président du Conseil constitutionnel, elle est cependant déposée entre les mains du greffier en chef contre délivrance de récépissé. Cette date fait donc foi pour la suite de la procédure.
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Le recours se fait sur papier libre et doit pour être recevable comporter l’identité du requérant, l’objet de la requête et les moyens invoqués. Il doit être aussi accompagné de pièces et documents justificatifs : deux copies du texte de loi attaqué et éventuellement de la jurisprudence évoquée. La requête doit être signée par le président de la République (demandes de conformité), par chacun des députés ou sénateurs (recours en inconstitutionnalité émanant d’un dixième au moins des membres de l’une des assemblées).
Il n’est pas possible de soulever des moyens nouveaux, la procédure devant le Conseil n’étant pas contradictoire et tout document produit après le dépôt de la requête n’ayant pour le Conseil qu’une valeur de simple renseignement.
II 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Ces conditions n’ont pas évolué dans le temps.
II 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Aucune possibilité de régularisation n’est possible ; le Conseil dans un tel cas déclare la requête irrecevable et le requérant ne peut reprendre sa procédure si les délais légaux sont épuisés.
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
Le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d’entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
II 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Les décisions du Conseil ne sont susceptibles d’aucun recours et elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et judiciaires (le ministre de l’Intérieur rejette la candidature à l’élection des députés du 24 mai 1998 du parti UDS-R pour non respect des dispositions de l’article L 165 du Code électoral. L’UDS/R saisit le Conseil qui confirme par décision n° 7/E/98 le rejet. Le mandataire de l’UDS/R saisit à nouveau le Conseil pour lui demander de reconsidérer sa décision et utilise des argument nouveaux à l’appui de sa requête. Par décision n° 10/E/98, le Conseil déclare le recours irrecevable).
II 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
Le Conseil statue toujours en formation plénière et sur rapport. Pour chaque affaire, un rapporteur est désigné parmi les membres du Conseil et par ordonnance du président de l’Institution ; Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef qui les reçoit suivant des modalités déjà abordées dans le paragraphe II-2.1.
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
La décision d’irrecevabilité, comme toutes les autres décisions, est motivée, prononcée et publiée dans le Journal officiel de la République du Sénégal.
II 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Non, le requérant abusif n’est passible d’aucune amende pour abus du droit d’agir.
II 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
La procédure conduisant à la déclaration d’irrecevabilité n’a pas évolué.
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Les recours déclarés irrecevables par le Conseil l’ont été jusqu’à présent pour deux motifs essentiels : 10 décisions d’irrecevabilité ont été rendues pour forclusion et 5 autres parce que la norme susceptible de contrôle échappe à la compétence du Conseil.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
III 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Lorsque le recours est exercé par le président de la République, le greffier en chef du Conseil en donne avis sans délai au président de l’Assemblée nationale.
III 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elle accès au prétoire ?
Sous réserve de la prestation de serment du président de la République, des membres du Conseil ou de l’Observatoire National des Élections, les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à y être entendus.
III 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Le principe du contradictoire n’existe pas.
III 2. – Égalité des armes
III 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Les pièces constitutives de la procédure sont : la requête, deux copies du texte de loi attaqué, les textes de la jurisprudence visée et tout autre document que le requérant estime utile à son recours.
III 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Les requêtes déposées au Greffe du Conseil sont communiquées par le greffier en chef aux autres candidats intéressés pour leur permettre de répondre.
III 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Désigné par ordonnance du président du Conseil, le rapporteur une fois en possession du dossier procède à l’instruction de l’affaire ; Il examine les questions de compétence, forclusion, désistement, autres recevabilités et le fond de l’affaire.
III 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ? de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
Si le Conseil constitutionnel relève dans la loi contestée, dans l’engagement international soumis à son examen, une violation de la Constitution qui n’a pas été invoquée, il doit la soulever d’office. La procédure devant le Conseil n’étant pas contradictoire, les requérants n’ont pas la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge constitutionnel.
III 3. – Délai de jugement
III 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Lorsque le Conseil est saisi d’un recours tendant à faire constater la non conformité à la Constitution d’une loi ou d’un engagement international, il doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du dépôt du recours. C’est aussi le délai prescrit lorsque le président de la République saisit le Conseil en matière de contrôle du respect de la délimitation du domaine législatif et du domaine réglementaire (art. 65, al. 1 Const.). Il est réduit à huit jours francs quand le gouvernement déclare l’urgence.
Lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation, le Conseil se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de saisine.
Les délais sont scrupuleusement respectés.
III 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
Le rapporteur choisit en fonction des données de chaque espèce, l’ordre dans lequel il examine les moyens. Puis il rédige une note qui propose une solution ou, éventuellement plusieurs solutions, si le doute est possible sur l’issue.
III 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
Comme expliqué dans le paragraphe III-3.1., le Conseil est tenu de rendre sa décision dans un délai prédéfini et suivant le recours dont il est saisi.
C’est dans ce délai que se font l’instruction, la tenue du délibéré, le prononcé et la notification de la décision aux intéressés et notamment au secrétaire général du gouvernement qui est chargé, conformément aux dispositions de l’article 23 de la Loi organique 92.23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, de la publication au Journal officiel de la République du Sénégal.
Conclusion
Compte tenu de sa composition (5 membres) le Conseil constitutionnel du Sénégal, suite à la modification de l’article 22 de la Loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 par la Loi organique n° 99-71 du 17 février 1999, ne peut délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d’entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres.
Ce sont donc les lois organiques précitées qui organisent toute la procédure devant le Conseil.
Rapport de la cour constitutionnelle de Slovénie
Mars 2000
Remarques préliminaires
La Constitution de la République socialiste de Slovénie de 1963 (Journal officiel de la RSS, n° 10/63) prévoyait une Cour constitutionnelle ; la loi sur la Cour constitutionnelle (Journal officiel de la RSS, n° 39/63 et 1/64) en établissait les compétences et procédures et fixait sa prise de fonctions au 15/2-1964. Le premier Règlement de la Cour constitutionnelle fut adopté le 23/2-1965 (Journal officiel de la RSS n° 11/65), et c’est le 5/6-1963 que furent pour la première fois élus par l’Assemblée de la RSS le président et les huit juges de la Cour constitutionnelle (décision publiée au Journal officiel de la RSS, n° 22/63). Le président et les juges prirent solennellement leurs fonctions devant le président de l’Assemblée le 15/2/1964.
La Constitution de 1974, quant à elle, réorganisait la position et les compétences de la Cour constitutionnelle (Journal officiel de la RSS, n° 6/74) ; la loi sur la Cour constitutionnelle de la République socialiste de Slovénie (Journal officiel de la RSS, n° 39/74 et 28/76) précisait, par des dispositions plus détaillées, les compétences et procédures de la Cour ; un nouveau Règlement de la Cour constitutionnelle fut également adopté (Journal officiel de la RSS, n° 10/74).
La Constitution de la République de Slovénie, adoptée en 1991, a de nouveau modifié la position et les compétences de la Cour constitutionnelle (Journal officiel de la RS, n° 33/91). Une nouvelle loi sur la Cour constitutionnelle a précisé les compétences et la procédure de la Cour constitutionnelle (Journal officiel de la RS, n° 15/94). La Cour constitutionnelle est l’organe judiciaire suprême chargé du contrôle de la constitutionnalité et de la légalité des actes ainsi que de la protection, non seulement de cette constitutionnalité et de cette légalité, mais également des droits de l’homme et des libertés fondamentales (l’article 1 (1) de la loi sur la Cour constitutionnelle).
La Cour constitutionnelle actuelle fonctionne sur la base des fondements textuels suivants :
Constitution de 1991 (Journal officiel de la RS, n° 33/91) ;
Loi sur la Cour constitutionnelle (Journal officiel de la RS, n° 15/94) ;
Règlement de la Cour constitutionnelle (Journal officiel de la RS, n° 49/98).
Définitions pertinentes :
Pour chacun des modèles de la saisine, les termes suivants sont employés [1] :
saisine = vloga
auteur de la saisine = vlagatelj (vloge)
requête = zahteva [2]
requérant = vlagatelj zahteve
pétition = pobuda [3]
pétitionnaire = pobudnik
recours constitutionnel (violation des droits de l’homme) = ustavna pritozˇba [4]
auteur du recours constitutionnel = pritozˇnik
mise en accusation [5] = postopek ugotavljanja odgovornosti predsednika republike, predsednika vlade ali ministrov
recours (électoral) = pritozˇba [6]
auteur du recours (électoral) = vlagatelj pritozˇbe
proposition = predlog [7]
auteur de la proposition = predlagatelj
Compétences de la Cour constitutionnelle slovène :
Le modèle slovène suit à cet égard les traditions européennes qui ont choisi de concentrer en une cour unique d’importantes compétences en matière de contrôle constitutionnel.
1. – Contrôle des actes
a. Contrôle préventif
Lors d’une procédure de ratification d’un traité international, la Cour émet un avis sur sa conformité avec la Constitution (art. 160(2) de la Constitution ; article 21(2) et article 70 de la Loi sur la Cour constitutionnelle). L’Assemblée nationale est liée par l’avis de la Cour constitutionnelle.
b. Contrôle a posteriori
i. Contrôle abstrait
La cour décide (art. 160(1) de la Constitution ; article 22 à 49 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) :
- de la conformité des lois avec la Constitution ;
- de la conformité des lois et autres règlements avec les traités internationaux ratifiés par la Slovénie et les principes généraux du droit international ;
- de la conformité des actes réglementaires avec la Constitution et la loi ;
- de la conformité des règlements des collectivités locales avec la Constitution et la loi ;
- de la conformité des actes généraux adoptés par un organe habilité, avec la Constitution, la loi et la réglementation en vigueur ;
- de la question de savoir s’il convient d’annuler (ex tunc) ou d’abroger (ex nunc) des règlements ou des actes généraux (les lois et autres règlements) par une décision sur un recours constitutionnel (art. 161(2) de la Constitution ; article 59(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
ii. Contrôle concret
La Cour assure également un contrôle concret des textes normatifs à la demande des tribunaux ordinaires (art. 156 de la Constitution ; article 23 (1/5,6) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
2. – Autres compétences
L’article 160(1) de la Constitution et l’article 21(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle disposent que la Cour est également compétente pour les matières suivantes :
- recours constitutionnel pour cause de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales par des actes spécifiques (art. 160(1/6) de la Constitution et articles 50 à 60 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- conflits de compétences entre l’Assemblée nationale, le président de la République et le gouvernement (art. 160(1/7 à 9) de la Constitution ; articles 61 et 62 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- inconstitutionnalité des actes et activités des partis politiques (art. 160(1/10) de la Constitution et article 68 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Elle se prononce également sur :
- les accusations portées contre le président de la République (art. 109 de la Constitution ; articles 63 à 67 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- les accusations portées contre le Premier ministre ou l’un quelconque de ses ministres (art. 119 de la Constitution ; art. 63 à 67 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- les recours (électoraux) interjetés contre des décisions de l’Assemblée nationale relatives à la vérification des mandats des députés (art. 82(3) de la Constitution ; art. 69 de la Loi sur la Cour constitutionnelle ; art. 8(1) de la Loi des députés, Journal officiel de la RS, n° 48/92) ;
- les recours (électoraux) interjetés contre des décisions du Conseil national relatives à la vérification des mandats des membres du Conseil national (art. 50(3) de la Loi sur le Conseil national, Journal officiel de la RS, n° 44/92) ;
- requête de l’autorité locale, si leurs droits sont menacés (art. 91 de la Loi d’autogestion locale, Journal officiel de la RS, n° 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 4/96 ; art. 23 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
– constitutionalité et légalité de la demande de convocation d’un référendum (art. 15 et 16 de la Loi de référendum et l’initiative populaire, Journal officiel de la RS, n° 15/94 et 13/95).
L’organisation slovène en vigueur pour toute procédure engagée devant la Cour constitutionnelle slovène comprend l’application des modèles de la saisine suivants :
- contrôle abstrait ; pétition déposée par les citoyens par laquelle une loi, un règlement ou un acte général est contesté : toute personne en mesure de prouver son intérêt juridique (art. 162(2) de la Constitution, article 24 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- recours constitutionnel, par lequel l’auteur du recours constitutionnel conteste un acte individuel d’un organe de l’État, qui aurait porté atteinte à ses droits de l’homme ou libertés fondamentales (art. 160, 161 et 162 de la Constitution ; article 50 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- contrôle abstrait ; requête par laquelle une loi, un règlement ou un acte général est contesté : Assemblée nationale (par au moins un tiers des députés), Conseil national, gouvernement, organes représentant les collectivités locales, représentants des syndicats (art. 23(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- contrôle concret ; requête par laquelle une loi, un règlement ou un acte général est contesté, lorsque la question de la constitutionnalité ou de la légalité est soulevée au cours d’un litige dont ils sont saisis : tribunaux, procureur de la République, Banque de Slovénie, Cour des comptes, médiateur (art. 23(1/5,6) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- conflits de compétences : pétition pour décision portant sur un conflit ou constatation de l’organe compétent, déposée par les citoyens ; requête : organes concernés (art. 61(1/3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- mise en accusation (portée contre le président de la République et portée contre le Premier ministre ou l’un quelconque de ses ministres) : Assemblée nationale (art. 109 et 119 de la Constitution ; article 63(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- activités anticonstitutionnelles des partis politiques ; pétition : citoyens et requête (art. 68(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- vérification des mandats des députés ; recours (électoral) : candidats concernés ou représentants des listes de candidats (art. 69(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle ; art. 8(1) de la Loi des députés, Journal officiel de la RS, n° 48/92) ;
- vérification des mandats des membres du Conseil national ; recours (électoral) : candidats concernés (art. 50(3) de la Loi sur le Conseil national, Journal officiel de la RS, n° 44/92) ;
- contrôle préventif des traités internationaux ; proposition : président de la République, gouvernement ou Assemblée nationale (un tiers des députés) (art. 160(2) de la Constitution ; article 70 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- requête de l’autorité locale, si leurs droits sont menacés (art. 91 de la Loi d’autogestion locale, Journal officiel de la RS, n° 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 4/96 ; article 23 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- requête ou pétition, de constitutionnalité et légalité de la demande de convocation du référendum (art. 15 et 16 de la Loi de référendum et initiative populaire, Journal officiel de la RS, n° 15/94 et 13/95).
I. L’ouverture du droit de saisine
I 1. – Les auteurs de la saisine
I 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
Requête (art. 23 de la loi sur la Cour constitutionnelle) :
l’Assemblée nationale
un tiers des députés de l’Assemblée nationale le Conseil national
le gouvernement
(lorsque la question de la constitutionnalité ou de la légalité est soulevée au cours d’un litige dont ils sont saisis) :
un tribunal ordinaire
le Procureur de la République la Banque de Slovénie
la Cour des comptes
médiateur de la République (en matière de droits de l’homme, pour les cas individuels qui lui sont soumis)
les organes représentatifs des collectivités locales (si leurs droits sont menacés)
les représentants des syndicats au niveau national (si les droits des travailleurs sont menacés)
maire (art. 91 de la Loi d’autogestion locale).
Pétition émanant d’une personne ou de groupements privés (art. 24 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) :
toute(s) personne(s) physique(s), y compris les non nationaux bénéficient du droit de saisir (contrôle abstrait, recours constitutionnel)
autorités religieuses partis politiques.

I-1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine?
L’organisation slovène exclut en principe la procédure de contrôle constitutionnel sur propre initiative de la Cour constitutionnelle (ex officio = d’office). Cependant, dans sa prise de décision sur la constitutionnalité et la légalité d’un règlement, la Cour constitutionnelle n’est pas liée au contenu de la requête ou de la pétition. Selon le principe de connexité, la Cour constitutionnelle peut statuer exceptionnellement, en plus de la disposition contestée, aussi sur la constitutionnalité et la légalité d’autres dispositions du même ou d’un autre règlement dont le jugement en constitutionnalité ou en légalité n’est pas demandé, si ces dispositions sont liées entre elles ou si cela est indispensable pour la solution de l’affaire. Ainsi, la Cour constitutionnelle peut décider non seulement des questions posées par les participants au contrôle constitutionnel, mais peut aussi soulever exceptionnellement d’elle-même ces questions, dans l’étendue et selon la manière fixées par cette décision. Lorsqu’elle se prononce sur la constitutionnalité des lois et la constitutionnalité et la légalité d’autres règlements ou actes généraux, y compris ceux adoptés par les organes habilités, la Cour constitutionnelle n’est pas liée par le contenu de la demande ou requête. Elle peut aussi contrôler la constitutionnalité ou la légalité d’autres dispositions de l’acte attaqué ou d’autres actes généraux d’autorité dont la constitutionnalité ou la légalité n’ont pas été contestées si les dispositions sont réciproquement liées ou si la solution de l’affaire l’exige (art. 30 de la Loi sur la Cour constitutionnelle). Si la Cour constitutionnelle, dans la procédure de recours constitutionnel constate que l’acte individuel annulé reposait sur un acte général inconstitutionnel ou un acte général adopté par les organes habilités, elle peut également annuler ou abroger (art. 59(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). La Cour constitutionnelle, quand elle se prononce sur les conflits de compétence prend une décision précisant l’organe compétent et peut également annuler ou abroger l’acte général ou l’acte général adopté par les organes habilités, dont l’inconstitutionnalité ou l’illégalité a été établie (art. 61(4)de la Loi sur la Cour constitutionnelle). Voir aussi chapitre III-2.4.
I-1.4. – Les auteurs peuvent-ils se désister de leur saisine?
Les auteurs de la saisine peuvent se désister de leur saisine: De même que chacun peut déposer une pétition (à condition de démontrer son intérêt légal) ou une requête, il peut à tout moment la retirer. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle arrête la procédure (OdlUS III, 47 et autres). La Cour constitutionnelle met fin à la procédure si la saisine est retirée par un organe de l’État (résolution n° U-I-56/94 du 16/6/1994, publiée OdIUS III, 72). La Cour constitutionnelle arrête la procédure si malgré la notification expresse de la Cour, le pétitionnaire ne communique pas qu’il maintient la pétition (résolution n° U-I-276/97 du 11/3/1999, publiée OdIUS VIII, 59; et suivantes). Une pétition peut aussi être retirée partiellement. Ceci a pour conséquence la suspension partielle de la procédure de jugement constitutionnel. Si dans la phase d’instruction, le pétitionnaire retire partiellement sa pétition, la Cour constitutionnelle arrête la procédure pour cette partie (résolution n° U-I-140/93 du 19/10/1994, publiée OdIUS III, 114). Si durant la phase d’examen de la pétition, le règlement contesté cesse d’être en vigueur, la cour constitutionnelle notifie officiellement au pétitionnaire que si celui-ci maintient sa pétition, il doit le communiquer expressément, car en cas de non réponse, la pétition sera considérée comme retirée. Si le pétitionnaire ne notifie pas son intention, la Cour constitutionnelle arrête la procédure d’examen de la pétition (résolution n° U-I-143/97 du 14/1/1999, publiée OdIUS VIII, 11, décision n° U-I-359/98 du 30/9/1999, publiée dans le J.O. de la RS, n° 89/99, OdIUS VIII, 216). L’arrêt de la procédure peut aussi être la conséquence du retrait d’un recours constitutionnel (résolution n° Up-93/95 du 7/3/1996, publiée OdIUS V, 60; et suivantes). Si l’auteur du recours constitutionnel transforme son recours en pétition pour contrôle de la constitutionnalité de dispositions légales, la procédure du recours constitutionnel est stoppée (résolution n° Up-61/96 du 23/4/1996, publiée dans le recueil électronique des données de la Cour constitutionnelle).
I-2. – Actes contrôlés
La Cour constitutionnelle est la juridiction suprême en matière de protection de la constitutionnalité, de la légalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 1 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
I-2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé
loi = zakon
règlement = poslovnik
acte réglementaire = podzakonski akt
règlement de collectivité locale = predpis lokalne skupnosti
acte général adopté par un organe habilité = splosˇni akt za izvrsˇevanje javnih pooblastil
le conflit de compétence = spor o pristojnosti
acte individuel (jugement, décision administrative, etc.) = posamisˇni akt (sodna odlocˇba, upravna odlocˇba itd.)

I 3. – Les délais
La Loi sur la Cour constitutionnelle fixe les délai pour les saisines suivantes :
recours constitutionnel (violation des droits de l’homme) ;
requête (conflits de compétences) ;
recours (électoral) = pritozˇba.
Un recours constitutionnel doit être formé dans les 60 jours de la notification de l’acte individuel contre lequel ce recours est autorisé (art. 52(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Une requête de la décision sur des conflits de compétences entre les tribunaux et autres organes de l’État ou entre l’Assemblée nationale, le président de la République et le gouvernement, peut être présentée par un des organes concernés dans les 90 jours suivant la date à laquelle ce dernier a eu connaissance de l’atteinte portée à sa compétence par un autre organe (art. 61(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Tout candidat ou représentant d’une liste de candidats qui, en vertu de la loi sur les élections à l’Assemblée nationale, a intenté un recours devant l’Assemblée nationale contre une décision du comité électoral pouvant influer sur l’homologation de l’élection d’un député, a le droit de saisir la Cour constitutionnelle de la décision adoptée à cet égard (art. 69(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). Le recours doit être formé dans les huit jours de la décision de l’Assemblée nationale (art. 69(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Les autres recours :
- requête ;
- pétition ;
- mise en accusation ;
- proposition ;
- sont recevables sans délai.
I 3.2. – Tableau des conditions de délais

II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives à l’auteur de la saisine
II 1.1. – L’auteur de la saisine doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Dans les procédures devant la Cour constitutionnelle, chaque partie supporte ses propres dépenses, à moins que la Cour n’en décide autrement (art. 34(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Lorsque l’audience doit être repoussée parce qu’une partie n’apporte pas les informations nécessaires à la Cour constitutionnelle, en raison de son absence injustifiée, de l’insuffisance de sa préparation ou de tout autre motif, la Cour peut décider que le renvoi de l’audience est aux frais de la partie (art. 34(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Les pétitionnaires s’acquittent des frais de justice dans les conditions prévues par une loi spéciale (art. 34(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). La loi en question n’a pas été adoptée jusqu’à ce jour.
Les frais de procédure que font valoir les parties et le paiement des frais entraînés à la Cour par la procédure (par ex. experts, interprètes, etc.) sont fixés par la chambre lorsque la procédure se termine par une décision de la chambre ; dans les autres cas, c’est la cour qui fixe les frais (art. 23 du Règlement de la Cour constitutionnelle).
II 1.2. – La représentation de l’auteur de la saisine doit-elle se faire par ministère avocat ?
Dans une procédure engagée devant la Cour constitutionnelle, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire.
Dans le cas où la personne déposant un recours constitutionnel est une personne physique qui n’a pas d’avocat et si la Cour constitutionnelle constate que la représentation est obligatoire, la cour est dans l’obligation d’attribuer à l’auteur du recours constitutionnel un avocat le représentant (art. 20(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Au cours des audiences publiques et des auditions préliminaires relatives au déroulement de chaque acte de procédure devant la Cour constitutionnelle, l’avocat porte la toge réglementaire revêtue pour plaider devant les tribunaux (art. 20(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Dans la procédure devant la Cour constitutionnelle, le mandataire de l’auteur de la saisine doit être autorisé par un mandat spécial (art. 21 du Règlement de la Cour constitutionnelle).
II 1.3. – L’auteur de la saisine doit-il démontrer son intérêt à agir ?
L’auteur de la saisine doit démontrer son intérêt à agir :
Toute personne peut présenter par écrit une pétition visant à l’ouverture de la procédure, pourvu qu’elle justifie d’un intérêt légal (art. 24(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). Il y a intérêt légal à présenter une pétition si l’acte général visé, y compris ceux adoptés pour l’exercice des pouvoirs publics, porte directement atteinte aux droits, aux intérêts légitimes ou à la situation juridique du pétitionnaire (art. 24(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
La preuve de l’intérêt légal est une condition légale pour déposer une pétition [8]. De même, pour déposer un recours constitutionnel comme voie de recours pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’auteur du recours constitutionnel doit démontrer son intérêt légal [9].
II 2. – Conditions relatives aux saisines
II 2.1. – Comment sont numérotées les saisines ?
D’après l’acte fixant le fonctionnement du bureau, les saisines sont numérotées comme suit :
pétition (art. 162(2) de la Constitution, article 24 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : U-I-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année
recours constitutionnel (art. 160, 161 et 162 de la Constitution ; article 50 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : Up-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année
requête (art. 23(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : U-I-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année
requête (art. 23(1/5,6) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : U-I-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année
pétition ou requête concernant les conflits de compétences (art. 61(1/3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : U-II-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année
mise en accusation (art. 109 et 119 de la Constitution ; art. 63(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : Op-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année
pétition ou requête, concernant les activités anticonstitutionnelles des partis politiques (art. 68(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : Ps-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année
recours (électoral) (art. 69(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle ; article 8(1) de la Loi des députés) : Mp-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année
recours (électoral) (art. 50(3) de la Loi sur le Conseil national) : Mp-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année 511
proposition (art. 160(2) de la Constitution ; article 70 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : Rm-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année
requête (art. 91 de la Loi d’autogestion locale ; article 23 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : U-I-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année
requête ou pétition (art. 15 et 16 de la Loi sur le référendum et initiative populaire) : U-I-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année
les saisines adressées à la Cour constitutionnelle qui, selon les règlements en vigueur, ne sont pas de la compétence de la Cour (art. 19 du Règlement de la Cour constitutionnelle) [10] : R-1/99 (par exemple)
1 = numéro consécutif 99 = année
Les requêtes pour l’appréciation de la conformité des lois à la constitution, de la constitutionnalité et de la légalité des règlements ou des actes généraux adoptés par les organes habilités, et les pétitions pour engager une procédure visant à apprécier la conformité des lois à la constitution, de la constitutionnalité et de la légalité des règlements ou des actes généraux adoptés par les organes habilités, ainsi que les recours constitutionnels, autres saisines et écrits, sont reçus au bureau central de la Cour constitutionnelle (art. 13 du Règlement de la Cour constitutionnelle). Le bureau central de la Cour constitutionnelle traite les demandes et autres saisines selon le mode défini dans l’acte fixant le fonctionnement du bureau (art. 14 du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Si plusieurs auteurs de saisines, dans leurs saisines, proposent un contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité des mêmes dispositions ou de dispositions liées quant au fond d’une loi, d’un règlement ou d’un acte général adopté par un organe habilité, la Cour constitutionnelle, sur proposition du juge rapporteur, peut décider, par résolution, de réunir toutes ces saisines pour délibération et prise de décision communes (art. 26 du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Si la saisine contient une proposition de contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité de dispositions de deux ou plusieurs lois, règlements ou actes généraux adoptés par les organes habilités, et qu’il n’est pas nécessaire ou recommandé de les traiter ensemble, la Cour constitutionnelle, sur proposition du juge rapporteur, peut décider de scinder la saisine en vue de délibérations et de prises de décisions distinctes sur leur constitutionnalité ou leur légalité (art. 27 du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Le secrétaire prescrit dans quel type de registre est enregistrée l’affaire objet de la saisine ou de quelque autre écrit (art. 16(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). L’acte fixant le fonctionnement du bureau détermine les différents types de registres, les données qui y sont inscrites et la façon dont ils sont tenus (art. 16(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Le chef du bureau central notifie à l’auteur de la saisine dans quel registre sa saisine a été inscrite et sous quel numéro d’enregistrement elle est traitée (art. 16(3) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Les saisines sont réparties aux juges (juges rapporteurs) selon le programme de travail (art. 17(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Le secrétaire répartit les affaires aux collaborateurs spécialistes de la Cour constitutionnelle (art. 17(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Le secrétaire se charge de régler les saisines adressées à la Cour constitutionnelle qui, selon les règlements en vigueur, ne sont pas de la compétence de la Cour constitutionnelle (art. 19(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Le secrétaire est également chargé de répondre aux plaintes et contestations émises à l’encontre des décisions de la Cour constitutionnelle (art. 19(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
D’après l’acte fixant le fonctionnement du bureau, la date de réception veut dire la date de l’enregistrement concernant la suite des procédures.
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des saisines actuellement en vigueur ?
Le contenu recommandé de chaque saisine se trouve dans les pièces annexes au Règlement de la Cour constitutionnelle (pièce annexe 1) (art. 15(3) du Règlement de la Cour constitutionnelle) :
Contenu de la requête, de la pétition et du recours constitutionnel (suivant l’annexe 1 au Règlement de la Cour constitutionnelle) :
La procédure de contrôle de la constitutionnalité et de la légalité des actes
généraux, y compris ceux adoptés par les organes habilités, est déclenchée par la présentation d’une requête écrite par un requérant (art. 22 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Toute personne peut présenter par écrit une pétition (art. 24 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
La requête, la pétition et le recours constitutionnel doivent contenir :
- le prénom et le nom, l’appellation ou la raison sociale de l’auteur de la saisine ;
- la résidence permanente ou provisoire, ou le siège de l’auteur de la saisine ;
- le prénom et le nom ou la raison sociale et la résidence permanente ou provisoire, ou le siège du représentant de l’auteur de la saisine ou du mandataire ;
- la mention de l’acte général ou individuel contesté dans la saisine et l’organe qui l’a émis ;
- la mention des dispositions de la Constitution ou de la loi censées être violées par l’acte contesté ;
- la mention des arguments selon lesquels l’acte contesté serait non conforme à la Constitution ou à la loi.
Outre le contenu susmentionné, la pétition doit aussi indiquer l’intérêt légal du pétitionnaire et la preuve de son statut lorsque l’auteur de la saisine n’est pas une personne physique.
Le recours constitutionnel doit mentionner l’acte attaqué, les faits soutenant le recours et la nature des droits de l’homme et libertés fondamentales dont la violation est alléguée (art. 53(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). Le recours constitutionnel est présenté par écrit. Il doit contenir une copie de l’acte individuel attaqué et des documents qui l’étayent (art. 53(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). Le recours et les annexes doivent être remis en triple exemplaire (art. 53(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Outre le contenu susmentionné, le recours constitutionnel doit aussi contenir :
- la mention du droit de l’homme ou de la liberté fondamentale censée avoir été violée ;
- la mention indiquant que les voies de recours sont épuisées ;
- si le recours constitutionnel est déposé avant l’épuisement des voies de recours extraordinaires, les faits qui prouvent le caractère manifeste de la violation alléguée et les faits justifiant l’assurance des dommages irréparables qui apparaîtraient pour l’auteur du recours constitutionnel par l’application de l’acte individuel ;
- les circonstances indiquant que la demande de recours constitutionnel est déposée en temps requis, ou les faits justifiant la décision d’un recours constitutionnel déposé après le délai limite pour la présentation du recours.
Si la requête est déposée par l’organe représentatif d’une collectivité locale, elle doit être accompagnée de la résolution de saisine sur laquelle doivent être mentionnées aussi les droits de la collectivité locale censés être menacés.
Si la requête est déposée par le maire au nom de l’organe représentatif de la collectivité locale, elle doit être accompagnée du mandat émanant du conseil de la collectivité locale ou de l’attestation indiquant le mandat général inclus dans les statuts de la collectivité locale.
Si la requête est déposée par un syndicat représentatif de travailleurs au niveau national, elle doit être accompagnée de la preuve de cette représentativité et contenir la mention des droits des travailleurs censés être menacés.
Contenu de la saisine pour décision de compétences (suivant l’annexe 1 au Règlement de la Cour constitutionnelle) :
La saisine pour décision sur un conflit de compétences entre les tribunaux et entre d’autres organes de l’État, et d’un conflit de compétences entre l’Assemblée nationale, le président de la République et le gouvernement, ainsi que pour les conflits quant à la compétence entre l’État et les collectivités locales et entre les collectivités locales entre elles, doit contenir :
- l’appellation et le siège de l’auteur de la saisine ;
- le prénom, le nom et la fonction du représentant de l’auteur de la saisine ;
- l’appellation et le siège de l’organe ou des organes concernés par le conflit ;
- la mention de l’acte général ou individuel cause du conflit ou bien la mention du cas en raison duquel les organes concernés ne peuvent s’accorder sur la compétence ;
- la mention des dispositions des règlements qui fixent la compétence des organes lésés.
Contenu de la mise en accusation (suivant l’annexe 1 au Règlement de la Cour constitutionnelle) :
La résolution sur mise en accusation doit comporter un exposé de la violation de la Constitution ou des graves violations de la loi reprochées, ainsi que des preuves présentées à l’appui de ces allégations (art. 63(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
La mise en accusation du président de la République, du président du gouvernement ou un ministre, doit contenir :
- la mention de la résolution de mise en accusation ;
- la preuve du résultat du vote portant sur la résolution de mise en accusation ;
- le prénom, le nom et l’adresse du mandataire qui représente l’accusation ;
- la description de la violation alléguée de la Constitution ou de la grave violation de la loi ;
- les faits qui justifient la violation et leurs preuves ;
- la proposition de l’auteur de la saisine.
La mise en accusation doit être accompagnée de la résolution de mise en accusation.
Contenu de la requête et de la pétition pour appréciation des actes et des activités des partis politique (suivant l’annexe 1 au Règlement de la Cour constitutionnelle) :
La pétition ou requête doit énoncer les actes contestés ou les circonstances concrètes de l’activité inconstitutionnelle du parti politique en cause (art. 68(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
La pétition et la requête pour appréciation de l’anticonstitutionnalité des actes et des activités d’un parti politique doit contenir :
- le prénom et le nom, l’appellation ou la raison sociale de l’auteur de la saisine ;
- la résidence permanente ou provisoire, ou le siège de l’auteur de la saisine ;
- le prénom et le nom ou la raison sociale et la résidence permanente ou provisoire, ou le siège du représentant de l’auteur de la saisine ou du mandataire ;
- le nom et le siège du parti politique dont l’acte et/ou les activités seraient anticonstitutionnels ;
- la mention de l’acte et/ou des activités du parti politique accusés d’anticonstitutionnalité ;
- la mention des dispositions de la Constitution censées être violées par l’acte ou les activités du parti politique ;
- la mention exacte et définie des faits justifiant l’anticonstitutionnalité et leurs preuves ;
- la proposition de l’auteur de la saisine.
Outre les éléments susmentionnés, la pétition doit comporter aussi la preuve attestant le statut du pétitionnaire quand celui-ci n’est pas une personne physique.
Si la requête est déposée par l’organe représentatif d’une collectivité locale, elle doit être accompagnée de la résolution de présentation de la requête.
Si la requête est déposée par un syndicat représentatif de travailleurs au niveau national, elle doit être accompagnée de la preuve de cette représentativité.
Contenu du recours (électoral) (suivant l’annexe 1 au Règlement de la Cour constitutionnelle) :
Le recours (électoral) déposé contre la décision de l’Assemblée nationale quant à la confirmation du mandat d’un député doit contenir :
- le prénom, le nom et l’adresse permanente ou provisoire de l’auteur du recours (électoral) ;
- le prénom et le nom ou la raison sociale et la résidence permanente ou provisoire, ou le siège de la personne mandatée par l’auteur du recours (électoral) ;
- la preuve que l’auteur du recours (électoral) est autorisé à déposer le recours (électoral) ;
- la preuve que le recours (électoral) est déposé dans les délais requis ;
- la proposition de l’auteur du recours (électoral).
Le recours (électoral) doit être accompagné de la décision de la commission pour les élections, du recours devant l’Assemblée nationale contre la décision de la commission pour les élections et de la décision de l’Assemblée nationale sur la confirmation des mandats des députés.
Contenu de la proposition d’avis de conformité des traités internationaux à la Constitution (suivant l’annexe 1 au Règlement de la Cour constitutionnelle) :
Dans la procédure de ratification d’un traité international, la proposition présentée à la Cour constitutionnelle pour qu’elle émette un avis de conformité à la Constitution doit contenir :
- l’appellation de l’organe ou la mention des prénoms et des noms des députés qui présentent la proposition ;
- la mention du traité international à propos duquel la proposition est présentée ;
- la mention des dispositions de la Constitution avec lesquelles le traité, ou une de ses parties, ne serait pas conforme, et la mention des raisons justifiant cette non conformité.
La proposition doit être accompagnée du traité international dans sa version originale et en langue slovène.
Contenu de la requête ou la pétition pour contrôler la décision de l’Assemblée nationale de ne pas organiser un référendum législatif (suivant l’annexe 1 au Règlement de la Cour constitutionnelle) :
La requête du représentant de l’auteur de la proposition ou de l’initiateur de la demande visant à vérifier la décision de l’Assemblée nationale de ne pas organiser un référendum législatif, prise aux termes du deuxième paragraphe de l’article 15 de la Loi sur le référendum et l’initiative populaire (Journal officiel de la RS n° 15/94 et 38/96) doit contenir :
- le prénom et le nom du représentant de l’auteur de la proposition ou de l’initiateur de la demande ;
- la résidence permanente ou provisoire, ou le siège du représentant de l’auteur de la proposition ou de l’initiateur de la demande ;
- le texte de la demande d’organiser le référendum et son explication ;
- les arguments expliquant pourquoi le requérant estime que la décision de l’Assemblée nationale est infondée.
La requête ou la pétition doit être accompagnée de la décision de l’Assemblée nationale de ne pas organiser un référendum législatif.
Contenu de la requête pour appréciation de la constitutionnalité du contenu de la demande d’organisation d’un référendum législatif (suivant l’annexe 1 au Règlement de la Cour constitutionnelle) :
La requête pour vérifier la constitutionnalité du contenu de la demande d’organisation d’un référendum législatif déposée par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 16 de la Loi sur le référendum et l’initiative populaire (Journal officiel de la RS n° 15/94 et 38/96) doit contenir :
- les données sur l’auteur de la saisine et sur son représentant dans la procédure devant la Cour constitutionnelle ;
- le texte de la demande pour organiser le référendum et son explication ;
- les arguments expliquant pourquoi l’auteur de la saisine estime que le contenu de la demande est contraire à la Constitution ;
- la mention des dispositions constitutionnelles auxquelles le contenu de la demande est présumé s’opposer.
Si l’auteur d’une requête ou d’une pétition ne fournit pas, dans le délai fixé, les informations nécessaires à la poursuite de la procédure, la Cour constitutionnelle peut mettre fin à celle-ci par une résolution (art. 28(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Si un recours constitutionnel est incomplet et que la Cour constitutionnelle ne peut l’examiner parce qu’il ne contient pas toutes les données requises ou les documents, la Cour constitutionnelle invite l’auteur du recours constitutionnel à compléter son dossier dans un délai déterminé (art. 54(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Le juge rapporteur vérifie si la saisine est complète. S’il constate que la saisine ne contient pas tous les éléments nécessaires à son traitement et à la décision devant s’y rapporter, ou s’il constate que la demande n’est pas claire, il le notifie à l’auteur de la saisine et lui demande de la compléter dans un délai déterminé (art. 15(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Dans la notification, le juge rapporteur avise l’auteur de la saisine des conséquences prévues par la Loi sur la Cour constitutionnelle dans le cas où il ne complète pas sa saisine dans le délai requis (art. 15(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
II 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
II 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
La Cour constitutionnelle rejette (en séance plénière) toute requête ou pétition si les conditions de procédure des articles 21, 23 et 24 de la présente loi ne sont pas remplies (la Cour constitutionnelle rejette la pétition, conformément à l’article 25 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
La Cour constitutionnelle rejette la pétition, conformément à l’article 25 de la Loi sur la Cour constitutionnelle :
- quand le pétitionnaire ne peut justifier d’un intérêt légal (art. 24 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- quand il ne s’agit pas d’un acte général (art. 21 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ;
- si les dispositions contestées ont déjà été annulées par décision de la Cour constitutionnelle ou si leur inconstitutionnalité a été constatée et qu’il n’existe pas de nouvelles raisons dictant un nouveau jugement ;
- si l’auteur de la saisine n’est pas habilité à saisir la Cour au nom d’un organe de l’État (art. 23 (1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) et s’il ne remplit pas non plus les conditions pour se présenter comme pétitionnaire.
La Cour constitutionnelle rejette (en séance plénière) un recours constitutionnel (art. 55(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) si :
- le recours constitutionnel a été introduit trop tard, sauf dans les cas visés à l’article 52(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle [11] ;
- toutes les voies de recours n’ont pas été épuisées, sauf dans le cas visé à l’article 51(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle [12] ;
- le recours a été introduit par une personne non habilitée à le faire ;
- le recours n’a pas été complété dans les délais sans motif valable dans les cas visés à l’article 54(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle [13]. La chambre de la Cour constitutionnelle [14] décide du rejet du recours constitutionnel à l’unanimité. Sa résolution n’est susceptible d’aucun appel (art. 55(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) [15].
La Cour constitutionnelle, ou la chambre, se prononce sur l’affaire objet de la procédure lors d’une séance, sur la base du rapport présenté à la Cour constitutionnelle ou à la chambre par le juge rapporteur, ou par tout autre juge (art. 25(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Le rapport mentionné inclut aussi soit la proposition de convoquer une audience publique, soit la proposition d’une audience à huis clos totale ou partielle. Si la cour statue sur le cas pendant l’audience, le rapport contient aussi en règle générale le projet de décision sur l’affaire (art. 25(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Dans les affaires plus simples, le projet de décision peut être présenté sans rapport spécial (art. 25(3) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
L’irrecevabilité est prononcée par la résolution qui doit être motivée (art. 26(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle ; art. 43 du Règlement de la Cour constitutionnelle) et doit être publiée dans le Recueil des décisions et arrêts de la Cour constitutionnelle, sur CD-Rom et dans les banques de données (en ligne, sur Internet) (art. 46(4) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
II 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
L’abus du droit d’agir n’est pas réglé par la Loi sur la Cour constitutionnelle. Pourtant, lorsque l’audience doit être repoussée parce qu’une partie n’apporte pas les informations nécessaires à la Cour constitutionnelle, en raison de son absence injustifiée, de l’insuffisance de sa préparation ou de tout autre motif, la Cour peut décider que le renvoi de l’audience est aux frais de la partie (art. 34(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Les motifs principaux d’irrecevabilité classés par type de normes contrôlées et donnés en nombre et en proportion sont indiqués ci-après :

III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
A) Forme écrite
La Cour constitutionnelle adresse à l’organe auteur de l’acte général ou de l’acte général adopté par l’organe habilité (partie adverse) copie de la requête ou de la pétition, y compris une copie de la résolution sur l’acceptation de la pétition, et fixe un délai raisonnable pour la réplique ou une réplique additionnelle si une réplique a été présentée lors de la procédure d’examen de la pétition (art. 28(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Après avoir été accepté, le recours constitutionnel est adressé à l’organe ayant adopté l’acte individuel contre lequel le recours est formé, pour lui permettre de répondre dans un délai déterminé (art. 56 de la Loi sur la Cour constitutionnelle). Par l’application mutatis mutandis de l’article 56 de la Loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle envoie le recours constitutionnel à chaque partie lésée dans la procédure concrète de recours constitutionnel d’affaires civiles ou d’affaires administratives, laquelle est personne physique ou morale, et l’invite à se prononcer.
La Cour constitutionnelle transmet la résolution portant mise en accusation du président de la République qui a le droit de présenter ses observations (art. 64(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
B) Forme orale
La Cour constitutionnelle connaît d’une affaire à huis clos ou en audience publique. La majorité de tous les juges doit être présente à la session à huis clos (art. 35(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Le président de la Cour constitutionnelle peut déclarer qu’il y aura une audience publique, d’office ou à l’initiative des parties à la procédure. Le président doit se prononcer en faveur de l’audience publique si trois juges en font la demande (art. 35(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Les parties, représentants et mandataires des parties à la procédure, ainsi que toute personne dont la Cour constitutionnelle estime la présence nécessaire, sont invités à assister à l’audience publique (art. 36(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
L’absence à l’audience des parties et autres personnes invitées n’empêche pas la Cour constitutionnelle de poursuivre la procédure et de trancher l’affaire (art. 36(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
La Cour peut exclure de l’audience tout ou partie du public pour des motifs tenant à la protection de la moralité publique, de l’ordre public, de la sûreté nationale, du droit au respect de la vie privée et des droits de la personne (art. 37 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
La Cour constitutionnelle se prononce sur l’exclusion du public de l’audience au moyen d’une résolution motivée (art. 38(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). Cette résolution n’est pas susceptible de recours (art. 38(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
L’audience publique est annoncée officiellement par le président de la Cour constitutionnelle (art. 28(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Les parties concernées par la procédure sont invitées à l’audience par une convocation écrite de façon à ce qu’elle soit reçue en règle générale huit jours avant la date de l’audience. Dans des cas spéciaux, le président de la Cour constitutionnelle peut fixer un délai plus court (art. 28(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
La convocation est accompagnée d’une copie de la saisine, d’une copie de la réponse à la saisine et d’autres pièces annexes nécessaires si ces documents n’ont pas été déjà envoyés à la partie convoquée pendant la procédure d’instruction (art. 28(3) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Outre les parties concernées par la procédure, la Cour constitutionnelle peut décider de convoquer à l’audience publique d’autres personnes susceptibles de contribuer au règlement de l’affaire objet de la procédure. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle décide également quelles parties du dossier sont annexées à la convocation adressée à ces personnes (art. 28(4) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Au début de l’audience, le président de la Cour constitutionnelle informe les personnes présentes de l’affaire objet de l’audience et constate la présence des personnes convoquées. Il rappelle aux personnes présentes qu’elles doivent limiter leurs déclarations aux points non mentionnés dans leur saisine et encore inconnus de la cour (art. 29(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Le président de la Cour constitutionnelle annonce au début de l’audience si celle-ci ou une partie de celle-ci se déroulera à huis clos, ou, au début de la partie qui se déroule à huis clos (art. 29(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Dans des cas justifiés, particulièrement lorsqu’il est nécessaire de démontrer des preuves, la Cour constitutionnelle peut ajourner l’audience et fixer un nouveau terme ; elle peut également suspendre l’audience (art. 29(3) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
L’ordre est maintenu durant l’audience publique par l’application mutatis mutandis des dispositions réglant les procès civils – la loi sur les procès civils, Journal officiel de la RS, n° 26/99, (art. 29(4) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
La délibération et le vote sur la décision de l’affaire objet de l’audience publique s’effectuent à huis clos. Seuls votent les juges qui étaient présents à l’audience publique (art. 30 du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Lorsque la décision est prononcée oralement, le président de la Cour constitutionnelle prononce la sentence, et le juge rapporteur, en règle générale, cite les principaux motifs de la décision adoptée (art. 31(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). La sentence de la décision prononcée oralement est toujours publique (art. 31(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
III 2. – Égalité des armes
Les personnes participant à la procédure ont le droit d’obtenir communication des documents relatifs à leur affaire à n’importe quel moment de la procédure, tandis que d’autres personnes peuvent exercer ce droit avec l’autorisation du président de la Cour constitutionnelle (art. 4(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). Si un tel examen est refusé, une objection peut être formée dans les trois jours de la notification de ce refus. La Cour constitutionnelle se prononce à huis clos sur l’objection (art. 4(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
Les parties concernées par la procédure ont le droit d’examiner le dossier. Les personnes qui ne sont pas parties de la procédure et démontrent leur intérêt juridique peuvent prendre connaissance du dossier seulement avec l’autorisation écrite du président de la Cour constitutionnelle, ou du juge rapporteur durant la procédure d’instruction (art. 24(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Le droit d’examen d’un dossier ne peut se rapporter à la partie interne du dossier qui comprend les projets de rapports, de décisions et de résolutions, le procès-verbal de la délibération et du vote, les pièces jointes aux demandes, si elles sont désignées comme étant d’intérêt économique, officiel ou de toute autre nature confidentielle, ni aux pièces contenant des données personnelles ou des données sur les membres de la famille ou les autres relations personnelles d’un individu (art. 24(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
L’examen doit s’effectuer au bureau principal, pendant les heures d’ouverture des bureaux et sous la surveillance du chef du bureau principal ou de l’agent qui le remplace (art. 24(3) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Un registre spécial est tenu sur l’examen des dossiers. Le contenu de ce registre est spécifié par l’acte fixant le fonctionnement du bureau (art. 24(4) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Le droit d’examen du dossier comprend aussi celui de reproduire certaines parties du dossier, la personne concernée par la procédure peut également recevoir un extrait recopié par courrier (art. 24(5) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
III 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
La Cour constitutionnelle peut obtenir les explications qui s’imposent de la part des parties à la procédure, des organes étatiques, des autorités locales et des entreprises publiques ; elle peut réclamer des expertises à des spécialistes, à des organisations professionnelles ou autres, interroger des témoins et des experts, faire des constats judiciaires et recueillir des preuves particulières auprès d’autres tribunaux ou autres organes (art. 28(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
III 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
Concernant la question « le juge peut-il se saisir d’office » voir chapitre I-1.3.
Les requérants ont la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge : voir chapitre III-1.
III 3. – Délai de jugement
La réglementation slovène n’oblige pas la Cour constitutionnelle à émettre sa décision dans un délai déterminé.
Le Règlement de la Cour constitutionnelle ne fixe que des délais pour la rédaction des textes définitifs de catégories individuelles de décisions de contrôle constitutionnel [16].
III 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
En pratique, la durée moyenne des procédures engagées devant la Cour constitutionnelle a été ces quelques dernières années de :
Affaires U-[17] : 13,8 mois par affaire
Affaires Up-[18] : 19,4 mois par affaire
Affaires R-[19] : 3 mois par affaire
- Durée moyenne de la procédure devant la Cour constitutionnelle pour les affaires U et Up ensemble : 16,87 mois par affaire ;
- Durée moyenne de la procédure devant la Cour constitutionnelle pour les affaires U, Up et R ensemble : 13,4 mois par affaire.
Cependant, le Règlement de la Cour constitutionnelle détermine un ordre de priorité pour le traitement des affaires qui lui sont soumises :
La Cour constitutionnelle traite généralement les affaires suivant l’ordre de réception des saisines, à l’exception des cas suivants (art. 52 du Règlement de la Cour constitutionnelle – ordre de traitement des affaires) :
- s’il s’agit d’affaires simples pouvant être traitées et réglées dès la phase d’examen ou dès la phase d’instruction ;
- si la longueur et la complexité de la procédure d’instruction ou de la procédure d’examen d’une affaire individuelle rendent impossible son traitement et son règlement par ordre de réception ;
- s’il s’agit d’affaires pour lesquelles les règlements appliqués aux termes de l’article 6 de la Loi sur la Cour constitutionnelle stipulent que la cour doit les traiter et prononcer un jugement rapidement ;
- si la Loi sur la Cour constitutionnelle ou quelque autre règlement fixe le délai dans lequel la Cour constitutionnelle doit traiter et prononcer un jugement sur l’affaire ;
- s’il s’agit de décisions concernant des conflits de compétences ;
- s’il s’agit du règlement d’une importante question judiciaire ou dans d’autres cas, quand la cour en décide ainsi.
Conclusion
À part les organes de l’État qui, en tant qu’auteurs de saisine devant la Cour constitutionnelle, sont immanents en général à tous les systèmes modernes de justice constitutionnelle, il convient de souligner en particulier la position de tout individu qui peut aussi saisir la Cour constitutionnelle slovène. En effet, avec la Constitution de 1963 et l’introduction de la justice constitutionnelle, la Cour constitutionnelle slovène d’alors est devenue compétente aussi en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle était censée statuer sur la protection du droit de l’autogestion et autres droits de l’homme et libertés fondamentales déterminés par la Constitution fédérale d’alors et celle de la République, si ces droits étaient violés par quelque acte individuel ou exécution d’un organe de l’État, d’une commune ou d’une entreprise et que la protection judiciaire n’était pas assurée d’une autre manière. Dans une telle procédure, au cas où la violation était constatée, la décision de la Cour constitutionnelle avait un effet d’annulation (abrogation ou annulation ou révision d’un acte individuel et annulation des conséquences éventuelles ; interdiction d’en poursuivre l’exécution). La compétence de la Cour constitutionnelle était subsidiaire. Une procédure pouvait donc être entamée devant la Cour constitutionnelle seulement si dans un cas concret, la protection judiciaire n’était pas prévue et si toutes les autres voies de recours avaient été épuisées.
Cependant, dans la pratique, la Cour constitutionnelle d’alors rejetait pour non compétence de telles demandes présentées par des individus et dirigeait ceux-ci vers la procédure des tribunaux ordinaires. Une telle situation provoquait également un certain flottement de la Cour constitutionnelle elle-même, car elle savait d’avance qu’elle rejetterait une telle demande et qu’elle effectuait donc un travail vain. La Cour constitutionnelle d’alors se limitait à attirer l’attention sur le fait qu’en ce qui concernait les actes individuels, la solution la plus appropriée était de transférer en totalité à la justice ordinaire les décisions s’y rapportant. La définition négative de la compétence de la Cour constitutionnelle (lorsqu’il n’y a pas assurance d’une autre protection judiciaire) a montré que précisément dans ce domaine, son activité n’a pas donné de résultats, bien que cette activité ait été entamée justement pour répondre aux demandes de protection des droits. Pourtant, ce système de justice constitutionnelle assurait entièrement à l’individu la possibilité de déposer une pétition, sans que l’auteur de la saisine ne soit obligé de démontrer son intérêt légal.
Depuis lors et plus tard, le recours constitutionnel n’a plus trouvé sa place dans le système, tant qu’il ne fut de nouveau introduit avec la Constitution de 1991. Selon la nouvelle organisation, cette voie de recours spécifique est restée combinée avec l’organisation précédente, c’est-à-dire, avec la possibilité de déposer une pétition devant la Cour constitutionnelle (bien que selon la nouvelle organisation, l’individu, en tant que pétitionnaire, doive prouver son intérêt légal – ce qui a sens de supposition procédurale limitative). L’individu peut donc, en tant qu’auteur de la saisine d’un recours constitutionnel ou d’une pétition, contester toutes les catégories d’actes (généraux). Ainsi, les portes de la Cour constitutionnelle sont grandes ouvertes aussi à tout individu auteur d’une saisine.
-
[1]
Dans le système slovène les mots saisine et auteur de la saisine sont considérés comme les termes généraux pour le système de contrôle a posteriori. [Retour au contenu] -
[2]
Dans ce rapport, le terme requête est employé pour les catégories de saisines mentionnées dans l’article 22 de la Loi sur la Cour constitutionnelle. Une requête peut être présentée par :l’Assemblée nationale ;
un tiers au moins des députés de l’Assemblée nationale ;
le Conseil national ;
le gouvernement ;
un tribunal (ordinaire), le procureur de la République, la Banque de Slovénie, la Cour des comptes, lorsque la question de la constitutionnalité ou de la légalité est soulevée au cours d’un litige
dont ils sont saisis ;
le médiateur en matière de droits de l’homme, pour les cas individuels qui lui sont soumis ;
les organes représentatifs des collectivités locales si leurs droits sont menacés ;
les représentants des syndicats au niveau national si les droits des travailleurs sont menacés (art. 22(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).Les requérants cités au paragraphe précédent ne peuvent demander l’ouverture d’une procédure de contrôle des règlements qu’ils ont eux-mêmes adoptés (art. 22(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). [Retour au contenu]
-
[3]
Contrôle abstrait ; pétition déposée par les citoyens par laquelle une loi, un règlement ou un acte général est contesté par toute personne en mesure de prouver son intérêt juridique (art. 162(2) de la Constitution, article 24 de la Loi sur la Cour constitutionnelle). [Retour au contenu] -
[4]
Recours constitutionnel, par lequel l’auteur du recours constitutionnel conteste un acte individuel d’un organe de l’État, qui aurait porté atteinte à ses droits de l’homme ou libertés fondamentales (art. 160, 161 et 162 de la Constitution ; article 50 de la Loi sur la Cour constitutionnelle). [Retour au contenu] -
[5]
Procédure constatant la responsabilité du président de la République, du premier ministre ou des ministres. [Retour au contenu] -
[6]
Les recours (électoraux) interjetés contre des décisions de l’Assemblée nationale relatives à la vérification des mandats des députés (art. 82(3) de la Constitution ; art. 69 de la Loi sur la Cour constitutionnelle ; art. 8(1) de la Loi des députés, Journal officiel de la RS, n° 48/92) ; les recours (électoraux) interjetés contre des décisions du Conseil national relatives à la vérification des mandats des membres du Conseil national (art. 50(3) de la Loi sur le Conseil national, Journal officiel de la RS, n° 44/92). [Retour au contenu] -
[7]
Lors d’une procédure de ratification d’un traité international, la Cour émet un avis sur sa conformité avec la Constitution (art. 160(2) de la Constitution ; art. 21(2) et art. 70 de la Loi sur la Cour constitutionnelle). L’Assemblée nationale est liée par l’avis de la Cour constitutionnelle. [Retour au contenu] -
[8]
– pétition déposée par les citoyens : toute personne en mesure de prouver son intérêt juridique (art. 162(2) de la Constitution, article 24 de la Loi sur la Cour constitutionnelle),
conflits de compétences : pétition déposée par les citoyens (art. 61(1/3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle),
activités anticonstitutionnelles des partis politiques : pétition, citoyens (art. 68(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle),
– pétition, de constitutionnalité et légalité de la demande de convocation du référendum (art. 15 et 16 de la Loi de référendum et initiative populaire, Journal officiel de la RS, n° 15/94 et 13/95). [Retour au contenu] -
[9]
Recours constitutionnel (art. 160, 161 et 162 de la Constitution ; article 50 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : résolution n° Up-60/94 du 25/3-1997, publiée dans le recueil électronique des données de la Cour constitutionnelle ; voir aussi résolution n° Up-130/97 du 13/5-1997, publiée dans le recueil électronique des données de la Cour constitutionnelle). Dans le cas où le droit de l’auteur du recours a déjà été acquis aux termes de la loi, c’est-àdire ce qu’il voulait obtenir par le recours constitutionnel, la décision sur le recours constitutionnel ne modifierait pas sa situation juridique ; pour cela, l’auteur du recours n’a plus d’intérêt légal quant à la décision le concernant et la Cour constitutionnelle rejette le recours constitutionnel (résolution n° Up-219/96 du 18-12-1997, publiée dans le recueil électronique des données de la Cour constitutionnelle ; résolution n° Up-262/96 du 12-12-1997, publiée dans le recueil électronique de base de données de la Cour constitutionnelle ; résolution n° Up-266/97 du 6-7-1999, publiée dans le recueil électronique des données de la Cour constitutionnelle). Si l’auteur du recours constitutionnel, dans un délai fixé par la Cour constitutionnelle, ne répond pas qu’il maintient son intérêt pour la décision se rapportant au recours constitutionnel, la Cour constitutionnelle met fin à la procédure de prise de décision du recours constitutionnel (résolution n° Up-155/97 du 14-1-1999, publiée dans le recueil électronique des données de la Cour constitutionnelle ; résolution n° Up-201/97 du 7-7-1999, publiée dans le recueil électronique des données de la Cour constitutionnelle. [Retour au contenu] -
[10]
Article 19 du Règlement de la Cour constitutionnelle : règlement des demandes hors procédure :
Le secrétaire se charge de régler les saisines adressées à la Cour constitutionnelle qui, selon les règlements en vigueur, ne sont pas de la compétence de la Cour constitutionnelle.
Le secrétaire est également chargé de répondre aux plaintes et contestations émises à l’encontre des décisions de la Cour constitutionnelle. [Retour au contenu] -
[11]
À titre exceptionnel, dans des cas particulièrement justifiés, la Cour constitutionnelle peut statuer sur un recours constitutionnel formé après l’expiration du délai mentionné au premier paragraphe du présent article (art. 52(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). [Retour au contenu] -
[12]
À titre exceptionnel, la Cour constitutionnelle peut se prononcer sur un recours constitutionnel avant l’épuisement de toutes les voies de recours extraordinaires si la violation alléguée est manifeste et que l’application d’un acte individuel risquerait de causer au requérant des dommages irréparables (art. 51(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). [Retour au contenu] -
[13]
Si un recours constitutionnel est incomplet et que la Cour constitutionnelle ne peut l’examiner parce qu’il ne contient pas toutes les données requises ou les documents mentionnés à l’article précédent de la présente loi, la Cour constitutionnelle invite le requérant à compléter son dossier dans un délai déterminé (art. 54(2) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). [Retour au contenu] -
[14]
La Cour constitutionnelle comprend trois chambres de trois membres chacune pour l’examen des recours constitutionnels, à savoir, pour les recours constitutionnels d’affaires se rapportant aux domaines du droit pénal, du droit civil et du droit administratif. La division du travail est décidée par la Cour constitutionnelle qui répartit le travail entre les chambres (art. 4(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). [Retour au contenu] -
[15]
Au cas où la chambre n’aurait pas accepté un recours constitutionnel, il peut cependant être accepté si telle est la décision écrite d’un groupe de trois juges de la Cour constitutionnelle dans les 15 jours de la décision de la chambre (art. 55(4) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). [Retour au contenu] -
[16]
Si l’affaire a été débattue en audience publique mais que la cour ne s’est pas immédiatement prononcée à son sujet, le projet de décision ou de résolution doit être soumis au président et aux juges cinq jours au moins avant le jour pour lequel est fixée la convocation de la délibération et du vote (art. 42(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).Le texte définitif de la décision et de la résolution, à l’exception de la résolution d’une chambre, est rédigé par la Commission de rédaction au plus tard dans les sept jours suivant le jour de son adoption (art. 44(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle). Le texte définitif de la résolution d’une chambre est rédigé par le président de la chambre dans les sept jours (art. 44(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
En cas de désaccord quant à la décision ou aux motifs, un juge de la Cour constitutionnelle peut émettre une opinion dissidente ou concordante, qu’il doit présenter dans un délai fixé par le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle (art. 40(3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
L’avis séparé doit en règle générale être préparé dans un délai de sept jours après réception par le juge du texte de la décision prise par la Commission de rédaction, attestée et signée par le secrétaire, à moins que la cour, à la demande d’un juge et à la majorité des voix des juges présents, n’en décide autrement. Pendant la période où la cour ne siège pas, le délai réglementaire pour présenter l’avis séparé est suspendu (art. 49(1) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
La Cour constitutionnelle peut décider que le délai pour la préparation de l’avis séparé peut être plus court ou plus long que sept jours, si la nature de la chose jugée l’exige. La cour se prononce sur la prolongation ou le raccourcissement du délai immédiatement après le vote final (art. 49(2) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
L’avis séparé est transmis aux autres juges qui peuvent émettre des observations à son égard dans un délai de trois jours. Le juge auteur de l’avis séparé dispose de trois jours pour répondre aux observations (art. 49(3) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Au cas où l’avis séparé n’est pas préparé dans le délai visé au premier et au deuxième paragraphe, la décision ou la résolution est adressée aux parties sans cet avis, et, à la demande du juge qui a préparé l’avis séparé, cet avis leur est transmis ultérieurement (art. 49(4) du Règlement de la Cour constitutionnelle).
Au cas où la chambre n’aurait pas accepté un recours constitutionnel, il peut cependant être accepté si telle est la résolution écrite d’un groupe de trois juges de la Cour constitutionnelle dans les 15 jours de la résolution de la chambre (art. 55(4) de la Loi sur la Cour constitutionnelle). [Retour au contenu]
-
[17]
– pétition (art. 162(2) de la Constitution, art. 24 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : U-I-1/99 (par exemple) 1 = numéro consécutif 99 = année
requête (art. 23(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : U-I-1/99 (par exemple) 1 = numéro consécutif 99 = année
requête (art. 23(1/5,6) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : U-I-1/99 (par exemple) 1 = numéro consécutif 99 = année
pétition ou requête concernant les conflits de compétences (art. 61(1/3) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : U-II-1/99 (par exemple) 1 = numéro consécutif 99 = année
requête (art. 91 de la Loi d’autogestion locale ; art. 23 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : U-I-1/99 (par exemple) 1 = numéro consécutif 99 = année
requête ou pétition (art. 15 et 16 de la Loi sur le référendum et initiative populaire) : U-I-1/99 (par exemple) 1 = numéro consécutif 99 = année [Retour au contenu] -
[18]
– recours constitutionnel (art. 160, 161 et 162 de la Constitution ; article 50 de la Loi sur la Cour constitutionnelle) : Up-1/99 (par exemple) 1 = numéro consécutif 99 = année [Retour au contenu] -
[19]
– Les saisines adressées à la Cour constitutionnelle qui, selon les règlements en vigueur, ne sont pas de la compétence de la Cour constitutionnelle (art. 19 du Règlement de la Cour constitutionnelle) : R-1/99 (par exemple) 1 = numéro consécutif 99 = année [Retour au contenu]
Rapport du tribunal fédéral Suisse
Mars 2000
Rapport établi par Dominique Favre,
juge fédéral, Tribunal fédéral suisse.
I. L’ouverture du droit de saisine
Il n’est pas possible au constitutionnaliste suisse de répondre aux questions réunies sous cette rubrique, sans exposer le système de sa juridiction constitutionnelle nationale, qui diverge notablement des solutions retenues dans les autres pays, en particulier en Europe. La Suisse ne connaît pas un corps judiciaire suprême, qui serait exactement l’équivalent du Conseil constitutionnel français ou des Cours constitutionnelles allemande ou italienne. Le Tribunal fédéral, que l’art. 188 al. 1 Cst. décrit comme étant l’autorité judiciaire suprême de la Confédération suisse est en quelque sorte à la fois le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État, la Cour de Cassation et le Tribunal des conflits, pour tenter d’établir une comparaison avec le système judiciaire français, mais sans posséder toutes les compétences et attributions de chacun de ces organes. La différence majeure réside en ce que le Tribunal fédéral ne dispose pas du pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois fédérales de la Confédération, sous aucune forme (ni a priori, ni a posteriori, ni abstrait, ni concret), sauf lorsqu’une telle compétence découle d’un traité international entré en vigueur pour la Suisse ; dans ce cas, le Tribunal fédéral peut contrôler la constitutionnalité des lois fédérales et leur conformité au droit conventionnel, ce qui est essentiellement le cas de tous les droits fondamentaux imprescriptibles et inaliénables garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, entrée en vigueur pour la Suisse en 1974.
Ainsi, la suprématie du législateur, soit le Parlement fédéral et le corps électoral suisse, par le biais de la démocratie semi-directe référendaire (référendum obligatoire ou facultatif, art. 140 et 141 Cst.), est affirmée au détriment d’un système de contrôle de la constitutionnalité des lois et/ou actes législatifs fédéraux, contrairement à l’évolution générale en la matière. Par contre, le Tribunal fédéral exerce un contrôle complet de la constitutionnalité des lois des États membres de la Confédération (cantons), aussi bien par voie d’action (contrôle abstrait) que par voie d’exception (contrôle concret) par rapport au droit supérieur, soit conventionnel, soit constitutionnel fédéral et cantonal. En effet, chaque canton dispose lui-même d’une constitution ; toutefois, ces constitutions cantonales ont perdu peu à peu leur importance en raison de la protection des droits fondamentaux accordée par la Constitution fédérale et par le Tribunal fédéral, qui a développé dans sa jurisprudence des droits constitutionnels non écrits (par exemple la liberté personnelle, la liberté syndicale), aujourd’hui codifiés dans la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000.
Le Tribunal fédéral est composé de 30 juges fédéraux, dont 19 de langue allemande, 9 de langue française et 2 de langue italienne. Cette répartition linguistique est fonction du nombre de procédures instruites dans ces trois langues sur le territoire de la Confédération suisse et fait l’objet de l’art. 188 al. 4 Cst., aux termes duquel le Parlement fédéral, qui élit les juges fédéraux, doit veiller à ce que les langues officielles soient représentées. De plus, actuellement, l’un des juges germanophones est bilingue allemand-romanche, soit la quatrième langue nationale de la Suisse, un parlé rhéto-roman ou ladin pratiqué au sud-est de la Suisse. Ces trente magistrats sont répartis en deux Cours de droit public, deux Cours civiles, une Cour de Cassation pénale, une Chambre d’accusation et une Chambre des poursuites pour dettes et faillites. L’art. 189 Cst. définit les compétences de la « juridiction constitutionnelle », à savoir :
a) des réclamations pour violation de droits constitutionnels ;
b) des réclamations pour violation de l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public ;
c) des réclamations pour violation de traités internationaux ou de conventions intercantonales ;
d) des différends de droit public entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
L’énoncé des compétences des deux Cours de droit public figure ainsi dans la Constitution, alors que l’art. 190 Cst., consacré à la juridiction civile, pénale et administrative, institue une délégation législative pour régler la compétence du Tribunal fédéral dans ces domaines. Les deux Cours de droit public traitent donc d’une part de la juridiction constitutionnelle (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2000, p. 641 ss) et d’autre part de la juridiction administrative de la Confédération ; elles comptent en tout 13 juges, soit respectivement 7 et 6 membres, le Tribunal fédéral siégeant dans une composition de 7 membres pour l’examen de la constitutionnalité d’une loi cantonale ou de la recevabilité d’une initiative populaire, c’est-à-dire dans toutes les hypothèses où la décision judiciaire est susceptible de censurer un acte entrant dans la compétence du corps électoral cantonal.
Ces remarques liminaires montrent la difficulté pour le rapporteur suisse d’entrer dans le schéma en trois sections prévu par le secrétariat de l’ACCPUF. Toutefois, comme le contentieux issu de décisions de justice, ou d’autorités administratives prises en application d’une loi cantonale entre également dans le sujet, soit le contrôle indirect ou concret de la constitutionnalité de ces actes judiciaires ou administratifs, il est possible de répondre en détail aux sections 2 (recevabilité de la saisine) et 3 (traitement de la saisine recevable) du questionnaire. Par contre, pour le chapitre 1er, consacré à l’ouverture du droit de saisine, les différences sont telles qu’il n’est guère possible de fournir des explications comparables avec les autres systèmes de tribunaux constitutionnels, et qu’il n’est en particulier pas concevable de s’appuyer sur les tableaux suggérés en pages 3 et 4 du questionnaire.
Il est toutefois important de signaler qu’en 1996, le gouvernement fédéral a voulu proposer, dans la réforme constitutionnelle qui a débouché sur l’adoption de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999, un système concentré prévoyant un contrôle des lois cantonales et surtout fédérales, répressif (a posteriori), concret et avec limitation des motifs de recours. Selon ce projet, les particuliers auraient pu soulever des griefs bien définis, en violation de leurs droits constitutionnels ou du droit international, dont la primauté est en principe garantie dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 125 II 417 consid. 4c p. 424/425). La nouveauté résidait dans la censure éventuelle d’une loi fédérale par voie d’exception. De plus, et c’était également une innovation, les cantons auraient pu demander au Tribunal fédéral d’examiner si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale (loi matérielle) violait des compétences cantonales garanties par la Constitution. Le gouvernement avait exclu le contrôle abstrait des normes pour éviter que le Tribunal fédéral ne joue un rôle d’arbitre entre la Confédération et les cantons, et pour ne pas heurter les droits du peuple dans une démocratie référendaire (Walter Kälin, L’accès à la juridiction constitutionnelle du Tribunal fédéral, in : Réforme de la justice, Lausanne 1998, p. 315, 320/321).
Toutefois, cette forme modérée de contrôle de la constitutionnalité par le Tribunal fédéral a été refusée en 1999 par le Parlement, de sorte que la juridiction constitutionnelle suisse ne concerne que le contrôle de la législation des États membres cantonaux, sous réserve de l’application des traités internationaux qui élargissent cette compétence à certains aspects du droit fédéral (en l’état, il s’agit essentiellement de la Convention européenne des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).
II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives au requérant
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Sous réserve des cas où la procédure est gratuite (art. 154 al. 1 de la Loi fédérale d’organisation judiciaire, du 16 décembre 1943 [OJ]), quiconque sai-
sit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, dans le délai imparti à cet effet, sous peine d’irrecevabilité (art. 150 al. 1 et 4 OJ). Le tribunal dispense, sur demande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, de payer les frais judiciaires ainsi que de fournir des sûretés pour les dépens (art. 152 al. 1 OJ). La décision est prise par la section compétente du tribunal, et non pas par son président ou le seul juge rapporteur, dans le cadre de la décision au fond ou par une décision préalable à celle-ci. Le montant de l’avance de frais oscille entre 200 et 5 000 francs pour les recours de droit public portant sur des affaires non pécuniaires (art. 153a al. 2 OJ). La loi ne pose aucune condition de nationalité ou de domicile en Suisse pour bénéficier de l’assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. L’art. 152 OJ est applicable en principe à toutes les procédures prévues par la Loi d’organisation judiciaire ; en raison des particularités de la procédure de contrôle abstrait des normes, il est généralement exclu d’accorder au recourant la dispense des frais judiciaires (ATF 121 I 314 consid. 3 et 4b).
II 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
Le justiciable qui n’est pas manifestement hors d’état de procéder luimême (cf. art. 29 al. 5 OJ) peut agir seul devant le Tribunal fédéral ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs avocats ; il peut également valablement déposer un recours de droit public par l’entremise d’un avocat-stagiaire (art. 29 al. 2 OJ a contrario), sans que ce dernier puisse toutefois prétendre à des dépens. Sous réserve de réciprocité, les avocats étrangers peuvent être admis à titre exceptionnel comme mandataires (art. 29 al. 3 OJ). Les parties domiciliées à l’étranger doivent élire en Suisse un domicile où les notifications puissent leur être adressées. Si elles ne le font pas, le tribunal peut s’abstenir de leur adresser des notifications ou les faire par sommation publique (art. 29 al. 4 OJ). Dans les causes autres que civiles et pénales, le choix du mandataire est libre et le recourant peut également se faire représenter par un tiers autorisé ou par une assurance de protection juridique.
Au besoin, le tribunal peut faire assister d’un avocat une partie dans le besoin et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec ; si elle n’obtient pas gain de cause ou que les dépens ne puissent être recouvrés, les honoraires de l’avocat sont fixés par le tribunal et supportés par la caisse du tribunal (art. 152 al. 1 et 2 OJ). En raison des particularités de la procédure de contrôle abstrait des normes, il est généralement exclu d’y accorder l’assistance gratuite d’un avocat (ATF 121 I 314 consid. 3 et 4b).
Les professeurs de droit des universités suisses peuvent aussi intervenir comme mandataires.
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Aux termes de l’art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux particuliers et aux collectivités publiques lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d’une portée générale.
Selon la jurisprudence relative à cette disposition, le recours de droit public est ouvert seulement à celui qui est atteint par l’acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés ; le recours formé pour sauvegarder l’intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait, est en revanche irrecevable. Un intérêt est juridiquement protégé s’il est l’objet d’une garantie constitutionnelle spécifique ou si une règle de droit fédéral ou cantonal tend au moins accessoirement à sa protection ; à elle seule, l’interdiction générale de l’arbitraire consacrée par l’art. 4 aCst. ne suffisait pas à conférer la qualité pour agir (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités). La situation actuelle, découlant de l’art. 9 Cst. adopté le 18 avril 1999, sur la protection contre l’arbitraire, n’est pas encore déterminée, mais un élargissement éventuel de la qualité pour agir n’est pas exclu. La qualité pour recourir par la voie du recours de droit public s’appréciant uniquement sous l’angle de l’art. 88 OJ, il importe peu que la qualité de partie ait été reconnue au recourant dans la procédure cantonale (ATF 125 I 253 consid. 1b p. 254/255 et les arrêts cités). Enfin, il incombe à celui-ci d’alléguer les faits qu’il considère comme propres à fonder sa légitimation active (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229).
Lorsque le recours est dirigé contre un arrêté de portée générale, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne à qui les dispositions prétendument inconstitutionnelles pourraient s’appliquer un jour. Une atteinte virtuelle aux intérêts juridiquement protégés suffit, à condition qu’elle puisse être envisagée avec une certaine vraisemblance (ATF 125 I 71 consid. 1b/aa p. 75, 104 consid. 1 p. 107, 173 consid. 1b p. 174, 369 consid. 1a p. 372 ; 125 II 440 consid. 1c p. 442). Même si le recourant n’est pas virtuellement touché dans ses intérêts juridiquement protégés par l’arrêté de portée générale mis en cause, la jurisprudence admet toutefois qu’il bénéficie de la qualité pour recourir à son encontre s’il prétend que cet arrêté est contraire au principe de l’égalité de traitement au sens de l’art. 4 aCst. En effet, cet arrêté privilégierait des tiers, et vu le rapport de corrélation entre sa situation et la leur, de telle sorte que l’avantage qui leur est accordé constitue un désavantage pour lui (ATF 124 I 159 consid. 1c p. 162 et les arrêts cités), la qualité pour s’en plaindre doit lui être conférée.
L’inconstitutionnalité d’une norme peut être contestée par la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens à l’occasion d’un recours dirigé contre une décision concrète (ATF 124 I 289 consid. 2 p. 291 ; 121 I 49 consid. 3a p. 50, 102 consid. 4 p. 103/104). La qualité pour agir se détermine ici également selon les principes déduits de l’art. 88 OJ.
Dans le cadre d’un contrôle concret des normes, une constatation de l’inconstitutionnalité de la règle n’entraîne pas l’annulation de celle-ci, mais uniquement son inapplication (ATF 124 I 289 consid. 2 p. 291 ; 121 I 49 consid. 3a p. 50, 102 consid. 4 p. 103/104). Le juge constitutionnel peut cependant, dans certains cas, constater l’inconstitutionnalité de la décision mais renoncer à l’annuler et rejeter le recours, cas échéant dans le sens des considérants (ATF 110 Ia 7 consid. 6 p. 27 s’agissant d’un contrôle abstrait ; ZBl 88/1987 306 consid. 5 et ZBl 87/1986 482 consid. 2c s’agissant d’un contrôle concret). Une telle décision est usuellement nommée « Appellentscheid » (décision incitative), car elle comporte un appel plus ou moins précis et directif à l’égard du législateur afin qu’il élabore une réglementation conforme à la Constitution (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, 2e éd., p. 403). De telles décisions ont ainsi pour conséquence, d’une part, de maintenir une décision viciée et de débouter un recourant qui obtient gain de cause et, d’autre part, de légitimer les autorités à continuer à appliquer, au moins temporairement, une norme reconnue comme n’étant pas conforme à la Constitution jusqu’à ce que le législateur adopte une nouvelle réglementation. Aussi une décision incitative ne peut-elle être admise qu’exceptionnellement et pour de justes motifs (cf. ATF 112 Ia 311 consid. 2c p. 313).
Une association peut également agir par la voie du recours de droit public en vue de sauvegarder les intérêts de ses membres, quand bien même elle n’est pas elle-même touchée par l’acte entrepris. Il faut notamment qu’elle ait la personnalité juridique et que la défense des intérêts de ceux-ci figure parmi ses buts statutaires. En outre, ses membres doivent être personnellement touchés par l’acte litigieux, du moins en majorité ou en grand nombre (ATF 125 I 369 consid. 1a p. 372).
Un membre des autorités ou une collectivité publique suisse n’ont pas qualité pour agir, pas davantage qu’un État étranger, sauf si ce dernier agit iure gestionis, en faisant valoir son immunité de juridiction (ATF 111 Ia 52, 62).
Une exception est faite en faveur des communes (municipales, scolaires, religieuses (paroisses, de droit public), bourgeoises (assemblées de citoyens habitant la commune municipale, mais ayant des droits dans la gestion de biens communs) agissant pour la défense de leur autonomie communale (ATF 124 I 223 consid. 2b, p. 226 ; 122 I 290 consid. 8).
La qualité pour s’opposer au recours dirigé contre un arrêté de portée générale appartient exclusivement au canton intéressé représenté, sauf disposition particulière, par son gouvernement ; elle n’est pas reconnue à un éventuel comité d’initiative qui serait à l’origine du texte litigieux (ATF 113 Ia 126 consid. 4 p. 130).
II 2. – Conditions relatives au recours
Les conditions formelles sont identiques, que les recours émanent de particuliers, de collectivités publiques ou d’associations.
Pour être valable, le mémoire de recours doit être remis dans le délai légal en mains de l’autorité compétente ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ou encore à un bureau de poste suisse ou du Liechtenstein à l’adresse de l’autorité (art. 32 al. 3 OJ), sous réserve d’un empêchement non fautif qui justifie la restitution du délai (art. 35 OJ). Le délai de recours court à dater de la notification ou communication de l’acte et non du jour où le destinataire en a effectivement pris connaissance. Alors que la preuve de la notification et de sa date incombe à l’autorité, celle de l’observation du délai, donc de l’expédition de l’acte en temps utile, incombe à la partie. Lorsque la question de l’observation du délai est litigieuse, le Tribunal fédéral l’instruit en la forme sommaire.
L’acte de recours doit être rédigé dans une des quatre langues nationales de la Confédération. Une partie peut ainsi procéder en romanche (ATF 122 I 93 consid. 1 p. 94/95), quitte à ce que le tribunal fasse traduire au besoin ses mémoires et pièces dans une des trois langues officielles. Le mémoire déposé dans une langue étrangère n’est pas d’emblée irrecevable, mais est renvoyé à son auteur avec un délai suffisant pour en produire une traduction ou avancer les frais de celle-ci.
L’acte de recours doit comporter la signature manuscrite de son auteur ; un acte muni d’une signature dactylographiée, photocopiée ou apposée sous la forme d’un tampon ou d’un autre moyen de reproduction n’est pas valable ; il en va de même d’un acte de recours transmis par téléfax le dernier jour du délai et posté le lendemain en raison des risques d’abus inhérents à l’absence de signature originale (cf. ATF 121 II 252).
L’acte de recours doit être produit en nombre suffisant pour le tribunal et chaque partie, mais au moins en deux exemplaires (art. 30 al. 1 OJ). Lorsque la signature d’une partie ou d’un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n’est pas habilité, un délai convenable est imparti à l’intéressé pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’acte ne sera pas pris en considération (art. 30 al. 2 OJ). Outre la désignation de l’arrêté ou de la décision attaqués, il doit contenir les conclusions du recourant, un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 OJ).
Les moyens invoqués à l’appui d’un recours de droit public doivent être énoncés dans le délai de trente jours de l’art. 89 al. 1 OJ. L’art. 93 al. 2 OJ permet certes d’impartir au recourant un délai pour présenter un mémoire complétif lorsque les considérants à l’appui de la décision attaquée ne sont énoncés que dans la réponse de l’autorité. Le mémoire de réplique ne peut toutefois contenir qu’une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés par l’autorité pour justifier sa décision et non de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (ATF 119 Ia 123 consid. 3d in fine p. 131 ; 118 Ia 305 consid. 1c p. 308 et les références citées).
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
La recevabilité d’un recours est examinée d’office et librement par le Tribunal fédéral, que ce soit dans le cadre de la procédure par voie de circulation de l’art. 36b OJ ou dans celui de la procédure simplifiée de l’art. 36a OJ ; la Loi d’organisation judiciaire prévoit en effet une procédure sommaire pour les recours manifestement bien ou mal fondés et les recours manifestement irrecevables, qui peuvent être tranchés par les sections siégeant à trois juges, sans délibération publique, au terme d’une motivation sommaire qui peut renvoyer à celle de l’acte attaqué ou au mémoire d’une partie ou d’une autorité (art. 36a al. 1 et 3 OJ). Les art. 92 aOJ, s’agissant du recours de droit public, et 109 aOJ, concernant le recours de droit administratif, qui ont été abrogés le 15 février 1992 avec l’entrée en vigueur de l’art. 36a OJ, autorisaient déjà une délégation de trois juges unanimes à refuser d’entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable ou de rejeter celui qu’ils tenaient pour mal fondé. Cette procédure simplifiée avait été introduite par l’arrêté fédéral du 11 décembre 1941, modifiant à titre provisoire l’organisation judiciaire fédérale dans le but de décharger le Tribunal fédéral (cf. JeanFrançois Poudret, Commentaire de la Loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 1 ad art. 36a).
Les juges composant la cour sont choisis par le président, qui fait obligatoirement partie de celle-ci. Ils statuent sur la base d’un projet de décision établi par l’un de ses membres en qualité de juge rapporteur (art. 17 du Règlement du Tribunal fédéral). Aucune voie de recours n’est ouverte contre l’arrêt d’irrecevabilité. En vertu de l’art. 36a al. 2 OJ, les recours et les actions introduits de manière procédurière ou à tout autre égard abusifs sont irrecevables. Le plaideur ou son représentant qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires peut en outre être condamné à une amende disciplinaire de 600 francs au plus et, en cas de récidive, de 1500 francs au plus (art. 31 al. 2 OJ).
II 4. – Motifs d’irrecevabilité. Synthèse
L’irrecevabilité manifeste peut résulter de l’incompétence du tribunal, de la nature de la contestation, de la tardiveté, du défaut de qualité pour agir ou de paiement de l’avance de frais, du caractère abusif du recours ou encore de l’insuffisance de la motivation (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76).
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
Le principe du contradictoire est connu dans l’ordre juridique suisse sous le terme de « das rechtliche Gehör », traduit en français et en italien par les expressions suivantes : « droit d’être entendu », « diritto di essere sentito ». Cette institution universelle, très ancienne, puisqu’elle est déjà mentionnée aussi bien dans la Bible hébraïque (Proverbes, ch. 18, v. 17) que dans la Bible chrétienne, directement (Evangile de Jean, ch. 7, v. 51) ou par référence au droit romain (Actes des apôtres, ch. 25, v. 16) vaut pour tous les types et degrés de juridictions, y compris la juridiction constitutionnelle, dont le rôle est notamment d’assurer la mise en œuvre de ce droit fondamental, énoncé à l’art. 29 al. 2 Cst. Selon l’art. 91 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral statue sur les contestations de droit public à la suite d’une procédure écrite, menée par le juge chargé d’instruire la cause ou juge délégué, le président de la Cour étant compétent pour se prononcer sur les mesures provisionnelles éventuelles (Walter Kälin, loc. cit., p. 375).
Une fois que le recours de droit public a été déposé devant le Tribunal fédéral, il est attribué, en fonction de la matière, à la Ire ou à la IIe Cour de droit public (cf. Règlement du Tribunal fédéral du 14 décembre 1978, art. 2 et 3). De façon très résumée, la Ire Cour de droit public est compétente pour la sauvegarde des droits politiques des citoyens (contrôle de la constitutionnalité des lois cantonales, opérations de démocratie semi-directe [référendums et initiatives]), la protection de l’équilibre écologique, la propriété, la liberté personnelle, d’expression, de presse, la garantie du juge naturel et l’interdiction de l’arbitraire. À la IIe Cour de droit public sont dévolus le contentieux de la fonction publique, fédérale et cantonale, le droit fiscal, la liberté religieuse, la liberté économique et le droit de s’exprimer dans sa langue, soit une des langues nationales de la Suisse (allemand, français, italien et romanche).
III 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
III 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
D’entrée de cause, le président de chaque Cour, par ses secrétaires présidentiels et les services de chancellerie qui leur sont attachés, ordonne un échange d’écritures en ce sens que l’autorité dont la décision est attaquée, la partie adverse du recourant, et d’autres intéressés éventuels ont le droit de prendre position et de produire leur dossier, dans un délai déterminé, généralement de 30 jours. Si le délai de recours est un délai légal strict, non susceptible de prolongation (art. 89 al. 1 OJ), le délai de réponse n’est pas fixé dans la loi et doit simplement être « suffisant ». Les parties ont donc accès au dossier dès le dépôt du recours, même si la question de sa recevabilité n’est pas encore tranchée et demeure réservée. La procédure spéciale permet de ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable (art. 36a al. 1 let. a OJ) ; dans ce cas, l’autorité attaquée et les parties adverses sont informées du dépôt du recours, mais pas invitées à fournir leurs déterminations. De même, le rejet d’un recours manifestement infondé peut intervenir dans ces conditions. Par contre, la consultation de l’autorité dont la décision est attaquée et des parties adverses ou intéressées est obligatoire dans l’hypothèse de l’admission du recours de droit public, ceci pour respecter le principe du contradictoire à l’égard des personnes dont la situation juridique va changer, suite à la censure constitutionnelle de la décision entreprise (Kälin, loc. cit., p. 375).
La faculté de présenter des observations est un droit et non une obligation ; par contre les délais, légaux ou judiciaires, doivent être respectés sous peine d’irrecevabilité pour ce qui est du recours, et de suppression de la procédure quant aux mémoires déposés par les autres parties en dehors du délai imparti, éventuellement prorogeable sur requête motivée.
Selon l’art. 93 al. 2 OJ déjà cité, un délai peut être accordé au recourant pour qu’il puisse produire un mémoire complétif. C’est particulièrement le cas lorsque la décision contestée n’a été que partiellement motivée, qu’elle a été rendue oralement, que l’autorité ne l’a pas confirmée ultérieurement par écrit à la requête de l’intéressé ou qu’elle émane d’une autorité incompétente (par exemple gouvernement cantonal au lieu de parlement cantonal). En réalité, pour respecter le principe du contradictoire, un nouveau délai doit être imparti au recourant, qui ne peut toutefois plus faire valoir des moyens qu’il aurait déjà pu diriger contre la partie motivée de la décision entreprise (Kälin, loc. cit., p. 377 ; ATF 125 I 71 consid. 1-4). De manière exceptionnelle, le président de la Cour ou le juge délégué peut ordonner un second échange d’écritures. Il n’est admissible que lorsque la situation de fait et les questions juridiques ne sont pas encore suffisamment élucidées, au point que le Tribunal fédéral ne pourrait prononcer son arrêt (ATF 118 Ia 305 consid. 1c).
En droit public suisse, singulièrement administratif, le droit d’être entendu, de l’art. 29 al. 2 Cst., n’implique pas celui d’être entendu oralement, soit d’être auditionné lors d’une comparution personnelle ou de pouvoir présenter une plaidoirie devant l’autorité compétente (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469 et les références). À défaut de dispositions contraires, cette jurisprudence s’applique également au procès constitutionnel. L’obligation d’organiser des débats publics, soit une audience de plaidoiries, au sens de l’art. 6 § 1 CEDH ne modifie pas cette conception, notamment lorsque, dans le cas d’une procédure exclusivement écrite, une partie se borne par exemple à demander sa comparution personnelle, son audition ou la participation à celle des témoins ainsi qu’à l’exécution d’un transport sur place (ATF 122 V 47 consid. 3a p.55 et les références).
À l’issue de l’instruction écrite, le dossier est en général en l’état d’être jugé, c’est-à-dire d’être remis à un juge rapporteur qui rédige un projet d’arrêt en concluant à l’irrecevabilité, au rejet ou à l’admission du recours de droit public. Ce rapport est soumis à la délibération de la Cour (cf. infra n° III-3.). Au début, parfois au cours de la procédure écrite, le président peut ordonner des mesures provisionnelles ; ensuite, à l’échéance de la procédure écrite, le juge délégué peut encore ordonner des mesures probatoires, avant de dresser son rapport (cf. infra n° III-2.3.).
Le « procès en constitutionnalité » peut donc être défini comme pleinement contradictoire, sous réserve de l’absence, en principe, de plaidoiries devant la cour compétente du Tribunal fédéral, dans sa composition de jugement, sauf lorsqu’est invoquée avec pertinence la violation d’un droit garanti par la CEDH, et que la partie recourante sollicite expressément une audience de plaidoiries.
À cet égard, il est utile de préciser que l’art. 17 al. 1 OJ assure la publicité des débats, des délibérations et des votations, à l’exception des délibérations et votations des sections pénales, de celles de la Chambre des poursuites et des faillites et lorsqu’il s’agit d’affaires disciplinaires plaidées devant les Cours de droit public. Toutefois la publicité est restreinte en matière fiscale, le huis clos relatif ne permettant qu’aux parties et à leurs mandataires d’assister aux débats, délibérations et votations (Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, p. 47). Cette restriction connaît elle-même une exception, qui permet de retrouver le principe général de la publicité des tribunaux, en matière fiscale, lorsque le problème traité vise une réglementation générale et non pas des assujettis pris individuellement (par exemple impôts ecclésiastiques, détermination de la valeur locative dans l’impôt sur le revenu des personnes physiques, pour leurs biens immobiliers habités personnellement) (Kälin, loc. cit., p. 384/385 ; ATF 124 I 145).
L’art. 91 OJ, cité plus haut, apporte également une limitation à la publicité des débats. Dans ces conditions, une audience de plaidoiries, avec les parties et leurs mandataires, ou éventuellement avec leurs mandataires seuls, ne peut être ordonnée que pour des motifs importants, et ceci de façon exceptionnelle. Comme le droit national, l’art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) prévoit la publicité des débats et de la lecture du jugement. Sur ce point toutefois, le droit conventionnel offre une protection moins grande au justiciable, qui ne peut pas assister aux délibérations du tribunal, ainsi que c’est le cas dans le procès constitutionnel en Suisse (cf. infra n° III-3.).
III 2. – Égalité des armes
Selon ce principe, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. À cet égard, dans l’examen des dossiers, il convient de distinguer les pièces qui sont fournies par les parties adverses de celles qui émanent de la juridiction inférieure, dont la décision est attaquée. Ainsi, si le recourant doit avoir accès à tous les documents de la procédure, ainsi que sa partie adverse intimée, le fait de ne pas leur remettre les observations du tribunal qui a statué en dernier lieu sur la cause les divisant, ne constitue pas un manquement au principe de l’égalité des armes. Si par contre de telles observations contiennent un avis motivé sur le bien-fondé du recours, à l’égard duquel des conclusions explicites en rejet sont prises, alors, dans ces conditions, les parties peuvent en prendre connaissance, notamment celles au détriment de qui la juridiction inférieure s’était prononcée.
Font partie de la procédure toutes les pièces relevant du dossier constitué par l’autorité qui a rendu la décision attaquée. À ces documents s’ajoutent l’échange d’écritures devant le Tribunal fédéral, les ordonnances de mesures provisionnelles ou d’instruction de la cause et les procès-verbaux d’exécution de ces dernières, d’éventuels rapports d’expertise et toute communication faite dans les délais prescrits au Tribunal fédéral, et à ce titre, accueillie dans le dossier. Le droit de le consulter n’est pas absolu ; il peut en particulier être limité pour la sauvegarde de l’intérêt public, dans l’intérêt prépondérant d’un particulier, voire même aussi dans l’intérêt du requérant lui-même, essentiellement dans l’hypothèse de dossiers médicaux (ATF 122 I 153 consid. 6a p. 161 et les arrêts cités). Une différence doit être faite entre les dossiers en cours, et les dossiers archivés, qui méritent une protection accrue lorsque l’intérêt public ou l’intérêt privé prépondérant de tiers exige le maintien au secret de divers documents ; l’accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause doit être ordonné en application du principe de la proportionnalité. Le droit de consulter le dossier contenant des données personnelles ne découle pas seulement du droit d’être entendu, ou principe du contradictoire, mais est également rattaché à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), qui garantit le respect de la personnalité (ATF 125 I 257 consid. 2b p. 260 et les références). Lorsque les dossiers archivés contiennent des pièces n’ayant plus aucun rapport avec la situation actuelle et susceptibles de porter atteinte à la liberté personnelle de l’intéressé, la consultation doit être interdite. En fait, de tels documents devraient être détruits, ce qui peut être le cas par exemple pour des dossiers de police, datant de plus de 30 ans et qui ne revêtent plus aucun intérêt pour la prévention, la recherche et la répression d’infractions concernant des protagonistes décédés, ou qui ont cessé d’avoir une activité dans le domaine concerné, ou qui ont donné lieu à une décision judiciaire, même s’agissant d’une éventuelle condamnation dont la peine pourrait avoir été exécutée ou être prescrite (ATF 113 Ia 257 consid. 4b p. 263 et les arrêts cités). L’efficacité de l’activité gouvernementale peut également justifier des restrictions au droit d’être entendu, mais ceci de façon exceptionnelle. Le refus de la consultation du dossier peut être opposé à la demande d’examen d’un dossier du Ministère des affaires étrangères, lorsque la liberté d’action de celui-ci dans la protection diplomatique de personnes se trouvant à l’étranger, victimes d’une prise d’otages, serait gravement compromise pour l’avenir (ATF 125 II 225 consid. 4 p. 228).
De façon générale, l’accès au dossier garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de consulter les pièces au siège de l’autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu’il n’en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l’autorité (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités). Devant le Tribunal fédéral, les mémoires de l’échange d’écritures, les ordonnances d’instruction de la procédure et les procès-verbaux de mesures d’instruction ainsi que les rapports d’expertise éventuels sont transmis aux parties, alors que les pièces annexes, soit essentiellement le dossier de l’autorité qui a pris la décision contestée, peuvent être consultées au Greffe, sur rendez-vous.
III 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
L’art. 95 al. 1 OJ fonde la compétence du juge chargé de l’instruction d’ordonner la procédure probatoire nécessaire pour élucider les faits. Il peut procéder lui-même aux enquêtes ou en charger les autorités compétentes de la Confédération ou du canton. L’art. 95 al. 2 OJ établit pour la procédure de recours de droit public le principe de la libre appréciation des preuves.
Pour l’établissement de l’état de fait, le juge peut agir d’office (maxime d’office ou inquisitoriale), sans être tenu aux conclusions des parties (maxime des débats), qui ont le droit de formuler une offre de preuves ; dans cette dernière hypothèse, le juge peut soit y donner suite, totalement ou partiellement, soit écarter les probatoires avancés, au terme d’une appréciation anticipée des preuves, de jurisprudence constante conforme au principe du contradictoire (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242 ; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). Les moyens de preuve utilisés le plus fréquemment sont la preuve documentaire, le transport sur place ou inspection locale et l’apport au dossier de prises de position de services publics, qui, sans constituer un rapport d’expertise, sont susceptibles de fournir des indications techniques spéciales dans un domaine particulier (ATF 120 Ia 321 consid. 1 p. 324 ; Kälin, loc. cit., p. 382 ; Spühler, loc. cit., p. 43). Fréquentes dans la procédure voisine de recours de droit administratif, la réalisation d’une expertise, de même que l’audition de témoins ne sont pas mentionnées par la doctrine et la jurisprudence, mais demeurent concevables. Comme dans n’importe quel autre procès, les parties sont associées à l’exécution des mesures probatoires, en application même de ce principe du droit d’être entendu (droit de proposer des moyens de preuve, de participer à leur collection et de s’exprimer, en principe par écrit, sur leur résultat). Le juge peut procéder en personne aux mesures d’instruction, ou les déléguer, au sens de l’art. 95 al. 1 in fine OJ.
L’exécution de mesures probatoires reste exceptionnelle, et la quasi totalité des recours de droit public sont jugés après un, éventuellement deux échanges d’écritures, sans autres mesures d’instruction ni audiences de plaidoiries.
III 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
Le juge ne peut se saisir d’office de moyens non soulevés dans le recours, car le Tribunal fédéral n’examine que les griefs d’ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l’acte de recours. L’intéressé doit donc présenter un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation alléguée, puisque le Tribunal fédéral n’a pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit et à l’équité (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités). Suivant les circonstances, par exemple lorsque le recours est introduit par une personne ne bénéficiant pas d’une formation juridique (cas devenu très rare), une motivation brève, comportant une référence indirecte à la violation de droits constitutionnels non expressément désignés peut, suivant les circonstances, satisfaire aux exigences de recevabilité de l’art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14).
L’évocation est donc inconnue, mais le juge constitutionnel peut statuer par substitution de motifs, pour autant que le dossier le permette et surtout que le droit d’être entendu de toutes les parties soit respecté (Kälin, loc. cit., p. 391 ; ATF 114 Ia 97, par analogie). Si le juge pouvait soulever d’office certains griefs, le droit d’être entendus des recourants et intimés devrait naturellement être observé ; lorsque le tribunal est amené à statuer par substitution de motifs, en se basant sur une règle ou une considération juridique inédite dans la procédure, et dont les parties ne pouvaient raisonnablement pas envisager l’application, il doit alors les inviter à se déterminer sur l’argumentation proposée. En effet, l’autorité n’est pas tenue de donner aux parties l’occasion de se prononcer spécialement sur les développements juridiques qu’elle envisage de retenir, sauf lorsqu’elle prévoit de fonder sa décision sur une norme ou une considération de droit qui n’a pas été évoquée au cours de la procédure, notamment parce qu’aucune des parties ne s’en est prévalue ou ne pouvait en supputer la pertinence dans le cas litigieux (ATF 124 I 49 consid. 3c p. 52 et les références ; 123 I 63 consid. 2d p. 69 ; arrêt CourEDH, Higgins c. France, du 12 février 1998, Rec. 1998-I, p. 44 ss, p. 60, § 42).
III 3. – Délai de jugement
L’examen du « délai de jugement » inclut la référence au principe de la publicité des débats, exposé ci-dessus, qui s’étend aux délibérations, pour les deux Cours de droit public, avec les restrictions déjà mentionnées. Ainsi, en principe, tout recours de droit public ne mettant pas directement en cause un intérêt public ou des intérêts privés prépondérants peut donner lieu à une délibération à laquelle non seulement les parties, mais également toute personne, peuvent assister, ce qui permet au public d’apprécier la formation de la volonté collective du tribunal et de mieux connaître l’institution, au bénéfice de cette transparence que peu de systèmes judiciaires connaissent.
Toutefois, la tenue d’audiences de délibération (ou séances, Sitzungen) est relativement rare, dans la mesure où l’art. 36b OJ permet de statuer par voie de circulation en cas d’unanimité de la Cour sur le rapport déposé par le juge chargé de sa rédaction. Une telle possibilité de délibération par voie de circulation existe, que la Cour siège dans sa composition ordinaire à trois membres, notamment en cas d’irrecevabilité, de rejet ou d’acceptation manifestes du recours, dans sa composition à cinq membres, lorsque la cause soulève une question de principe ou lorsque la publication de l’arrêt est envisagée, ou dans la composition spéciale indiquée à l’art. 15 OJ. Dans cette dernière hypothèse, les Cours de droit public siègent, en leur qualité de juges constitutionnels, à sept membres, lorsqu’il s’agit de contrôler la constitutionnalité d’actes législatifs cantonaux soumis au referendum ou contre des décisions concernant une initiative populaire, au niveau cantonal.
Ainsi, une composition plus large est prévue lorsque la censure constitutionnelle risque de toucher une décision entrant dans le mécanisme de la démocratie directe, donc du suffrage universel.
Il n’existe ainsi pas de procédure formelle de clôture de l’instruction ; une fois celle-ci achevée, et le rapport établi, ce dernier est mis en circulation, et s’il ne recueille pas l’unanimité des membres siégeant, sous réserve d’ajustements rédactionnels, il fait l’objet d’une délibération publique. Dans ce cas, les parties sont convoquées à l’audience, dont la date est également communiquée aux journalistes accrédités auprès du Tribunal fédéral, et une telle convocation peut être considérée comme la procédure de clôture existant dans d’autres systèmes.
III 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
Aucun délai de jugement n’étant imparti, la durée de la procédure s’apprécie en fonction de la nature de la cause et de l’importance de l’objet traité. Le contrôle abstrait de la constitutionnalité d’une loi cantonale, ou de la recevabilité d’une initiative visant à introduire une telle loi, nécessite davantage de temps que le contrôle incident, à l’occasion de la critique d’une décision prise par une autorité ou un tribunal cantonaux. Les délais s’échelonnent ainsi de quelques jours, par exemple pour le contrôle de la régularité de la détention préventive au regard de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 § 3 et 4 CEDH), à plusieurs mois pour les affaires plus complexes.
Si la cause est jugée par voie de circulation, les délais sont courts entre la fin de l’instruction et la notification de l’arrêt aux parties. Il faut compter quelques semaines entre la fin de l’instruction et la délibération, qui se conclut par le prononcé de l’arrêt, et à nouveau quelques semaines entre ce prononcé et la notification de la décision du Tribunal fédéral.
Dans l’hypothèse d’une procédure faisant l’objet d’une délibération publique, la rédaction du rapport prend en général plus de temps, puisqu’il s’agit de l’examen de situations très controversées en doctrine et en jurisprudence. Un certain délai doit ensuite être respecté entre la convocation et l’audience de délibération. Cette dernière dure en général plusieurs heures avant de se terminer par le prononcé de la décision. Dans certains cas exceptionnels, l’audience de délibération publique est suspendue, pour être reprise et terminée quelques semaines plus tard après une nouvelle convocation à une autre séance, parce que le tribunal n’était pas en mesure de dégager une majorité lors des premiers débats. Cette situation est extrêmement rare, mais doit être signalée par souci d’exhaustivité. Entre le prononcé en délibération publique et la notification écrite de la décision s’écoule un délai de quelques semaines, parfois de quelques mois, en fonction du travail demandé aux greffiers rédacteurs et pour permettre aux juges d’apporter des précisions ou des modifications rédactionnelles dans le sens du dispositif lu à l’issue de l’audience publique, qui scelle la décision.
De manière générale, comme cela ressort des citations susmentionnées, le Tribunal fédéral s’attache à suivre la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, les solutions dégagées par les deux cours étant similaires, vu le développement du droit constitutionnel suisse.
Conclusion
1. – L’accès au juge constitutionnel et l’explosion du nombre des procédures, passant d’environ 3 000 en 1980 à environ 5 500 en 1999, est à l’origine de l’introduction de la procédure dite simplifiée et de la procédure par voie de circulation des art. 36a et b OJ, en 1991. Antérieurement, en 1984, le nombre de juges suppléants a été doublé, passant de 15 à 30 pour l’ensemble du Tribunal fédéral, les deux tiers de cet effectif étant attribués aux deux Cours de droit public ; de même en 1988, le nombre des collaborateurs scientifiques a été augmenté de manière significative. La situation est restée inchangée quant à des transformations structurelles du Tribunal fédéral jusqu’à l’adoption de dispositions de nature constitutionnelle, le 12 mars 2000, qui apportent de sensibles améliorations en matière de procédure civile et pénale, qui peuvent probablement avoir un effet indirect sur la charge de la juridiction constitutionnelle, par la rationalisation qu’elles postulent.
2. – Concernant le projet de transformation de la juridiction constitutionnelle, je me réfère aux remarques articulées en tête du présent rapport, en rappelant que la réforme envisagée n’a pas abouti, suite au vote négatif du Parlement à fin 1999.
3. – Même si le recours de droit public est une nouvelle procédure, distincte des causes civiles, pénales ou administratives à l’occasion desquelles un droit constitutionnel a pu être violé, il est souvent considéré en pratique comme la continuation de la procédure antérieure, conduite le plus souvent avec l’assistance d’un mandataire professionnellement qualifié (avocat). Dans ce sens, il ne peut être parlé de « professionnalisation » des recours, même si les justiciables agissant en personne ne représentent plus qu’une infime minorité, alors qu’ils étaient plus nombreux à l’origine du système actuel, soit lors de l’introduction de la loi d’organisation judiciaire, du 16 décembre 1943.
Rapport du Tribunal fédéral suisse, partie statistiques
Remarques
Comme expliqué en détail dans le rapport, le Tribunal fédéral est en quelque sorte à la fois le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État, la Cour de Cassation et le Tribunal des conflits. Il peut être saisi par tous les particuliers, mais aussi par les états membres (les cantons), les communes et la Confédération elle-même. Des griefs de nature administrative et constitutionnelle, par exemple, peuvent être présentés dans le même mémoire. Le Tribunal fédéral ne tient pas une statistique des griefs soulevés. Chaque cas n’étant attribué qu’à un seul code de statistiques en fonction de la question juridique prépondérante, il n’est pas possible de présenter des statistiques fiables de la jurisprudence constitutionnelle selon les critères établis par le Secrétariat de l’ACCPUF. Cela vaut également pour la distinction entre contrôle abstrait (avant l’entrée en vigueur d’une loi cantonale) et contrôle concret des lois cantonales. On pourrait prendre en considération le critère supplémentaire selon lequel le Tribunal fédéral siège toujours à 7 juges lorsqu’il doit se prononcer sur des recours de droit public intentés contre des actes législatifs cantonaux soumis au référendum (contrôle abstrait) pour lesquels le Tribunal fédéral dispose des chiffres exacts. Néanmoins, le résultat n’est pas précis parce que, en raison de la variété des législations cantonales, les lois cantonales ne sont pas soumises au référendum dans tous les cantons.
Pour donner une idée du travail du Tribunal fédéral, nous vous présentons les statistiques ci-jointes. Il s’agit des chiffres concernant 1999. La charge de travail ayant été assez stable ces dernières années, on peut les multiplier par 6 pour obtenir des chiffres approximatifs des années 1994-1999.
Secrétariat général Lausanne,
le 24 février 2000/vjc
1999

Lausanne, le 25 février 2000/vjc
Nombre et nature des affaires

1. En plus : 6 échanges de vue et 3 procédures de consultation CEDH.
2. En plus : 6 échanges de vue et 3 procédures de consultation CEDH. Langue des décisions : – allemand 58,7% – français 31,0% – Italien 10,3%.
3. Dont 179 suspendues.
Rapport du conseil constitutionnel du Tchad
Mars 2000
La mise en place d’un contrôle de constitutionnalité de la loi est une création récente dans l’histoire constitutionnelle tchadienne. La Constitution du 31 mars 1996 lui consacre un titre entier. C’est le titre VII qui comprend douze (12) articles. C’est six mois après la promulgation de la Loi organique n° 19/PR/98 du 2 novembre 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel que celui-ci a été mis en place par la désignation de ses membres.
Cela explique donc que la jurisprudence constitutionnelle tchadienne ne soit pas assez fournie pour permettre une étude exhaustive de son évolution dans le temps. Les réponses qui seront apportées au questionnaire émanent beaucoup plus des textes de base que de ladite jurisprudence.
I. L’ouverture du droit de saisine
I 1. – Les requérants
Dans le tableau ci-dessous nous prenons comme date de départ l’année 1960 puisqu’elle correspond à celle de l’indépendance du Tchad.

I 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Les conditions d’ouverture du recours n’ont pas encore évolué dans le temps.
I 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Le Conseil constitutionnel du Tchad ne dispose pas d’une possibilité d’auto-saisine.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Aucune procédure de désistement n’a été prévue par les textes tchadiens.
I 2. – Actes contrôlés
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé

I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 166 de la Constitution : « Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux. »
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
Rien n’est prévu dans nos textes concernant la contestation de la constitutionnalité d’une autre loi à l’occasion d’un recours contre une loi.
I 3. – Les délais
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Il n’y a pas de recours recevables sans délai, sauf cas de l’article 136 de la Constitution.
I 3.2. – Tableau des conditions de délais

II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives au requérant
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Le requérant n’est pas astreint à s’acquitter d’un droit de timbre.
II 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
La représentation du requérant par ministère d’avocat n’est pas possible.
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Le requérant n’est pas tenu de démontrer son intérêt à agir.
II 2. – Conditions relatives au recours
L’article 21 de la Loi organique 019/PR/98 du 2 novembre 1998 dispose que le Conseil constitutionnel est saisi par requête adressée à son Greffe ou au Greffe du Tribunal de Première instance ou de la Justice de Paix.
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
Conditions formelles

Conditions matérielles

II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
C’est le Conseil constitutionnel réuni en séance plénière qui statue sur la recevabilité des recours.
II 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours (art. 174 de la Constitution).
II 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
Le Conseil statue en séance plénière sur un rapport. Le président du Conseil constitutionnel désigne un rapporteur qui peut être assisté d’une commission ad-hoc.
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
La décision d’irrecevabilité est motivée et publiée.
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse
L’état actuel de notre jurisprudence qui se limite à une seule décision sur l’irrecevabilité ne permet pas d’indiquer les principaux motifs d’irrecevabilité, ni même de les classer.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
L’article 24 alinéa 1 de la Loi organique n° 19/PR/98 du 2 novembre 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel dispose que : « La procédure devant le Conseil constitutionnel n’est pas contradictoire. Tout document produit après le dépôt de la requête n’a pour le Conseil qu’une valeur de simple renseignement. »
III 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Il n’existe pas de formalités à accomplir une fois que le Conseil se juge valablement saisi.
III 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
À aucune étape de la procédure, les parties n’ont accès au prétoire.
III 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
Conformément à l’article 24, alinéa 1er, on peut dire que le procès en constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel tchadien n’est pas et ne peut être défini comme contradictoire.
III 2. – Égalité des armes
III 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Il n’y a pas de pièces qui soient exclues de la procédure. Cependant, tout document produit après le dépôt de la requête n’a pour le Conseil qu’une valeur de simple renseignement (art. 24, alinéa 1er, Loi organique n° 19).
III 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Le procès n’étant pas contradictoire, il va de soi que les pièces ne sont ni transmises, ni accessibles aux parties.
III 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
L’article 24 dernier alinéa de la Loi organique dispose que : « Le Conseil constitutionnel prescrit toutes mesures d’instruction qui lui paraissent utiles et fixe les délais dans lesquels ces mesures devront être exécutées. »
III 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ? Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
L’article 27 de la Loi organique dispose que : « Si le Conseil constitutionnel dans la loi contestée ou dans l’engagement international soumis à son examen constate une violation de la Constitution qui n’a pas été invoquée, il doit la soulever d’office. » Cette possibilité d’évocation d’office n’est pas soumise à des conditions. Les requérants n’ont pas la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge car les décisions du juge ne sont pas susceptibles de recours.
III 3. – Délai de jugement
III 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
Le Conseil constitutionnel est tenu de rendre sa décision dans un délai de quinze (15) jours ou huit (8) en cas d’urgence (art. 26, alinéa 1 de la Loi organique). Les délais sont jusque là respectés.
III 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
C’est le dépôt du rapport au Secrétariat général qui clôt la procédure d’instruction.
Rapport de la cour constitutionnelle du Togo
Mars 2000
Introduction
Le siège de la matière se trouve dans le titre VI de la Constitution togolaise promulguée le 14 octobre 1992, dans le chapitre 2 du titre II de la Loi organique n° 97-01 du 8 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et dans la section II du chapitre II du Règlement intérieur de ladite cour adopté le 13 mai 1997.
Le contrôle de la constitutionnalité des normes en République togolaise existe depuis les Lois n° 61-17 du 12 juin 1961 et n° 62-9 du 14 mars 1962 abrogées et réorganisé par la Loi n° 814 du 30 mars 1981 réorganisant la Cour suprême. Ce contrôle était confié à la chambre constitutionnelle, formation spécialisée de cette cour. Le contrôle est passé à la Cour constitutionnelle créée par la Constitution du 14 octobre 1992 en tant qu’institution indépendante et se justifie par le caractère fondamental de la Constitution qui implique que toute norme applicable dans la République soit conforme à sa teneur. Cela explique qu’en cas de non conformité d’un texte de valeur supérieure, tels les accords et traités, l’autorisation de la ratification ou de l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution (art. 139). S’agissant de textes de rang inférieur, tels les lois ordinaires et organiques, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Économique et Social, ils doivent être contrôlés et au besoin révisés avant de rentrer dans l’ordonnancement juridique.
I. L’ouverture du droit de saisine
Définition
La saisine est l’acte juridique initial, introductif d’instance par lequel on met en mouvement le pouvoir de contrôle de la constitutionnalité des normes par la Cour ; elle se fait par un acte – instrumentum – appelé requête, présenté au juge constitutionnel. Le mot requête ou saisine est employé devant la Cour pour désigner la même opération ; ainsi la Loi organique (art. 29) et le Règlement intérieur (art. 35) parlent de saisine et de requête de manière indifférente.
I 1. – Les requérants
I 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
Saisine émanant d’une personne publique

I 1.2. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Non, elles n’ont pas évolué.
I 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
Non, aucun texte ne confère à la Cour le droit d’auto-saisine.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
Oui. Les requérants peuvent se désister dans les conditions suivantes :
- lorsqu’il s’agit d’une loi ordinaire soumise facultativement au contrôle ;
- lorsqu’il s’agit d’une loi de ratification ou d’approbation d’un traité ou accord international.
Le délai de désistement n’est pas prévu par les textes. Cependant la Cour estime que le désistement doit se faire avant le prononcé de sa décision.
Le désistement peut être partiel.
I 2. – Actes contrôlés
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’actes contrôlés :
Les actes contrôlés sont indiqués dans la première colonne du tableau ci-après :

I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Oui. Ce sont les actes relevant du domaine réglementaire du pouvoir exécutif (art. 85).
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
En principe c’est possible, mais cette question n’est prévue par aucun texte, et il n’existe aucune jurisprudence en la matière.
I 3. – Les délais
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
Oui lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée in limine litis par une partie devant une juridiction.

I 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Non.
I 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques, pour quelles raisons ?
Sans objet.
II. Recevabilité de la saisine
II 1. – Conditions relatives au requérant
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Non, le requérant n’a à s’acquitter d’aucun droit de timbre.
II 1.2. – La représentation du requérant doit-elle se faire par ministère d’avocat ?
Non, le droit de saisine de la Cour est personnel à l’autorité qualifiée et exclut toute représentation.
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
Le requérant n’est pas obligé de démontrer son intérêt à agir.
II 2. – Conditions relatives au recours
II 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?
Les requêtes sont reçues au Greffe de la Cour qui affecte à chacune un numéro d’ordre ; ce numéro est précédé d’une lettre de l’alphabet selon la nature de l’affaire, soit « C » pour les affaires constitutionnelles suivi des deux derniers chiffres du millésime ; exemple : requête numéro C-005/00 du 20 janvier 2000.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
La date de l’enregistrement fait foi pour la suite des procédures.
II 2.3. – Quelles sont les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes actuellement en vigueur ?
La requête ne revêt aucun formalisme obligatoire : elle est rédigée sur papier libre auquel sont annexés les textes soumis au contrôle.
Elle comprend en outre l’identité, la qualité et la signature du requérant. Les requêtes doivent contenir les moyens et les conclusions.
Les moyens nouveaux peuvent être présentés en cours de procédure jusqu’au dépôt du rapport du juge rapporteur.
Conditions formelles

Conditions matérielles

II 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Non, la Cour constitutionnelle est une institution récente qui n’a pas encore de pratique. De même aucun texte législatif n’est intervenu dans le sens de l’évolution des conditions.
II 2.5. – Existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ?
Il n’existe pas dans les textes en vigueur une procédure de régularisation de la requête. Cependant le requérant peut prendre l’initiative de la régularisation avant le dépôt du rapport du juge rapporteur ; celui-ci peut aussi inviter le requérant à le faire sans délai.
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
C’est la Cour qui statue sur la recevabilité des recours.
II 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité est-elle susceptible de recours ?
Non, la décision est sans recours.
II 3.3. – La Cour statue-t-elle en formation plénière ou dans une formation particulière ?
La Cour statue en formation plénière sur rapport du juge rapporteur. Le rapporteur est désigné par ordonnance du président de la Cour.
Les requêtes sont enregistrées par le greffier dans la rubrique des affaires constitutionnelles portant la lettre « C » suivie d’un numéro d’ordre et des deux derniers chiffres du millésime.
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité doit-elle être motivée, prononcée, publiée ?
La décision d’irrecevabilité est motivée, prononcée et publiée au Journal officiel.
II 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Les requérants abusifs ne sont pas passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ; aucun texte ne le prévoit.
II 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ?
Non, il n’existe aucun texte et aucune jurisprudence dans ce sens.
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse
Sans objet, aucune pratique.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
III 1.1. – Y a-t-il certaines formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie ?
Dès sa saisine, la Cour accomplit les formalités suivantes :
- elle avise toute autorité intéressée par la procédure d’inconstitutionnalité et lui communique la requête et toutes les pièces y annexées ;
- elle invite l’autorité concernée à présenter ses observations dans un délai déterminé par le juge rapporteur ;
- elle communique les observations reçues à l’auteur de la saisine.
III 1.2. – À quelles étapes de la procédure et dans quelles conditions les parties ont-elles accès au prétoire ?
La procédure étant essentiellement écrite, les parties ne peuvent pas demander, soit en personne soit par ministère d’avocat, à être entendues lors des débats de la Cour.
III 1.3. – Le procès en constitutionnalité devant l’organe chargé de ce contrôle peut-il être défini comme pleinement ou seulement partiellement contradictoire ?
La procédure devant la Cour en matière de contrôle de la constitutionnalité est partiellement contradictoire, à l’appréciation du juge rapporteur.
III 2. – Égalité des armes
III 2.1. – Quelles sont les pièces constitutives de la procédure ? Certaines pièces sont-elles exclues de la procédure ?
Les pièces sont : la requête, le texte critiqué, la norme de référence base de la critique, et toutes autres pièces justifiant les prétentions du requérant ; le mémoire le cas échéant de l’autorité auteur de la norme critiquée.
Il n’existe pas de texte excluant a priori la production de telle ou telle pièce.
III 2.2. – Toutes les pièces sont-elles transmises ou accessibles aux parties ? Quelles sont celles qui ne sont pas transmises et/ou accessibles ?
Toutes les pièces produites sont transmises et accessibles aux parties.
III 2.3. – Le juge constitutionnel dispose-t-il de moyens propres d’instruction d’une affaire ?
Le juge constitutionnel dispose de tous les moyens légaux d’investigation et d’information propres à instruire l’affaire, en particulier le recours aux travaux préparatoires et procès verbaux de la norme critiquée.
III 2.4. – Le juge peut-il se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête ou de dispositions non contestées dans la requête ?
Le juge peut se saisir d’office :
- des moyens non soulevés dans la requête ;
- des dispositions non contestées, dès lors que la norme est déférée.
Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par le juge ?
Non, puisque le rapport du juge rapporteur ne leur est pas communiqué pour observations.
III 3. – Délai de jugement
III 3.1. – La Cour est-elle tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ?
La Cour doit rendre ses décisions dans un délai de 30 jours ; toutefois ce délai est réduit à 8 jours lorsque la Cour statue sur les violations des droits de la personne humaine et des libertés publiques.
En matière d’exception d’inconstitutionnalité, la Cour statue dans un délai d’un mois qui peut être réduit à 8 jours en cas d’urgence.
Les délais sont respectés.
III 3.2. – Y a-t-il une procédure formelle de clôture de l’instruction ?
Le dépôt du rapport met fin à l’instruction de l’affaire.
III 3.3. – Si aucun texte ne définit de délai, quel est le délai moyen pris par la Cour pour statuer ?
Les textes qui définissent les délais impartis à la Cour pour statuer existent :
- entre la fin de l’instruction et la tenue du délibéré, aucun délai n’est imparti ;
- entre la tenue du délibéré et le prononcé de la décision il n’y a pas non plus de délai imparti ;
- entre le prononcé de la décision et la publication ou la notification il n’y a pas de délai imparti.
Toutefois la Cour s’organise toujours pour respecter le délai de 30 jours ou de 8 jours tel que spécifié au III-3.1. ci-dessus.
Conclusion
La Cour constitutionnelle du Togo étant une institution jeune, elle n’a pas encore senti le besoin de procéder à des adaptations structurelles.
Cependant, elle réfléchit à la possibilité d’élargir l’accès au juge constitutionnel à d’autres personnes physiques ou morales.
La tendance actuelle n’est pas à la professionnalisation des requêtes et des requérants.
III. Débats
Note du Secrétariat général de l’ACCPUF : Le chapitre consacré aux débats propose d’une part les rapports de synthèse et le rapport général présentés lors du Congrès, d’autre part les discussions qui ont suivi ces présentations.
Le Secrétariat général attire l’attention du lecteur sur le fait que les précisions et corrections suggérées par les participants au cours des discussions ont été intégrées aux rapports de synthèse ainsi qu’au rapport général publiés ci-après.
En outre, certaines interventions se réfèrent aux rapports nationaux préparés pour le Congrès par chacune des institutions participantes. Ces rapports, supports de travail du Congrès, ont été diffusés à Libreville sous la forme d’une brochure par pays. Par conséquent, la pagination à laquelle il est fait référence par les intervenants ne correspond pas au foliotage de la présente publication. Cependant, pour faciliter la lecture de ces débats, est indiqué, entre crochets, le numéro de la page du présent volume sur laquelle porte l’intervention.
Enfin, le Secrétariat général a choisi d’identifier les intervenants uniquement par leurs nom et institution d’appartenance. Toute information supplémentaire relative à leur(s) titre(s) et fonction(s) peut être recherchée sur la liste des participants publiée ci-après p. 773.
Le droit au recours
sous la présidence de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar

Libreville, deuxième Congrès de l’ACCPUF
De gauche à droite : Monsieur Jean-Michel RAJAONARIVONY, juge à la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar, Madame Conceptia D. OUINSOU, présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin.
Le droit de recours

Premier rapport de synthèse par Madame Conceptia D. OUINSOU,
présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin
Juin 2000
Ouverture du droit de saisine
L’accès à la juridiction constitutionnelle varie selon les pays membres de l’ACCPUF.
I 1. – Les requérants
I 1.1. – Tableau des saisines par type de requérant
- Dans certains pays comme la Belgique, le Bénin, le Canada, la Centrafrique, le Gabon, l’Ile Maurice, le Sénégal, la Slovénie et la Suisse, le droit de saisir le juge constitutionnel est accordé aux autorités publiques et aux personnes physiques. En Slovénie, le droit de saisir le juge constitutionnel est aussi accordé aux personnes morales. Toutefois, en Belgique, au Canada et en Slovénie, la personne physique (ainsi que la personne morale en Slovénie) qui saisit la juridiction constitutionnelle doit justifier d’un intérêt à agir.
- Tandis que Madagascar, la Roumanie et le Sénégal n’offrent cette opportunité à la personne physique qu’à l’occasion d’un procès au cours duquel a été soulevée l’exception d’inconstitutionnalité.
- On note en revanche, une restriction au niveau des pays comme : la Bulgarie, le Cambodge, Djibouti, la France, la Guinée, le Liban, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, la Moldavie, le Rwanda, le Tchad et le Togo. Dans ces pays, la saisine est ouverte aux autorités publiques seules.
- Mais il convient de relever quelques particularités dans les rapports soumis à étude :
1. – Au niveau de l’Ile Maurice, le requérant peut être une personne physique ou morale. Aux termes de l’article 83 de la Constitution « lorsqu’une personne prétend qu’une disposition quelconque de la Constitution a été violée et que ses intérêts ont été ou sont susceptibles d’être affectés par une telle violation, elle peut, sans préjudice de tout autre action légalement disponible à propos de la même question, saisir la Cour suprême pour obtenir une déclaration à cet effet et réparation en vertu du présent article ». Le rapport ne mentionne aucune disposition traitant particulièrement du contrôle normatif.
2. – En Slovénie, l’accès à la Cour constitutionnelle est permis aux personnes morales telles que les organes représentatifs des collectivités locales et les représentants des syndicats au niveau national si les droits des collectivités et des travailleurs sont menacés. Par ailleurs, le médiateur pourra saisir la Cour constitutionnelle des cas individuels qui lui sont soumis.
3. – Au Liban, le droit de saisine est accordé aux chefs des communautés religieuses, mais uniquement en ce qui concerne les « intérêts religieux » au nom desquels ces communautés ont été érigées.
4. – S’agissant de l’Égypte et de la République de Haïti, les rapports présentés restent muets sur la question de la qualité des requérants.
Il faut noter que toutes les Cours n’ont pas élaboré un tableau synthétique quantitatif des saisines.
I 1.1. – Les conditions d’ouverture du recours ont-elles évolué dans le temps ?
Sur les vingt-six (26) rapports qui ont été examinés, sept (7) seulement ont mentionné des modifications relatives aux conditions d’ouverture des recours.
Le Bénin a, par suite de la modification de son Règlement intérieur le 18 novembre 1997, étendu les conditions de recevabilité aux citoyens qui ne savent pas signer, admettant de suite comme condition de validité de la requête, l’apposition d’empreintes digitales.
La Haute Juridiction a également admis depuis août 1997, le recours introduit par des Étrangers, ceux-ci bénéficiant sur le territoire de la République, aux termes des dispositions de l’article 39 de la Constitution, des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi.
En France, les deux réformes constitutionnelles intervenues les 29 octobre 1974 et 25 juin 1992 ont élargi le droit de recours, qui s’est révélé être à chaque fois, au profit de la minorité parlementaire.
Au Gabon, la réforme n’a concerné que le recours par voie d’exception à la faveur d’une révision constitutionnelle. Dorénavant, le juge du fond, une fois l’exception soulevée par le justiciable, se borne à saisir la Cour par voie d’exception préjudicielle.
Au Maroc, les révisions constitutionnelles de 1992 et 1996 ont porté sur la nature des actes contrôlés (la loi ordinaire avant sa promulgation) et les bénéficiaires du droit de saisine (le président de la Chambre des conseillers et la minorité au sein de celle-ci : le quart de ses membres).
La révision en 1998 de la Constitution malgache laisse augurer d’un changement structurel important. Dès la mise en œuvre effective de la réforme territoriale, le droit de saisine sera ouvert au président de la République pour les lois organiques et les ordonnances avant leur promulgation, aux chefs d’institutions et aux trois-quarts des membres composant l’une des Assemblées
Parlementaires pour les lois ordinaires avant leur promulgation, et à toutes personnes physiques devant une juridiction quelconque, pour l’inconstitutionnalité d’une disposition législative ou réglementaire qu’elle estime comme pouvant porter atteinte à ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution.
En Roumanie, la Loi modificative n° 138 de 1997 a porté entre autres sur la réglementation des jugements des exceptions d’inconstitutionnalité par le Plénum de la Cour, l’établissement des conditions d’irrecevabilité des exceptions d’inconstitutionnalité, ainsi que la possibilité pour les tribunaux de vérifier eux-mêmes l’existence de celles-ci.
I 1.3. – La Cour elle-même dispose-t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?
La possibilité d’une auto-saisine spécifique aux juridictions du Bénin et de l’Égypte n’est pas connue de toutes les autres juridictions constitutionnelles de l’Association.
Au Bénin, l’article 121 alinéa 2 de la Constitution permet à la Cour constitutionnelle de se « saisir d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne publique et aux libertés publiques ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 23 du Règlement intérieur l’autorisent à rectifier d’office toute décision entachée d’erreurs matérielles et à procéder à tous amendements jugés nécessaires.
En Égypte, la Cour peut « s’auto-saisir » sur la base de l’article 27 de la Loi sur la Cour qui prévoit que « dans tous les cas, la Cour peut décider de l’inconstitutionnalité de tout texte légal ou réglementaire qu’elle rencontre dans l’exercice de ses compétences et qui a un rapport avec le litige qui lui est soumis, après avoir suivi la procédure prescrite pour la mise en état des actes d’inconstitutionnalité ».
Le juge mauricien quant à lui, joue toujours le rôle de gardien de la Constitution et, indépendamment de la nature du contentieux, tranchera de droit, incidemment ou pas, toute question relative aux droits fondamentaux qui apparaît lors d’un procès devant la Cour suprême.
Cependant, il faudra préciser que cette procédure se lit en filigrane dans les textes fondamentaux des pays comme la France, la Roumanie et la Slovénie et est applicable dans des conditions bien précises.
Ainsi :
- lorsque le Conseil constitutionnel français est saisi d’un texte dans les conditions prévues par l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, le juge constitutionnel peut soulever d’office des griefs qui n’ont pas été invoqués par les requérants ;
- en Roumanie, la Cour ne peut se saisir d’office qu’en cas d’initiatives de révision de la Constitution ;
- enfin, selon le principe de connexité, la Cour constitutionnelle slovène peut statuer exceptionnellement aussi, en plus de la disposition contestée, sur la constitutionnalité et la légalité d’autres dispositions du même ou d’un autre règlement.
I 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?
La liberté accordée au requérant de se rétracter devant la juridiction constitutionnelle ne s’observe pas au niveau de tous les membres de l’Association. La Belgique, le Bénin, le Cambodge, le Canada, la Centrafrique, Djibouti, l’Égypte, le Gabon, l’Ile Maurice, la Moldavie, la Slovénie et le Togo seuls permettent cette procédure.
Celle-ci est assortie de certaines conditions dans des pays comme la Belgique où elle dépend du type de recours.
Elle n’est généralement enfermée dans aucun délai. Et dans tous les pays, la lettre de désistement doit parvenir à la juridiction constitutionnelle avant que cette dernière ne statue sur la requête initiale.
Dans la plupart des cas, le caractère partiel du désistement dépend du requérant.
Le rapport du Maroc exclut le principe du désistement dans les cas de saisine obligatoire. Toutefois, il précise que cette éventualité pourrait être accordée aux parlementaires requérants.
En revanche, pour la France, la Guinée, le Liban, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, la Roumanie et le Tchad, le désistement n’est pas permis.
Quant aux rapports d’Haïti, du Rwanda, de la Suisse et du Sénégal, ils n’ont pas répondu à la question.
I 2. – Actes contrôlés
I 2.1. – Tableau des saisines par type d’acte contrôlé
Les actes soumis au contrôle constitutionnel sont quasiment les mêmes dans la plupart des pays. On peut citer notamment les lois, les lois organiques, les règlements des Assemblées, les traités.
Au Bénin, au Gabon et en Roumanie, les ordonnances du président de la République et du gouvernement dans le cas de la Roumanie peuvent être également soumis au contrôle de constitutionnalité, de même que les décrets au Bénin, au Gabon, au Rwanda et en Slovénie.
L’éventail assez large des actes déférés à son contrôle permet à la Cour constitutionnelle du Bénin de censurer aussi les arrêtés et les actes administratifs pris par le gouvernement et présumés inconstitutionnels.
Au Canada, toute règle de droit est susceptible d’être contrôlée. Cette expression couvre les règlements municipaux et l’ensemble de la common law. Le système judiciaire constitutionnel suisse diverge notablement de tous les systèmes européens. Dans ce pays, « le Tribunal Fédéral ne dispose pas du pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois fédérales de la Confédération sous aucune forme (ni a priori, ni a posteriori, ni abstrait, ni concret), sauf lorsqu’une telle compétence découle d’un traité international entré en vigueur pour la Suisse… de sorte que la juridiction constitutionnelle suisse ne concerne que le contrôle de la législation des États membres cantonaux… ». De l’analyse de tous les tableaux présentés dans cette rubrique, le contrôle de constitutionnalité des lois (ordinaires ou organiques) est en bonne place.
I 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle ?
Ici, les actes qui ne peuvent être soumis au contrôle constitutionnel varient selon les pays.
Ainsi, la norme de référence qu’est la Constitution elle-même ne peut être contrôlée dans bon nombre de pays comme le Bénin, le Canada, la Centrafrique et le Sénégal ; il en est de même des actes du gouvernement au Cambodge, à Djibouti, en Roumanie et au Togo. Au Canada, en Guinée et au Maroc, les traités ne peuvent plus être contrôlés par les juridictions constitutionnelles lorsqu’ils sont déjà ratifiés. En France et en Centrafrique, les lois référendaires échappent au contrôle de la Haute juridiction constitutionnelle. C’est également le cas des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire exclues du contrôle au Bénin et dans de nombreux systèmes, des actes royaux portant lois ou lois organiques pris pendant les périodes de transition interparlementaires au Maroc. Les actes royaux (dahirs) peuvent cependant être soumis au contrôle du Conseil constitutionnel à l’occasion d’un examen aux fins de délégalisation.
La Bulgarie, le Gabon, Haïti, le Liban, le Rwanda, la Slovénie et la Suisse n’ont pas donné de précisions sur cette rubrique.
Le constat fait à ce niveau du questionnaire est que dans le tableau précédent, la plupart des pays n’y ont pas mentionné les actes réglementaires en tant qu’actes contrôlés. Ils ne les ont pas non plus classé dans la catégorie des actes hors contrôle.
I 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi est-il possible de contester la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle qui fait l’objet du recours modifie ?
En principe, l’institution du contrôle a priori de la loi implique déjà un examen approfondi de sa conformité à la Constitution. Ce contrôle du texte de loi, obligatoire dans certains pays, est fait avant toute promulgation. Sur cette base, on ne saurait mettre en vigueur une loi sans l’avoir soumise au contrôle de constitutionnalité. C’est cette idée qui sous-tend la réponse négative de la plupart des rapports étudiés qui soutiennent que l’on ne saurait contester la constitutionnalité d’une loi que celle qui fait l’objet d’un recours modifie.
Toutefois, quelques adaptations structurelles sont notées. Ainsi, une décision du Conseil constitutionnel français a indiqué que « si la régularité au regard de la Constitution des termes de la loi promulguée peut être utilement contestée à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine, il ne saurait en être de même lorsqu’il s’agit de la simple mise en application d’une telle loi ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 27 de la Loi sur la Cour suprême Constitutionnelle égyptienne relatives à l’auto-saisine de cette juridiction prévoient en outre que « dans tous les cas, la Cour peut décider de l’inconstitutionnalité de tout texte légal ou réglementaire qu’elle rencontre dans l’exercice de ses compétences et qui a un rapport avec le litige qui lui est soumis, après avoir suivi la procédure prescrite pour la mise en état des actes d’inconstitutionnalité ».
De même, en Moldavie, « en contrôlant la constitutionnalité d’un acte contesté, la Cour peut prononcer un arrêt concernant autres actes normatifs, dont la constitutionnalité dépend, en tout ou en partie, de la constitutionnalité de l’acte contesté. Article 6 alinéa 3 du code de la juridiction constitutionnelle ».
I 3. – Les délais
I 3.1. – Y a-t-il des recours recevables sans délai ?
D’une façon générale, dans la plupart des pays, les lois (ordinaires et organiques) sont soumises au contrôle de constitutionnalité après adoption et avant leur promulgation. Les recours sont formés dans un délai variant de six (6) jours (Djibouti – Sénégal), huit (8) jours (Guinée), quinze (15) jours (Bénin – France – Gabon – Mali – Tchad – Togo) à trente (30) jours (Maroc – Mauritanie).
Les règlements des Assemblées sont généralement soumis au contrôle de constitutionnalité avant leur mise en application. Mais au Sénégal, le recours doit être formé six (6) jours après l’adoption du texte. Au Maroc, pour être recevable, il doit être formé avant la promulgation du texte.
Les lois portant ratification des traités ou engagements internationaux peuvent faire l’objet de recours seulement avant la ratification du traité ou de l’engagement.
Quant aux recours relatifs à la nature législative ou réglementaire d’une disposition, ils ne sont soumis à aucun délai dans les pays où la procédure est en vigueur, sauf au Sénégal où le délai est fixé à huit (8) jours.
En Belgique, tout recours en annulation doit être formé dans le délai de six (6) mois (60 jours pour les lois d’assentiment aux traités) à compter de la publication de la loi au Moniteur belge (Journal officiel). Il y a toutefois des cas de réouverture des délais, notamment après un arrêt préjudiciel de la Cour.
En Centrafrique, les recours par voie d’action contre les lois (ordinaires et organiques) sont formés contre des lois déjà promulguées ; aucun délai n’est de même imposé à ceux exercés par voie d’exception.
En Slovénie, les délais paraissent beaucoup plus longs : en effet, « le recours constitutionnel (violation des droits de l’homme) doit être formé dans les soixante (60) jours de la notification de l’acte individuel contre lequel ce recours est autorisé (art. 52 (1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle) ; la requête de la décision sur des conflits de compétences entre les tribunaux et autres organes de l’État ou entre l’Assemblée nationale, le président de la République et le gouvernement, peut être présenté par un des organes concernés dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date à laquelle ce dernier a eu connaissance de l’atteinte portée à sa compétence par un autre organe (art. 61-1 de la Loi sur la Cour constitutionnelle).
En Bulgarie, aucun délai n’est fixé par les textes constitutionnels ; le recours est en conséquence recevable dès la publication du texte de loi.
Au Cambodge, les recours sont recevables sans délai excepté ceux qui sont contre les lois organiques. Le recours doit être formé dans ce cas avant la promulgation.
Au Canada et en Roumanie, aucun délai n’est fixé pour les recours.
I 3.3. – Les délais ont-ils changé sur la période d’ensemble ?
Aucun des Cours et Conseils Constitutionnels n’a apporté une modification aux délais de recours sus indiqués.
I 3.4. – Sont-ils l’objet de critiques ? Pour quelles raisons ?
Ceux-ci ont été l’objet de vives critiques dans certains pays comme la France, le Gabon et Djibouti.
Ces critiques ont essentiellement trait à la durée très courte des délais impartis aux requérants pour saisir le juge constitutionnel. Ils se heurtent très souvent à une fin de non-recevoir, le chef de l’État ayant déjà promulgué la loi au moment de l’introduction du recours.
Débats
Débats
M. Rajaonarivony, président de séance, Haute Cour constitutionnelle de Madagascar : Merci Madame le président pour vos remarques et vos commentaires très pertinents qui pourront servir de base à une discussion que nous espérons très animée et fructueuse. Peut-être faudrait-il d’abord demander, pour un bon déroulement de nos débats, à chaque pays qui a produit un rapport national de nous indiquer s’il y a ou non des modifications à introduire dans son rapport. Est-ce que chaque pays qui a fait un rapport national maintient ce qui ressort de ce rapport de synthèse ?
M. Khair, Conseil constitutionnel du Liban : Le rapporteur, voulant faire un travail très résumé, a omis certains détails de nos rapports qui ont leur importance et qui reflètent une certaine physionomie du pays en question. Je veux parler, et cela est indiqué dans le rapport libanais, du droit de recours ou droit de saisine accordé au Liban aux chefs des communautés religieuses. Je ne veux pas trop m’étendre sur la question, mais ce droit de saisine est dans le fil d’une tradition qui date depuis l’époque ottomane en Orient et qui accorde aux communautés religieuses un droit de législation et un droit de juridiction en matière de statuts personnels.
Mme Peeroo, Cour suprême de l’Ile Maurice : J’ai une rectification à faire au niveau de la question relative à la possibilité pour la Cour suprême de s’auto-saisir. En réalité, notre Cour ne peut pas s’auto-saisir. Il faut qu’il y ait un procès devant la Cour. Les articles 17, 83, 84 et 119 de la Constitution donnent certains moyens à la Cour suprême pour statuer en matière constitutionnelle. Ils sont : (1) la mise en œuvre des garanties des droits fondamentaux et des libertés individuelles ; (2) ja juridiction de première instance de la Cour suprême en matière constitutionnelle ; (3) le renvoi des questions constitutionnelles à la Cour suprême (juridiction d’exception) ; et (4) la compétence sauvegardée de la Cour suprême pour apprécier si la personne ou l’autorité qui n’est soumise au contrôle d’aucune autre personne ou autorité dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Constitution a en effet exercé ses fonctions en conformité avec la constitution ou toute autre loi. Donc il faut qu’il y ait un procès devant la Cour pour que la Cour suprême puisse statuer.
Mais bien sûr, elle veillera à ce que les droits fondamentaux prescrits dans la Constitution ne soient pas violés.
M. Melchior, Cour d’arbitrage de Belgique : Une brève observation particulière qui peut déboucher sur une réflexion plus générale. L’excellent rapport de Madame la présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin a exprimé en quelques sorte la dualité entre la saisine par requête d’une part et d’autre part l’auto-saisine. Je pense qu’il y a une troisième hypothèse qui est explorée par certaines de nos Cours, c’est l’exception d’inconstitutionnalité, c’est-à-dire la possibilité d’une saisine par les juridictions, je crois que c’est une hypothèse qui présente un grand intérêt.
M. Fiser, Cour constitutionnelle de Slovénie : J’ai une remarque à propos du rapport de synthèse chapitre I-1.1., parce que je dois dire que la conclusion faite par le rapport concernant la Slovénie n’est pas complètement exacte. Il est écrit qu’en Slovénie, l’accès à la Cour constitutionnelle est ouvert aussi aux personnes morales telles que les représentants des collectivités locales et les représentants des syndicats. Cela est vrai, mais c’est un droit propre et ultérieur. Nous devons commencer avec l’individu, le citoyen et aussi avec les personnes qui ont déjà en vertu de la Constitution slovène le droit de saisir la Cour constitutionnelle s’ils peuvent démontrer un intérêt à agir. Alors existe la possibilité ultérieure pour les collectivités locales et pour les syndicats, dans les conditions explicitement prévues dans la loi, de saisir aussi la Cour constitutionnelle.
M. Rajaonarivony, président de séance, Haute Cour constitutionnelle de Madagascar : Merci Monsieur. Il me semble que la notion de médiateur ressort de votre rapport national. Est-ce que vous pouvez donc nous donner quelques précisions complémentaires sur le médiateur.
M. Fiser, Cour constitutionnelle de Slovénie : Une personne physique ou une personne morale n’a pas besoin de saisir le médiateur pour accéder à la Cour constitutionnelle. Le médiateur dispose également d’un droit de saisine propre pour les cas qu’il traite. Mais il n’y a pas d’obligation pour le citoyen de saisir le médiateur. L’individu, c’est-à-dire tant la personne physique que la personne morale, qui peut démontrer un intérêt à agir, peut accéder directement à la Cour constitutionnelle.
M. Rajaonarivony, président de séance, Haute Cour constitutionnelle de Madagascar : C’est très clair. Donc l’individu, et c’est une garantie des libertés fondamentales, tant individuelles que publiques, a un droit de recours direct devant la Cour constitutionnelle et le médiateur aussi, d’un autre côté, a ce droit en sa qualité de médiateur.
M. Loudghiri, Conseil constitutionnel du Maroc : Je m’associe évidemment au concert d’éloges faites au rapport du Bénin, rapport qui se caractérise par sa clarté et, lors de son exposé, par sa vivacité. Et je remercie particulièrement le rapporteur d’avoir porté un intérêt particulier au Maroc, lorsqu’il s’est agi d’indiquer les actes dits placés hors contrôle. Il y a simplement une petite précision à ajouter – et encore une fois le rapporteur n’est pas responsable de l’imprécision – cette imprécision résulte probablement de la formulation dans notre rapport national. Il est indiqué dans votre rapport que les actes royaux échappent totalement au contrôle du Conseil constitutionnel. C’est exact en partie, mais il y a au moins une phase lors de laquelle ce contrôle est exercé par le Conseil constitutionnel. C’est lorsqu’on est appelé à modifier des textes dits dahirs, promulgués, pris par le roi pendant la période au cours de laquelle il exerce les fonctions du législateur, les périodes d’exception et les périodes transitoires. Ces dahirs là, qui sont des actes royaux sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel lorsqu’ils sont appelés à être modifiés. On ne peut les modifier par voie de décret que si le Conseil constitutionnel exerce son contrôle et dit qu’ils relèvent véritablement du pouvoir réglementaire. Donc ce que vous avez dit est exact, mais il y a cette petite exception qui est de taille, à savoir que le Conseil exerce quand même un contrôle sur ces actes royaux au moment où ils doivent faire l’objet d’une modification. Puisque je parle des actes échappant au contrôle constitutionnel, je relève dans votre rapport que vous n’avez cité qu’un seul exemple pour dire que les décisions judiciaires, c’est-à-dire rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire, ne sont pas soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle, or je pense que c’est le cas général – c’est le cas du Maroc en tout cas. C’est le cas de la France. Je ne connais pas beaucoup de pays qui soumettent les décisions judiciaires au contrôle du Conseil constitutionnel sans quoi il y aurait là un autre degré de juridiction qui, à mon avis, serait contraire à un certain nombre de principes que nous ne devons pas remettre en question.
M. Lô, Conseil constitutionnel du Sénégal : J’interviens dans ce débat à la suite de l’intervention de Monsieur le représentant du Conseil constitutionnel du Maroc avant de donner mon appréciation sur le rapport. Cette intervention a trait au recours susceptible d’être porté contre les décisions rendues par les juridictions suprêmes : Cour de Cassation ou même Conseil d’État. Exceptionnellement, au Sénégal, il existe une procédure qui consiste à déferrer au Conseil constitutionnel les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions suprêmes. C’est le rabat d’arrêt [1]. Quand le dernier juge dans la hiérarchie rend une décision définitive, ce qui lui confère d’ailleurs le caractère d’une loi, parce qu’en principe, il n’y a plus de voie de recours, elle s’impose avec l’autorité de la chose jugée. La procédure dite de rabat d’arrêt permet de remettre en cause la décision devant la même juridiction [2]. Le recours en inconstitutionnalité est ouvert contre les décisions rendues sur rabat d’arrêt (Conseil constitutionnel D n° 11/93 du 23 juin 1993, p. 4) [3].
Je crois que cette précision devait être donnée parce que nous sommes confrontés à des situations nationales diverses. Il est extrêmement difficile, à partir de tant d’expériences nationales, de faire un rapport de synthèse, à cause de la diversité de notre démarche et de la diversité des problèmes que nous avons à résoudre dans notre espace judiciaire national. Certes le fonds commun, hérité du droit français, nous fait partager beaucoup de choses, mais l’évolution de notre pays nous conduit parfois à adopter des dispositions qui divergent.
Je félicite le Bénin pour avoir fait un rapport de synthèse à partir de trente expériences nationales divergentes. C’est le premier mérite de ce rapport, d’avoir osé le faire. La question qui est posée sur le droit de recours constitutionnel est essentiellement commandée par les compétences de la Cour. C’est une juridiction qui a un objectif déterminé, puisqu’il s’agit de juger en fonction de la Constitution. Or, l’objet de la Constitution, c’est non seulement de déterminer les compétences des pouvoirs publics, mais de les réguler, ce qui peut expliquer une restriction de la saisine de la Cour. La saisine est commandée en partie par les compétences qui sont dévolues par les Constitutions. Or ces compétences sont essentiellement tournées vers l’organisation des pouvoirs de l’État. Cela va expliquer la restriction du droit de saisine aux seuls pouvoirs publics comme c’est le cas au Sénégal. Il s’agit donc principalement de conflits de compétences qui peuvent surgir entre l’exécutif et le législatif, et la Cour doit arbitrer. C’est le cas de la France. C’est en fait quelque chose d’exceptionnel que dans la tradition française, on puisse trouver un juge au législateur. Je crois que la première expérience est celle qui a été élaborée par la Constitution de 1958. Donc c’est cette restriction à la régulation des relations entre les pouvoirs publics qui explique pourquoi beaucoup de choses sont exclues de la compétence des Cours et entraîne par voie de conséquence l’étroitesse du droit de saisine.
Il y a d’un côté le président de la République et les autres pouvoirs publics cités dans la Constitution qui peuvent, pour défendre leurs compétences respectives, saisir directement le Conseil constitutionnel par voie d’action. Cela se situe parfois au moment de la procédure législative. Les individus ne sont pas admis par voie d’action à saisir les Cours constitutionnelles, parce que finalement, le problème qui se pose n’est pas un problème d’atteinte à leur liberté, mais un problème d’empiètement de compétences. Et certaines Cours font de timides avancées dans ce sens en permettant par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité, en cours de procédure devant d’autres juridictions, de soulever cette question sous la forme d’une question préjudicielle qui permet au juge saisi de la question évoquant l’inconstitutionnalité de la loi qui s’applique, ou de la mesure normative qui s’applique, de surseoir à statuer et de saisir la Cour constitutionnelle pour qu’elle puisse se prononcer sur la validité de la norme qui est en train d’être appliquée dans un litige concret. Donc il s’agit là d’un contrôle par voie d’exception. Et ce n’est que de côté-là que les personnes physiques et les individus peuvent avoir accès, de façon indirecte d’ailleurs, au Conseil constitutionnel sur un procès qui les oppose et dont la norme qui s’applique peut être considérée comme anti-constitutionnelle.
Cette solution s’explique par la définition des compétences qui sont données au Conseil constitutionnel : si cette compétence est de veiller au respect de la Constitution, alors il s’agira tout simplement de faire en sorte que chaque organe constitutionnel reste dans son domaine de compétence. Et le droit de saisine est limité aux organes dont les compétences peuvent être menacées par un autre organe.
Pour les individus, en ce qui concerne maintenant la défense des droits énumérés dans des préambules ou les chartes des droits de l’homme qui ont valeur constitutionnelle, ce n’est que par voie d’exception qu’ils peuvent saisir la Cour quand leurs droits se trouvent menacés ou quand ces droits sont contestés sur la base d’une disposition normative qu’ils considèrent comme anticonstitutionnelle. C’est le recours de la voie d’exception d’inconstitutionnalité.
Je crois que la difficulté réside évidemment dans la nouveauté du système de contrôle constitutionnel dans les pays africains, systèmes contemporains peut-être de la Constitution de 1958 qui a inspiré beaucoup de nos constitutions. Et à partir de ce moment-là, j’ai pu noter – et c’est là l’intérêt de nos rencontres – les expériences nationales qui conduisent à des avancées que l’on peut considérer comme révolutionnaires dans ces systèmes. Les avancées de la Cour du Bénin par exemple qui permettent non seulement à des individus, à des étrangers de saisir la Cour, et cela sur n’importe quel acte à valeur normative, ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays. Et cela, je crois que c’est quelque chose qui mérite d’être souligné pour que de part et d’autre nous puissions nous inspirer de ces avancées-là pour faire progresser le droit dans nos pays. Voilà, l’observation que je voulais faire sur ce point.
M. Rajaonarivony, président de séance, Haute Cour constitutionnelle de Madagascar : Merci Monsieur le conseiller. Votre exposé est très clair. Permettez-moi cependant de vous poser une question suscitée par votre exposé. Si j’ai bien compris, votre système de compétences est basé sur une compétence ratione materiae, c’est-à-dire que c’est le fond qui détermine la compétence mais votre système opère aussi une distinction fondée sur la personne : les pouvoirs publics peuvent saisir votre Conseil par voie d’action alors que les individus ne pourraient disposer que d’un recours indirect dans le cadre d’une procédure par voie d’exception.
La première question que vous avez traitée porte sur les décisions juridictionnelles pour lesquelles votre Cour constitutionnelle peut être considérée comme un troisième degré de juridiction. Peut-être serait-il intéressant de voir quelles sont les conditions d’ouverture de ce recours, de ce troisième degré, en fait, et quels sont les effets. Est-ce que vous annulez donc des décisions déjà rendues par le dernier degré de juridiction par exemple ?
M. Lô, Conseil constitutionnel du Sénégal : Oui, en fait, c’est l’équivalent du recours dans l’intérêt de la loi. On peut l’assimiler à cette procédurelà, mais avec des effets tout à fait différents, parce que dans le recours dans l’intérêt de la loi, que l’on peut faire devant une juridiction suprême, il n’y a pas d’effets entre les parties. La décision qui a été rendue est devenue définitive, mais peut-être que le juge a pu commettre une erreur dans son appréciation et rendre une décision qui ne peut plus être contestée. Pour rétablir la hiérarchie des normes, et éviter que demain cette décision ne puisse servir de référence à d’autres décisions qui vont continuer à violer la loi, on permet, dans l’intérêt de la loi, de rectifier, en fait, l’erreur du juge qui sinon ne peut plus être rectifiée par une autre juridiction. Mais cette rectification se fait sans remise en cause des dispositions rendues entre les parties.
Dans la procédure de rabat d’arrêt, c’est le contraire. La décision qui est rendue a un effet similaire à celui d’une décision rendue par une juridiction de première instance. Donc c’est là l’amorce d’un troisième degré de juridiction comme vous l’avez bien noté. Et cela, je crois que nous avons eu à l’appliquer dans des dispositions concernant d’ailleurs des litiges relatifs à la compagnie multinationale Air Afrique et un certain nombre de ses travailleurs qui, en fait, ont été licenciés. La procédure a suivi tout son cours jusqu’à la Cour de Cassation, mais elle a fait l’objet d’un recours en exception d’inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel qui a remis en cause la décision rendue par la Cour de Cassation sur cet aspect du problème.
M. Rajaonarivony, président de séance, Haute Cour constitutionnelle de Madagascar : Merci Monsieur le conseiller. Cette procédure est vraiment intéressante et pourrait inspirer nos Cours.
M. Guilao, Cour suprême de Guinée : Je souhaiterais simplement savoir si cette procédure est systématique, c’est-à-dire si tous les arrêts des hautes juridictions telles que le Conseil d’État ou la Cour de Cassation qui ne font plus l’objet de recours sont systématiquement déférés devant le Conseil constitutionnel ou s’il s’agit de décisions qui violent manifestement la loi ? Et alors, je vous pose une question : qui constate que cette décision-là, à ce niveau-là, viole manifestement la loi pour qu’il y ait la procédure de rabat
d’arrêt ? Qui saisit le Conseil constitutionnel dans ces conditions ?
M. Lô, Conseil constitutionnel du Sénégal : Je dois d’abord donner une précision. Notre Conseil constitutionnel n’a pas de saisine automatique. Donc il faut qu’il soit saisi par quelqu’un. Comme il s’agit d’un procès entre particuliers, c’est celui qui se plaint de la décision qui prend l’initiative de saisir le Conseil constitutionnel. C’est clair. Il n’y a pas de saisine systématique, il faut que les intéressés se rendent compte que leurs intérêts sont lésés par la décision et qu’ils veuillent aller au-delà. Donc ce sont les requérants, l’un des requérants qui a perdu, qui a le droit de saisir le Conseil constitutionnel par voie d’exception avec les moyens qu’il va développer comme pour un procès contradictoire. En dehors de ce cas, le procès constitutionnel n’est pas contradictoire sauf en ce qui concerne cet aspect du litige qui lui est transmis par des particuliers qui contestent la décision rendue en dernier ressort par une juridiction suprême, un rabat d’arrêt.
Mme Ouinsou, rapporteur, Cour constitutionnelle du Bénin : C’est un sujet qui m’intéresse beaucoup dans la mesure où nous nous débattons dans ce dilemme. Si je reviens au cas spécifique du Bénin, comme je le disais tantôt, la Cour suprême du Bénin rend sa décision et sa décision est sans recours et s’impose à tout le monde. La Cour constitutionnelle rend des décisions qui sont sans recours et elle s’imposent également à tous.
Alors le problème que nous essayons de résoudre, de façon académique pour le moment, est le suivant : si une décision rendue par la Cour suprême a manifestement violé une disposition de la Charte africaine des droits de l’homme qui fait partie intégrante de notre Constitution, et qui a donc manifestement violé une disposition constitutionnelle, alors nous nous posons la question de savoir si un individu, comme on le fait au Sénégal, saisit la Cour constitutionnelle, est-ce que la Cour constitutionnelle du Bénin a le droit de trancher au fond ? Là est tout le problème. La question que je voudrais vous poser est la suivante : la procédure de rabat est-elle prévue dans la Loi organique du Conseil constitutionnel du Sénégal ?
M. Lô, Conseil constitutionnel du Sénégal : C’est une nouveauté. En 1992, quand le Conseil constitutionnel du Sénégal a été créé, après l’éclatement de la Cour suprême, on lui a transféré les compétences politiques de la Cour suprême en ce qui concerne le contrôle des élections. Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs a été dévolu au Conseil d’État. Et on a créé une Cour de Cassation pour s’occuper de tout ce qui est judiciaire.
La procédure du rabat d’arrêt prévue par l’article 33 de la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 est un cas d’ouverture du recours en exception d’inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel (article 20 de la Loi organique 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel).
Donc la Cour ne peut pas inventer des éléments de compétence qui lui permettent de remettre en cause les décisions qui sont rendues par les juridictions suprêmes du Sénégal qui sont au nombre de deux : le Conseil d’État et la Cour de Cassation. Donc cela fait partie des compétences que le législateur a reconnu au Conseil constitutionnel sénégalais de procéder par voie de rabat d’arrêt à la remise en cause des décisions définitives rendues par les juridictions suprêmes.
M. Zinzindohoue, Association ouest-africaine des hautes juridictions francophones : Je voudrais intervenir sur la question qu’a posée Madame le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, à savoir que doit faire la Cour constitutionnelle si une décision définitive d’une structure judiciaire viole manifestement la Constitution. Cette question a trouvé un début de réponse auprès de notre collègue du Sénégal.
Je voudrais dire deux choses. En l’état de la loi au Bénin, comme l’a si bien dit Madame le président, les décisions de la Cour suprême sont sans recours et s’imposent à tous les pouvoirs, à toutes les juridictions, à toutes les autorités. Si l’on considère cela et qu’on considère que le rôle de la Cour constitutionnelle est de contrôler la constitutionnalité des lois et des règlements, une décision de justice en tant que telle n’est ni une loi au sens formel, juridique, ni un acte administratif. Si on constate cela, on peut dire que de ce point de vue, il n’y a aucune possibilité. Déjà au niveau de la Cour suprême, nous ne sommes même pas un troisième degré de juridiction, puisque les juges de la Cour suprême sont des juges du droit, ils ne sont même pas des juges du fait.
Et la tendance actuellement en Afrique, quand on prend les textes de l’OHADA est de réduire, dans le domaine du droit des affaires, les délais mêmes des procédures des litiges. Et pour un certain nombre d’affaires, il n’y a même plus de navette : quand le tribunal de l’OHADA est saisi, il règle une fois pour de bon, de façon définitive, un certain nombre de choses. Donc la tendance est à réduire le délai des procès. On ne peut pas poursuivre un procès éternellement. Alors quand on vient parler de rabat d’arrêt, il faut que les choses soient assez claires. Est-ce qu’il s’agit d’un troisième degré de juridiction ? Il faudrait que les choses soient claires sinon on remettra en cause incessamment des décisions, on n’en finira pas. Donc je crois que ce serait bon que nous ayons ces textes sous les yeux, que nous puissions bien les lire, comprendre, parce que cela a un intérêt à la fois théorique et pratique compte tenu de la question qu’a posée Madame le président. Est-ce que c’est une hypothèse d’école ? Est-ce que c’est un cas concret ? Ce serait bon que nous puissions voir cela, notamment des cas concrets, sinon nous risquons de remettre en cause des principes de base.
M. Rajaonarivony, président de séance, Haute Cour constitutionnelle de Madagascar : Merci Monsieur, je crois que c’est une réflexion très intéressante étant donné que nous savons tous que les constitutions sont propres à chaque pays, mais nous sommes uniquement là, non pas pour porter des
jugements de valeur, mais pour essayer de débattre un peu, afin d’avoir peut-être une inspiration future sur nos jurisprudences, sur nos constitutions ou notre législation.
M. Hountondji, Cour constitutionnelle du Bénin : Ce dont on parle concernant les décisions de la Cour suprême, c’est un cas concret. La Cour du Bénin a déjà statué une fois sur ce cas et je me souviens de l’arrêt n° 93-06/CJ-P rendu le 22 avril 1993 par l’Assemblée plénière de la Cour suprême (arrêt Campbell) où la Cour suprême a violé manifestement les droits de la défense. Nous avons été saisis à la Cour et n’avons pas pu aller au fond. C’est notre décision DCC 95-001 du 6 janvier 1995. Et cela nous pose problème aujourd’hui, parce que nous ne savons pas ce qu’il faut faire. Il y a une décision rendue. Donc c’est un cas réel que nous vivons actuellement chez nous. Ensuite, je voudrais revenir sur les questions de délais qui nous posent des problèmes pratiques. Les délais sont souvent trop courts et ce sont des délais constitutionnels. Ce qui arrive, c’est que l’instruction est assez longue, parce que les gens ne répondent pas assez tôt aux mesures d’instruction. La conséquence est qu’un citoyen pointilleux peut saisir la Cour en disant que la Cour elle-même viole la Constitution parce qu’elle ne respecte pas un délai constitutionnel. Je ne sais pas comment cela se passe dans les autres pays. Chez nous, lorsque les gens ne répondent pas aux mesures d’instruction, on les relance trois fois, quatre fois, et puis à la fin, on peut régler le dossier en l’état. Et si on le fait, on en profite pour sanctionner – je dis bien sanctionner – l’agent public qui n’a pas répondu aux mesures d’instruction, parce que nous avons un article 35 de la Constitution qui dit qu’un juge doit exécuter sa fonction avec loyauté, dévouement, etc., et de temps en temps, nous en profitons pour régler ce problème-là. J’aimerais savoir comment cela se passe dans les autres pays ?
Ensuite je voudrais revenir sur le problème de l’auto-saisine. Nous sommes tous d’accord sur le fait que l’auto-saisine ne doit concerner que les cas de violation des droits de l’homme et des libertés publiques. Il ne s’agit pas d’une auto-saisine systématique. Au Bénin cette auto-saisine est mise en œuvre de la manière suivante. Il suffit qu’un citoyen adresse une lettre en ampliation à la Cour pour que la Cour s’en saisisse d’office. Je crois que souvent, c’est ce qui est arrivé, ce sont les ampliations qui nous amènent à l’auto-saisine.
Ensuite, nous n’avons pas de quotas au Bénin. Etant donné que la saisine est ouverte à tout citoyen – articles 3 de la Constitution et 29 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle –, on n’a pas estimé judicieux d’exiger un quota de député, si bien que tout député peut saisir la Cour constitutionnelle et pratiquement à tout moment.
Voilà ce que je voulais dire, mais ma préoccupation concerne les délais.
M. Menouni, Conseil constitutionnel du Maroc : Je voudrais aborder un autre problème qui a été exposé brillamment d’ailleurs par la délégation du Bénin qui est celui du désistement et qui me semble poser un certain nombre de difficultés. Cela est connu en matière de contentieux électoral : un tribunal constitutionnel d’une manière générale prend acte du désistement de l’une des parties. Donc le problème se pose essentiellement en matière de contrôle de constitutionnalité. Et dans le cas du Maroc, la difficulté provient du fait qu’au Maroc le contrôle de constitutionnalité est un contrôle a priori et que les parties qui sont habilitées à saisir le Conseil constitutionnel sont uniquement les autorités publiques, à savoir le chef de l’État, le Premier ministre, le président de l’une ou de l’autre chambre et le quart des députés. Donc le problème est de savoir quelle serait la position du Conseil constitutionnel, que ce soit le Conseil constitutionnel marocain ou bien une autre juridiction placée dans la même situation, c’est-à-dire qui est habituée à contrôler la loi à titre préventif, si une saisine a été faite devant ce Conseil et que par la suite l’autorité publique ou bien les députés demandent le retrait de la lettre de saisine. Quelle serait la position du Conseil constitutionnel ? Jusqu’ici, nous n’avons pas eu à connaître de cette question et nous avons été particulièrement, pour cela, intéressés par la position de certains Conseils constitutionnels, particulièrement le Conseil constitutionnel français qui, me semble-t-il, a pris une décision refusant aux députés de retirer leur lettre de saisine. Cette position est assez intéressante et elle peut nous aider, mais je voudrais poser quelques questions, parce que cette position ne me semble pas généralisable : cette position peut paraître utile, lorsqu’un Conseil constitutionnel est saisi par des députés, parce qu’effectivement refuser le retrait de la saisine reviendrait à décourager les pressions auxquelles pourraient être soumis les députés. Mais dans le cas, par exemple, où la saisine a été faite par le chef de l’État, celui-ci, s’il demande le retrait de la saisine, pourrait éventuellement prendre la décision de promulguer le texte initialement déféré. Et dans ce cas, quelle serait la situation ? Quelle serait la position du Conseil constitutionnel ? Et si la promulgation a lieu et si le processus d’examen de la constitutionnalité des lois est interrompue, alors le Conseil constitutionnel pourrait être conduit à refuser aux députés ce qu’il a accepté pour le chef de l’État. Donc nous souhaiterions être éclairés sur cette question, parce que jusqu’ici le problème ne s’est pas posé à nous. Il pourrait se poser mais déjà nous entrevoyons des difficultés et nous voudrions donc que cette difficulté soit discutée collectivement pour que l’on soit peut-être inspiré dans nos décisions ultérieures.
M. Abadie, Conseil constitutionnel de France : Monsieur le président Yves Guéna me charge de répondre à cette question qui est directement destinée au Conseil constitutionnel français, puisque nos amis marocains ont fait un excellent repérage d’une décision rendue il y a deux ans et qui est peut-être unique en son genre, puisque pour nous-mêmes, il n’y a pas eu de précédents dans notre jurisprudence ; y en a-t-il eu dans d’autres Cours constitutionnelles ? Je ne sais [4].
Que cette affaire soit unique certes, mais elle est néanmoins, à nos yeux, fondamentale, parce qu’elle touche à l’essence même de nos Cours constitutionnelles. De quoi s’agissait-il ? Une loi votée et non encore promulguée (nous sommes dans le cadre d’un contrôle a priori), fait l’objet d’une saisine auprès du Conseil constitutionnel par 60 députés ou sénateurs. Deux jours après cette saisine, un ou deux des signataires de la saisine annulent leur signature. De ce fait la saisine, qui nécessite en France la signature de 60 parlementaires – sénateurs ou députés – n’atteignait plus le quota constitutionnel nécessaire. Les deux parlementaires qui avaient retiré leur signature ont bien indiqué qu’à leurs yeux de ce fait le Conseil constitutionnel n’était plus valablement saisi du contrôle de constitutionnalité de la loi en cause. Le Conseil constitutionnel français a décidé, au contraire, qu’ayant été saisi régulièrement, il ne pouvait pas être dessaisi de cette saisine par le retrait de signatures même s’il en résultait que le nombre de signatures nécessaire pour cette saisine n’était plus atteint. Alors, pourquoi une telle attitude tout à fait différente de celle des juridictions habituelles qui appliquent le principe que tout requérant retirant sa requête le procès s’arrête ? En effet devant une juridiction ordinaire, nous avons l’adage « pas d’intérêt ou plus d’intérêt, plus de procès » ; mais ce n’est pas le cas aux yeux du Conseil constitutionnel français pour les contrôles de constitutionnalité qui sont engagés « dans l’intérêt de l’ordre public constitutionnel » et non pas dans l’intérêt des saisissants.
M Khair, Conseil constitutionnel du Liban : Permettez-moi simplement d’intervenir sur la question du désistement et de vous signaler qu’avant la décision du Conseil constitutionnel français sur cette question, le Conseil constitutionnel du Liban a rendu une décision qui va dans le même sens. Il s’agit d’une décision du 25 février 1995 qui concerne une saisine par des députés qui se sont ensuite désistés. Le Conseil constitutionnel libanais a fondé sa décision, d’une part sur la nature de l’institution qu’est le Conseil constitutionnel et d’autre part sur la théorie du « bloc de la saisine »[5].
M. Costa, Cour européenne des droits de l’homme : La question du désistement s’est également posée devant le Conseil d’État français, dans le cadre du déféré préfectoral. Le préfet peut-il se désister de ce recours ? Le Conseil d’État a admis un tel désistement. Pourtant, le contentieux préfectoral est lui aussi un contentieux tout à fait objectif.
J’en tire, personnellement, une première conséquence, c’est que je crois qu’au moins dans le système français – peut-être dans le système de certains États ici représentés, le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle n’est pas exactement une juridiction et qu’elle est quelque chose d’autre. On a pu parler d’organe régulateur. Mais c’est une impression purement personnelle.
La deuxième chose que je voulais dire – comme vous l’avez très justement remarqué – est que ce problème de désistement confine à celui de l’auto-saisine. Et je vais en donner un autre exemple qui est que dès les débuts de la jurisprudence du Conseil constitutionnel français, le Conseil constitutionnel a admis que s’il était saisi d’une loi à seule fin de contrôle de la constitutionnalité de cette loi, il n’avait pas à se limiter aux griefs exposés par les auteurs de la saisine, ni même aux dispositions de la loi qui étaient critiquées, mais qu’il pouvait examiner l’ensemble des dispositions législatives si elles lui paraissaient soulever des problèmes de constitutionnalité, alors qu’une juridiction ordinaire – qu’elle soit administrative ou judiciaire – ne pourrait pas faire cela, parce que ce serait statuer ultra petita.
Donc ces deux exemples me paraissent aller dans le même sens et me paraissent montrer qu’au moins dans le système français, le Conseil constitutionnel, lorsqu’il joue son rôle de contrôleur de la constitutionnalité des lois, n’est pas tout à fait la même chose qu’une juridiction.
M. Rajaonarivony, président de séance, Haute Cour constitutionnelle de Madagascar : Moi-même, j’ai eu une petite réflexion sur le désistement. On avait parlé de désistement lors d’un contrôle a priori. Tout dépend. Est-ce que la saisine était une saisine obligatoire ? À mon avis, il y a certaines nuances : il y a des saisines obligatoires, il y a des saisines facultatives. Dans le cadre d’une saisine facultative, si une Constitution prévoit par exemple des deuxièmes lectures pour les assemblées ou que l’exécutif peut encore examiner, avec un droit d’amendement, un acte, est-ce que le retrait est possible ? Dans le désistement, il y a en effet ce que l’on appelle aussi le désistement d’action en droit administratif et il y a le désistement d’instance et non pas un désistement tout court. Est-ce que il n’est pas permis pour celui qui détient la saisine de se retirer, même momentanément, pour réagir ultérieurement ? C’est peut-être une question aussi qui se pose ? En attendant les réactions, je vais donner la parole au professeur Mengué puis au professeur Nguéma.
M. Mengué, Réseau africain de droit constitutionnel : Il y a une question d’ordre pratique qui me trotte dans la tête depuis quelques instants, c’est de savoir le sort qui sera réservé à nos réflexions. Il me semble que certains thèmes de ces réflexions interpellent davantage le pouvoir constituant et le pouvoir législatif que les juridictions constitutionnelles qui sont réunies ici. Toutes les questions liées à l’élargissement de la saisine ou à une saisine sans restriction nécessiteraient une modification des dispositions de la Constitution ou tout au moins des lois organiques qui régissent le fonctionnement de nos juridictions constitutionnelles. Est-ce que le secrétariat général de l’ACCPUF a prévu un moyen d’interpeller le pouvoir constituant ou le pouvoir législatif ou de faire connaître – le verbe « interpeller » n’étant pas tout à fait approprié – nos réflexions à ces pouvoirs, parce qu’ici, je pense
que nous n’avons pas le pouvoir de modifier la Constitution, ni celui de modifier la Loi organique. Il n’y a que le pouvoir constituant ou le pouvoir législatif qui puisse le faire. C’est une question d’ordre pratique qui me trotte dans la tête depuis quelques instants.
Maintenant, s’agissant de la saisine, tout ce que j’ai entendu depuis quelques instants m’amène à la conclusion que la meilleure solution, c’est probablement celle d’un droit de saisine sans restriction. En effet, lorsque devant les juridictions ordinaires de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif on parle d’intérêt à agir, il s’agit des intérêts privés. Or, s’agissant du fonctionnement régulier des institutions, du respect des droits fondamentaux ou du contentieux électoral, je crois que c’est l’intérêt général qui est en cause. Et il me semble que dans ce cas, tout citoyen a intérêt à agir. Et je trouve qu’il n’est pas juste que ce droit de saisine soit réservé à quelques individus, fussent-ils ceux qui nous représentent comme président de la République, comme Premier ministre ou comme président de l’une ou l’autre chambre du Parlement. Je pense que lorsque le fonctionnement régulier des institutions est en cause, tout citoyen a intérêt à agir et dans ces conditions, le droit de saisine devrait être élargi à tout citoyen. C’est la réflexion que m’inspire tout ce que j’ai entendu et je pense qu’il faudrait que ceux qui ne se sont pas encore engagés dans cette direction y réfléchissent sérieusement.
M. Menouni, Conseil constitutionnel du Maroc : Merci Monsieur le président. J’interviens simplement pour un petit supplément de clarification de la position marocaine. Evidemment il ne s’agissait pas de remettre en cause la jurisprudence des Cours constitutionnelles sœurs. Ce n’était pas là notre volonté initiale. Il s’agissait simplement de connaître le point de vue des collègues français, éventuellement d’autres collègues, comme cela a été fait lors de la discussion, notamment par les collègues libanais, de voir, de connaître un peu leurs motivations, parce que de telles situations peuvent se présenter également à l’avenir au Maroc. Ceci dit, pour revenir à cette question de désistement, évidemment, d’un point de vue plus théorique, la position qui a été prise par les deux Cours est fondée sur le plan théorique et personne ne discute le bien fondé théorique de cette décision. Evidemment, en matière de contrôle de la constitutionnalité, on fait un procès à la loi. Il n’y a pas d’intérêt privé à défendre, etc., et donc d’un point de vue théorique, le problème n’était pas posé, bien que j’ai quelques réserves en ce qui concerne le bloc de saisissants. Peut-être que ce n’est pas le cas du Conseil constitutionnel français, du Conseil constitutionnel libanais, mais en ce qui concerne le Conseil constitutionnel marocain, lorsque ce sont les parlementaires qui saisissent le Conseil constitutionnel, ils peuvent le faire soit par des lettres individuelles, soit par une saisine collective. Et je me demande si dans cette situation, on peut parler véritablement de bloc, parce que pour exposer les mêmes griefs, le Conseil constitutionnel peut être récepteur soit de lettres collectives, soit de lettres individuelles. Le problème que nous posons est donc essentiellement d’ordre pratique. Quelle serait la position que le Conseil constitutionnel prendrait si d’autres autorités politiques étaient en cause ? Cela nous pose problème et c’est pourquoi on considérait que cette position n’est peut-être pas généralisable, c’est-à-dire qu’on peut la défendre lorsqu’il s’agit de requérants parlementaires, mais il serait peut-être difficile de la défendre pour des raisons aussi bien juridiques que politiques, lorsqu’il s’agit d’autres requérants.
M. Nguéma, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : Je tenais tout d’abord à vous dire ma satisfaction de pouvoir participer à cette réunion, à l’invitation du président Guéna, et je suis heureux de constater tous les égards et services qui me sont rendus personnellement au cours de cette réunion. Je voudrais dire deux choses sur ce chapitre du « droit au recours ».
La première, c’est vous faire part des informations sur les pratiques que nous avons à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Bien entendu, nous ne nous occupons pas des problèmes de constitutionnalité, mais des droits de l’homme et des peuples. J’ai néanmoins cru comprendre que l’allure générale des procédures est un peu la même dans toutes ces instances. Je voudrais parler des personnes qualifiées justement pour introduire le recours. Quand on lit la Charte des droits de l’homme et des peuples, les seuls qui sont vraiment nommés, ce sont les États. Notre charte n’a rien prévu ni pour les personnes physiques, ni pour les ONG, etc. L’article 47 traite ainsi des communications émanant des États parties à la présente Charte. Mais, étant donné que, comme on peut le supposer, et comme cela a été révélé à l’expérience, les États n’ont pas généralement introduit de recours, une deuxième rubrique a été utilisée. Il s’agit de la rubrique que l’on appelle « les autres communications ». Qu’est-ce que cela signifie ? Le mot de « communication » pour les profanes, n’est pas compréhensible. Pourquoi ne pas dire « plainte » ? La Commission a interprété ces « autres communications » comme pouvant émaner de toutes les autres personnes physiques, morales, ONG, groupes. Mais, c’est une décision jurisprudentielle qui a institué cette interprétation. D’après les textes, cette deuxième série n’est pas visée du tout. Tout cela signifie que quand vous êtes sûr d’aller dans un sens qui correspond aux objectifs que l’on doit atteindre, je crois qu’il n’y a pas de honte à le faire : il faut savoir « oser ».
La deuxième information que je voudrais donner concerne le problème de la saisine. Au niveau de notre Commission qui ne s’occupe que des droits de l’homme, je le répète, la saisine concerne uniquement les recours introduits par les particuliers, c’est-à-dire au titre de la deuxième rubrique : la Charte demande que la Commission se prononce par une décision prise à la majorité absolue des membres de la Commission ou à la majorité simple. Je souhaitais attirer votre attention sur le fait, puisque je vois qu’il y a aussi des anglophones ici, que le texte français de la Charte parle de majorité absolue et le texte anglais parle de majorité simple. Comment résoudre cela ? Pendant longtemps, cela ne m’a pas du tout impressionné. Il a fallu que l’on se rende au Costa-Rica rencontrer nos collègues de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, car, eux, avaient les deux textes sous les yeux. Ils nous ont fait remarquer qu’il y avait d’un côté « majorité simple » et de l’autre « majorité absolue ». Nous nous en sommes sortis, parce que souvent, chez nous, on prend généralement en bons africains qui se respectent nos décisions à l’unanimité ou par consensus. Il n’est pas question de discuter des heures sur ces problèmes somme toute mineurs.
Donc le terme de « saisine » ne concerne que le recours des particuliers. Là aussi, une précision doit être apportée, parce que le terme de « recevabilité » sur lequel nous aurons peut-être à revenir, en anglais, correspond à la « saisine » en français dans la procédure suivie par notre Commission. Tandis qu’en français nous utilisons le terme de « recevabilité » pour apprécier la requête au regard des conditions qui sont posées à l’article 56, alors que les anglophones parlent dès le début de décision de « recevabilité ».
M. Frank, Centrafrique : Monsieur le président, dans le rapport de synthèse, une coquille a été remarquée à la page 10 [I-3.1.] [pp. 584 et 585 du présent volume] au quatrième paragraphe. Ce passage concerne la république Centrafricaine. Il est écrit « en Centrafrique, les recours par voie d’action contre les lois ordinaires et organiques sont formés avant la promulgation du texte. Aucun délai n’est par contre imposé à ceux exercés par voie d’exception ». La coquille est à la deuxième ligne de ce paragraphe, c’est-à-dire la partie de la phrase qui va de « en Centrafrique, les recours par voie d’action contre les lois ordinaires et organiques sont formés avant la promulgation du texte ». Cette première partie de la phrase n’est pas exacte. Les recours en Centrafrique par voie d’action sont formés contre des lois déjà promulguées.
M. Rajaonarivony, président de séance, Haute Cour constitutionnelle de Madagascar : Cela est logique. On ne peut pas porter une action contre une loi qui n’est pas promulguée et qui n’est donc pas portée à la connaissance du public.
M. Gonthier, Cour suprême du Canada : Pour apporter un écho de l’autre système, c’est-à-dire du système de la « Common Law » sous laquelle nous opérons au Canada, j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt, le débat sur le désistement et comme personne un peu extérieure au système, j’ai eu une réaction, qui coïncide je pense avec ce qui a été exprimé. C’est-à-dire que pour un Conseil constitutionnel ou autre organisme qui se prononce avant la promulgation de la loi, son rôle s’intègre un peu dans le cadre législatif par opposition au cadre juridictionnel. Chez nous, évidemment, il n’y a aucun recours de quelque nature autre que politique évidemment au sein du Parlement avant la promulgation de la loi. Donc nous nous situons toujours après que la loi soit passée, avec une exception particulière à la Cour suprême, c’est-à-dire que le gouvernement par voies diverses, pour le fédéral et les provinces, peut s’adresser à la Cour suprême pour le Parlement fédéral et à la Cour d’Appel provinciale pour les législatures provinciales pour obtenir une opinion. Mais cela est particulier, c’est autre chose.
Donc, sur la question de saisine, nous parlons de saisine dans un cadre juridictionnel, et c’est la règle générale de l’intérêt d’agir qui s’applique. Mais je vous signale simplement que la Cour est très consciente du besoin pour que la règle de droit prévale et soit respectée que les lois puissent toutes être soumises à l’examen de la Cour. Donc la règle générale est un intérêt d’agir. Cependant, la Cour reconnaît que si la situation est telle qu’il est peu probable qu’un justiciable s’adresse aux tribunaux en raison d’un effet particulier de la loi quant à lui, la Cour va reconnaître aux particuliers un intérêt d’agir pour le public dans son ensemble. Mais évidemment, par ailleurs, le gouvernement peut agir.
Il reste bien sûr une certaine préoccupation pour éviter les abus en matière de droits de la personne ; évidemment, toute personne peut invoquer, mais encore faut-il qu’il y ait un intérêt d’agir.
Je vous signale également que dans notre système il n’y a pas ce partage de compétences entre Tribunal ou Conseil constitutionnel et les tribunaux juridictionnels. Tout le système britannique repose sur cette réalité que ce sont les Cours supérieures qui sont une émanation du pouvoir royal et donc qui ne dépendent d’aucune loi pour leurs compétences. Ils en sont tributaires, évidemment, en ce sens que cette compétence peut être réduite par la législation, mais si elle ne l’est pas, elle demeure. Donc il serait impensable que nous ayons un conflit de compétences pour lequel aucun tribunal ou organisme serait compétent pour le régler.
M. Kombila, Professeur à l’Université de Libreville, Gabon : Je voudrais tout simplement éprouver une certaine inquiétude à propos du sérieux d’un recours. La saisine est largement ouverte. C’est bien beau. C’est la démocratie ! Mais il y a le côté sérieux. Et la question se pose, lorsqu’on permet à un citoyen de saisir directement une juridiction constitutionnelle contre une loi qui n’est même pas encore promulguée. Une loi qui n’est pas promulguée, elle est encore au laboratoire, ce n’est pas encore une loi.
Est-ce que ces citoyens, dans nos jeunes États, qui sont préoccupés par des questions de survivance quotidienne, qui cherchent d’abord à s’alimenter, vont aller au Parlement pour s’informer de ce qui se passe là-bas, pour saisir la Cour et, eux-mêmes motiver leur requête ?
Dans tout cela, il y a un manque de sérieux.
S’agissant du recours par voie d’action, ce même citoyen à qui on permet la saisine sans que celle-ci soit entourée d’un certain nombre de précautions trouvera là un juste divertissement. Quand il saisira la Cour et que sa requête sera rejetée, par la suite, il y aura un découragement général. Donc, je trouve qu’il est important que la saisine soit entourée d’un certain nombre de précautions pour que cela ne ressemble pas à un simple divertissement.
Mme Ouinsou, rapporteur, Cour constitutionnelle du Bénin : Je voudrais juste faire remarquer que dans le rapport de synthèse, à part la coquille qui vient d’être levée par le président de la Cour constitutionnelle de Centrafrique, il n’est nul part mentionné que le citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle avant la promulgation d’une loi. Il y a en effet un principe bien simple qui dit que le citoyen ne connaît la loi qu’après promulgation et publication.
Mme Angué, Cour constitutionnelle du Gabon : Je voudrais préciser que dans le cas du Gabon, la Loi organique permet au citoyen de saisir la Cour constitutionnelle d’une loi ordinaire avant sa promulgation.
Mme Ouinsou, rapporteur, Cour constitutionnelle du Bénin : En conclusion, je retiens trois éléments intéressants.
Sur le droit de saisine, il est bien vrai que la trilogie n’apparaît pas de façon bien schématisée dans ce document, mais je crois que cette trilogie est claire. Il y a le droit d’action, il y a l’exception et il y a l’auto-saisine. Soit les institutions connaissent de ces trois voies de recours, soit non.
Je retiens en outre les discussions que nous avons eu sur le désistement et la notion de « bloc », enfin, la contribution très importante du Conseil constitutionnel du Sénégal sur la procédure de rabat d’arrêt dont je tenais à souligner l’originalité.
-
[1]
Cas d’ouverture du recours en exception d’inconstitutionnalité. [Retour au contenu] -
[2]
Cf. art. 33, Loi organique 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation. [Retour au contenu] -
[3]
Voir ci-dessous, l’annexe p. 717. [Retour au contenu] -
[4]
Voir ci-dessous, l’annexe p. 721. [Retour au contenu] -
[5]
Voir ci-dessous, l’annexe p. 723. [Retour au contenu]
La recevabilité des saisines
sous la présidence du Conseil constitutionnel du Cambodge

Libreville, deuxième Congrès de l’ACCPUF
De gauche à droite : Monsieur THOR Péng Leath, membre du Conseil constitutionnel du Cambodge, Monsieur Abdelaziz BENJELLOUN, président du Conseil constitutionnel du Maroc.

Deuxième rapport de synthèse par Monsieur Abdelaziz BENJELLOUN,
président du Conseil constitutionnel du Maroc
Juin 2000
L’examen de la recevabilité des requêtes est un moment important dans le travail du juge constitutionnel. Effectué au début de la procédure de l’instruction, relevant d’un contrôle de légalité externe, il n’en met pas moins en jeu un certain nombre de logiques et de procédures qui expriment d’une certaine manière la considération d’exigences aussi essentielles que le droit de la défense, la sécurité juridique et la nécessité d’un examen approprié des griefs formulés.
L’analyse de la pratique des juridictions constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, révèle une sensibilité réelle à l’égard du respect de ces principes et de ces exigences, ce qui explique sans doute la relative uniformité des solutions adoptées en la matière.
Le présent rapport a pour objet de donner la synthèse de ces réponses au regard des conditions de recevabilité relatives au requérant et au recours et des modalités de rejet pour irrecevabilité ainsi que les motifs de rejet.
II 1. – Conditions relatives au requérant
Les conditions relatives au requérant, sont dans la plupart des États concernés consignées dans des textes à valeur juridique variable : Loi organique ou loi ordinaire. Ces textes s’efforcent de répondre aux questions de savoir si la procédure devant la juridiction constitutionnelle est gratuite, si le requérant est dans l’obligation d’être représenté au cours du procès, si enfin, il doit démontrer l’existence d’un intérêt pour agir.
II 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre ?
Sur la question de la gratuité ou non de la procédure, l’examen des différentes réponses données dans les rapports nationaux révèle l’existence de trois tendances.
Il y a d’abord une tendance majoritaire représentée par les juridictions de la Belgique, du Bénin, de la Bulgarie, de Burundi, de Centrafrique, de Côte d’Ivoire, de Djibouti, de la France, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, de la Moldavie, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad, du Togo.
Dans tous ces États, la requête est dispensée de tous frais d’enregistrement ou de timbre. Et même dans certains États, comme c’est le cas de la France, où le législateur est revenu en 1993 sur le principe de la gratuité des requêtes en justice notamment pour les requêtes introductives d’instance devant les juridictions administratives, la procédure est demeurée gratuite devant le Conseil constitutionnel. Cette tendance largement admise n’est pas sans justification. Pour certains elle serait liée au fait que celui qui saisit la juridiction constitutionnelle est une personne publique, pour d’autres elle s’expliquerait essentiellement par la nature de l’action introduite devant le juge, action populaire, liée à la mise en œuvre d’une procédure à caractère inquisitoire dont la gratuité de la requête serait le corollaire.
La seconde tendance est caractérisée par une certaine souplesse permise par les pouvoirs conférés au juge en la matière. Aussi bien au Canada qu’en Suisse et en Slovénie, le principe de la non gratuité de la procédure est posé, honoraires ou droits de timbres existent, mais la Cour constitutionnelle ou ses services peuvent exempter une personne du paiement de ces droits.
La troisième tendance est représentée par l’Égypte où la procédure est non gratuite, la loi prescrivant le paiement d’un droit fixe en plus du dépôt d’une caution à la caisse de la Cour.
II 1.2. – La représentation du requérant par un avocat ou par une autre personne
Cette question fait l’objet de réponses qui, même si elles manifestaient l’existence d’une tendance majoritaire, ont fait montre de l’existence d’une gamme de possibilités graduelles, allant de la position la plus souple à l’attitude la plus franche et la plus tranchée. Il n’est pas exclu que cette variété juridique recoupe dans certains cas d’autres clivages, notamment celui des contrôles a posteriori et a priori de la constitutionnalité des lois qui mettent ou non en jeu l’existence de droits subjectifs des requérants.
Les réponses favorables à la représentation du requérant bien que l’emportant chez la grande majorité des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, sont de deux sortes. La première qui dénote une certaine souplesse du législateur admet la possibilité de cette représentation sans en affirmer le caractère obligatoire : la représentation peut se réaliser par ministère d’avocat ou par une personne dûment mandatée. C’est la solution préconisée par les Cours constitutionnelles de la Belgique, du Bénin, de la Bulgarie, du Canada, de la Centrafrique, de Djibouti, du Gabon, de la Guinée, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, de la Moldavie, de la Roumanie, du Sénégal, de la Slovénie et de la Suisse. À ces Cours, il convient d’ajouter celle de l’Égypte où la représentation par avocat est déclarée obligatoire.
En revanche d’autres législations n’admettent pas du tout la représentation, soit que celle-ci est purement et simplement exclue par les textes, soit que n’ayant pas été prévue, elle n’a pas eu l’occasion d’être admise par la pratique du juge. La première tendance est illustrée par les Cours constitutionnelles du Sénégal, du Tchad et du Togo, la seconde, celle en particulier du Maroc où la représentation du requérant par un avocat ou par une autre personne n’est pas prévue, mais où la pratique n’a pas encore permis à la juridiction de ce pays de se prononcer sur la question. Entre ces deux options se situe la position du Conseil constitutionnel français qui n’est pas sans nuances. En France, même si les textes sont muets sur la question de la représentation du requérant, le Conseil constitutionnel a fixé les usages dans le contentieux de constitutionnalité des lois en faisant état d’une certaine méfiance à l’égard de la représentation par un ministère d’avocat. Cette position de principe cependant n’exclut pas que le Conseil constitutionnel saisi d’une demande de délégalisation par le premier ministre, accepte que ce soit un représentant du Secrétariat général du gouvernement qui réponde par écrit ou oralement à une demande émanant du conseiller rapporteur.
II 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?
C’est la troisième question posée et qui clôt la problématique du statut du requérant devant la Cour constitutionnelle. La question ne manque pas d’importance d’autant plus que le contrôle exercé par le juge peut être selon les cas, abstrait ou concret et qu’il porte sur un texte de portée générale et impersonnelle dont l’intérêt tant juridique que politique est certain. Elle est importante également dans la mesure où, d’une certaine façon, elle détermine le degré d’ouverture du recours devant le juge constitutionnel et implique une politique jurisprudentielle du juge.
La première position exprimée dans ce domaine, position la plus partagée est celle qui consiste à dire que le requérant n’est pas tenu de démontrer un intérêt à agir et que les textes en vigueur, Constitution ou loi, ne prévoient dans ce sens aucune condition spéciale. Cette position qui est celle du Bénin, de la Bulgarie, du Cambodge, de la Centrafrique, de Djibouti, de la France, de la Guinée, du Mali, du Maroc, du Rwanda, du Tchad, du Togo trouve son fondement dans la spécificité des textes confirmés par la jurisprudence. Pour certains l’intérêt général nécessairement présent dans les questions de constitutionnalité empêcherait l’exigence d’un intérêt particulier pour agir, pour d’autres il convient de faire une distinction entre motifs de la requête et intérêt pour agir et si les premiers sont exigés les seconds ne le sont pas, pour un troisième groupe de cours appartenant à cette première mouvance juridique, dans la mesure où le législateur désigne les saisissants l’intérêt se confond avec la qualité pour agir, le juge se contentant simplement de s’assurer de la qualité de celui qui le saisit.
Une deuxième position, tout en se rapprochant de la première, réserve une place à part aux autorités par rapport aux personnes physiques ou morales saisissantes. Si l’intérêt des premières (les autorités) est présumée, les secondes (les personnes physiques ou morales) doivent démontrer que l’acte attaqué porte atteinte à leurs intérêts. Cette position est préconisée par la Belgique, le Gabon et la Slovénie.
En fait la position du Gabon, assez souple et relativement sélective n’est pas sans relations avec la troisième attitude préconisée par la Centrafrique et le Canada pour qui, dans tous les cas prévus par la loi, le requérant doit établir qu’un de ses droits constitutionnellement protégés a été ou est susceptible d’être lésé par l’acte attaqué.
Enfin un quatrième groupe de cours constitutionnelles présenté par l’Égypte et la Suisse exige du requérant la démonstration de son intérêt à agir.
II 2. – Conditions relatives au recours
II 2.1. – Numérotations des requêtes
Les requêtes sont numérotées par ordre chronologique et de manière continue. Il est procédé à leur enregistrement sur le registre du Greffe ou l’un des registres du Greffe. Dans certains rapports, il est indiqué qu’il comporte l’indice de l’objet (Bulgarie, Moldavie, Togo). Il y a aussi des rapports qui font état de l’existence d’un registre spécial pour les affaires constitutionnelles (Cambodge, Sénégal, Slovénie). Par ailleurs, selon le rapport français, le numéro d’enregistrement sera celui de la décision et comporte l’année et le numéro de la saisine, ainsi que les lettres d’identification de la nature du contrôle engagé.
II 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures ?
Suivant les rapports reçus, la date qui fait foi pour la suite des procédures est tantôt la date de réception (Belgique, Bénin, Cambodge, Centrafrique, Djibouti, Égypte, Mali, Maroc, Slovénie), tantôt celle de l’enregistrement (France, Gabon, Moldavie, Roumanie,Togo), tantôt à la fois celle de la réception et de l’enregistrement (Bulgarie, Sénégal) ou de la réception et de l’arrivée de la requête au siège de la Cour (Madagascar) et tantôt encore celle du dépôt de la requête au Greffe (Canada, Guinée). Il est précisé que, selon le rapport français, c’est la date d’enregistrement du recours dit original qui compte. Par ailleurs, le rapport de la Belgique souligne que les requêtes doivent être envoyées sous pli recommandé et c’est la date de dépôt à la poste qui fait foi pour le calcul des délais. Dans le rapport de la Bulgarie, on relève que « les demandes visant l’établissement de l’inconstitutionnalité des lois et autres actes de la constitutionnalité, peuvent être introduites à la date de publication de ces textes, la question de la date qui fait foi pour la suite des procédures n’est pas d’une telle importance ».
II 2.3. – Conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes
La requête est généralement présentée sur simple lettre. Des mentions obligatoires doivent y figurer : la date et la signature du requérant, de son avocat (Égypte) ou, s’il y a lieu, de son représentant. Quelquefois, elle doit porter l’adresse ou le siège permanent du requérant (Bulgarie, Sénégal).
D’une manière générale, elle doit identifier clairement la norme dont la vérification est demandée et contenir l’exposé des faits et moyens invoqués. Certains rapports mentionnent d’autres éléments : en Égypte, la requête d’inconstitutinnalité des lois et règlements doit faire état du texte dont la constitutionnalité est en cause, de la disposition constitutionnelle qu’il est censé enfreindre et les modalités de cette infraction ; en Belgique, il est exigé une copie de la loi faisant l’objet du recours ; en Guinée, les pièces annexes sont deux copies du textes de loi attaquée ; au Togo, doivent être annexés à la requête les textes soumis au contrôle ; en Suisse, l’acte de recours doit être présenté au moins en deux exemplaires ; au Canada, il est précisé que les documents imprimés doivent être clairs et lisibles et présentés dans un papier blanc de bonne qualité et format.
La motivation est toujours exigée en Roumanie dans le cadre du contrôle a posteriori. Dans le rapport français, il est précisé qu’elle est inutile pour les recours obligatoires et facultative pour les autres recours. En Guinée, la requête doit conternir les conclusions du requérant et un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés. En Slovénie, le requérant doit fournir à la Cour divers éléments d’appréciation : indiquer l’acte général ou individuel attaqué et l’autorité qui l’a émis, les dispositions de la Constitution ou de la loi censées être violées, les arguments selon lesquels l’acte contesté serait non conforme à la Constitution ou à la loi, les droits de l’Homme ou la liberté fondamentale censés être violés et, dans le domaine des traités, le traité international à propos duquel la proposition est présentée et la vérification des dispositions de la Constitution avec lesquelles le traité, ou une des parties ne serait pas conforme et les raisons justifiant cette non conformité…
S’agissant des moyens nouveaux, diverses positions sont à relever. C’est ainsi que le rapport du Bénin précise « qu’aucune disposition n’interdit que des moyens nouveaux puissent être soulevés au cour d’une procédure. L’essentiel est que la Cour soit, en tout état de cause, saisie avant que le recours soit examiné en audience plénière ». De même, le rapport du Canada souligne que « des moyens nouveaux peuvent être soulevés en cour de procédure à la condition que la Cour accorde la permission d’amender les actes de procédure ». Au Togo, les moyens nouveaux peuvent être présentés au cour de la procédure jusqu’au dépôt du rapport du juge rapporteur. En Belgique, la Cour a admis qu’une seconde requête adressée dans le délai « remplaçait » la première irrégulière.
Complétant le commentaire précédent, les deux tableaux ci-dessous fournissent certaines indications sur les conditions formelles et matérielles de recevabilité des requêtes.
Conditions formelles


La mention « Premier ministre » dans le tableau ci-dessus doit être comprise, en ce qui concerne la Belgique, comme visant chacun des gouvernements, soit le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées.
Personnes physiques et morales :
Lois : Bénin : Nom, prénom, adresse et signature ; Belgique : Personnes physiques, et personnes morales de droit public, de droit privé à but non lucratif (ASBL), de droit privé poursuivant un but de lucre, et groupements, ordres, unions, associations professionnel(le)s; Gabon : Nom, raison sociale et signature).
Nature législative ou réglementaire d’une disposition (actes du gouvernement).
Gabon : nom, raison sociale et signature ; Roumanie : saisine écrite et motivée
Pts. Cour : présidents des Cours Judiciaire, Administrative et des Compte (Gabon).
Pt. H.A.A.C. : président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Togo).
Pt. H.C.C.T. : président du Haut Conseil des collectivités territoriales.
Conditions matérielles

II 2.4. – Ces conditions ont-elles évolué dans le temps ?
Selon la plupart des rapports, les conditions d’ouverture des recours sont demeurées les mêmes. Toutefois une évolution a été relevée dans certains cas. C’est ainsi qu’au Maroc l’ouverture des recours a subi une double extension par voie de révision constitutionnelle (possibilité, depuis 1992, de présenter un recours contre la loi par diverses autorités publiques et par une minorité au sein de la Chambre des représentants et cette possibilité a été étendue, depuis 1996, à une minorité de la Chambre des conseillers, par suite du retour au bicaméralisme). Dans le cas français, l’élargissement de la saisine résulte, comme pour le Maroc, d’une révision constitutionnelle (1974).
II 2.5. – Procédure de régularisation de la requête
De nombreux rapports se contentent de préciser que cette régularisation n’est pas prévue par les textes (Cambodge, Centrafrique, Égypte, Gabon, Guinée, Maroc, Mauritanie, Roumanie, Sénégal). Mais on trouve, dans d’autres rapports, des réponses affirmatives. C’est ainsi que, dans certains cas, la juridiction constitutionnelle prend elle-même l’initiative de faire régulariser la requête en la complétant par ce qui manque (Belgique [1], Bulgarie, France, Slovénie). En Belgique, la Cour peut soulever des moyens d’office ou poser des questions aux parties. Quant au rapport français, il souligne que « lors de la réception d’une saisine, les vérifications effectuées par le secrétariat général du Conseil le conduisent, le cas échéant, à intervenir auprès des autorités de saisine afin qu’elles procèdent, dans les plus brefs délais, aux régularisations nécessaires à l’examen du bien-fondé de la demande ».
II 3. – Modalités de rejet pour irrecevabilité
II 3.1. – Qui statue sur la recevabilité des recours ?
Il ressort des rapports nationaux reçus que les constituants ont tenu à ce que l’appréciation de la recevabilité des recours soit confiée à l’organe chargé du contrôle constitutionnel.
La présence d’un nombre minimum des membres est expressément exigée lors de l’examen de cette question. Ainsi, au Maroc, la présence de neuf membres du Conseil constitutionnel est indispensable lorsque le Conseil est appelé, sous la présidence de son président ou du membre le plus âgé, à statuer sur la recevabilité d’un recours.
D’une manière générale, les décisions relatives à la recevabilité sont celles appliquées lors de l’examen au fond des recours, et parmi ces conditions celles relatives à la composition de l’organe du contrôle constitutionnel.
Les pays dans lesquels la Cour constitutionnelle statue sur la recevabilité sont notamment la Belgique, le Bénin, la Bulgarie (où cette question est examinée lors d’une phase précise de la procédure, celle de la recevabilité), la Centrafrique, l’Égypte, la France, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, la Moldavie, la Roumanie, le Sénégal, la Slovénie, le Tchad, le Togo, la Suisse (où cette mission est confiée au Tribunal Fédéral). En Belgique toutefois, les cas d’irrecevabilité manifeste peuvent être constatés par une chambre restreinte de la Cour au terme d’une procédure préalable. Il est à noter à propos du cas roumain que si la Cour constitutionnelle est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des recours qui lui sont soumis, un Tribunal pourrait être appelé à se prononcer sur cette question lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée devant lui. Il pourrait, le cas échéant, déclarer irrecevable une telle exception (art. 23 de la Loi n° 47/1992). Un système comparable est prévu en Belgique.
II 3.2. – La décision de l’instance qui statue sur la recevabilité, est-elle susceptible de recours
De façon générale, les décisions statuant au fond sur les recours ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, Il en est de même pour les décisions statuant sur la recevabilité des saisines.
II 3.3. – La Cour statue t-elle en formation plénière ?
Les décisions prononçant l’irrecevabilité d’un recours devant la juridiction constitutionnelle sont rendues, d’une manière générale en séance plénière.
La question de recevabilité est soumise à la Cour dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles sont examinés au fond les recours déférés à ladite juridiction. C’est ainsi que le même nombre de membres est exigé pour permettre à la juridiction de statuer sur la question de recevabilité de la saisine. Le ministère public est représenté dans le cas de la Guinée, par le Procureur Général et les Avocats Généraux.
Le rapporteur, désigné par le président (généralement sur la base d’une répartition équilibrée des tâches, comme dans le cas du Maroc) présente son rapport, et parfois un projet de décision (France, Maroc, Slovénie, Suisse). Ce rapporteur est quelquefois assisté d’une Commission ad-hoc devant le Conseil constitutionnel du Tchad.
II 3.4. – La décision d’irrecevabilité : Doit-elle être motivée ? Doit-elle être prononcée ? Doit-elle être publiée ?
Les décisions rendues en matière de recevabilité, sont d’après les cas examinés, toujours motivées, à l’exception du cas de la Slovénie.
Ainsi sont motivées les décisions d’irrecevabilité rendues dans plusieurs pays dont le Bénin, la Bulgarie, le Cambodge, l’Égypte, la France, … Les motifs de rejet permettent aux requérants de corriger leur demande initiale et la soumettre, quand la loi l’autorise, à la juridiction constitutionnelle (c’est le cas de la France en particulier).D’une manière générale, ces décisions, sont, après leur prononcé dans les conditions applicables lors de l’examen au fond des recours, publiées. Dans la plupart des cas cette publication est faite par insertion au Journal officiel (Guinée, Maroc, Moldavie, Roumanie, …). D’autres pays se contentent de la notification à la partie concernée (Bulgarie). Il est à signaler qu’en Belgique l’ensemble des recours en annulation et des questions préjudicielles font l’objet d’une mention au Moniteur belge.
Quant à la question de savoir si les décisions relatives à la recevabilité des recours sont « prononcées », il convient de souligner que ces décisions sont, dans l’ensemble, rendues dans les mêmes conditions que celles statuant au fond sur les recours soumis à la juridiction constitutionnelle. Elles sont donc prononcées soit à huis clos comme dans le cas du Maroc et de la Bulgarie, soit en audience publique comme en Centrafrique et en Moldavie pour ne citer que ces exemples.
II 3.5. – Les requérants abusifs sont-ils passibles d’une amende pour abus du droit d’agir ?
Dans la plupart des textes constitutionnels, il n’est pas prévu de sanction à l’encontre d’un requérant dont l’action est rejetée. Cependant, l’article 53 du texte relatif à la Cour constitutionnelle égyptienne prévoit la perte de la caution consignée en cas d’irrecevabilité du recours.
En Moldavie, il est prévu une amende à l’encontre du requérant dont le recours a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité, mais l’article 82 du Code de la Juridiction constitutionnelle, a énuméré limitativement les cas où cette amende est appliquée.
La Cour constitutionnelle roumaine peut infliger une amende à la partie dont l’exception d’inconstitutionnalité est écartée, lorsque cette exception a été soulevée de mauvaise foi pour faire retarder la solution du procès en cours.
II 3.6. – La procédure conduisant à déclaration d’irrecevabilité a-t-elle évolué ? Si oui dans quel sens et pour quelles raisons ? Est-elle l’objet de projets de réformes ?
Dans l’ensemble, il n’a pas été constaté d’évolution dans ce domaine. Cependant des changements sont intervenus en Bulgarie à propos des personnes recevables à saisir la juridiction constitutionnelle.
Il est à noter qu’au Maroc, seules deux décisions d’irrecevabilité ont été prononcées par le juge constitutionnel, l’une par l’ex-Chambre constitutionnelle de la Cour suprême et l’autre par le Conseil constitutionnel, de telle sorte qu’il n’est pas possible de parler d’évolution de la procédure en matière de recevabilité dans le domaine du contrôle de constitutionnalité.
Le tableau page suivante indique soit le total des rejets répartis selon leur motif, soit le pourcentage de chaque motif de rejet par rapport à l’ensemble des rejets (Gabon). On remarque le très petit nombre de rejets et l’absence de tout rejet pour raison de motivation (loi ordinaire).
II 4. – Motifs de rejet. Synthèse [2] – Exemples

3. Voir ci-dessous les débats p. 629.
-
[1]
En Belgique, cette possibilité n’est offerte qu’aux personnes morales afin de leur permettre d’établir que leur organe compétent a pris la décision d’introduire le recours. [Retour au contenu] -
[2]
2. Au Mali, dans un cas, la Cour s’est déclarée incompétente parce que l’objet de la demande des saisissants (i.e. la question de l’immunité parlementaire d’un député) n’entrait pas dans ses attributions. [Retour au contenu]
Débats
M. Thor, président de séance, Conseil constitutionnel du Cambodge : Merci Monsieur le président Benjelloun pour votre exposé bien précis, concis, clair, en ordre, très bien découpé selon le questionnaire proposé. Cela va beaucoup faciliter notre discussion.
À titre préalable, si vous avez pu relever des erreurs, c’est à vous de le signaler pour que le comité de rédaction, le secrétaire général ou le rédacteur du rapport de synthèse puisse apporter les modifications au fur et à mesure et afin que le rapport soit publié le plus tôt possible. Je vous propose de commencer immédiatement la discussion, selon l’ordre qu’a adopté Monsieur Benjelloun, étape par étape, afin d’éviter ce que l’on appelle le double emploi et les oublis. Pour commencer, je me permets d’ouvrir la discussion sur le premier volet qui serait « Conditions relatives aux requérants ».
M. Hountondji, Cour constitutionnelle du Bénin : Il y a une affaire sur laquelle on n’a pas insisté et qui peut être source de difficultés. C’est le problème de la qualité du requérant. Il est vrai que souvent les textes prévoient la qualité des requérants, mais je crois que la question devrait être abordée. Ensuite, je voudrais revenir sur le problème des signatures. Nous savons très bien que dans les pays africains où 80 % des gens sont illettrés, nous avons un problème de signatures. Si bien qu’à un moment donné, nous avons décidé à la Cour constitutionnelle de réviser le Règlement intérieur et de considérer l’empreinte digitale comme une signature et ceci a donné lieu à un grand débat sur la question de savoir ce que l’on appelle « signature » et ce que l’on appelle « empreinte digitale ».
Par ailleurs, nous avons ouvert la saisine aux associations, mais malheureusement le citoyen pense qu’il suffit de se regrouper en club pour saisir la Cour. Je pose ici le problème de la capacité à ester en justice et souvent nos compatriotes se trompent et nous sommes obligés de leur écrire pour leur demander de prouver leur capacité à agir, c’est-à-dire de prouver que l’association qui agit est enregistré au Ministère de l’Intérieur.
Je voudrais aussi intervenir sur le problème des avocats. Les avocats ne plaident pas devant la Cour chez nous. Cependant, on reconnaît au requérant le droit d’assistance. Il y a un article qui dispose que le requérant peut se faire assister de toute personne physique ou morale. C’est l’article 28 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du Bénin. Et ce qui a lieu souvent, c’est que les gens transforment cette assistance en une substitution. Les avocats écrivent, rédigent la requête et se permettent de signer à la place des requérants et souvent il arrive à la Cour de déclarer cette requête irrecevable, parce que l’on estime que le requérant doit aussi signer.
Maintenant je voudrais poser une question : Est-ce que la différenciation entre recevabilité de forme et de fond est toujours pertinente ? Personnellement, j’ai toujours l’impression qu’il y a cet élément de solidarité entre les conditions de forme qui concernent certainement la forme qu’il faut donner à la requête et les conditions de recevabilité au fond. Je pense notamment au problème de l’autorité de la chose jugée.
M. Hage-Chahine, Professeur à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban : Monsieur le président Benjelloun vient de parler de la condition d’intérêt. Il a dit qu’en matière de contrôle de constitutionnalité, quand il s’agit de questions de constitutionnalité, on n’exige pas un intérêt particulier pour agir, on se contente de la qualité du requérant.
Je crois qu’on peut trouver dans cette solution, une réponse à la question qui a été posée ce matin sur le désistement [1] du président de la République. Il s’est posé la question de savoir si on doit ou non prendre en considération le désistement du président de la République dans l’hypothèse où il saisit le Conseil constitutionnel.
À mon avis, on ne doit pas prendre en considération ce désistement pour les trois raisons suivantes : d’abord, parce que la condition d’intérêt n’est pas exigée et quand il n’y a pas d’intérêt particulier, il n’y a pas de désistement. La deuxième raison est que le président de la République, quand il saisit le Conseil constitutionnel, exerce un pouvoir et non une prérogative juridique au sens de droit subjectif. Or, on exerce le pouvoir dans un intérêt public et on ne renonce pas à un intérêt public. Le troisième argument est tiré de l’opposition du procès en matière civile et du recours devant le Conseil constitutionnel. Le code de procédure civile français et le code de procédure civile libanais contiennent des principes directeurs du procès civil. Le premier de ces principes directeurs est que le procès civil appartient aux parties. Or, le recours devant le Conseil constitutionnel n’appartient pas au titulaire du droit de saisir le Conseil constitutionnel. D’ailleurs l’arrêt du Conseil constitutionnel libanais qui a rejeté la possibilité du désistement est conçu en termes généraux, ce qui montre que le désistement est rejeté, même dans l’hypothèse ou il émane du président de la République.
M. Doldur, Cour constitutionnelle de Roumanie : Je voudrais tout d’abord souligner la qualité de la synthèse présentée par Monsieur le président du Conseil constitutionnel marocain et apporter avec votre permission quelques précisions.
On a mentionné que la loi roumaine, concernant l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, prévoit l’obligation pour le requérant de motiver sa démarche, sa requête devant la Cour constitutionnelle. Cela est vrai. La loi prévoit l’obligation de motiver l’objection d’inconstitutionnalité dans le système du contrôle a priori ou de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant un tribunal dans le cadre du contrôle a posteriori puisque la Roumanie a les deux types de contrôle de constitutionnalité. Mais c’est seulement dans le cas où l’exception, donc dans le cadre du contrôle a posteriori, a été soulevée devant un tribunal, alors ce tribunal peut rejeter comme irrecevable l’exception si les conditions d’irrecevabilité prévues par la loi sont remplies, sans saisir, en ce cas, la Cour constitutionnelle.
Le second problème est le suivant : la Cour constitutionnelle a considéré aussi, conformément à l’article 12 alinéa 2 de la Loi organique relative à la Cour, que la motivation est obligatoire, parce que c’est le principe de la saisine qui gouverne la loi roumaine. La Cour constitutionnelle roumaine ne peut pas s’auto-saisir. Elle doit être saisie. Cependant, quand la requête, l’exception d’inconstitutionnalité ou l’objection formulée, par exemple par un groupe de 50 députés ou 25 sénateurs, n’est pas motivée, alors le manque de motivation a été considéré comme valant auto-saisine alors qu’elle n’est prévue ni par la Constitution, ni par la Loi organique. Est-ce que la Cour se prononce sur cette objection ou sur cette exception d’inconstitutionnalité ? Non, elle doit rejeter la requête comme irrecevable.
Enfin, je voudrais faire quelques commentaires sur la question du désistement. La Cour roumaine a prononcé plusieurs décisions dont on a pu tirer la conclusion que le désistement n’est pas recevable en ce qui concerne l’objection d’inconstitutionnalité et aussi les exceptions d’inconstitutionnalité. Donc autant dans le cadre du contrôle a priori que dans le cadre du contrôle a posteriori, les auteurs des objections ou des exceptions ne peuvent se désister, parce que la Cour constitutionnelle roumaine a considéré que c’est une question d’ordre constitutionnel, une exception ou une objection d’ordre public qui n’est pas à la disposition des autorités ou des personnes qui ont soulevé ce problème. La motivation est la même que celle évoquée ce matin. Je voudrais souligner seulement le fait que c’est la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle roumaine et qu’elle date de la création de la Cour. Elle est très ancienne [2]. D’ailleurs, le Règlement d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle prévoit à l’article 25 : « Une fois légalement saisie, la Cour procède à l’examen de la constitutionnalité, les dispositions relatives à la suspension, l’interruption ou l’extinction du procès n’étant pas applicables. »
M. Fiser, Cour constitutionnelle de Slovénie : J’ai une objection à faire au rapport de synthèse à propos du chapitre II-1.3., ce sont les pages 3 et 4 [p. 609 du présent volume]. Puisqu’il s’agit d’une question de fond, je tiens à préciser notre situation. Nous parlons de l’intérêt à agir. La Slovénie a été positionnée dans le quatrième groupe parmi les pays où tous les requérants doivent démontrer leur intérêt à agir. C’est notre position mais ce n’est pas complètement exact. La position slovène a tous les effets de celle du deuxième groupe où se trouvent les pays qui pour certains requérants, dits « les autorités », n’exigent pas l’intérêt à agir, alors que les autres, généralement personnes physiques et morales, doivent démontrer leur intérêt juridique à agir. C’est notre solution, nous l’avons expliquée dans le rapport national. Nous avons aussi essayé de la rendre plus visible, plus claire, en utilisant deux expressions différentes. Nous parlons de requête pour la saisine dite de l’autorité, c’est-à-dire l’Assemblée nationale, un tiers des députés, le Conseil National, gouvernement, etc. ; et de l’autre côté, nous employons le terme de pétition pour les autres saisines qui ont besoin, comme je l’avais dit, de démontrer un intérêt à agir. Je crois qu’avec cette petite explication supplémentaire, la situation de la Slovénie en la matière est claire.
M. Berger-Perrin, Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune : Pardonnez-moi de faire un plaidoyer pro domo, je ne suis pas venu pour cela, mais l’occasion se présente tout de même, car je trouve dommage quand on parle de justice et quand on parle de droits de l’homme, quand on parle de libertés fondamentales, de laisser l’avocat sur la touche ou en tout cas de lui laisser un rôle extrêmement réduit. C’est ce que l’on croit comprendre à la lecture du rapport de synthèse. Or, il s’agit, encore une fois, de défendre des droits essentiels et il n’y a pas de bonne justice sans magistrats indépendants, certes, mais il n’y a pas non plus de bonne justice sans une défense libre. Or la défense libre dans le monde entier, quand il s’agit d’États libres et démocratiques, elle s’assure par les avocats qui en sont les représentants naturels.
Dans le rôle des Cours constitutionnelles, il y a les deux aspects que l’on connaît bien : un aspect juridictionnel et puis un aspect politique. Pour ce qui est de l’aspect purement politique, lorsqu’elle est saisie par les autorités publiques et qu’il n’y a pas véritablement un débat contradictoire entre des intérêts opposés, je comprends que l’on puisse se passer de l’avocat. En revanche, dès lors que l’on passe à la défense d’intérêts contradictoires, à ce moment-là, le rôle de l’avocat me paraît s’imposer.
On remarque tout naturellement, je prends l’exemple de la France, que le Conseil constitutionnel a une composition absolument libre. Les personnes qui désignent les membres du Conseil constitutionnel peuvent désigner qui elles veulent. Or, il s’avère à l’usage, je crois, qu’aujourd’hui les neuf membres du Conseil constitutionnel français sont tous des juristes – en tout cas des légistes –et il me paraît donc naturel que de la même manière les intervenants éventuels soient des avocats qui peuvent d’ailleurs aussi bien assister que représenter, car on parle de représentation, mais cela peut être une assistance. Je pense qu’il serait bon que lorsque l’on prévoit un débat contradictoire, lorsque l’on prévoit une saisine directe par les citoyens, par exemple, et pour éviter les recours abusifs ou mal motivés que l’on évoquait ce matin, de dire que dans ce cas-là, il y a assistance ou représentation obligatoire par avocat.
M. Nguéma, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : Je voudrais également vous donner quelques informations en ce qui concerne la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples qui, une fois encore, je vous le répète, ne s’occupe pas des problèmes de constitutionnalité, mais des problèmes des droits de l’homme.
Les conditions de recevabilité sont extrêmement restrictives. Elles ne s’appliquent qu’aux requêtes introduites par des particuliers. Il y en a sept (article 56 de la Charte). Les requêtes doivent indiquer l’identité de l’auteur, cela va de soi. Deuxièmement, elles doivent être compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’unité africaine et avec la présente Charte ; cela va de soi également. Troisièmement, elles ne doivent pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État mis en cause, de ses institutions ou de l’OUA, mais quelqu’un de bien élevé ne va pas mettre des bêtises dans une requête. Quatrièmement, ne pas se limiter à rassembler exclusivement les nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, parce que nous sommes un peu réservés vis-à-vis des journalistes qui disent n’importe quoi dans les médias et si l’on se fonde là-dessus, on peut aller loin. Et comme nous sommes en matière de droits de l’homme, il faut faire extrêmement attention. Cinquièmement, et là c’est la condition la plus difficile que les requêtes venant des personnes privées n’arrivent pas du tout à remplir le plus souvent : il s’agit de l’épuisement des voies de recours internes si elles existent. Sixièmement : être introduites dans un délai raisonnable… Septièmement : ne pas concerner des cas déjà réglés…
Les requêtes des particuliers sont donc particulièrement encadrées. Le mouvement vers la démocratisation devrait conduire à revoir ces conditions trop restrictives.
M. Rajaonarivony, Haute Cour constitutionnelle de Madagascar : La qualité des requérants est liée à la nature du recours, c’est-à-dire à son caractère contentieux ou non contentieux. Dans le cas des recours non contentieux, un seul critère est mis en avant : celui de la qualité du requérant. Seules quelques autorités publiques peuvent ainsi saisir la juridiction constitutionnelle afin de contrôler les normes a priori. Tandis que pour le recours que je qualifierais de contentieux, c’est-à-dire a posteriori, dans le cas où un droit fondamental a été violé, ce droit appartient en principe à tout le monde. À ce moment-là, c’est l’intérêt pour agir qui doit donc motiver la requête,
que le recours émane d’une personne privée ou d’une personne morale. Et à ce moment-là en principe, la requête doit être écrite, ce qui dans certains pays comme chez nous par exemple peut parfois être difficilement satisfait sans l’assistance d’un avocat ou d’une tierce personne, bien que la requête demeure personnelle afin d’éviter l’anonymat et les requêtes dilatoires. Enfin, la requête doit être motivée.
M. Thor, président de séance, Conseil constitutionnel du Cambodge : Je vous propose de passer au second volet qui est : « Conditions relatives au recours ».
M. Frank, Cour constitutionnelle de Centrafrique : Monsieur le président, je sollicitais tout à l’heure une rectification, au sujet de la procédure de régularisation de la requête, c’est le point II-2.5.
Concernant cette procédure de régularisation de la requête, il est dit que de nombreux rapports se contentent de préciser que cette régularisation n’est pas prévue par les textes. Mais on trouve dans d’autres rapports des réponses affirmatives. C’est ainsi que dans certains cas, la juridiction constitutionnelle prend elle-même l’initiative de faire régulariser la requête en la complétant par ce qui manque et c’est à ce sujet que la Cour constitutionnelle de Centrafrique a été citée. Bien au contraire, la République centrafricaine se situe dans la première catégorie, c’est-à-dire là où la régularisation n’est pas prévue par les textes et cela est dit dans notre rapport national. Si Monsieur le président a sous les yeux le rapport national de Centrafrique, à la page 7 [p. 206 du présent volume] la question est bien posée. Il est dit : existe-t-il une procédure de régularisation de la requête ? Et dans notre rapport national, nous avons été précis : non. La réponse est négative. L’état actuel de la législation centrafricaine ne prévoit pas une telle procédure. Donc Monsieur le président, nous sommes dans la première catégorie où la régularisation n’a pas été prévue par les textes. Par conséquent, pour rectifier il suffit de barrer « Centrafrique » et de mettre à côté de Cambodge, Égypte, Gabon, Guinée, Maroc, Mauritanie, Roumanie, Sénégal.
M. Menouni, Conseil constitutionnel du Maroc : Il s’agit d’une simple question que je voudrais poser à propos de la régularisation. Dans la plupart des rapports nationaux qui ont été présentés, on n’a pas été, me semble-t-il, suffisamment explicite sur la question. Soit on dit que la régularisation de la requête est possible, soit on dit qu’elle est effectuée dans certaines situations. Ce que je voudrais savoir, et je pose justement la question aux Cours constitutionnelles qui procèdent à cette régularisation de la requête, quelles sont les formes de cette régularisation. Parce que la régularisation de la requête, me semble-t-il, c’est quelque chose qui se fait couramment lorsqu’il s’agit du contentieux électoral, mais en matière de contentieux constitutionnel, je voudrais bien être éclairé sur cette question, c’est-à-dire sur les formes de la régularisation et ses limites.
M. Abadie, Conseil constitutionnel français : La France est dans la catégorie qui régularise au moins pour les cas simples et de portée réduite. Il s’agit souvent du doute que l’on peut avoir sur la réalité de la signature d’un ou de plusieurs des parlementaires qui font partie du groupe des soixante saisissants. Premier type de cas, doute sur la volonté de saisir : on vérifie que véritablement la signature est authentique, on le peut car tous les parlementaires déposent leur signature au bureau de leur assemblée et nous pouvons donc exercer ce contrôle par comparaison avec la signature déposée.
Il y a un deuxième type de régularisation : c’est lorsque nous sommes saisis par fax, alors que nous exigeons une signature authentique. Donc quand on reçoit un fax, on demande à l’intéressé qui a envoyé un fax pour accompagner en la complétant la saisine du groupe des saisissants, de confirmer par signature authentique. Ce sont les deux seuls types de cas où nous avons mis en œuvre des régularisations.
M. Melchior, Cour d’arbitrage de Belgique : En ce qui concerne, la régularisation de la requête, personnellement, je ne crois pas que cela existe en Belgique. Je crois qu’il faut biffer cette mention. Ce qui arrive éventuellement (c’est peut-être ça qui a été compris comme étant une régularisation de la requête), c’est que lorsqu’il s’agit d’une personne morale qui dépose une requête, il arrive qu’elle ne joigne pas les statuts tels qu’ils ont été publiés par exemple au Moniteur. Dans ce cas, le Greffe demande une copie de ces statuts, mais ce n’est pas une régularisation du fond de la requête. C’est vraiment un point de pure forme. D’autre part, on a dit que pour la Belgique, pour faciliter peut-être le travail de la Cour, on exige une copie de la loi qui fait l’objet du recours. En fait, c’est un peu ridicule que la loi prévoit cet élément-là, parce que la Cour est tout de même censée connaître les lois existant en Belgique, puisqu’on ne peut attaquer les lois qu’après leur publication au Journal officiel.
Par contre, ce qui est plus important, c’est que la Belgique est comparable à la Roumanie, dans la mesure où la motivation de la requête est toujours exigée. On doit indiquer la norme attaquée et en quoi cette norme viole telle ou telle disposition constitutionnelle. Cette motivation est une condition de recevabilité, une requête non motivée est rejetée. Par exemple un article de la loi est attaqué, mais il n’y a pas de moyens développés à l’égard de cet article. La demande sera rejetée, sauf si la Cour soulève d’office des moyens, mais cela est relativement rare. Voilà quelques petites précisions.
Mme Sidibe, Cour constitutionnelle du Mali : Je suis exactement dans le même cas que mon collègue du Maroc. Je n’ai pas très bien saisi encore nonobstant les explications données par le préfet Abadie comment on peut régulariser une requête. En tout cas, d’après les explications, la régularisation consiste en une confirmation, puisque le fax est quand même un moyen moderne
de transmission d’une demande, c’est-à-dire d’une requête. Maintenant, les documents annexes que l’on peut envoyer, de mon point de vue, comme l’a dit le représentant de la Belgique, cela me paraît être autre chose. Alors j’aimerais que l’on explique mieux cette notion de régularisation, pour la simple raison que dans nos Cours, on a un peu tendance à faire comme cela se passe en France, parce que c’est l’institution aînée de nous tous. Et donc si l’on ne comprend pas bien, il risque d’y avoir des dérapages. Je souhaite, avant de partir, que l’on soit bien fixé. Les explications du représentant de la Belgique me confortent dans ma compréhension de la chose que dès qu’on a fait une requête, on n’a rien à modifier. Maintenant, on peut faire une modification ou une confirmation, je ne sais pas quel terme a été utilisé. On peut, par la suite, transmettre des documents annexes pour bien asseoir la demande que l’on a faite à la Cour. Cela, je l’entends bien. Mais modifier ou régulariser une requête, je n’ai pas bien compris et je ne vois pas la pertinence de cela.
Mme Merlin-Desmartis, Conseil constitutionnel français : Lorsque le Conseil constitutionnel français reçoit une requête, une saisine, les signatures nous parviennent sur d’autres feuilles, le plus souvent sur des feuilles séparées. C’est-à-dire nous avons le nom du député ou du sénateur, et sa signature en bas de cette feuille. Il faut savoir que par commodité, une mauvaise habitude s’était instaurée – il faut dire les choses comme elles étaient : les députés n’étant pas toujours à Paris, les sénateurs non plus, c’était une secrétaire ou quelqu’autre membre du groupe qui imitait leur signature, qui mettait un quelconque grigri en bas de la requête. On s’est rendu compte de cette pratique et comme nous avons au service juridique du Conseil constitutionnel, un relevé de toutes les signatures manuscrites, nous avons décidé de comparer tout simplement la signature manuscrite déposée, qui est authentique, et celle qui figure sur ces feuilles annexes. Lorsque l’on a un doute, on demande si Monsieur le député untel ou Monsieur le sénateur untel a bien signé la requête. Il y a eu un cas où le député ou le sénateur untel a répondu que jamais il n’avait entendu déposer cette saisine. Cela démontre l’utilité de cette procédure : il faut savoir que les députés et les sénateurs ont un peu de mal à se mettre d’accord pour saisir ou pour ne pas saisir, que tout cela se fait dans l’agitation et la précipitation. Or il faut que nous soyons absolument sûrs, surtout lorsque l’on a 61 ou 62 saisissants, que tous les députés ou tous les sénateurs ont bien entendu saisir le Conseil. D’où cette invitation, non pas à régulariser – la formule est peut-être maladroite – mais à confirmer que le député ou le sénateur en cause a bien entendu déposer cette saisine.
Mme Sidibe, Cour constitutionnelle du Mali : S’agissant de fax, quand on appose sa propre signature, cela sort de l’autre côté, telle que la signature authentique déposée. En fait, c’est une vérification de la conformité des signatures. Cela ne change rien au contenu de la requête !
Mme Merlin-Desmartis, Conseil constitutionnel français : Non, cela ne change bien évidemment rien au contenu de la requête. Ce qui importe, c’est le décompte. D’ailleurs dans les décisions, nous disons que le Conseil constitutionnel a été saisi par tant de députés ou par tant de sénateurs. Il faut donc que le décompte soit exact, surtout lorsqu’il ne dépasse pas de beaucoup le nombre des 60. Il s’agit véritablement d’authentifier la signature pour être assuré de la justesse du décompte.
Quant au fax, nous admettons la saisine par fax, mais il faut que cette saisine soit régularisée par la poste, de façon à ce que ce soit toujours la signature manuscrite qui soit apposée sur la requête. Certes cette pratique peut changer. Vous dites que ça devient une modalité de saisine du juge. Mais pour le moment, nous en sommes encore là, c’est-à-dire à demander une régularisation par voie postale avec l’apposition de la signature manuscrite.
Mme Sidibe, Cour constitutionnelle du Mali : Eh bien nous sommes en avance au Mali, parce que nous, on accepte la saisine par fax.
Mme Angué, Cour constitutionnelle du Gabon : Merci Monsieur le président, je voulais citer un peu l’exemple du Gabon, pour essayer d’éclairer notre collègue du Mali sur la question de la régularisation de la requête. Au Gabon, la Loi organique prévoit un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour saisir la Cour constitutionnelle et la requête doit comporter certaines mentions. C’est ainsi que, par exemple, dans le cadre du contrôle a priori qui nous occupe maintenant, nous avons la particularité au Gabon, que les particuliers et, disons, les personnes physiques ou morales peuvent saisir la Cour constitutionnelle. La qualité pourra agir à ce moment-là. Disons que l’intéressé met son nom, son adresse. Il doit le faire avant la promulgation de la loi. On ne lui demande pas au moment du dépôt de la requête, c’est-à-dire que l’on peut, en quelque sorte, fermer les yeux sur la question. Il met juste le nom, l’adresse et dépose sa requête. Par la suite, on peut lui demander de venir prouver, par exemple, qu’il s’agit d’une personne morale et on peut aussi, comme pour les lois justement, demander à ce que l’acte attaqué soit joint à la requête. Et comme en général, les particuliers ont du mal à se procurer la loi dès qu’elle est adoptée par le Parlement, ils peuvent déposer la requête et la Cour peut – disons le greffier en chef en général – lui dire « vous avez 24 heures pour venir compléter votre requête ». Sinon, il n’y a pas une forme particulière, c’est-à-dire qu’il n’est pas par exemple nécessaire de faire une lettre à l’attention ou à l’adresse du requérant pour, disons, formaliser ou matérialiser cette régularisation de la requête. C’est une simple pratique.
Mme Sidibe, Cour constitutionnelle du Mali : Je vous remercie. Mais vous avez à la fin de votre exposé dit qu’il s’agissait de compléter. Mon problème est le suivant : dès que l’on a déposé une requête, si elle est recevable, j’ai dit tantôt si c’est par fax – en tout cas chez moi, c’est admis par fax – c’est peut-être compte tenu de l’étendue du territoire, parce que quand quelqu’un à Tombouctou se trouve à plus de 1 000 kilomètres, il ne faut pas lui demander de venir à Bamako déposer sa requête, il peut très bien le faire par fax. Donc nous acceptons cela. S’il y a des documents à envoyer en plus, comme vous l’avez dit vous-même tout à l’heure, ça c’est compléter, mais cela ne veut pas dire qu’il doit régulariser sa requête. En France, peut-être que vous avez la possibilité d’avoir des spécimens de signatures de tous les députés, mais en tout cas chez moi, non. On n’a pas ce luxe-là et donc on ne vérifie pas si c’est X ou Y qui a signé dès lors que l’on a reçu une requête. Si elle répond aux conditions matérielles et formelles, on la déclare recevable et on examine sa demande. Voilà. Donc je vous remercie d’ajouter le mot « compléter » et non « régulariser ». Peut-être que la régularisation est improprement utilisée dans ce cas-là, car il s’agit simplement de compléter.
M. Thor, président de séance, Conseil constitutionnel du Cambodge : Je passe au volet n° 3 qui s’intitule « Modalités de rejets pour irrecevabilité ». La discussion est ouverte.
Qui ne dit mot consent ? Bon. Alors je passe au volet suivant. C’est le dernier volet qui s’intitule « Motifs de rejets. Synthèse ».
M. Benjelloun, Conseil constitutionnel du Maroc : Je voulais poser une question aux chers collègues. Pour ce tableau de synthèse qui est à la page 15 [II-4.] « Motifs de rejets » [p. 618 du présent volume], nous n’avons eu des réponses que de quelques pays. On a compris que les autres n’ont pas eu de rejets. Alors si jamais une Cour constitutionnelle a prononcé un rejet, il convient de vous manifester afin que l’on complète le tableau.
M. Abadie, Conseil constitutionnel français : Dans le tableau « Motifs de rejets. Synthèse’» sur lequel vous nous demandez de nous exprimer, la France a été mise dans la colonne « forclusion », ce qui semble vouloir dire que l’on impose des délais aux requêtes en contrôle a priori. Or, nous n’imposons pas de délai. Il y a un délai évident, qui s’impose de lui-même, c’est celui qui se termine par la promulgation de la loi ou par la transmission du traité soumis au Parlement pour ratification. Ce délai passé, le Conseil constitutionnel n’est plus en état de pouvoir examiner le litige éventuel. J’ai indiqué jusqu’à la promulgation, mais c’est plus précisément jusqu’à la décision du président de la République de promulguer. En effet, nous avons eu un cas assez limite : nous avons reçu une requête qui est arrivée au Conseil avant que le Journal officiel ne publie la loi en cause ; mais le président de la République avait déjà pris la décision de promulguer la loi avant que la requête n’arrive au Conseil constitutionnel et la procédure interne du cheminement de la mise en œuvre vers le Journal officiel de la décision de promulguer avait été engagée. Donc la requête n’était plus recevable et le Conseil ne s’est pas réuni pour l’examiner. Il n’y a pas eu de rejet de la saisine à proprement parler, simplement le Conseil ne s’est pas réuni.
Mme Sidibe, Cour constitutionnelle du Mali : À la page 10 [II-3.] [p. 348 du présent volume] du rapport du Mali, nous avons indiqué que nous avons rejeté un certain nombre de requêtes que le rapport de synthèse n’a pas pris en compte. Il s’agit de rejets prononcés pour les motifs suivants : les saisissants n’avaient pas la compétence de saisir la Cour.
Dans l’autre cas, c’est la Cour elle-même qui était incompétente, parce qu’un certain nombre de députés avaient demandé à la Cour de se prononcer sur l’immunité parlementaire d’un député, ce qui n’était pas dans les attributions de la Cour. Ces demandes ont donc été déclarées irrecevables.
M. Hage-Chahine, Professeur à l’Université Saint Joseph de Beyrouth, Liban : La cinquième colonne du tableau dont nous parlons porte comme titre : « incompétence de l’auteur de saisine ». S’agit-il de l’incompétence ou de l’absence de qualité ?
M. Thor, président de séance, Conseil constitutionnel du Cambodge : C’est une bonne question. Le Cambodge a rejeté deux fois pour ce motif. Monsieur Prak, pouvez-vous expliquer l’expérience du Cambodge qui pourrait apporter une réponse à la question posée.
M. Prak, Conseil constitutionnel du Cambodge : Je voudrais bien souligner que, en ce qui concerne l’« incompétence de l’auteur de l’acte », il s’agit, bien sûr, de ceux qui ne rentrent pas dans la compétence pour saisir le Conseil. Le texte de la loi a prévu des personnalités habilitées à nous saisir. Mais ceux qui ne sont pas prévus dans le texte sont ceux qui sont incompétents pour saisir le Conseil. Ainsi, il est prévu qu’un dixième des membres de l’Assemblée nationale peut saisir le Conseil ou un quart des sénateurs. Or, deux difficultés se sont produites : dans le premier cas, douze députés avaient saisi le Conseil, or l’assemblée compte 122 députés. Donc douze personnes représentent moins d’un dixième des membres de l’Assemblée et ne peuvent être compétentes pour saisir le Conseil. Nous avons donc rejeté la demande d’interprétation de la loi qui était formulée, pour cause d’incompétence.
Le deuxième cas concerne les sénateurs. Un quart de sénateurs, soit quinze sénateurs, peuvent saisir le Conseil. Malheureusement, six sénateurs seulement ont saisi le Conseil qui a donc rejeté pour incompétence de l’auteur de la saisine.
M. Thor, président de séance, Conseil constitutionnel du Cambodge : Merci Monsieur Prak. D’après le tableau publié dans le rapport sur la recevabilité des saisines, la France a rejeté cinq fois pour « incompétence de l’auteur de la saisine ». La France peut-elle donc nous apporter quelques
éclaircissements sur cette question ?
Mme Remy-Granger, Conseil constitutionnel français, ACCPUF : Je pense que l’incompétence venait de ce que les saisissants étaient des particuliers.
La question libanaise est très pertinente. Si parmi vous il y a une vraie différence entre « incompétence de l’auteur de saisine » et « manque de qualité du saisissant », peut-être faudrait-il mettre les deux rubriques dans les colonnes, si le Maroc est d’accord ?
M. Annour, Conseil constitutionnel du Tchad : Je voulais juste souligner que le rapport a omis de mentionner le cas du Tchad. Nous avons relevé dans notre rapport à la page 6 [II-3.] [p. 557 du présent volume] qu’il y a un cas où nous avons rendu une décision concernant l’incompétence de l’auteur ou le défaut de qualité. En fait, il s’agit d’une lettre de saisine qui a été signée par le secrétaire général de la Présidence de la République. Or, le texte dit que c’est le président de la République, seul, qui peut saisir le Conseil constitutionnel. Il s’agit d’un pouvoir propre du chef de l’état.
Mme Gbeha-Afouda, Cour constitutionnelle du Bénin : Il conviendrait d’apporter une modification aux chiffres reportés dans la colonne « Incompétence de l’auteur de saisine ». Si cette incompétence s’entend « défaut de qualité » ou « défaut de capacité », alors il y a eu au total 14 rejets pour le Bénin.
M. Hountondji, Cour constitutionnelle du Bénin : Je constate que nous sommes en train de modifier les chiffres d’un rapport, alors même que nous ne sommes pas d’accord sur les termes des rubriques. Je m’excuse, je suis professeur de médecine, je ne suis pas juriste, mais je me suis égaré à la Cour constitutionnelle. Nous sommes en train de confondre, à mon avis, « incompétence » et « défaut de qualité ». Je crois savoir que l’incompétence, c’est par rapport au juge, alors que lorsque l’incompétence s’adresse à la personne qui n’est pas habilitée à saisir l’institution, c’est un défaut de qualité, ce n’est pas une incompétence. C’est pour cela que je me demande pourquoi la Cour constitutionnelle du Bénin est en train de modifier les chiffres, alors que nous avons une autre compréhension de l’incompétence et de la qualité à agir.
Mme Ouinsou, Cour constitutionnelle du Bénin : Monsieur le Professeur, on a ajouté, pour éviter toute discussion sur la terminologie, « ou défaut de qualité ».
M. Vandernoot, conseiller d’État, référendaire honoraire à la Cour d’arbitrage de Belgique : Je crois ressentir un consensus dans la salle qui conduit à supprimer carrément la formule « incompétence de l’auteur de saisine » et à la remplacer par « défaut de qualité ». Cela me semble résulter d’un consensus que j’entends autour de moi, mais je ne voudrais pas imposer ce point de vue, s’il n’est pas certifié.
M. Thor, président de séance, Conseil constitutionnel du Cambodge : Pour le Cambodge, cela ne marche pas. Je crois que l’on ne peut pas maintenant trancher sur la terminologie qui est vraiment délicate. L’utilisation du terme « ou » pourrait régler le problème pour le moment…
M. Mengué, Réseau africain de droit constitutionnel : Il me semble qu’il n’y a pas matière à débat. L’incompétence de l’auteur n’est, me semble-t-il, que la conséquence de son défaut de qualité. Je n’ai pas la qualité de président de la République. Je suis donc incompétent pour saisir la Cour constitutionnelle. L’une n’est que la conséquence de l’autre. Donc je ne vois pas vraiment quel débat il peut y avoir autour de tout cela.
M. Berger-Perrin, Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune : Juridiquement, c’est une fin de non recevoir et non pas une exception. C’est pour cela que les termes sont quand même trompeurs.
M. Loudghiri, Conseil constitutionnel du Maroc : Si vous permettez, puisque la rédaction émane du Maroc – et je parle sous le contrôle de Monsieur le président du Conseil marocain – j’estime que, probablement, c’est une mauvaise traduction ou une mauvaise rédaction dans notre esprit, et par conséquent nous ne voyons aucun inconvénient, en tant que simples rédacteurs de ce rapport qu’il soit substitué au terme « incompétence »,
« défaut de qualité ». D’ailleurs, c’est l’esprit même du texte.
M. Benjelloun, Conseil constitutionnel du Maroc : Pour ce qui est de cette question-là, je crois, dans l’optique du droit public, qu’il sera très facile de suivre ce courant. Comme l’a dit Madame, ce débat doctrinal chez les civilistes, les a amenés à ne plus distinguer réellement le terme « incompétence » d’« absence de qualité ».
Maintenant, pour notre collègue du Cambodge, si l’on veut respecter la teneur de tous les rapports et dans la mesure où est abordée à la fois l’« incompétence » et l’« absence de qualité », si l’on veut tenir compte de cette alternative, je crois qu’il convient de conserver les deux propositions.
M. Mengué, Réseau africain de droit constitutionnel : Cela me semble un bon compromis, parce que la confusion vient de ce que les personnes habilitées à saisir la Cour peuvent être des autorités publiques, des autorités politiques ou de simples particuliers. Et je crois que lorsqu’on se situe sur le terrain du droit public et de ses autorités, on parle d’incompétence. Et lorsqu’il s’agit de particulier, c’est plutôt le défaut de qualité qui s’applique le mieux. Donc le bon compromis consisterait justement à garder les deux
formules c’est-à-dire « incompétence » et « défaut de qualité ».
M. Thor, président de séance, Conseil constitutionnel du Cambodge : Merci beaucoup. Je crois que le problème est réglé. Je passe maintenant la parole à Monsieur Benjelloun pour la conclusion.
M. Benjelloun, Conseil constitutionnel du Maroc : La conclusion ne va pas être longue, parce que les remarques qui ont été faites sont toutes pertinentes et aussi bonnes les unes que les autres. Les propositions d’ajout ou de modification, telles qu’on les a adoptées en assemblée, seront intégrées au rapport.
Je souhaiterais reprendre quelques questions qui ont été posées afin d’apporter un petit commentaire personnel.
Concernant la qualité du requérant et s’agissant de la signature que l’on peut exiger des illettrés, ce problème peut se poser au niveau du contentieux électoral. Maintenant, dans le cas où le saisissant est le président de la République, les autorités publiques, les personnes morales, les députés, alors ce problème ne se pose pas. Si l’on admet qu’un représentant peut signer à la place du requérant, comme certains systèmes le permettent, le problème se pose encore moins. Toujours est-il que si les participants ou un participant veut ajouter une note particulière, je n’y vois pas d’inconvénient.
Pour ce qui est de l’intérêt à agir, la question des désistements a amené des propositions intéressantes et de nombreuses interrogations de la part des collègues. Personnellement, je retiens la différence qu’il convient de faire entre les constitutionnalistes et les privatistes ou civilistes. La matière constitutionnelle offre en effet une optique particulière.
Quant aux autres rectifications et oublis, je pense notamment à la Slovénie, à la République centrafricaine, à la Belgique ou encore à la question de la régularisation, vous êtes invités à nous transmettre les modifications souhaitées. Un point reste tout de même en suspens, c’est le sens à donner à la régularisation. Qu’entend-t-on par « régularisation » et quelles en sont les limites exactes ? Lorsqu’il est dit que quelqu’un qui n’a pas signé va signer, peut-on considérer cela comme une régularisation ? Quelqu’un qui a envoyé un fax et qui va envoyer une lettre ensuite, procède-t-il à une régularisation ? Il est très difficile d’établir un parallélisme avec la régularisation à laquelle il est procédé dans le contentieux électoral où elle consistera à fournir à la juridiction constitutionnelle des pièces justificatives, etc.
Dans le système marocain, on ne dit rien. On laisse faire. Si le requérant apporte les pièces nécessaires pendant le délai de quinze jours après l’élection, alors il régularise lui-même, et l’on considère que la requête est une. Mais s’il ne fait rien, s’il se tait, le Conseil se tait aussi et rejette pour irrecevabilité. La régularisation se comprend donc de cette façon au Maroc.
Pour le cas du Tchad, je vous prie de m’en excuser, c’est une lacune que nous allons corriger. Concernant la rectification du Bénin, nous allons inscrire « 14 » et non « 1 » à la colonne du dernier tableau correspondant au rejet pour « incompétence ou défaut de qualité ».
Le rapport a tenu compte des catégories retenues dans le questionnaire. Notre collègue du réseau africain de droit constitutionnel nous propose de distinguer le terme « compétence » renvoyant aux autorités publiques et celui de « défaut de qualité », réservé aux particuliers. Conserver l’alternative me semble plus simple. D’ailleurs, à la fin du rapport de synthèse, vous trouvez le total des rejets répartis selon leur motif, en pourcentage. Mais c’est principalement le faible nombre de rejets qui devrait retenir notre attention. Sans doute nous manque-t-il des éléments chiffrés dans ce tableau. Il conviendrait d’y remédier.
M. Vandernoot, conseiller d’État, référendaire honoraire à la Cour d’arbitrage de Belgique : Monsieur le président, si vous m’y autorisez, simplement un motif d’explication pour lequel cette colonne, ce tableau n’a peut-être pas été complété de manière aussi abondante que vous l’auriez souhaité. C’est que dans le questionnaire, il nous a été demandé, effectivement, d’indiquer les différents motifs de rejets, en suivant, par exemple, la grille qui est proposée. Et je pense que plusieurs juridictions, dont la Cour d’arbitrage de Belgique, ont proposé une grille, mais différente, parce que la grille proposée était considérée comme un exemple.
Je pense donc qu’il est possible, et c’est l’exercice auquel je viens de me livrer, de reprendre le tableau que nous avons communiqué, de faire des regroupements adéquats et d’amender en quelque sorte votre rapport de synthèse sur ce point. La difficulté vient donc de ce que certaines cours ont utilisé une grille de classification qui n’est pas nécessairement celle qui était proposée à titre d’exemple dans le questionnaire.
Mme Ouinsou, Cour constitutionnelle du Bénin : Merci Monsieur le président. Je crois aussi qu’il faudra tenir compte peut-être de certaines pratiques administratives qui filtrent les requêtes avant qu’elles ne soient examinées en assemblée plénière. Peut-être que dans certaines juridictions où il y a des Greffes, le greffier fait ce travail-là : toute requête qui ne correspond pas aux normes est ipso facto rejetée, de façon administrative. Cela explique que l’on n’aura jamais de décision en assemblée plénière de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, si l’on revient à l’histoire des compétences des cours, il est à noter qu’au niveau de la Cour constitutionnelle du Bénin, on a fait une régularisation de terminologie, parce que dans notre rapport national, à la page 18 [II-4.] [p. 66 du présent volume], on n’a pas parlé d’« incompétence », on a parlé de « défaut de qualité » et de « défaut de capacité ».
M. Gonthier, Cour suprême du Canada : Au Canada, il n’y a qu’environ 20 % des pourvois qui sont des pourvois de plein droit. Souvent les moyens qui seraient peut-être des moyens de recevabilité trouvent leur traitement par le refus tout simplement d’accorder la permission d’appel. C’est pour cette raison que dans le rapport canadien, nous avons simplement donné les chiffres globaux de requêtes en annulation qui sont très peu nombreux. Et nous avons suivi ces chiffres, c’est aux pages 21 et 22 [II-4.] [p. 167 du présent volume], d’une explication quant aux motifs les plus courants d’irrecevabilité. Alors évidemment, cela ne cadre pas avec cette présentation sous forme de tableau et de pourcentages, parce que nous pensions que ce ne serait pas significatif.
D’autre part, pour la question de qualité ou de défaut d’intérêt ou intérêt d’agir, nous en traitons dans une autre partie de notre rapport. Nous en avons discuté ce matin.
M. Benjelloun, Conseil constitutionnel du Maroc : Certaines propositions sont relativement courtes et pourront être intégrées sans difficulté. En revanche, certaines explications me semblent difficiles à inclure dans le tableau de synthèse, parce qu’il faut penser au lecteur, à l’utilisateur de ces tableaux. Si nos éminents collègues estiment que la particularité mérite une note ou un astérisque à part – personnellement, si vous voulez, je pencherai dans ce sens-là – on ajoutera expressément au tableau un astérisque pour telle ou telle institution. En tant que juristes, nous sommes familiers des exceptions et illustrations particulières et parfois il est renvoyé, pour un petit paragraphe, à des thèses.
M. Loudghiri, Conseil constitutionnel du Maroc : Monsieur le président du Conseil constitutionnel du Maroc, en tant qu’auteur du rapport, a fait en quelque sorte, la synthèse de ce qui ressort de notre débat, profitant de cette occasion pour expliciter certains points développés dans son rapport. Je souhaiterais qu’il soit fait mention de l’intervention du bâtonnier Berger-Perrin à propos du ministère d’avocat, d’autant que la question a été reprise par d’autres éminents délégués, et si cette mention est reprise, je pense qu’elle fera partie des questions soulevées ou livrées à notre réflexion. Je vous remercie.
M. Ndong, Cour constitutionnelle du Gabon : Simplement une question à propos du désistement. Il a été indiqué que dans certaines Cours constitutionnelles, dans certaines juridictions constitutionnelles, les désistements n’étaient pas admis dans le cadre du contrôle a priori, contrôle préventif, parce que, précisément, il s’agissait d’un contrôle qui se situait dans l’intérêt général. Mais la loi ou la Constitution exige un certain nombre de parlementaires pour pouvoir saisir la Cour, par ailleurs, quel que soit le nombre des désistements, la juridiction saisie poursuit tout de même l’examen de la saisine ou de la requête, parce qu’ici c’est l’intérêt général qui est mis en index. Alors je me posais la question de savoir si, pour les pays qui prévoient ce nombre de saisissants, députés ou sénateurs et dans la mesure où le désistement de certains d’entre eux n’annule pas la saisine, cette exigence tenant au nombre des saisissants est nécessaire. Est-ce qu’il ne serait pas bon simplement d’autoriser un député ou un sénateur, à titre individuel, à saisir la juridiction constitutionnelle si tel est son désir à partir du moment où, même si ils étaient dix, si cinq ou six se désistent, la Cour ou le Conseil poursuit quand même l’examen de la norme contestée ou attaquée ?
M. Thor, président de séance, Conseil constitutionnel du Cambodge : En l’absence d’autres interventions, nous terminons ainsi notre deuxième thème. Je vous remercie beaucoup pour votre participation active.
-
[1]
Voir ci-dessus les débats p. 595. [Retour au contenu] -
[2]
Voir ci-dessous l’annexe p. 725. [Retour au contenu]
Le procès équitable
sous la présidence du Conseil constitutionnel du Sénégal

Libreville, deuxième Congrès de l’ACCPUF
De gauche à droite : Monsieur Gilbert KOLLY, juge au Tribunal fédéral suisse,
Monsieur Mamadou LÔ, membre du Conseil constitutionnel du Sénégal.

Troisième rapport de synthèse par Monsieur Gilbert KOLLY, juge au Tribunal fédéral suisse
Juin 2000
Rapport établi par Dominique Favre,
juge au Tribunal fédéral suisse.
III. Procédure et traitement de la saisine recevable
III 1. – Principe du contradictoire
Garantie fondamentale de la procédure, dans tous les ordres juridiques, le principe du contradictoire ne revêt parfois qu’une portée restreinte en matière de contrôle de la constitutionnalité des normes. De façon générale, lorsque le système de contrôle est préventif et abstrait, la procédure apparaît davantage comme une étape du processus d’entrée en vigueur et de mise en application de la règle critiquée ; la caractéristique marquante de cette intervention est plus « législative » que « judiciaire », c’est pourquoi le principe du contradictoire ne joue qu’un rôle très limité. À l’inverse, dans les États qui connaissent un contrôle diffus et dans les hypothèses de contrôles successifs ou répressifs, intervenant souvent par voie d’exception (contrôle concret), l’inconstitutionnalité éventuelle de la règle doit être prononcée alors que la loi s’applique déjà, dans un cas concret séparant deux parties ou opposant un citoyen ou un administré à la puissance publique. Dans ce contexte, le principe du contradictoire reprend toute son importance.
Le fait que ce principe soit apprécié de manières diverses suivant les systèmes nationaux n’implique pas un jugement de valeur ou une sensibilité plus ou moins grande à la sauvegarde des droits de la personne humaine, mais est inhérent à la matière et au système de contrôle de la constitutionnalité choisi par les États.
À cet égard, on peut distinguer les nuances suivantes :
a) La négation du principe du contradictoire :
Tel est le cas en République islamique de Mauritanie et en République du Tchad, où le procès en constitutionnalité n’est pas contradictoire, les documents produits n’ayant qu’une valeur de renseignements ; les parties n’ont pas accès au prétoire, à aucune étape de la procédure. Au Cambodge, le Conseil constitutionnel n’est pas soumis à la procédure du contradictoire, puisqu’il n’est pas une véritable cour en matière de contrôle de constitutionnalité. La procédure est écrite et non contradictoire devant la Cour suprême de la République de Guinée, dont les séances, en matière constitutionnelle, ne sont pas publiques. Le principe du contradictoire n’existe pas non plus au Sénégal. Devant le Conseil constitutionnel de France, la contradiction n’est nulle part inscrite dans les dispositions réglementant le contrôle de constitutionnalité des normes, notamment en ce qui concerne le contrôle concentré préventif obligatoire. Pour certaines procédures de contrôle, une pratique empirique du principe de la contradiction s’est développée à partir d’une ordonnance faisant simplement mention d’une information des autorités de saisine.
b) Le respect partiel du principe du contradictoire :
La pratique française citée plus haut pourrait, en fait, entrer dans cette rubrique. Il en va de même en République de Bulgarie, où le principe du contradictoire ne s’applique guère à la phase de la recevabilité de la demande de contrôle constitutionnel, mais bien davantage à la deuxième phase de la procédure qui est consacrée au jugement de l’affaire sur le fond. À ce stade, la participation des intéressés et leurs possibilités de présenter des moyens d’inconstitutionnalité, de même que la faculté pour la Cour de déclarer une loi inconstitutionnelle sans être limitée par les motifs soulevés, accordent d’une part à la procédure un caractère d’office et relèvent d’autre part du principe du contradictoire. Devant la Cour constitutionnelle du Bénin, le procès en constitutionnalité n’est que partiellement contradictoire en raison du type inquisitorial de la procédure suivie, des pouvoirs d’investigation très étendus du rapporteur et du caractère secret de l’instruction. Au Royaume du Maroc, le recours en constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel n’est pas pleinement contradictoire, en ce sens que la demande des requérants et la réponse de l’autre partie ne font pas l’objet de communications aux intéressés. De même, les parties n’ont pas accès au prétoire.
Toutefois, le droit pour les parties de se faire assister par toutes personnes physiques ou morales compétentes et la possibilité parfois accordée aux personnes ou autorités mises en cause de s’expliquer sur les griefs portés contre eux, permettent de conclure à une application limitée du principe du contradictoire. En Égypte, le procès en constitutionnalité est décrit comme pleinement ou partiellement contradictoire, ce qui ressort notamment de l’accès des parties au prétoire, soit oralement, par écrit et par ministère d’avocats. En République du Mali, le principe du contradictoire s’applique aux fins du contrôle de constitutionnalité des lois, ou en cas de litige sur la définition légale ou réglementaire d’une disposition, mais pas lorsqu’il s’agit du contrôle obligatoire des lois organiques et des règlements de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social et culturel et du Haut Conseil des collectivités. Cette exception réduit la portée du principe du contradictoire, dès lors que le contrôle de constitutionnalité s’est quasiment limité, jusqu’à présent, aux lois organiques et aux règlements des hautes instances nationales mentionnées ci-avant. La loi relative à la Cour constitutionnelle de la République de Moldavie ne prévoit pas le principe du contradictoire, qui est une création jurisprudentielle. Les parties au procès de juridiction constitutionnelle jouissent d’un libre accès au dossier, peuvent présenter des arguments et participer à l’instruction de la cause, oralement ou par écrit, et se prononcer sur la position d’autres participants à la procédure, soit des garanties fondamentales de procédure relativement étendues. En République du Togo, la procédure est partiellement contradictoire, à l’appréciation du juge rapporteur. Comme elle est essentiellement écrite, les parties ne peuvent pas demander à être entendues, soit en personne, soit par ministère d’avocats, lors des débats de la Cour. Le principe du contradictoire est partiellement respecté en ce que l’autorité visée par l’auteur de la saisine peut présenter des observations, qui sont communiquées à ce dernier.
c) Le principe du contradictoire est assuré, mais avec quelques réserves :
À Djibouti, le procès est défini comme pleinement contradictoire en ce que toutes les pièces sont communiquées aux parties qui peuvent consulter les dossiers au siège du Conseil constitutionnel. Les séances de celui-ci ne sont pas publiques et les intéressés ne peuvent pas demander à y être entendus oralement, vu le caractère écrit de la procédure. Toutefois, si le Conseil estime les auditions nécessaires pour la manifestation de la vérité, il peut les ordonner. En République gabonaise, où tout procès devant la Cour constitutionnelle est contradictoire, cela vaut également pour le procès en constitutionnalité. L’accès des parties au prétoire dépend de l’appréciation du rapporteur, qui peut entendre les parties oralement, par écrit ou par ministère d’avocats. Exceptionnellement, et par dérogation au caractère écrit de la procédure, le président de la Cour peut, après lecture du rapport à l’audience, et s’il le juge opportun, convoquer les parties ou toute autre personne intéressée et les inviter à présenter verbalement leurs observations.
d) Le principe du contradictoire pleinement respecté :
Devant la Cour d’arbitrage de Belgique, pour la procédure des recours en annulation (contrôle a posteriori), ainsi que pour les questions préjudicielles (procédure de renvoi sur exception d’inconstitutionnalité), un large accès est réservé aux parties ; ces procédures sont essentiellement écrites, et l’audience de la Cour d’arbitrage se déroule en public. Lorsqu’un moyen d’office est soulevé, ou que les parties font état d’éléments nouveaux, notamment à l’audience publique, la Cour garantit aux autres participants le pouvoir d’émettre des observations sur les derniers éléments apportés aux débats. Au Canada, le procès en constitutionnalité est largement contradictoire, le respect de ce principe étant vu comme un contrepoids à la primauté du législateur, la Cour suprême ne pouvant prononcer l’inconstitutionnalité d’une loi contestée qu’à l’issue d’un examen en profondeur des questions constitutionnelles soulevées devant les Cours ou le Tribunal dont les jugements sont portés en appel devant elle. La procédure fait l’objet d’une instruction écrite, puis d’une mise au rôle en vue d’une audience au cours de laquelle les parties peuvent présenter des plaidoiries strictement réglementées (quant au temps et à la possibilité de répliquer).
En République Centrafricaine, le procès en constitutionnalité est décrit comme pleinement contradictoire, les parties et leurs représentants, notamment avocats, ayant accès au prétoire le jour de l’audience publique, au cours de laquelle ils sont autorisés à prendre la parole. À Madagascar, la procédure est essentiellement écrite et la contradiction est assurée par les échanges de mémoires entre les parties concernées ; leurs avocats peuvent demander à plaider oralement devant la Haute Cour constitutionnelle, moyennant une requête présentée à l’avance. Devant la Cour suprême de l’Ile Maurice, la procédure est réglée par des dispositions spéciales s’inspirant des procès civils ; le principe du contradictoire est respecté ; la représentation du requérant par ministère d’avocats est obligatoire. En Roumanie, le principe du contradictoire est observé dans le sens de l’échange de mémoires écrits par les parties. Cela vaut aussi bien pour le contrôle préventif que pour la censure de l’inconstitutionnalité éventuelle des lois par voie d’exception ; dans cette dernière hypothèse, les parties, qui peuvent être assistées et représentées par des avocats, ont la faculté d’intervenir oralement, ce qui s’explique par le caractère plus judiciaire du contrôle répressif.
En République de Slovénie, la procédure est soit écrite, soit orale. Dans le premier cas, chaque partie intéressée au contrôle de constitutionnalité, soit le requérant et l’auteur de l’acte général (loi matérielle ou formelle), dispose du droit de formuler des observations. Lorsque la procédure est orale, elle peut se dérouler soit à huis clos, soit en audience publique, séances qui ont lieu après communication des documents. Outre les personnes concernées par la procédure, d’autres personnes susceptibles de contribuer au règlement de la cause peuvent être auditionnées. Le huis clos partiel peut également être décidé. Lorsque l’audience a eu lieu publiquement, la délibération et le vote sur la décision se font par contre à huis clos, seuls les juges présents à l’audience publique étant alors habilités à participer au jugement. Quand la sentence est prononcée oralement, sa lecture a lieu en audience publique. En Suisse, le principe du contradictoire, appelé « droit d’être entendu » en raison d’une traduction littérale de l’expression allemande « Rechtliches Gehör », est largement reconnu tant dans le contrôle préventif, par voie d’action, que répressif par voie d’exception. La procédure est essentiellement écrite, mais dans certaines circonstances, assez rares, des débats oraux ont lieu pour respecter l’article 6 CEDH. Indépendamment de l’éventuelle oralité des débats, l’audience de délibération et de prononcé du jugement est publique lorsque les juges (cinq ou sept) ne sont pas unanimes ou lorsque l’un d’eux le demande expressément.
III 1.1. – Formalités à accomplir une fois que la Cour se juge valablement saisie
Vu l’imbrication du procès en constitutionnalité dans le mécanisme de promulgation des lois, la plupart des systèmes nationaux prévoient la notification de la demande (saisine) aux autres autorités de saisine. Dans la plupart des systèmes, le président de la République, le Premier ministre et le président du Parlement sont informés de la demande de contrôle de constitutionnalité faite par l’un d’eux, ou en cas de saisine parlementaire, par le groupe de parlementaires prévu par la loi. Dans certains cas, la contradiction est rendue publique, par la parution, dans un organisme officiel, des échanges d’arguments pour ou contre la constitutionnalité du texte déféré au juge constitutionnel.
En cas de contrôle répressif, et/ou par voie d’exception, les démarches de communication se rapprochent de celles des autres procédures ordinaires, civiles ou administratives.
Concernant le détail de ces diverses formalités, il est difficile d’établir une synthèse, en dehors des considérations générales relevées ci-dessus. Il suffit de remarquer que dans les systèmes concentrés et préventifs, où la faculté de recourir est réservée le plus souvent à des organes de l’État, voire à des communautés religieuses comme au Liban et au Gabon, l’information est donnée à toutes les autorités compétentes, notamment pour traiter correctement la question de la promulgation de la loi et suspendre celle qui fait l’objet d’une demande de contrôle de constitutionnalité. Lorsque les particuliers sont habilités à solliciter un tel contrôle concret, ou incident ou par voie d’exception, les mêmes impératifs d’information n’existent pas puisque la loi est déjà promulguée et que la relativité du procès n’aboutira en général pas à l’abrogation de la loi déclarée inconstitutionnelle, mais seulement à son inapplicabilité dans le cas d’espèce, et dans toutes les situations semblables qui pourraient être invoquées par d’autres particuliers.
Un bref regard sur les institutions comparées permet encore de préciser les éléments suivants :
Le système d’avis, au Roi, au président de la République ou au président de l’Assemblée nationale, notifiés par des fonctionnaires supérieurs des Cours suprêmes, en général le greffier en chef, est ainsi prévu au Sénégal, en Guinée, au Maroc, au Bénin, au Mali, en Moldavie, au Togo, à Djibouti, au Gabon, en République Centrafricaine, à Madagascar et en Roumanie. En Mauritanie, l’obligation d’informer le président de la République, le Premier ministre et les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale n’est requise qu’en cas de saisine parlementaire, lorsque le contrôle de constitutionnalité est demandé par un tiers du Sénat ou un tiers de l’Assemblée nationale.
En Belgique, l’information est organisée pratiquement dans les mêmes termes aussi bien dans l’hypothèse des recours en annulation que dans celle d’une question préjudicielle ; dans ce dernier cas, la décision de renvoi est également notifiée aux parties à la procédure ayant donné lieu au renvoi. À l’instar de la publication française au Journal officiel, le Greffe de la Cour d’arbitrage de Belgique fait publier au Moniteur belge une mention relative à l’existence d’une question préjudicielle ou concernant le recours en annulation. Suite à cette parution, toute personne justifiant d’un intérêt peut adresser un mémoire à la Cour.
Au Rwanda, la Cour constitutionnelle ne peut être saisie que par une personne publique, l’Assemblée nationale ou le gouvernement. Le contrôle est préventif et systématique, aucun recours ne peut être accepté contre une loi ou un décret loi gouvernemental régulièrement promulgué. Par contre, les personnes qui s’estimeraient lésées par certaines décisions judiciaires ou administratives peuvent notamment recourir à la Section « Conseil d’État » de la Cour suprême, qui statue sur les recours en annulation formés contre les règlements, arrêtés et décisions des autorités administratives. Ce système est proche de celui des institutions suisses, où le Tribunal fédéral (Cour suprême) ne peut pas revoir la constitutionnalité des lois fédérales, mais censure, dans ses deux sections de droit public, équivalentes au Conseil d’État, la légalité des règlements, ordonnances et décisions des autorités administratives fédérales, ainsi que les lois des États membres de la Confédération (cantons).
Des procédures d’avis beaucoup plus larges, fonctions notamment des contrôles répressifs abstraits, et surtout concrets, existent à l’Ile Maurice, en Slovénie, au Canada, en Suisse et en Bulgarie.
III 1.2. – Conditions de l’accès des parties au juge constitutionnel
Ici également, en fonction de la portée plus ou moins grande du contrôle de la constitutionnalité des actes généraux et des différents systèmes nationaux existants, trois groupes de pays peuvent apparemment être distingués :
a) Les systèmes où les parties n’ont pas accès au juge constitutionnel :
C’est par exemple le cas de la République du Tchad, où les parties n’ont accès au prétoire à aucune étape de la procédure, en raison du caractère non contradictoire de celle-ci devant le Conseil constitutionnel. La même solution est retenue en République islamique de Mauritanie. Pareillement, au Royaume du Maroc, dans aucune étape de la procédure, les parties n’ont accès au prétoire. Le même modèle vaut au Sénégal, où les intéressés ne peuvent demander à être entendus par le Conseil constitutionnel, dont les séances ne sont pas publiques, à l’exception de certains cas d’assermentation, notamment du président de la République, ce qui ne concerne pas le contrôle de la constitutionnalité des lois et actes généraux. Dans ce domaine, en République du Mali, le principe du contradictoire n’est pas davantage reconnu, mais il existe une volonté de formuler des propositions d’amélioration, voire des adaptations structurelles de la Cour constitutionnelle. Ceci, dans le cadre d’une réforme relative à l’accès au juge constitutionnel, en considération surtout de l’incorporation de la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples dans la Constitution de la République du Mali, et de l’article 85 de celle-là, qui pourrait ouvrir aux citoyens le chemin du tribunal constitutionnel. En France, la jurisprudence permet l’intervention des « acteurs du procès constitutionnel » au cours de la phase d’instruction, s’agissant du contrôle des lois. L’intervention de l’avocat n’est pas admise, ce qui peut se comprendre dans l’hypothèse d’un contrôle concentré préventif, alors que le contrôle a posteriori, notamment incident ou par voie d’exception (concret), légitime la présence d’un mandataire professionnellement qualifié.
b) Les systèmes d’accès réduit ou partiel :
En République gabonaise également, l’intervention des parties s’opère durant la phase de l’instruction, si le rapporteur le juge utile. Lorsque le rapporteur a décidé de l’opportunité de la collaboration des parties, les modalités de cette dernière sont très larges, soit par audition, dépôt d’observations écrites ou encore par le ministère d’un avocat. Au stade du jugement, à titre exceptionnel et par dérogation au caractère écrit de la procédure, le président de la Cour constitutionnelle peut encore convoquer les parties ou toute autre personne intéressée et les inviter à présenter verbalement des observations. Madagascar connaît une procédure essentiellement écrite, ainsi que la faculté de recourir au service d’un avocat, qui peut demander à plaider oralement devant la Cour, à condition qu’il l’informe d’avance. En République Centrafricaine, l’intervention des parties, de leurs avocats ou représentants est limitée au jour de l’audience publique, au cours de laquelle ces personnes sont autorisées à prendre la parole, s’ils ont en fait préalablement la demande.
À Djibouti, les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à y être entendus en raison du caractère entièrement écrit de la procédure. Une dérogation est réservée à l’appréciation du Conseil, si ce dernier estime les auditions nécessaires pour la manifestation de la vérité. Le caractère essentiellement écrit de la procédure exclut, en République togolaise, que les parties soient entendues lors des débats de la Cour constitutionnelle, soit en personne, soit par ministère d’avocats. En République de Guinée, les séances de la Cour suprême en matière constitutionnelle ne sont pas publiques, de sorte que les requérants n’ont pas accès au prétoire ; ils peuvent par contre déposer un mémoire à l’intention du conseiller rapporteur qui réunit les informations, fait les enquêtes et dresse un rapport en évoquant tous les moyens soulevés par le requérant.
c) Les systèmes garantissant un large accès au juge constitutionnel :
Un très large accès est reconnu devant la Cour d’arbitrage de Belgique tant aux parties « institutionnelles » qu’aux personnes justifiant d’un intérêt, ce qui inclut également celles qui ont la qualité pour agir devant la juridiction qui ordonne le renvoi préjudiciel, dans l’hypothèse du contrôle sur
renvoi. Les parties participent à la procédure écrite, qui est suivie d’une audience au cours de laquelle chacune d’entre elles peut être entendue, assistée le cas échéant d’un avocat. Devant la Cour constitutionnelle de Moldavie, les mêmes principes sont observés, le procès constitutionnel présentant toutes les garanties fondamentales de procédure admises généralement dans les litiges civils ou administratifs. En Égypte, les parties ont accès au prétoire dans toutes les étapes de la procédure et dans toutes les conditions, soit oralement, par écrit et par ministère d’avocats. En République de Bulgarie, l’accès est large dans la deuxième phase de la procédure, s’agissant du jugement de l’affaire sur le fond, la procédure étant essentiellement écrite, avec la possibilité toutefois de tenir des séances publiques. Dans la phase initiale de la recevabilité, les parties ont accès au dossier par le dépôt d’observations, la Cour constitutionnelle siégeant en la présence des parties institutionnelles et des personnes intéressées. Au Canada, celles-ci peuvent présenter leurs arguments sous la forme écrite ou orale, les seules limitations mentionnées étant d’ordre pratique (fixation de délais et durée des plaidoiries). Comme déjà indiqué, la compétence de la Cour suprême de l’Île Maurice est très vaste en matière constitutionnelle, et la procédure analogue au domaine civil.
Devant la Cour constitutionnelle de la Roumanie, l’accès au juge n’est garanti sans réserve que pour le jugement des exceptions d’inconstitutionnalité, et non pas dans le cas du contrôle préventif. Dans la première hypothèse, les parties peuvent déposer des mémoires écrits et faire des interventions orales avec ou sans l’assistance ou la représentation d’avocats. Au Bénin, les parties ont accès au procès constitutionnel par écrit et peuvent fournir à la Cour des renseignements complémentaires à la requête, le cas échéant. Elles peuvent se faire assister de toutes personnes physiques ou morales compétentes. Le mandataire peut déposer au dossier des mémoires qui doivent par contre être signés par la partie concernée elle-même. Les débats ne sont pas publics.
En Suisse, l’accès au juge constitutionnel est total pour ceux qui sont atteints dans un intérêt juridiquement protégé, aussi longtemps qu’il s’agit de traiter de la constitutionnalité des lois des États membres de la Confédération. Par contre, il n’existe pas de contrôle de la constitutionnalité des lois fédérales, la réforme de 1999 visant à établir un contrôle préventif et sur renvoi n’ayant pas abouti.
III 2. – Le principe de l’égalité des armes
III 2.1. – Les pièces constitutives de la procédure
Il est difficile, en cette matière, de dégager un concept, l’examen comparatif des divers systèmes prenant davantage l’aspect d’une description et d’un inventaire.
Selon le principe de l’égalité des armes, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. À cet égard, dans l’examen des dossiers, il convient de distinguer les pièces qui sont fournies par les parties adverses de celles qui émanent de l’autorité dont la décision est attaquée.
Dans certaines formes de contrôle répressif, par voie d’exception, si le recourant doit avoir accès à tous les documents de la procédure ainsi que sa partie adverse, le fait de ne pas lui remettre les observations de l’autorité, en général judiciaire, qui a statué en dernier lieu sur la cause les divisant et à qui il est reproché d’avoir appliqué une disposition légale inconstitutionnelle, ne constitue pas un manquement au principe de l’égalité des armes. Si, par contre, les observations remises par cette autorité à la Cour constitutionnelle contiennent un avis motivé sur le bien-fondé du recours, à l’égard duquel des conclusions explicites concernant le grief d’inconstitutionnalité ont été prises, alors les parties doivent pouvoir se prononcer sur la détermination de l’autorité intimée.
Dans le contrôle préventif, et avec le système concentré, le dossier de procédure devant la Cour constitutionnelle comprend la lettre de saisine, l’acte livré à l’examen de constitutionnalité, les observations responsives du gouvernement et éventuellement un mémoire ampliatif des saisissants, soit une manière de réplique à la réponse du gouvernement. Divers autres documents (instruments internationaux, textes législatifs et réglementaires) en rapport avec le texte soumis à l’examen de constitutionnalité font également partie de la procédure. Tel est le cas devant le Conseil constitutionnel français. À cet égard, le dossier de procédure constitué par son service juridique comprend en plus les documents parlementaires, les décisions de justice en relation avec les questions abordées et les références doctrinales, qui, dans d’autres systèmes (notamment en Suisse), relèvent davantage des sources du droit et servent au développement de l’argumentation des parties, sans être à proprement parler des pièces constitutives de la procédure. Au Bénin, il n’existe pas une liste exhaustive de pièces à déposer devant la Cour constitutionnelle, la lettre de saisine et l’acte attaqué étant bien entendu les documents de base. L’Égypte connaît une même souplesse, en ce sens que n’importe quelle pièce peut être apportée à la procédure. Il en est de même au Maroc où le dossier comprend la lettre de saisine, les textes applicables, la requête en cas de recours contre la loi et la décision du président du Conseil constitutionnel portant désignation du rapporteur, aucune pièce de l’affaire n’étant exclue de la procédure. Le dossier de la procédure devant la Cour d’arbitrage belge se compose de l’acte introductif (requête en annulation ou décision juridictionnelle portant la question préjudicielle), des mémoires des parties intervenantes et des mémoires responsifs des autres parties. En cas de développement de l’instruction et d’examen d’office de certains moyens, de nouveaux délais sont impartis aux parties pour se prononcer sur ces actes de procédure justifiant ainsi le dépôt d’un mémoire complémentaire. En Guinée, les pièces sont la requête, l’acte soumis à l’appréciation du juge constitutionnel, les moyens invoqués et l’acte d’instruction du conseiller rapporteur, ainsi que les observations du Ministère public. Le dossier togolais présente les mêmes caractéristiques, ainsi que ceux de Madagascar, de la République gabonaise et du Tchad. Dans ce dernier pays, à l’instar de la Guinée, toutes pièces communiquées par les parties après le dépôt du recours ou de la requête sont exclues du dossier et ne revêtent respectivement pour la Cour et le Conseil constitutionnel qu’une valeur de simple renseignement. La question est sans objet en République islamique de Mauritanie.
Au Sénégal, le dossier comporte les documents habituels, y compris les textes de la jurisprudence visée. En République Centrafricaine, les conclusions échangées entre les parties sont constitutives de la procédure, de même qu’à Djibouti. En République de Moldavie, le dossier de la Cour constitutionnelle est composé de la décision de la Cour sur l’examen préliminaire de la saisine, de celle-ci et de ses pièces annexées, de la demande éventuelle d’effectuer des expertises, des notes informatives et des rapports faits pendant l’examen préliminaire de la saisine, des rapports d’expertise et toutes autres pièces. En République de Roumanie, il faut distinguer le cas du contrôle a priori de celui du contrôle répressif, par voie d’exception d’inconstitutionnalité, lequel se déroule conformément aux règles de la procédure civile. Dans la première hypothèse, le dossier rassemble la saisine, les documents et les avis qui lui sont annexés ainsi que les dispositions attaquées et celles qui ne peuvent plus en être dissociées, dans l’examen de la constitutionnalité. Pour le contrôle concret par voie d’exception, toutes les règles du procès civil s’appliquent, situation proche de celle qui existe en Suisse. Le dossier canadien comprend les pièces habituelles ainsi que les décisions de jurisprudence et la doctrine, chaque partie devant déposer auprès du Registraire et signifier aux autres parties et intervenants un recueil de jurisprudence et de doctrine contenant uniquement les extraits pertinents des arrêts et ouvrages sur lesquels elle entend s’appuyer. En Bulgarie, tout dépend des particularités du cas, mais le système est large, la jurisprudence n’ayant pas établi de critères et d’exigences stricts et spécifiques concernant les moyens de preuve qui doivent obligatoirement accompagner la demande de contrôle de constitutionnalité.
Quant à la transmissibilité ou à l’accessibilité des pièces aux parties, on peut discerner schématiquement trois tendances :
a) Une totale liberté d’accès :
C’est le cas au Canada, en Roumanie, en Bulgarie, en Moldavie, à Djibouti, en République Centrafricaine, au Sénégal, à Madagascar, au Togo et en Égypte.
b) L’inaccessibilité des pièces :
Lorsque le procès n’est pas contradictoire, cela implique que les pièces ne sont ni transmises ni accessibles aux parties. Cette hypothèse se rencontre le plus souvent dans le cas du contrôle préventif ou par voie d’action. C’est notamment le cas lorsqu’il n’y a pas deux parties au procès, mais une seule, le requérant, qui dépose des pièces relatives à l’acte soumis à l’appréciation du juge constitutionnel, documents dont les autorités à informer ne sont pas destinataires ; seul un avis leur est adressé (République de Guinée). Ces mêmes considérations valent pour le Bénin.
La question n’a guère de pertinence pour le Cambodge, le Tchad et la République islamique de Mauritanie, systèmes dans lesquels le procès en constitutionnalité n’est pas contradictoire, de même qu’au Royaume du Maroc.
c) La position intermédiaire :
En France, les pièces de la procédure font l’objet d’un échange contradictoire écrit analogue à celui qui se déroule devant les juridictions administratives. En revanche, les fiches techniques qui apportent des précisions sur des éléments non évoqués dans la saisine devant le conseiller rapporteur lors de la réunion de travail avec les représentants du gouvernement, ou ultérieurement dans la procédure, ne sont pas communiquées. En Belgique, chaque partie reçoit la notification des mémoires et de l’inventaire des dossiers éventuels qui peuvent être consultés au Greffe de la Cour d’arbitrage, dont l’accès est facilité par une publication au Moniteur belge. Par contre, aucune pièce émanant de la Cour n’est notifiée aux parties, pas même les rapports d’audience prononcés par les juges rapporteurs, par exemple ; fait exception l’ordonnance de clôture de l’instruction préparatoire qui peut contenir des questions aux parties ou des moyens d’office. Il n’y a pas de notification de pièces en République gabonaise. Un principe semblable est retenu en Slovénie, où le droit d’examen d’un dossier ne s’étend pas à la partie interne de celui-ci, qui comprend les projets de rapports, de décisions et de résolutions, le procès-verbal de la délibération et du vote, les pièces jointes aux demandes, si elles sont désignées comme étant d’intérêt économique, officiel ou de toute autre nature exigeant la confidentialité. Une même restriction d’accès vise les documents portant atteinte à des données personnelles ou familiales d’une des parties à la procédure. L’examen des pièces doit s’effectuer au Bureau principal de la Cour constitutionnelle, sous la surveillance d’un fonctionnaire, avec inscription dans un registre spécial officiel. Le droit de reproduire certaines parties du dossier ou de recevoir un extrait recopié est également garanti. En Suisse, le droit d’accéder au dossier est général et s’effectue par communication de pièces pour ce qui est des documents émanant des parties, et par consultation de ceux-ci au Greffe du Tribunal fédéral en ce qui concerne le dossier établi par l’autorité contre la décision de laquelle est dirigé un grief d’inconstitutionnalité.
Il ressort de ces constatations que les « documents internes » ne sont pas accessibles aux parties, ces dernières n’ayant pas le droit de connaître la démarche de formation de la volonté collective de la Cour constitutionnelle, sauf lorsque la délibération publique de l’arrêt est admise, ce qui est très rare (Suisse).
De plus, le droit de consulter le dossier peut être restreint pour la sauvegarde de l’intérêt public ou celle de l’intérêt prépondérant d’un particulier, voire même aussi dans l’intérêt du requérant lui-même, essentiellement dans l’hypothèse de dossiers médicaux.
La confidentialité des documents internes, et l’exception consentie à la consultation des dossiers lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant est en jeu, paraissent inhérentes à toute procédure judiciaire, y compris constitutionnelle. Toutefois, un mécanisme de contrôle doit être institué au sein de la Cour, pour statuer sur le caractère confidentiel des documents remis et en interdire la communication ou la consultation lorsqu’un motif déterminant est reconnu, et pour éviter une limitation excessive des droits des parties. Vu le laconisme de la plupart des réponses des pays mentionnés sous lettre a), il est difficile de dire si la classification proposée ci-dessus demeure pertinente, dans la mesure où la réserve en faveur de la confidentialité des documents « internes » et de ceux touchant un intérêt public ou privé prépondérant est peut être implicitement contenue dans les réponses apportées. Il en est de même si, par « documents de la procédure », il faut comprendre toutes les pièces, sauf celles qui servent à la formation de la volonté collective de la Cour.
III 2.2. – Maxime d’office ou inquisitoriale
Devant le Conseil constitutionnel français, la procédure est inquisitoriale, le membre désigné comme rapporteur de l’affaire dirigeant librement son instruction. Il lui revient de prendre toutes les initiatives nécessaires, par exemple de convoquer et d’interroger les représentants des ministères intéressés par le texte soumis à contrôle, de même que toutes personnalités ou spécialistes susceptibles d’éclairer sa réflexion. Le rapporteur peut entendre les experts, ou même prendre les contacts informels qui semblent utiles à son information. En Suisse, le juge peut également agir d’office dans le cadre des conclusions des parties. Il décide librement de l’administration des preuves et peut même écarter certaines d’entre elles par une appréciation anticipée, admise de jurisprudence constante comme étant conforme au principe du contradictoire. Les moyens de preuve utilisés le plus fréquemment sont la preuve documentaire, le transport sur place ou l’inspection locale et l’apport de prises de position de services publiques, qui, sans constituer un rapport d’expertise, sont susceptibles de fournir des indications techniques spéciales dans un domaine particulier. Rare, l’expertise est néanmoins concevable. Comme dans n’importe quel autre litige, les parties à la procédure de contrôle de constitutionnalité sont associées à l’exécution des mesures probatoires, sur le résultat desquelles elles ont le droit de s’exprimer par écrit ou verbalement. Dans la pratique, en Suisse par exemple, l’exécution des mesures probatoires reste exceptionnelle et la quasi totalité des recours de droit constitutionnel sont jugés après un, éventuellement deux échanges d’écritures, soit par la communication d’un arrêt écrit, soit par la tenue d’une audience de délibération publique. La maxime d’office s’applique aussi très largement en Slovénie. Les mêmes principes sont retenus au Royaume du Maroc, au Gabon, au Tchad, en Belgique, au Cambodge, au Bénin, en Guinée, en Égypte, au Togo, à Madagascar, au Sénégal, en République Centrafricaine, à Djibouti, en Moldavie et à l’Ile Maurice. En Bulgarie, le pouvoir d’instruction d’office de la Cour constitutionnelle est remarquablement étendu et nul n’a le droit de refuser de présenter les informations ou les preuves documentaires, quand bien même il s’agirait de secrets d’État ou de secrets officiels.
À l’opposé, la Cour suprême du Canada statuant en matière constitutionnelle ne dispose pas de moyens propres d’instruction d’une cause. Elle peut prendre connaissance d’office du droit ainsi que des faits incontestables et notoires, de même que d’études sociales et de données socio-économiques sérieuses. En Roumanie, le juge ne dispose pas de moyens propres d’instruction, ceux-ci n’étant pas nécessaires, car la Cour constitutionnelle se prononce uniquement sur des problèmes de droit, ce qui semble rejoindre la solution canadienne. Il peut solliciter des consultations écrites ou des avis de droit de spécialistes dans des domaines déterminés. La question est sans objet pour la Mauritanie, en raison du caractère non contradictoire du procès en constitutionnalité.
III 2.3. – Principe de l’allégation : le juge peut-il se saisir d’office de dispositions ou de moyens non contestés ou non soulevés dans la requête ?
a) L’admissibilité d’office :
Dès lors que l’examen de la constitutionnalité porte sur l’ensemble de l’acte déféré et qu’il est caractérisé comme un contentieux d’ordre public, cela autorise en France le Conseil constitutionnel à statuer sur toutes questions, y compris celles que n’a pas évoquées l’auteur d’une saisine. Et ceci d’autant plus que les lettres de saisine, dans certaines hypothèses, ne sont même pas motivées. Le pouvoir de substituer des moyens d’inconstitutionnalité à ceux des saisissants et d’élargir l’objet de l’instance est ancré dans la jurisprudence depuis 1977, la loi ainsi contrôlée a priori n’étant toutefois pas « revêtues d’un brevet de constitutionnalité irréfragable ». Le pouvoir d’évocation du juge n’est soumis à aucune condition particulière. Toutefois, une pratique informelle s’est développée, destinée à sauvegarder le principe du contradictoire pour les questions examinées d’office, ce qui est reconnu en matière administrative où le juge est tenu de communiquer aux parties les moyens d’ordre public qu’il entend soulever. Dans un certains nombres de pays, le juge constitutionnel peut donc se saisir d’office de moyens non soulevés dans la requête, sans formalisme, pourvu qu’il relève dans le texte soumis à son examen une disposition non conforme à la constitution. Dans la plupart des cas, les requérants, ou les autres parties au procès n’ont pas la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office par la Cour constitutionnelle. Une telle solution est ainsi adoptée au Royaume du Maroc, au Tchad, en Guinée et au Togo, de nombreux rapporteurs nationaux relevant qu’une telle procédure d’évocation des moyens d’office est très rare.
La Cour d’arbitrage de Belgique peut en soulever d’office, soit dans l’instruction préparatoire avant l’ordonnance de mise en débats, soit après l’audience, au stade du délibéré, ce qui ne s’est produit qu’une seule fois. À l’opposé des systèmes mentionnés plus haut, le principe du contradictoire est pleinement respecté, oralement ou par la voie d’un mémoire. La même solution est retenue en Slovénie, en Égypte et au Bénin.
b) L’admissibilité partielle des moyens soulevés d’office :
En Roumanie, le seul cas où la Cour constitutionnelle procède à une saisine d’office est le contrôle de la constitutionnalité des initiatives de révision de la Constitution. Au Gabon, la Cour statue uniquement sur l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Elle ne peut soulever de moyens d’office, sauf en cas de violation manifeste de la Constitution ou de principes à valeur constitutionnelle. De manière générale, la Cour le fait chaque fois que cela est nécessaire. Le principe du contradictoire n’est alors pas observé. Une solution identique prévaut au Sénégal, en Moldavie, en Bulgarie et en République Centrafricaine, mais dans ce dernier pays, les requérants ont la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés d’office soit oralement à l’audience, soit en versant des notes en délibéré.
c) L’inexistence de l’évocation d’office :
C’est le cas au Canada, où la Cour ne peut se saisir d’office de dispositions non contestées, en raison de la maxime des débats, qui implique que le cadre judiciaire est défini par les parties ; de plus il existe une présomption de constitutionnalité. En Suisse, le juge constitutionnel ne peut se saisir de moyens non soulevés dans le recours, car il se trouve lié par le principe de l’allégation. L’évocation est inconnue, mais dans le cadre de moyens régulièrement soulevés, le juge constitutionnel peut statuer par substitution de motifs pour autant que le dossier le permette et que le principe du contradictoire ait été respecté. Il semble ainsi que dans les situations de contrôle diffus, qui impliquent une plus grande similitude entre le procès en constitutionnalité et les procédures civiles ou administratives ordinaires, le principe de l’allégation l’emporte, de même que la présomption de constitutionnalité. S’agissant d’un contrôle a posteriori, le juge n’a pas à éliminer d’office toute atteinte à l’ordre constitutionnel qu’il peut déceler dans la loi ou l’acte général soumis à son examen. Il se situe en dehors du processus d’élaboration législative.
Ne pouvant pas en principe se saisir d’office, le Conseil constitutionnel du Cambodge n’est pas habilité à soulever les moyens et dispositions non contestés dans la requête. L’évocation des moyens d’office n’existe pas davantage à Djibouti, Madagascar et en Mauritanie.
III 3. – Délai de jugement et procédures (formelles) de clôture de l’instruction
a) Dans le système qui institue un contrôle abstrait exercé a priori (préventif), le délai de jugement est rapide, ce qui est rendu nécessaire par le rattachement de ce mode de contrôle constitutionnel au processus d’adoption des lois. Le délai légal imparti est d’un mois pour le Conseil constitutionnel de France, et peut être ramené, en cas d’urgence, à huit jours en ce qui concerne les lois, l’examen de demandes de délégalisation, ou s’il s’agit de statuer sur la nature réglementaire ou législative d’une initiative parlementaire en cours de discussion. Les mêmes délais valent pour le contrôle des normes générales et abstraites, au regard des traités internationaux, avec une possibilité de statuer en urgence dans un délai de huit jours. De façon générale, ces délais sont rigoureusement tenus, le Conseil constitutionnel statuant en moyenne dans un délai d’environ vingt jours. Il n’y a aucune procédure formelle de clôture de l’instruction, qui prend fin la veille du jour où le Conseil statue.
Le même système vaut pour le Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, qui doit statuer dans des délais de un mois, éventuellement huit jours en cas d’urgence, hypothèse dans laquelle la notification de la décision doit intervenir dans les trois jours. Il n’existe pas davantage de procédures formelles de clôture de l’instruction, qui semble se situer à la mise de l’affaire à l’ordre du jour du Conseil, par son président, après communication du rapport aux membres de la juridiction. Au Gabon, ces délais sont respectivement de trente jours et de huit jours en cas d’urgence, même de quarante-huit heures, en ce qui concerne le contrôle d’ordonnances prises par le président de la République dans l’hypothèse particulière de l’article 26 de la Constitution gabonaise. Ces délais sont toujours respectés. La clôture de l’instruction se fait par le dépôt du rapport au Greffe de la Cour. En République Centrafricaine, le même système de délais de trente jours et de huit jours est adopté, lesquels sont en général observés, avec quelques exceptions en raison de difficultés d’ordre matériel rencontrées par la Cour constitutionnelle de ce pays. Il n’y a pas de procédure formelle de clôture de l’instruction, qui intervient par le dépôt du rapport. La situation est identique au Cambodge, au Togo et en Mauritanie. Au Tchad, le Conseil constitutionnel est tenu de rendre sa décision dans un délai de quinze jours, ou de huit jours en cas d’urgence, délais qui ont jusque-là été respectés. La clôture de l’instruction coïncide avec le dépôt du rapport. Au Bénin, la Cour doit statuer dans les quinze jours pour l’examen d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés politiques, délai ramené à huit jours en cas d’urgence. Lorsque le contrôle de la constitutionnalité intervient par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une autre juridiction dans une affaire qui concerne un citoyen, la décision de la haute juridiction doit être rendue dans un délai de trente jours. Devant le nombre de plus en plus croissant de recours enregistrés par la Cour constitutionnelle du Bénin, les délais ne sont pas systématiquement tenus. La fin de l’instruction est marquée par le dépôt du rapport, procédure non formelle. Le délai entre la fin de l’instruction et le prononcé de la décision varie en fonction de l’ampleur et de la longueur des débats à l’audience, les délibérations pouvant s’étendre sur plusieurs séances en raison de la difficulté des questions soulevées (comme, très exceptionnellement, en Suisse). La Guinée connaît les délais prédéfinis de quinze jours, un mois et exceptionnellement huit jours, qui sont respectés. Au Mali, les délais sont en général de trente jours et de huit jours en cas d’urgence. Le délai est de quinze jours lorsqu’il s’agit de l’examen de la nature législative ou réglementaire d’une disposition. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle statue généralement dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, terme qui peut être prorogé pour des raisons particulières dûment motivées. Il n’y a pas de procédure formelle de clôture de l’instruction. Le Sénégal connaît les mêmes délais de un mois et de huit jours en cas d’urgence, pour le contrôle préventif abstrait. Dans le contrôle par renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de Cassation, lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée devant ces juridictions, le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Ces délais sont scrupuleusement respectés. À Djibouti, les délais de un mois et de huit jours, en cas d’urgence, sont tenus. L’instruction est close par l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour du Conseil constitutionnel. Les délais entre la fin de l’instruction et la tenue du délibéré, puis entre ce dernier et la notification de la décision sont très brefs, de manière à respecter les délais légaux fixés. Il n’existe pas de délais prédéfinis en Égypte, ni de procédure formelle de clôture de l’instruction. Le délai moyen qui s’écoule entre le prononcé de la décision en constitutionnalité et sa publication est de quinze jours.
b) En Belgique, les arrêts doivent être prononcés par la Cour d’arbitrage dans un délai de six mois dès l’introduction de l’affaire, avec une double prorogation éventuelle portant le délai maximal à dix-huit mois. Ces délais sont toujours respectés, quel que soit le type du contentieux soumis à la Cour, et aucune différence n’est faite entre le recours en annulation ou le renvoi pour l’examen de questions préjudicielles. Toutefois, s’agissant des recours en annulation, la Cour doit statuer sans délai lorsqu’une demande de suspension accompagne le recours. Par « sans délai » il faut entendre une décision provisionnelle rendue dans l’intervalle de un à trois mois, l’arrêt sur la demande principale devant intervenir dans les trois mois depuis l’éventuel arrêt de suspension, lorsque cette dernière est ordonnée. Au Canada, la Cour n’est pas tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini. Les documents fournis dans le rapport national ne permettent pas de se faire une idée précise, dans la mesure où les délais entre le dépôt de la demande et le jugement sont en moyenne de vingt mois, mais pour l’ensemble des appels entendus par la Cour et pas seulement pour les affaires constitutionnelles. La même situation prévaut en Suisse où les délais vont de quelques semaines à plusieurs mois, voire une année. À l’Ile Maurice, la Cour n’est pas tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini ; en principe, celle-ci intervient relativement vite.
La différence d’avec le système mentionné sous lettre a) réside dans le fait que l’accent est mis, dans ces pays, sur le contrôle diffus de la constitutionnalité, ce qui explique le relatif allongement de la durée de la procédure. En Bulgarie, le délai est de deux mois dès la fin de l’instruction, soit plus exactement dès que les preuves recueillies sont considérées comme suffisantes. Le délai moyen entre la fin de l’instruction et le prononcé de la décision est d’environ un mois. La Cour constitutionnelle de Slovénie n’est pas liée par un délai déterminé, la durée moyenne des procédures engagées devant la Cour étant, suivant le type de contrôle de constitutionnalité, d’environ un an à un an et demi. En Moldavie, le délai maximal est de six mois à compter de l’enregistrement de la saisine. En Roumanie, la Constitution n’établit aucun délai ; ceux-ci sont fixés dans la loi ou dans le règlement d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Les délais varient suivant les circonstances, de dix à trente jours. Ils sont respectés. Il n’existe pas de procédure formelle de clôture de l’instruction ; en fait, est déterminant le seul prononcé de la décision, dans les délais de dix ou de trente jours rappelés ci-dessus.
Comme indiqué à titre liminaire, suivant son genre, sa portée et ses modalités, le contrôle de la constitutionnalité des actes généraux s’apparente soit au processus législatif, dans sa phase ultime, soit au procès judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, les exigences du procès équitable, et notamment le principe du contradictoire, sont respectées à l’instar des procédures civiles ou administratives à l’occasion desquelles l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée. Le défaut d’application des principes régissant le procès équitable au contrôle constitutionnel a priori, sur requête d’une partie institutionnelle, tient à la nature même d’un tel système et ne consacre pas un affaiblissement des droits des particuliers ; en effet, dans le contrôle constitutionnel préventif, la loi, ou de manière plus générale l’acte attaqué, n’a pas à proprement parler de partie adverse, car les opposants à son adoption ont pu se faire entendre lors des débats parlementaires.
Débats
M. Lô, président de séance, Conseil constitutionnel du Sénégal : Mesdames, Messieurs, Chers collègues, nous allons entamer la deuxième journée de notre congrès par l’examen du troisième sous-rapport consacré au « procès équitable ». Le rapport a été confié au tribunal fédéral suisse qui va vous rendre compte de ses réflexions. Par la suite, nous ouvrirons un débat que j’espère fructueux sur cette question. Je donne la parole à Monsieur le rapporteur.
M. Kolly, rapporteur, Tribunal fédéral suisse [1] : Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les présidents des Cours, Messieurs les conseillers, chers collègues. Il m’échoit ce matin l’avantage et l’honneur de vous présenter le troisième sous-rapport de synthèse que la Suisse a reçu mandat d’établir. Je dois relever d’emblée que je n’en suis pas l’auteur. Ce rapport a été écrit par mon collègue, le juge Dominique Favre, qui est malheureusement empêché, il n’a pas pu venir à Libreville. Je le remplace, vous devez donc vous contenter de ma personne pour le présenter.
L’objet du troisième sous-rapport est de décrire le traitement d’une requête recevable au regard de trois aspects du procès équitable : le principe du contradictoire, l’égalité des armes et le délai de jugement. Les questions à traiter sont donc placées sous le titre général du procès équitable. D’une manière générale, on admet que l’exigence d’équité requiert que chaque partie à la procédure puisse soutenir sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas substantiellement, par rapport aux autres parties. Le procès équitable doit permettre en particulier à toutes les parties de présenter de manière appropriée leur thèse devant le juge appelé à trancher. Le « Procès équitable », en d’autres mots, est un combat judiciaire loyal entre les parties. Alors je crois pouvoir dire qu’avec cela nous sommes d’accord. Je vois assez mal quelqu’un qui aimerait que les procès soient inéquitables. Quel juge voudrait dans son humble justice faire preuve d’inéquité ?
À première vue, donc, on pourrait penser que la comparaison, à laquelle il a été procédé dans le rapport de synthèse, ne va pas démontrer de grandes différences, mais au contraire une large convergence et des divergences uniquement sur des points de détail. Or, il n’en est rien. À la lecture du rapport que vous avez reçu pour cette séance, on peut en effet constater qu’il existe des différences très importantes entre les différentes procédures de nos Cours.
Que faut-il en conclure ? Que notre perception de ce qui est équitable et de ce qui ne l’est pas diverge profondément, que la notion de l’équité est fondamentalement différente d’un pays à l’autre ? Évidemment pas. Les différences constatées sont pour l’essentiel dues à une autre cause : le fait que les systèmes de contrôle de constitutionnalité que nous connaissons sont très dissemblables. Les différences que nous avons constatées dans l’application du principe du procès équitable sont inhérentes à la forme de la juridiction constitutionnelle choisie par les États. À cet égard, beaucoup d’États ici représentés, à l’instar de la France, ont opté pour un contrôle préventif ou a priori. Le contrôle est préventif lorsque la question de la constitutionnalité d’une norme légale est examinée et tranchée avant l’entrée en vigueur ou la promulgation de la norme. Le contrôle intervient à un stade ou la norme légale examinée ne déploie pas encore d’effets juridiques pour les particuliers.
Le résultat du contrôle préventif ne sera donc, le cas échéant, que l’impossibilité pour la norme d’entrer en vigueur. Le contrôle préventif apparaît ainsi plutôt comme une phase, soit obligatoire, soit facultative de la procédure législative elle-même. Il est en quelque sorte la dernière étape avant la promulgation ou la mise en application. C’est la procédure dont nous avons surtout parlé hier. Mais dans cette assemblée, il y a des Cours qui ont un système très différent. D’autres États, comme par exemple le Canada, la Belgique, la Slovénie ou la Suisse ont opté pour un contrôle dit répressif, a posteriori. Ce contrôle répressif, lui, s’exerce sur une norme légale qui est déjà en vigueur. Le contrôle ne s’insère alors plus dans la procédure d’adoption de loi qui est terminée, mais s’inscrit à un moment ou à un autre dans la problématique de l’application de cette norme légale.
Il existe différents systèmes de contrôles répressifs, ou a posteriori, qui ont tous été choisis par l’un ou l’autre État. Il y a le contrôle abstrait : la question de la constitutionnalité est soumise à un juge constitutionnel indépendamment de tout litige particulier concret au fond. Il y a le contrôle concret dans le cadre d’un procès ordinaire pendant devant un tribunal ordinaire : l’une des parties soulève l’exception d’inconstitutionnalité d’une norme légale qui doit être appliquée pour juger l’affaire pendante au fond.
Et là, il y a de nouveau deux possibilités. Soit le juge saisi, devant lequel on soulève l’exception, la tranche, même si c’est un tribunal de première instance. C’est ce que nous appelons le système diffus et alors l’affaire peut être portée par la voie des recours ordinaires jusqu’au tribunal de dernière instance, ordinaire, qui tranche aussi cette question constitutionnelle en der-
nière instance. Ou bien il y a le système dit concentré où alors le juge devant lequel l’exception est soulevée doit stopper la procédure et soumettre la question à un juge spécialisé, constitutionnel, qui lui donnera la solution et ensuite retournera l’affaire pour que le procès ordinaire puisse continuer.
Ce sont beaucoup de systèmes différents et qui conduisent évidemment à des règles de procédures très différentes et ensuite aussi aux résultats du rapport.
Comme dit plus haut, le procès équitable est un combat judiciaire loyal entre parties. Cette situation de combat judiciaire est bien évidemment surtout propre à la forme de la juridiction constitutionnelle répressive et concrète – juridiction a posteriori –, au contrôle de la constitutionnalité d’une loi déjà en force à titre préjudiciel dans le cadre d’un litige concret. Dans ce cas de figure d’un procès pendant entre deux parties, le principe du combat judiciaire loyal s’applique pleinement. Ce combat judiciaire ne doit, et ne peut pas, se dérouler dans des conditions qui placeraient l’une des parties dans une position désavantageuse par rapport à l’autre.
La situation du combat judiciaire fait, par contre, largement défaut dans le système d’un contrôle préventif ou a priori. Contrairement à ce qu’il en est en cas de contrôle répressif et concret, il n’y a pas à proprement parler de procès opposant deux parties. Or, à défaut d’un tel procès entre deux parties, les principes du procès équitables, les principes du combat judiciaire loyal entre deux parties ne peuvent logiquement trouver qu’une application limitée et restreinte.
Après ces quelques remarques introductives, j’en viens aux différents points traités dans le rapport. Points qui correspondent aux questions auxquelles il a été répondu dans les rapports nationaux. Je serai bref. Le rapport a été distribué, vous en avez certainement pris connaissance, je vais donc vous éviter une lecture. Je vais simplement relever quelques points. Par prudence, je vais essayer de citer le moins possible de pays pour ne pas dire quelque chose qui est faux et m’attirer l’ire des représentants du pays concerné, mais je prendrai quand même des risques.
Le premier aspect principal du procès qui a est à traiter dans le rapport de synthèse est le principe du contradictoire. Le principe du contradictoire qu’on appelle dans mon pays « droit d’être entendu » offre plusieurs garanties aux parties au procès, notamment le droit de présenter des requêtes au juge, le droit à ce que le juge se prononce sur ces requêtes, droit d’être informé de tous les éléments importants de la procédure, en particulier des actes procéduraux posés par la partie adverse. Il a aussi le droit d’assister aux actes d’instruction.
Un premier groupe d’États ne connaît pas le principe du contradictoire en juridiction constitutionnelle. À titre d’exemple, je cite le Tchad. La disposition légale topique relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil constitutionnel dit expressément, textuellement : « La procédure devant le Conseil constitutionnel n’est pas contradictoire ». Tout document produit après le dépôt de la requête n’a pour le Conseil donc qu’une valeur de simple renseignement. Au Tchad, les parties n’ont pas accès au prétoire, les pièces produites ne leur sont pas transmises, elles ne sont même pas accessibles. Il s’agit là d’un cas typique de juridiction constitutionnelle préventive, abstraite, par un Conseil constitutionnel que seuls les requérants institutionnels peuvent saisir.
À l’opposé, il y a les États où le principe du contradictoire est entièrement ou très largement appliqué. Dans ces États, les parties peuvent présenter évidemment leur point de vue, se déterminer sur celui des autres parties, soit par écrit, soit par oral. Ils ont accès au dossier. Ils peuvent parfois même plaider devant la Cour, et cela avec l’assistance d’avocats.
Enfin, il y a un troisième groupe d’États, ceux qui appliquent partiellement le principe du contradictoire. Les limitations apportées au principe alors sont d’ordres différents. Si j’ai bien compris, le Mali fait la différence entre le contrôle constitutionnel d’une loi ordinaire et d’une Loi organique. Dans l’un, le contradictoire s’applique, dans l’autre pas.
En Bulgarie, la Cour constitutionnelle applique le principe du contradictoire lorsqu’il s’agit de traiter les griefs soulevés par les parties. Par contre, lorsqu’elles sont saisies d’office, le contradictoire ne s’applique pas et n’a donc pas à donner possibilité aux parties de se déterminer sur les points qu’elles soulèvent d’office.
Un autre point qui devait être traité dans le rapport sont les formalités à accomplir par la Cour constitutionnelle une fois qu’elle se juge valablement saisie. Ces formalités évidemment varient fortement d’un État à l’autre, leur nature et leur ampleur dépendent essentiellement du système choisi. En cas de contrôle préventif, la plupart des législations nationales prévoit la notification de la requête aux autres autorités étatiques habilitées à saisir la Cour constitutionnelle. Ce sont souvent le président de la République, le Premier ministre, le président du Parlement, parfois des groupes parlementaires. Dans certains cas, la contradiction est rendue publique par la parution d’un organe officiel, des échanges d’arguments pour et contre.
En cas de contrôle répressif et concret, par contre, les démarches de communication se rapprochent de celles en vigueur dans la procédure ordinaire au fond, donc qui est très large.
Au sujet de ces formalités, j’aimerais relever le cas de la Belgique qui est particulièrement intéressant. La Cour d’arbitrage belge peut être saisie de deux façons. Elle peut l’être par un recours en annulation. Celui-ci peut être interjeté, d’une part par les requérants institutionnels, c’est-à-dire Conseil des ministres fédéral, gouvernement des Communautés et Régions, présidents des Assemblées législatives. Et d’autre part aussi, par des particuliers, personnes physiques ou morales, pour autant qu’elles justifient d’un intérêt à agir. Le recours est notifié aux requérants institutionnels lorsqu’il est déposé par un particulier. Ceci est le recours en annulation.
La Cour belge peut aussi être saisie par question préjudicielle. C’est le cas lorsqu’une juridiction ordinaire est confrontée à une exception d’inconstitutionnalité et qu’elle interroge alors la Cour constitutionnelle sur la question posée. La question préjudicielle est, elle aussi, notifiée à toutes les parties. La particularité est la suivante : en matière de communication, tant les recours en annulation que les questions préjudicielles font l’objet d’une mention au Moniteur belge, une feuille de publication officielle. Et suite à cette publication, des mémoires peuvent être déposés non seulement par les destinataires des notifications personnelles, mais par toute partie justifiant d’un intérêt.
Ainsi en Belgique, la communication de l’acte de saisine par la Cour constitutionnelle est faite de manière si large que tout particulier justifiant d’un intérêt peut participer à la procédure de contrôle constitutionnel. Monsieur le juge Henneuse m’a même dit que lorsque l’on mettait en cause la constitutionnalité de l’interdiction de la publicité pour le tabac, pouvaient donc intervenir non pas seulement les vendeurs et les producteurs de tabac, mais même les associations sportives sponsorisées par des entreprises de l’industrie du tabac. C’est une ouverture très large. Et ces personnes qui peuvent intervenir peuvent aussi par la suite se présenter devant la Cour à l’audience et y être entendues. Cette différence est assez frappante avec l’exemple tchadien donné tout à l’heure.
Le deuxième aspect principal du procès qui est traité dans le rapport de synthèse est le principe de l’égalité des armes. Ce principe veut que chaque partie au procès se voit offrir une possibilité de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à la partie adverse. Je ne soulève qu’une question qui a été posée là : est-ce que le juge constitutionnel dispose de moyens propres d’instruction d’une affaire ? Là aussi les solutions sont diverses.
En France, par exemple, la procédure est inquisitoriale. Le membre du Conseil constitutionnel désigné comme rapporteur dirige librement l’instruction. Il lui revient de prendre toutes les initiatives nécessaires, par exemple convoquer et interroger les représentants des ministères intéressés, de même que les personnalités et les spécialistes susceptibles d’éclairer sa réflexion. Le rapporteur peut aussi entendre des experts ou prendre des contacts informels, si cela lui semble utile.
À l’opposé, la Cour suprême du Canada statuant en matière constitutionnelle ne dispose pas de moyens propres d’instruction. Elle doit se limiter à prendre connaissance d’office du droit, ainsi que des faits incontestables et notoires.
Ces différences sont toutefois plus théoriques que réelles. En effet, la juridiction constitutionnelle consiste essentiellement en l’interprétation de la Constitution, d’une part de la loi incriminée, d’autre part, s’il s’agit de question de droit ou d’une instruction, par exemple par audition de témoins ou inspection des lieux, cela n’est guère envisageable.
Telle est aussi la situation notamment en Suisse où l’administration de la preuve en matière de juridiction constitutionnelle reste exceptionnelle.
La dernière question posée sous ce chapitre est encore de savoir si le juge constitutionnel peut se saisir d’office de dispositions ou de moyens non soulevés dans la requête. Là aussi, les solutions retenues sont diverses. Dans un certain nombre de pays, le juge peut le faire sans autres précautions, par exemple en France ou au Maroc. Dans certains pays qui connaissent le contrôle d’office, comme par exemple la Belgique, le juge doit aviser les parties qu’il entend soulever des moyens d’office et leur donner la possibilité de se déterminer. Le principe du contradictoire est alors respecté. Dans d’autres pays, ce n’est pas le cas.
Enfin, d’autres réglementations ne permettent pas au juge constitutionnel de se saisir d’office de moyens non soulevés par les parties. C’est notamment le cas pour la Cour canadienne, pour qui cela découle de la maxime des débats. Maxime qui implique que le cadre du procès est défini par les parties. On peut en conclure que dans les systèmes de contrôle répressif et concret, systèmes qui impliquent une plus grande similitude entre le procès en constitutionnalité et le procès ordinaire, le principe d’allégation et de la présomption de constitutionnalité l’emporte. Le contrôle se fait a posteriori, le juge n’a dès lors pas à relever et éliminer d’office toute atteinte à l’ordre
constitutionnel qu’il peut déceler dans la loi.
J’en viens enfin au dernier point, celui qui a trait aux délais du jugement. Dans les pays qui, comme la France, ont instauré le contrôle préventif abstrait, le délai de jugement est rapide, ce qui est rendu nécessaire par le rattachement de ce mode de contrôle constitutionnel au processus d’adoption des lois. En règle générale, ce délai est d’un mois et est toujours respecté. Lors d’un symposium international au Tribunal fédéral suisse en 1998, le président du Conseil constitutionnel français de l’époque a relevé les avantages de ce délai bref. Il a déclaré qu’à cause de ce délai bref, le contrôle constitutionnel ne pouvait pas être utilisé comme manœuvre dilatoire dont l’effet est l’entrave à la mise en œuvre de la volonté du législateur.
Dans les pays, par contre, qui ont opté pour le système du contrôle répressif, la procédure est évidemment nettement plus longue, notamment si c’est un système diffus. Certains pays connaissent des délais qui peuvent être prolongés.
J’en arrive donc à la conclusion du rapport. Comme relevé au début de l’exposé, suivant son genre, sa portée et ses modalités, le contrôle de la constitutionnalité des lois s’apparente, soit au processus législatif dont il est en quelque sorte la phase ultime, soit au procès judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, celle du contrôle judiciaire, les exigences du procès équitable et notamment le principe du contradictoire sont respectées à l’instar des procédures judiciaires ordinaires à l’occasion desquelles l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée. Le défaut d’application des principes régissant le procès équitable au contrôle constitutionnel préventif, intervenant sur la requête d’une partie institutionnelle, tient à la nature même d’un tel système et ne consacre pas un affaiblissement des droits des particuliers. En effet, dans le contrôle constitutionnel préventif, la loi n’a pas, à proprement parlé, de parties adverses ; les opposants à son adoption se sont fait entendre lors des débats parlementaires.
M. Lô, président de séance, Conseil constitutionnel du Sénégal : Je remercie le rapporteur qui a été d’une grande clarté dans l’exposé d’un sujet difficile. Il n’échappe à personne que pour faire la synthèse de trente rapports provenant de trente expériences nationales différentes, il faut consacrer beaucoup plus de temps à le rédiger qu’à l’exposer. Je crois que nous avons retenu l’essentiel de ce qui a été exposé.
En amont, la procédure législative ne peut pas donner lieu à un contentieux. Se pose ainsi la question de savoir quel genre de contradiction, dans un procès, l’on peut introduire devant une Cour constitutionnelle ? Quand le contrôle est préventif, c’est un prolongement de la procédure législative, et en quelque sorte, la Cour est saisie par les requérants institutionnels, les détenteurs du pouvoir d’initiative en matière législative, qui sont les seuls requérants possibles. À ce niveau-là, il ne peut pas y avoir de procédure qui puisse entraîner une discussion contradictoire, parce que c’est l’initiative législative qui est en cause. La loi n’est pas encore parfaite puisqu’elle n’a pas encore été promulguée. Donc nous devons éliminer du débat sur la notion de procès équitable cette partie de l’activité de la Cour constitutionnelle qui examine préventivement la mise en œuvre des initiatives du législatif ou de l’exécutif.
À quel niveau le problème du contradictoire, qui est le soubassement d’un procès équitable, peut-il donc se poser au niveau d’une Cour constitutionnelle ? Une fois la loi promulguée, les expériences nationales divergent. Dans la tradition française, la loi, une fois qu’elle est promulguée, ne peut plus faire l’objet d’une procédure par voie d’action. Ce n’est que par la voie d’exception qu’elle peut être attaquée devant le tribunal et cette voie d’exception peut intervenir dans le procès entre particuliers qui soulève peut-être l’invalidité de la disposition qu’on veut appliquer. À ce niveau-là, évidemment, comme il s’agit d’un procès entre particuliers, que la Cour va connaître indirectement, par l’exception d’inconstitutionnalité qui lui est déferrée par les juridictions qui sont saisies, la saisine de la Cour dépend de la juridiction saisie qui apprécie si l’exception peut être transmise à la Cour constitutionnelle pour examen ou non. Dans ce cas, les parties ont déjà exposé leurs doléances et leurs mémoires qui seront transmis à la Cour. Ce n’est qu’à ce niveau-là que le contradictoire peut valablement se justifier au niveau d’une instance constitutionnelle qui a à sa charge l’examen par la voie de l’exception d’une disposition qui échappe à tout contrôle direct.
Nos expériences varient et je crois qu’il faut centrer le débat sur ce qui peut nous amener à déboucher sur des propositions concrètes destinées à permettre, peut-être, de mieux assurer la protection des individus et des droits dont l’essentiel se trouve intégré dans les préambules des Constitutions.
Il s’agit notamment de la possibilité qui devrait être offerte à des particuliers qui se sentent lésés par des dispositions de pouvoir saisir directement les Cours constitutionnelles, afin de faire sanctionner le droit. Il convient donc que nous concentrions nos réflexions sur l’essentiel, pour déboucher sur des conclusions pratiques que nous pourrons suggérer à nos constituants pour améliorer en fait la protection des droits de l’homme et des libertés.
M. Vandernoot, conseiller d’État, référendaire honoraire à la Cour d’arbitrage de Belgique : Merci Monsieur le président. Après, effectivement, l’exposé qui a révélé une précision d’horloger des délégués suisses, je voulais apporter peut-être un léger bémol à la première conclusion provisoire que vous avez tentée de dégager de l’exposé. Malgré toute la compréhension que l’on peut avoir et que l’on doit avoir à l’égard des spécificités nationales et de la distinction qu’il faut faire, effectivement, entre le contrôle a priori, qui s’inscrit dans le contexte de la procédure d’adoption des lois, et d’autre part, la procédure a posteriori, je pense qu’il y a malgré tout des concepts qui peuvent se rapprocher. Je crois qu’aujourd’hui, on ne peut plus distinguer aussi clairement qu’on a pu le faire les notions de contrôles concret et abstrait, notions qui sont pourtant classiques dans nos enseignements. Lorsqu’un juge, à l’occasion d’un litige concret, est amené à examiner la validité constitutionnelle d’une loi, bien sûr il le fait à l’occasion d’un litige concret, mais il n’en reste pas moins que sa démarche est une démarche de confrontation objective de deux normes, ce qui a donc un caractère abstrait. Alors dans ce contexte, je me demande si les juges constitutionnels ne sont pas pris à leur propre piège.
Je crois enfoncer une porte ouverte en parlant de la « constitutionnalisation » du droit, de l’ensemble des branches du droit. Le doyen Favoreu, à cet égard, a beaucoup écrit me semble-t-il, sur la constitutionnalisation du droit et donc, je pense, des droits subjectifs. Lorsqu’une loi est en discussion, qu’il s’agisse d’une loi sur le point d’être promulguée ou d’une loi qui a été promulguée ou publiée, des droits subjectifs sont en cause. Et dans ce contexte, dès le moment où, grâce à l’apport, grâce au rôle joué par les juridictions constitutionnelles, nous vérifions ce phénomène qui est un phénomène profond, lourd, de la constitutionnalisation des droits, il me paraît relativement naturel de dépasser cette distinction entre contrôle a priori ou a posteriori.
Je vais donner un exemple très concret. Imaginez une loi qui comporterait une disposition pouvant porter atteinte au droit de propriété, par exemple, disposition qui, a priori, disons, n’attirerait pas l’attention des autorités instituées par la Constitution ou par la Loi organique des Cours et qui ne susciterait pas de leur part une objection qui les amènerait devant le juge constitutionnel. Est-ce qu’il ne serait pas normal qu’a priori les sujets de droit aient l’occasion, pour éviter une atteinte à leur droit subjectif, atteinte qui serait en quelque sorte matérialisée par une violation de la Constitution, est-ce qu’il ne serait pas de bonne sagesse que le juge constitutionnel en soit avisé et puisse, au terme d’une procédure contradictoire, juger quant à la conformité à la Constitution ? Je crois que c’est l’intérêt de tous, mais encore une fois, les systèmes nationaux ont leur spécificité, mes réflexions ne visent qu’à alimenter la discussion. Je crois que c’est l’intérêt de la Cour d’être elle-même informée : informée non pas des considérations abstraites que peut soulever la discussion de constitutionnalité, mais de ses incidences concrètes. Et nul n’est mieux placé pour connaître les incidences concrètes d’une législation nouvelle que les destinataires de la norme. Et les premiers destinataires d’une norme, ce sont bien sûr les institutions, mais ce sont aussi les sujets de droit. Il me semble qu’à ce titre, le principe du contradictoire peut voir son champ éventuellement élargi à d’autres contentieux que le contentieux strictement a posteriori.
M. Kolly, rapporteur, Tribunal fédéral suisse : Évidemment tout est possible. Simplement cela poserait quand même quelques problèmes pratiques pour instaurer ce contradictoire à un stade où la loi n’est pas encore publiée. Une publication devrait être prévue. Je suis donc tout à fait d’accord avec vous. Je vois simplement encore quelques difficultés pratiques pour la mettre en pratique.
M. Lô, président de séance, Conseil constitutionnel du Sénégal : La question que vous posez risque de déboucher sur quelque chose qui a toujours effrayé les gouvernements et qui est l’institution d’un gouvernement des juges. En effet, en amont, on ne peut pas vérifier les incidences d’une loi qui n’est pas encore appliquée. Cela laisse donc supposer que l’on va sonder les intentions du législateur pour savoir si ce qu’il a déjà mis en place et qu’il cherche à élaborer, pourrait porter atteinte à des droits, une fois le texte adopté.
Cela conduirait donc à instaurer une sorte de référé législatif qui consisterait à arrêter la procédure législative pour demander l’avis de la Cour constitutionnelle sur la question de savoir si la loi qui est en gestation ne porterait pas atteinte à des droits. Cela conduit la juge à sonder l’intention du législateur avant que celle-ci ne soit concrétisée par une loi. C’est la raison pour laquelle seuls les requérants institutionnels, détenteurs du pouvoir législatif et qui représentent une certaine proportion des députés et sénateurs à saisir la Cour pour arrêter la procédure. Je crois qu’ils sont les garants des intérêts de leurs citoyens si la loi qu’ils sont appelés à voter, et qui leur est proposée, recèle des dispositions qui pourraient porter atteinte à des droits. Et préventivement, il peut, effectivement, arrêter la procédure pour déclarer la mesure irrecevable ou anticonstitutionnelle et la Cour se prononcera de manière préventive.
Alors, pourquoi mettre à la disposition des individus qui ne sont pas encore victimes d’une disposition qui n’a pour le moment aucune existence, la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle ? Ce serait l’encombrer et étendre la compétence de la Cour constitutionnelle dans des domaines qui conduiront à un gouvernement des juges. Or, cela est la crainte majeure de tout État.
Dans le cas d’un contrôle préventif, initié par des requérants institutionnels, nous ne sommes pas encore dans une phase d’exécution d’une loi. Nous sommes dans une phase d’élaboration de la loi. Et tant que cette loi n’est pas examinée par la Cour – il y en a dont la Cour doit être obligatoirement saisie comme les lois organiques, les règlements intérieurs – il y a déjà un début de contradictoire, puisqu’il faut nécessairement communiquer la requête à l’institution dont la décision semble être contestée. Mais là encore, je crois que la césure est très nette. La Cour intervient dans le prolongement de la procédure législative qu’elle achève en disant que la loi peut être promulguée ou non. Je crois donc que vos craintes risquent d’engendrer des conséquences beaucoup plus graves pour les Parlements et même pour la Cour constitutionnelle qui apparaîtrait comme un pouvoir dangereux.
Mme Sidibe, Cour constitutionnelle du Mali : Le rapporteur a relevé qu’au Mali nous faisions une distinction entre les lois organiques et les lois ordinaires et que par conséquent, nous faisions application du principe du contradictoire concernant les lois ordinaires et pas les lois organiques. Je voudrais simplement indiquer que s’agissant des lois organiques, le seul requérant est le chef du gouvernement et il est obligé de déférer les lois organiques à la sanction ou à l’examen de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, le principe du contradictoire n’est pas appliqué, effectivement. Mais s’agissant des lois ordinaires, il y a quand même un éventail assez large de saisissants, et la saisine est facultative. La saisine peut émaner d’un dixième des députés ou d’un dixième des députés ou d’un dixième de conseillers nationaux, qui, je crois, correspond un peu au Sénateurs dans les autres pays ou aux hauts conseillers des collectivités territoriales.
Et au sein du Parlement où il y a l’opposition, en général, c’est l’opposition qui nous saisit quand c’est une loi ordinaire qui ne va pas dans le sens de son intérêt. Par conséquent, il est tout à fait normal que le principe du contradictoire s’applique.
Par exemple, la loi portant code électoral, ainsi que la loi portant création de la Commission Électorale Nationale Indépendante, et le décret portant convocation du collège électoral ont été attaqués par l’opposition. Et il fallait que le principe du contradictoire joue. Je voudrais aussi indiquer que ce principe se réalise aussi par la possibilité d’une représentation par ministère d’avocat. Dans l’opposition au Mali, il y a beaucoup d’avocats. C’est peutêtre une simple coïncidence, mais en tout cas cela se passe de cette façon. C’est la raison pour laquelle, je voulais indiquer que pour la Loi organique, comme pour les règlements intérieurs des assemblées nationales, il tombe sous le bon sens que le principe du contradictoire ne s’applique pas, puisqu’il
s’agit d’un seul saisissant.
Pour terminer, je voudrais qu’on tempère un peu le rapport de synthèse. Le rapport indique qu’au Mali, le fait que les lois organiques et les règlements de l’Assemblée nationale, du Conseil économique, social et culturel et du haut Conseil des collectivités ne soient pas soumises au respect du principe du contradictoire, réduit de manière notable la portée de ce principe dès lors que le contrôle de constitutionnalité s’est quasiment limité jusqu’à présent aux lois organiques et règlements des hautes instances nationales mentionnées. Ceci n’est pas tout à fait exact, puisque je viens de vous indiquer que des lois ordinaires et même le décret portant convocation du collège électoral ont été déférés à la Cour constitutionnelle avec application du principe du contradictoire. Nous n’avons indiqué dans le rapport national que les lois organiques et les lois ordinaires, parce que c’est ce qui nous avait été demandé. On nous a
dit d’enlever du champ de ce rapport tout ce qui avait trait aux élections.
Mme Peeroo, Cour suprême de l’Ile Maurice : Je voulais apporter une précision concernant le principe du contradictoire et la représentation par ministère d’avocats. Pour initier un procès, le requérant doit être représenté par un avoué et un avocat. Dans un cas récent, le défendeur n’était autre qu’un avocat. Il assurait sa propre défense. Le juge lui a refusé l’autorisation de plaider. Il a fait appel contre la décision du juge. La Cour d’appel a maintenu la décision. Il a eu recours au Conseil privé de la Reine qui lui a donné gain de cause. La raison, brièvement – il avait droit à un procès juste et équitable [2].
M. Benjelloun, Conseil constitutionnel du Maroc : J’ai quelques remarques à faire à propos du rapport de synthèse. À la page 3 [pp. 641 et s. du présent volume], le Maroc a été classé dans la rubrique réservée à la négation du principe du contradictoire.
Le Maroc devrait être classé dans la catégorie qui retient le principe du contradictoire avec souplesse, en ce sens que bien que les parties n’aient pas accès au prétoire, le Conseil avise les Autorités et les présidents des Chambres qui informent les membres des chambres, lesquels peuvent lui présenter des observations. Il ne s’agit donc pas d’une obligation, la personne n’est pas obligée de se défendre et c’est là où je voudrais retenir votre attention sur la souplesse.
Il en va de même en ce qui concerne l’irrecevabilité législative, il y a également une certaine souplesse à ce niveau.
M. Yoadimnadji, Conseil constitutionnel du Tchad : Je prends la parole non pas pour contester ce qui a été dit à propos du Conseil constitutionnel du Tchad, car effectivement la procédure devant le Conseil n’est pas contradictoire, mais le dire ainsi pourrait, à mon sens, prêter à confusion. La réflexion de Monsieur le rapporteur relative à la forme choisie de la juridiction constitutionnelle me semble très importante. Au Tchad en effet, en matière d’élection, la procédure est tout à fait contradictoire, mais s’agissant du contrôle de la constitutionnalité des lois, nous pensons qu’il y a un ordre judiciaire qui existe avec au sommet la Cour suprême. C’est à elle de dire le droit et de protéger les droits des citoyens. Donc tout ce qui concerne la protection des citoyens, les recours pour excès de pouvoirs et autre, sont du ressort de la Cour suprême et de ses différentes chambres.
Au niveau du Conseil constitutionnel, le législateur n’a pas voulu charger le prétoire de ce Conseil, encore qu’en matière électorale, c’est tout à fait différent. Le Conseil constitutionnel n’est pas une juridiction au sens où on l’entend et se distingue de la Cour suprême. Parce que peut-être que pour les pays qui ont un contrôle au fond aussi large peut-être que l’organisation judiciaire n’est pas tout à fait la même. Je vois certaines Cours ou Conseils constitutionnels africains où l’accès est assez ouvert aux citoyens. Cela implique certainement des différences au niveau de l’organisation judiciaire.
M. Kolly, rapporteur, Tribunal fédéral suisse : Il n’y a aucune appréciation de ma part. Vous avez eu la malchance d’écrire dans votre rapport national que cette disposition existe en toutes lettres, alors cela m’a rassuré. Je l’ai prise, parce que je ne risquais pas de dire quelque chose qui était mal interprété !
M. Hage-Chahine, Professeur à l’Université Saint Joseph de Beyrouth, Liban : Monsieur le rapporteur vient de nous parler de la manière dont le juge constitutionnel applique des principes du procès équitable. Je voudrais, si vous le permettez, lui demander des précisions sur la manière dont le juge constitutionnel protégerait les principes du procès équitable.
Par exemple une loi spéciale de procédure applicable devant un tribunal spécial, ou devant une juridiction d’exception, contient des dispositions contraires au principe du procès équitable. Cette loi sera-t-elle jugée anticonstitutionnelle ? Autrement dit, le droit au procès équitable est-il doté de la force constitutionnelle ?
M. Kolly, rapporteur, Tribunal fédéral suisse : Pour répondre à la question qui a été posée par le Liban au sujet de la constitutionnalité de règles de procédures, je crois que l’on ne peut examiner la constitutionnalité que par rapport à ce qui est dans la Constitution. Donc il faudra qu’en principe ce qui est inscrit dans la Constitution, ou qu’on peut en tout cas y trouver en cherchant suffisamment, soit violé. En ce qui concerne la Suisse, il y a la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui, probablement, serait
violée par une telle loi de procédures.
Mme Ouinsou, Cour constitutionnelle du Bénin : Je crois qu’au Bénin, on donnerait également la même réponse. Soit il y a un principe constitutionnel, il y a une disposition de la Constitution, soit non. Au Bénin, nous avons intégré dans notre Constitution la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples qui prévoit tout un tas de principes assurant le respect des droits de l’homme, la promotion des libertés individuelles, etc. Donc le problème serait très certainement tranché par la Cour constitutionnelle. À côté, s’il n’y a pas une telle disposition constitutionnelle, il faut rentrer maintenant dans la problématique des principes à valeur constitutionnelle. C’est un autre débat.
M. Nguéma, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : Je vais intervenir en dehors du sujet, c’est-à-dire pas sur des problèmes de constitutionnalité, parce que je m’occupe des droits de l’homme au sein de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et c’est uniquement l’expérience que j’ai là-bas que je peux peut-être apporter ici.
Au sein de notre Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, naturellement nous avons ce fameux principe de procès équitable, mais les gens ne nous prennent pas au sérieux, parce qu’ils se disent que tous les membres de la Commission ne peuvent pas se considérer comme étant indépendants des gouvernements et des États. Les membres de la Commission sont en effet élus par des chefs d’État. Ensuite, après les mesures d’instruction d’une requête, ce sont les chefs d’État qui doivent prendre la décision. La Commission ne fait que proposer des avis. Alors, comment voulez-vous que les chefs d’État qui sont responsables des violations des droits de l’homme soient encore ces personnes qui sont appelées à prendre des décisions qui concernent leurs pairs ? Tout le monde nous rit au nez. Cela nous choque. Parce que en tant qu’africains, nous ne voulons pas continuer à vivre dans ce flou artistique et appeler cela un « procès équitable ».
Alors si je laisse de côté ce qui se passe à la Commission, pour voir ce que nous avons en Afrique – je ne parle pas d’Europe, je me dis « comment peuton parler d’un procès équitable sans faire intervenir la personne du juge qui est appelée à arbitrer ? » Si le juge est tellement lié à une partie ou à une autre, alors l’arbitrage sera tout à fait différent et inéquitable. Or aujourd’hui, nous voulons aller au fond des choses, en Afrique, et non nous contenter des apparences ni de la figuration ; c’est ce que nous souhaitons maintenant et notamment au sein de la francophonie.
Il n’est plus question de nous dire « on fait ça en France, on fait ça au Canada ». Mais nous voulons vivre nos propres réalités africaines. C’est la raison pour laquelle, je pense, que nous ne pouvons pas parler de procès équitable en laissant de côté la personne du juge comme cela ressort des rapports des Cours constitutionnelles africaines. On a l’impression que nous sommes ici à la Sorbonne, que nous présentons des thèses de doctorat, nous les défendons, etc., et puis après nous sommes contents sur le plan intellectuel. Pendant ce temps, les vrais problèmes africains, ils sont mis de côté. Cette francophonie-là, nous n’en voulons plus. Vous voyez, c’est pour cela que je disais « je vais intervenir en dehors du sujet » et je suis d’autant plus surpris que le questionnaire qui a servi à étudier cette question de procès équitable a été établi à Paris, c’est-à-dire en France, à laquelle se confond pour beaucoup, la francophonie. Quand par ailleurs on fait ici la distinction entre ce qui est constitutionnel et ce que l’on peut appeler les problèmes liés aux élections, qui eux n’entrent pas dans le sujet du Congrès, mais enfin, vous parlez pour qui ? Vous parlez pour les Africains, nous, qui vivons ces problèmes, est-ce que vous croyez que nous avons cette distinction-là dans notre vie quotidienne ? En Afrique, quand on parle de juridiction constitutionnelle, tout le monde a avant tout en image l’activité et le rôle de ces juridictions en matière électorale. On a l’impression que toutes les précautions ont été prises pour enfermer le sujet dans un carcan où les gens doivent absolument tourner en rond. Moi, je dis non. Si on continue dans cette voie, je crois que ce n’est pas la meilleure. Il ne s’agit pas de donner des leçons à qui que ce soit. J’ai été heureux hier d’apprendre de la part du président Guéna, que maintenant les choses évoluent au niveau des conceptions et des mentalités. Il n’y a plus de pays qui puissent donner des leçons à d’autres. Mais d’un autre côté, là je me tourne vers nous autres, Africains. Dans mon village, il y a un proverbe qui dit « il n’appartient pas au porc – au cochon – de vanter la qualité de sa chair. Ce sont ceux qui mangent le cochon qui apprécient ». Or, nous sommes ici, comme pour dire « Tout va bien ! Tout va bien. Nous sommes de bons juges ». Non ! L’indépendance des juges est la pierre angulaire de cette histoire de procès équitable. Et l’indépendance du juge ne s’apprécie pas en fonction de la virgule ou du point virgule ou de l’apostrophe, mais en fonction de l’opinion que l’opinion publique se fait de la qualité du juge et de la personne du juge. Il se peut très bien que le juge soit très compétent, bien formé sur le plan juridique et ne commette pas de fautes. Mais ce n’est pas cet aspect-là qui va déterminer l’indépendance du juge.
Nous avons eu un cas à la Commission où le fils du président Sam Nujoma de Namibie est venu défendre le rapport établi sur la situation des droits de l’homme en Namibie ; il était brillant. Brillant ! On a même eu des difficultés à lui poser des questions, tellement son exposé était brillant. Mais rien que de savoir que c’est son père qui est le chef de l’État de Namibie et que c’est son fils qui a été envoyé pour défendre le rapport de Namibie, cela nous a laissés un peu rêveurs. Il ne pouvait prétendre à une quelconque indépendance ni à une quelconque objectivité.
Monsieur le président, j’ai été un peu en dehors du sujet, je m’en excuse.
J’en ai terminé.
M. Lô, président de séance, Conseil constitutionnel du Sénégal : Non Monsieur le président, vous n’êtes pas en dehors du sujet, si j’en juge par l’attention qui a été apportée à votre prestation. Les droits de l’homme ont fait une incursion extraordinaire dans les relations internationales et je pense qu’ils sont devenus même la clé de voûte de la coopération internationale. J’en juge par la floraison de tribunaux que l’on créés essentiellement pour gérer ces problèmes. C’est un nouveau-né dans la préoccupation des gouvernants et des juristes, mais qui grandit assez vite. J’ai le sentiment que sa prise en charge par les constituants se traduira par la création d’institutions qui pourront peut-être plus vite et plus efficacement rendre des décisions que des citoyens pourraient apprécier plus que des leçons des Cours constitutionnelles qui ont été conçues, en fait, pour régler les problèmes des pouvoirs constitutionnels.
Je pense que votre intervention a peut-être une valeur didactique. Nous la prenons en compte et nous ferons parvenir à nos gouvernants ces réflexions-là, pour qu’ils soient un peu plus attentifs. Je vous remercie de votre intervention.
Mme Ouinsou, Cour constitutionnelle du Bénin : Merci Monsieur le président. Le professeur Nguéma vient de dire qu’il était en dehors du sujet, je crois qu’il l’a dit par modestie. Il était en plein dans le débat.
Je voudrais axer mon intervention sur plusieurs points. En premier lieu, Monsieur Nguema a pensé que l’on a circonscrit le sujet. Je voudrais dire que le Congrès a un thème : l’accès au juge constitutionnel. Si le prochain congrès porte sur les élections, on parlera également des élections. Donc n’ayez aucune crainte, nous n’avons pas voulu nous-mêmes nous faire hara-kiri.
Le deuxième point est le suivant. Vous voyez, j’ai un peu la voix qui tremble. Vous avez exactement traduit le sentiment que les citoyens ont des Cours, de nos Cours constitutionnelles africaines. Hier, il y a une journaliste qui m’a posé la question « mais vos Cours constitutionnelles, est-ce que vous connaissez l’opinion que le citoyen a de vos Cours constitutionnelles ? D’ailleurs vous êtes nommés et comment voulez-vous faire un travail sérieux ? » Je n’ai pas pris la mouche, parce que je sais qu’effectivement, c’est cette perception que le citoyen africain a des Cours constitutionnelles africaines. Mais je lui ai dit une chose : effectivement, nous sommes nommés, soit par l’Assemblée, soit par le président de la République, mais il y a une chose que le magistrat, le juge qui est à la Cour constitutionnelle, le conseiller, doit savoir, même s’il est nommé, il n’a pas été nommé pour être à la botte de quelqu’un. Parce que chaque personne appartient à une corporation. Chaque personne a une personnalité propre et si la personne est quelqu’un qui veut se sentir bien dans sa peau, nommée ou pas nommée, il y a un travail à faire, il doit le faire de façon correcte. Et j’ai encore rajouté qu’il n’y a de pire amalgame que de mélanger le droit et la politique. Soit on fait du droit, soit on fait de la politique.
Il est bien vrai que le droit est affaire d’interprétation et que la même règle de droit peut être sujette à plusieurs interprétations, mais parmi toutes ces interprétations, il y en a une qui est plus ou moins acceptable et c’est là toute la tâche du juge constitutionnel quand il rend une décision. Le juge doit rendre une décision et il doit pouvoir regarder tout un chacun dans le blanc des yeux. Il peut se tromper. Nous sommes sept, nous sommes neuf, nous pouvons nous tromper, mais il est rare que neuf personnes, à moins de collusion évidente, se mettent d’accord pour rendre une décision inique. Donc Monsieur le président, je vous demanderai de nous accorder le bénéfice du doute.
M. Nguéma, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : Pour le Bénin, oui et non pour la Cour constitutionnelle de Côte d’Ivoire sous le régime du Général Gueï ; ni pour le tribunal de Conakry dans l’affaire du député Alpha Condé, etc.
M. Abadie, Conseil constitutionnel français : Mon intervention sera double. D’abord une intervention liminaire de simple rectification et de précision en ce qui concerne le sous-rapport de synthèse. Et ensuite des réflexions plus approfondies sur la difficulté de la mise en œuvre du contradictoire dans certaines phases du contrôle a posteriori, notamment en perspective avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La petite rectification se situe à la page 15 où vous écrivez « en France, la reconnaissance du principe du contradictoire, par création jurisprudentielle, permet l’intervention des acteurs du procès constitutionnel ». Cela n’est pas très exact en ce sens que si l’on interprète le mot « contradictoire » par la nécessité d’avoir en face de soi et de faire échanger des arguments contraires entre des parties, et donc au minimum deux parties, ce n’est pas le cas en France ; en effet, nous ne considérons pas qu’il y a deux ou des parties dans un débat constitutionnel a priori sur l’examen en abstrait d’une loi votée ou d’un traité soumis. Si dans notre rapport, effectivement, il est indiqué que l’on a fait un effort d’information et de diffusion des informations concernant les arguments pouvant être présentés en demandant par exemple l’avis du gouvernement, ce n’est pas pour considérer que le gouvernement est une partie au litige constitutionnel. C’est simplement, d’une part, parce que le plus souvent le gouvernement est à l’initiative de la loi, puisque souvent il s’agit d’un projet de loi, et d’autre part parce que le gouvernement est l’autorité qui va soumettre au président de la République la décision de promulgation de la loi. Et vous savez que chez nous, le président de la République peut demander une deuxième lecture sans promulguer immédiatement.
Donc c’est en référence à ces deux considérations que nous élargissons au gouvernement le champ des informations qui vont vers le Conseil constitutionnel pour asseoir sa décision ; mais il ne s’agit pas d’une partie véritable, donc il ne s’agit pas du contradictoire au sens donné par le sous-rapport de synthèse. En fonction de cela, nous devrions figurer dans la catégorie que vous estimez devoir correspondre à cette situation.
J’en viens, Monsieur le président, à un élément plus fondamental qui est la difficulté, souvent, de mettre en œuvre le principe du contradictoire dans
certaines phases qui peuvent venir devant les Cours constitutionnelles. Je ne parlerai pas des phases a priori, puisque Monsieur le rapporteur a très excellemment dit que là, le contradictoire ne se pose pas, puisque nous sommes en queue de parcours législatif en quelque sorte et qu’il ne peut pas y avoir de parties au sens du contradictoire à ce moment-là. Mais la question se pose dans une situation de contrôle a posteriori. Pourquoi je parle du contrôle a posteriori, alors que la France n’a que l’a priori dans sa compétence constitutionnelle ? C’est que nous avons failli avoir un contrôle a posteriori si avaient été acceptées par le constituant les propositions de révision de la Constitution qui se sont manifestées en 1990 et 1993 établissant à côté du contrôle a priori un contrôle a posteriori en une exception d’inconstitutionnalité ; la loi organique préparée pour sa mise en œuvre précisait que ce contrôle du Conseil constitutionnel devait intervenir dans les deux mois et contradictoirement. Donc l’idée du contradictoire était dans cette révision constitutionnelle, si bien que le Conseil constitutionnel français fait porter souvent sa réflexion interne au delà du contrôle a priori pour imaginer comment il pourrait se situer, éventuellement, dans un contrôle a posteriori : certains de nous y voient quelques inconvénients ponctuels que je vais exposer.
Premier cas, il n’y a pas d’inconvénient à mettre en œuvre le contradictoire lorsque la Cour constitutionnelle est saisie directement par un requérant à l’occasion d’un procès qu’il a instauré et où il a un accès direct à la Cour constitutionnelle qui donc va trancher sur le plan de la constitutionnalité de la loi au regard d’un litige subjectif. À cet égard, il est évident qu’une Cour constitutionnelle peut mettre en œuvre facilement le contradictoire s’agissant de parties qui existent déjà à l’origine du procès, quel que soit le caractère du procès, qu’il soit civil, administratif ou pénal. Quand il est pénal, il y a toujours une petite difficulté : est-ce que les parties sont bien d’une part le prévenu ou l’inculpé ou le mis en examen et d’autre part, le Ministère Public ? Donc cela veut dire que la Cour constitutionnelle va demander l’avis du Ministère Public et va faire échanger les appréciations de l’inculpé et du Ministère Public réciproquement pour assurer le contradictoire. Il y a une petite difficulté conceptuelle, mais en fait, il n’y a pas de difficulté fondamentale à assurer le contradictoire dans ce cas-là.
Deuxième cas : peu de difficultés, lorsque dans un procès administratif, on conteste, par exemple, une décision de nomination ou une décision du président de la République qui peut prendre, dans certains domaines, des décisions sans contre-seing du gouvernement ou d’un ministre. Il peut y avoir là également une expérience de contradictoire au niveau d’une Cour constitutionnelle, avec des parties qui sont le requérant et par exemple le président de la République, avec organisation de l’échange de leurs arguments réciproques. Il y a quand même une petite difficulté dans la situation respective des parties que je laisse à l’appréciation de chacun.
Troisième cas : je voudrais m’étendre beaucoup plus sur la difficulté à mettre en œuvre le contradictoire lorsqu’il s’agit d’une instance introduite devant une Cour constitutionnelle par question préjudicielle de constitutionnalité d’une loi, à l’occasion d’un procès qui est venu et qui a pris son origine dans une juridiction ordinaire et au regard de laquelle le requérant n’a pas lui-même demandé la saisine de la Cour constitutionnelle, tout en ayant porté une partie de ses griefs sur l’inconstitutionnalité d’une loi ; dans un tel cas, c’est le tribunal qui, lui-même – à tel ou tel niveau en fonction des caractéristiques constitutionnelles du pays en cause – va demander à la Cour constitutionnelle, par question préjudicielle, son interprétation constitutionnelle d’une loi qui doit être appliquée.
De tels cas se sont posés et ont donné lieu à des divergences d’interprétation de la nécessité du contradictoire, entre d’une part la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et d’autre part des arguments présentés par certains pays concernés.
D’abord pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg ? Certes ici, nous ne sommes qu’une minorité de pays qui ont adhéré à la Convention européenne des droits de l’homme mais les questions de principe qui y sont tranchées sont intéressantes pour tous ; sur la notion du procès équitable, la plupart des constitutionnalistes se réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne, parce que c’est elle qui a à mettre en œuvre l’article qui vise très spécifiquement la condition à remplir pour respecter les règles du procès équitable dont l’une a été définie par sa jurisprudence comme imposant le respect du contradictoire. Il s’agit de l’article 6.1 de la Convention européenne qui dit – je lis cet article, parce qu’il est fondamental sur le plan des réflexions que nous devons avoir – « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera des contestations à caractère pénal et des droits et obligations à caractère civil ».
Dans l’interprétation de la Cour européenne – et je le fais sous le contrôle de Jean-Paul Costa, président de section à la Cour européenne des droits de l’homme, qui nous fait bénéficier de sa présence et qui pourra prendre mon relais pour préciser et compléter – d’une part, le tribunal en cause peut-être également une Cour constitutionnelle, et d’autre part « procès équitable » veut dire dans l’esprit de la Cour, on le lit dans toute sa jurisprudence, « respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes », le principe du contradictoire étant bien évidemment la nécessité de faire échanger les arguments en cause entre les parties, donc il faut qu’il y ait des parties.
Est-ce que cette jurisprudence de la Cour européenne est applicable dans le cas que j’évoque d’une question préjudicielle portée non pas par un requérant directement auprès d’une Cour constitutionnelle, mais par un tribunal ? : Est-ce que nous nous trouvons dans le cadre d’un seul litige ? Ou est-ce que nous nous trouvons dans le cadre de deux litiges ? Je m’explique.
Un seul litige, c’est-à-dire le litige d’origine initié par le requérant auprès d’une juridiction ordinaire et qui se poursuit lui-même devant la Cour constitutionnelle par la question préjudicielle de l’interprétation constitutionnelle.
À ce moment-là, naturellement, on doit considérer que le contradictoire doit s’appliquer à l’ensemble des éléments de ce litige unique et donc lorsque la Cour constitutionnelle examine le problème de constitutionnalité, elle doit assurer le contradictoire en échangeant avec les parties initiales du procès d’origine, les arguments contradictoires qu’elle peut retenir, obtenir ou réunir, sur telle ou telle interprétation constitutionnelle de la loi, permettant au requérant d’y répondre. Ça, c’est dans le cas d’un seul litige. Le contradictoire, dans cette conception, semble naturel.
Mais n’y aurait-il pas en réalité deux litiges distincts ? : je veux dire un premier litige, donc celui qui a démarré dans une juridiction ordinaire, mais qui est stoppé, mis entre parenthèses, en attente par la question préjudicielle posée par le tribunal et un deuxième litige, de nature différente, puisqu’il s’agit à ce moment-là non pas d’un élément concernant spécifiquement des droits subjectifs d’un requérant, mais seulement d’un droit objectif de confrontation entre la loi et la Constitution. Le deuxième litige est donc tout à fait différent. À ce moment-là, il n’y aurait pas lieu à obligation du contradictoire et le litige n’appellerait pas la venue de parties auprès de la Cour constitutionnelle, puisqu’il s’agit d’un élément qui ressemble plus à un contrôle en abstrait de la loi qu’à un contrôle a posteriori en concret.
Le choix entre ces deux conceptions de ce procès unique ou double a été fait par la Cour européenne des droits de l’homme qui a, dans un arrêt fondamental de 1993, l’arrêt Ruis-Mateos, qui concernait le Tribunal constitutionnel d’Espagne, opté pour la théorie d’un seul litige. C’est ainsi que la Cour européenne a, dans son arrêt, considéré que le Tribunal constitutionnel espagnol, lorsqu’il s’est prononcé en exception de constitutionalité par question préjudicielle, aurait du mettre en œuvre le contradictoire, ce que le Tribunal constitutionnel espagnol n’avait pas fait. L’État espagnol a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme. Sur cette jurisprudence, d’autres jurisprudences identiques se sont développées.
Cette position de la Cour européenne a été contestée en son sein même : cette décision Ruis-Mateos a été prise par dix-neuf voix contre six, la minorité des juges ayant fait paraître une opinion dissidente très claire. L’opinion dissidente disait « il y a deux litiges qui ne sont pas confondus, dont l’un doit être examiné indépendamment de l’autre, et celui qui est afférent au contrôle de constitutionnalité n’est pas concerné par l’intervention de l’article 6.1 de la Convention, puisqu’il ne s’agit plus d’une contestation à caractère pénal ou d’obligations ou de droits à caractère civil. C’est une contestation d’un autre type, de type objectif, de nature constitutionnelle, donc pas de contradictoire ».
Cette thèse qui était celle aussi de l’État espagnol n’a pas été admise par la majorité de la Cour européenne qui a considéré qu’il n’y avait qu’un seul litige. Dans l’arrêt Ruis-Mateos, il s’agissait d’une loi votée par le Parlement espagnol qui portait sur la nationalisation pour utilité publique d’une société privée, avec indemnisation. Cette loi avait été déferée en contrôle a priori et le tribunal constitutionnel espagnol l’avait déclarée conforme à la Constitution et notamment ses premiers articles qui définissaient le transfert des actions. Donc la loi a été promulguée et a été mise en application. Lors de sa mise en application, les titulaires des actions de cette société ont intenté auprès du juge ordinaire une procédure au civil pour faire interrompre le transfert des actions en arguant entre autres d’un grief d’inconstitutionnalité de cette loi. La juridiction ordinaire de dernier recours a stoppé ce procès initial et a posé une question préjudicielle auprès du Tribunal constitutionnel espagnol d’interprétation de la loi sur la même disposition pourtant déjà interprétée a priori par le Tribunal constitutionnel, afin de savoir si véritablement le Tribunal constitutionnel, maintenait une deuxième fois son interprétation de conformité à la Constitution.
C’est une situation un peu paradoxale, mais parfois elle peut se présenter. Pas au Gabon par exemple dont la Constitution précise que l’on ne peut pas présenter d’exception de constitutionnalité sur une loi qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution en examen a priori, mais en Espagne oui, une telle disposition n’était pas inscrite dans la Constitution ; donc le juge de la juridiction ordinaire a pu s’estimer fondé à redemander à la Cour constitutionnelle d’Espagne si elle maintenait ou non sa première interprétation constitutionnelle de la loi. Bien sûr le Tribunal constitutionnel espagnol a maintenu sa décision de conformité à la Constitution et donc le requérant a été débouté. Mais le requérant est allé auprès de la Cour européenne des droits de l’homme pour dire « le procès devant la Cour constitutionnelle n’est pas équitable, puisque le contradictoire n’a pas été mis en œuvre et que je n’ai pas reçu les arguments de conformité à la Constitution qui ont pu être retenus par la Cour constitutionnelle avant sa décision et je n’ai pas pu me situer vis-à-vis d’eux. Le contradictoire n’a donc pas été organisé ». La Cour européenne lui a donné raison en épousant cette thèse.
Voilà la synthèse de cet arrêt Ruis Mateos qui me conduit à exprimer quelques inquiétudes au regard finalement de la nature même des Cours constitutionnelles.
Je vois deux difficultés. La première, c’est que par le biais d’une requête d’un particulier, on voit que l’on peut mettre en échec ce qui est dans toutes nos constitutions, une décision de Cour constitutionnelle, alors qu’elle s’impose à toute juridiction et administration. Voilà que par ce biais-là, on peut se trouver en situation de contestation d’une décision déjà prise par une Cour constitutionnelle. Cela pose un problème.
La deuxième réflexion porte sur la place donnée à un requérant qui a pu obtenir de porter une contestation de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, en concurrence et en primauté par rapport aux autorités publiques qui seules sont mentionnées par la Constitution pour contester la constitutionnalité d’une loi. Par ce biais-là, le voilà donc hissé à la hauteur des respon-
sables politiques qui peuvent mettre en œuvre un contrôle de constitutionnalité.
Je ne vais pas plus loin. Je voulais simplement apporter à nos Cours ces réflexions en ne mettant nullement en cause la décision de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a eu le souci face aux deux thèses en présence de trouver dans les éléments particuliers de ce dossier Ruis-Mateos une présentation astucieuse de sa décision majoritaire en estimant « que les instances civiles et constitutionnelles étaient tellement imbriquées qu’à les dissocier, on verserait dans l’artifice et qu’en conséquence, le contradictoire aurait dû être respecté et parce qu’aussi la réponse en constitutionnalité conditionnait l’issue du procès ». Chacun appréciera si cela constitue des raisons suffisantes pour qu’un requérant puisse atteindre une Cour constitutionnelle en lui faisant réexaminer la constitutionnalité d’une loi qu’il a déjà déclarée constitutionnelle, et lui imposer un contradictoire qu’elle n’avait pas eu à mettre en œuvre dans son examen a priori.
M. Costa, Cour européenne des droits de l’homme : Je précise que je m’exprime à titre personnel et que je n’engage pas l’ensemble de la Cour européenne des droits de l’homme.
Il y a plusieurs choses à dire. Première chose, comme l’a dit en commençant Monsieur Abadie, la Cour européenne des droits de l’homme est obligée, évidemment, de décider au cas par cas si la procédure constitutionnelle dans un pays qui a signé et ratifié la Convention – il y en a six dans cette salle – constitue bien un problème d’applicabilité de l’article 6.1. Et cela pose en réalité au moins deux questions : est-ce que l’organe constitutionnel, quand il statue, constitue un tribunal ? Et est-ce que, par ailleurs, il s’agit de la détermination de droits et obligations de caractère civil ou du bien fondé d’une accusation en matière pénale ?
En ce qui concerne le Conseil constitutionnel français – que je connais évidemment un peu mieux que d’autres organes constitutionnels – la Cour de Strasbourg a déjà eu l’occasion de dire qu’en matière de contentieux électoral – c’est la célèbre affaire Pierre-Bloch contre la France de 1997 – la procédure était une procédure juridictionnelle, que le Conseil constitutionnel agissait comme un tribunal, mais que malgré tout l’article 6 paragraphe 1 de la Convention n’était pas applicable, car la Cour, à tort ou à raison, a estimé que le litige, qui portait notamment sur le dépassement du plafond des dépenses de campagne d’un candidat aux élections, ne portait ni sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien fondé d’une accusation en matière pénale contre cette personne. Donc la Cour a estimé que l’article 6 paragraphe 1 ne s’appliquait pas en l’espèce, et qu’il ne pouvait pas avoir été violé et elle a débouté le requérant.
Mais il peut y avoir d’autres hypothèses où se pose en amont, le problème en quelque sorte, de savoir si le Conseil constitutionnel est un tribunal ou pas. Dans le système du contrôle a priori qu’a institué la Constitution de 1958, même après la révision de 1974 qui a élargi la saisine à 60 députés et 60 sénateurs, à mon avis – purement personnel encore une fois – le Conseil constitutionnel n’est pas dans ce cadre-là un tribunal. Il n’y a pas un procès devant lui et donc le problème du procès équitable n’a pas à se poser.
J’ai été évidemment très intéressé par l’intervention de Monsieur Vandernoot, mais je crois qu’au moins dans le système français, il serait tout à fait difficile, sur le plan pratique et même probablement délicat sur le plan théorique et sur le plan de la démocratie, de faire intervenir des sujets de droit susceptibles d’être touchés par la loi votée, et non encore promulguée, devant le Conseil constitutionnel. En tout cas, je pense que ce type de procédures échapperait à l’article 6 paragraphe 1, parce qu’il n’y aurait pas de notion de requérant pouvant faire entendre sa cause devant un tribunal. Je crois, personnellement, que dans ce cadre de contrôle a priori, le Conseil constitutionnel ne constitue pas un tribunal. Cela rejoint un petit peu l’intervention que j’avais faite hier en disant que certains Conseils constitutionnels ou Cours constitutionnelles, dans certaines procédures, ne sont pas des juridictions. Ce sont plutôt des organes régulateurs des pouvoirs publics, mais c’est évidemment une idée que l’on peut discuter.
Le deuxième élément est le suivant : lorsque la Cour de Strasbourg estime que l’on est bien dans le champ d’un tribunal et que le litige devant ce tribunal oppose des parties entre elles, évidemment, les règles du procès équitable et la procédure du contradictoire doivent s’appliquer. Monsieur Abadie, avec beaucoup d’éloquence, a montré les avantages et les inconvénients de la jurisprudence Ruis-Mateos contre l’Espagne et les arguments que l’on peut faire valoir contre cette jurisprudence.
En réalité, la Cour en 1993 a estimé que le fait, pour un requérant, dont les droits civils dépendaient de la réponse à la question constitutionnelle, d’avoir excipé de l’inconstitutionnalité de la loi qui était importante pour la solution du litige, et qui avait donc obligé les juridictions ordinaires à poser une question préjudicielle au Tribunal constitutionnel espagnol, la Cour a estimé qu’il y avait en quelque sorte, en effet, unité du litige.
À mon avis, c’est en réalité une réponse qui me paraît assez solide, parce que je crois qu’à partir du moment où, pour reprendre les heureuses expressions du juge Kolly, il existe un contrôle de constitutionnalité ouvert aux citoyens par voie d’exception, le fait qu’il s’agisse d’un contrôle diffus, exercé directement par les juridictions ordinaires, ou d’un contrôle concentré qui oblige les juridictions ordinaires à renvoyer la question préjudicielle au juge constitutionnel et qui ensuite, lié par sa réponse, tranche le litige, à mon avis, il n’y a que des différences techniques ou de détail entre ces deux façons d’opérer un contrôle de constitutionnalité – là encore, c’est mon opinion personnelle. Mais je dois dire que dans la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, il y a l’idée que lorsqu’une question préjudicielle est posée devant une juridiction qui fait partie du même ordre juridique national, il y a unité du litige.
Par exemple, en matière de délai raisonnable, on a jugé – justement dans le cas de l’Espagne – il y a quelques années, que le fait de renvoyer au tribunal constitutionnel espagnol une question de constitutionnalité et le fait que le tribunal constitutionnel ait mis, par exemple, deux ans pour répondre à cette question, eh bien cela faisait partie de la computation du délai pour savoir si ce délai était raisonnable ou pas.
A contrario, lorsque la question préjudicielle est renvoyée à une juridiction qui n’appartient pas à l’ordre juridique national, alors là, le délai imputable à cette juridiction de renvoi n’est pas calculé.
L’exemple célèbre et évidemment facile à comprendre, est celui de l’ancien article 177 du Traité de Rome, qui je crois maintenant s’appelle 234, qui permet – et qui parfois oblige – les juridictions nationales, dans le cadre de l’Union Européenne, à renvoyer une question d’interprétation du traité ou du droit communautaire dérivé ou de validité de ces normes, à la Cour de Justice des Communautés Européennes à Luxembourg. Là, la Cour de Strasbourg a jugé que la lenteur imputable à la Cour de Luxembourg ou au tribunal de première instance n’était pas imputable à la juridiction ou aux autorités nationales qui avaient cru bon de poser cette question, car il s’agissait de deux ordres juridiques différents. Et là, l’unité du litige se brise, parce que l’on a une dualité des ordres juridiques.
Donc personnellement, même si je suis devenu juge à Strasbourg plusieurs années après l’arrêt Ruis-Mateos, je considère que c’est une jurisprudence qui se défend et qui a une certaine cohérence avec l’ensemble de la jurisprudence de la Cour.
Et je voudrais terminer très brièvement sur un point qui me paraît important et qui est un petit peu en filigrane et notamment qui a été évoqué tout à l’heure par le juge Kolly, lorsqu’il a répondu à la question de la « régularité » d’une loi de procédures qui serait contraire aux règles du procès équitable. Il y a en France, depuis 1975, une situation qui est très intéressante et qui est connue par certains autres pays, notamment par la Suisse, pas vraiment par la Belgique depuis qu’existe la Cour d’arbitrage. C’est la complémentarité entre le contrôle de constitutionnalité des lois et le contrôle de compatibilité de ces lois avec la Convention européenne des droits de l’homme et ces protocoles. Comme vous le savez bien, à propos de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse, en 1975, le Conseil constitutionnel, interprétant la Constitution, a dit qu’il ne lui appartient pas de vérifier la compatibilité d’une loi avec un traité. Son rôle est seulement de comparer la loi avec la Constitution et le bloc de constitutionnalité au sens large, notamment les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Mais il s’agissait d’une invitation implicite faite par le Conseil constitutionnel aux juridictions administratives et judiciaires d’exercer ce contrôle de compatibilité des lois avec les traités. Il se trouve que depuis des décisions célèbres de la Cour de Cassation en 1975 et du Conseil d’État en 1989, toutes les juridictions françaises admettent qu’elles ont le pouvoir de contrôler la compatibilité des lois avec des traités internationaux, même si ces traités internationaux sont antérieurs aux lois. La Cour de Cassation et le Conseil d’État n’appliquent plus la théorie dite de la loi écran. Ainsi maintenant, n’importe quel juge en France – le tribunal de Grande Instance de Périgueux dans l’affaire Chassagnou sur la chasse, par exemple – contrôle la compatibilité d’une loi avec la Convention européenne des droits de l’homme. Et donc si les citoyens n’ont pas à leur disposition l’exception d’inconstitutionnalité, comme dans beaucoup de pays représentés dans cette salle, en revanche les citoyens disposent de la possibilité de porter leur recours devant les juridictions administratives ou judiciaires.
Reste le problème, illustré par l’arrêt Zielinski et Pradal contre la France, du cas où une loi est déclarée par le Conseil constitutionnel conforme à la Constitution, puis où la Cour de Strasbourg considère que cette loi n’est pas compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme. Cela pose un gros problème. Un problème de souveraineté juridique, sinon politique. La vérité est que les citoyens font juger la loi française, non pas par le Conseil constitutionnel français, mais par une juridiction internationale, qui a certes son siège dans une ville française, mais qui est une juridiction internationale.
Alors je livre ceci à votre réflexion et peut-être que dans le débat de 1990 et 1993 sur l’exception d’inconstitutionnalité, il y avait l’idée que après tout, peut-être qu’il vaut mieux faire cela en famille, si je puis dire, et faire juger la compatibilité de la loi avec des normes supra législatives par un organe national plutôt que par une juridiction internationale. Cela dit, je me réjouis que la Cour européenne des droits de l’homme existe et je suis très fier d’y appartenir.
M. Gonthier, Cour suprême du Canada : Merci Monsieur le président. J’aimerais ajouter deux choses très brièvement. Tout d’abord dans la suite de l’intervention du représentant de la Commission africaine qui a souligné l’importance de l’indépendance du juge, finalement, et en dernière analyse, ce n’est pas cela qui est déterminant au niveau du justiciable, du citoyen. Un autre aspect me semble plus important, c’est celui des moyens du citoyen de faire valoir ses droits. Et ceci peut peut-être se présenter de façon assez différente selon la situation a priori ou la situation a posteriori, pour les raisons dont nous avons déjà débattu.
Lorsque nous parlons a posteriori et qu’un procès est donc pendant, les procès en matière constitutionnelle peuvent être simples et peuvent aussi être très complexes. Ainsi, je pense que nous devons nous interroger sur la possibilité pratique pour le simple citoyen de faire valoir ses droits constitutionnels, qui, le plus souvent, sont les droits de l’homme. J’aurais aimé qu’il y ait une discussion, des échanges sur la réalité des systèmes des différents pays à ce niveau. Vous avez évoqué, Monsieur le président, la possibilité qu’il y ait d’autres organismes, des Commissions des droits de l’homme par exemple ou qu’au sein même des administrations, il y ait des moyens à la disposition des citoyens.
Ceci élargit peut-être le débat au-delà des Cours constitutionnelles, mais l’ACCPUF ne serait-elle pas quand même une association dont le mandat pourrait inclure un regard sur l’ensemble des situations où les Cours constitutionnelles ou les Conseils constitutionnels ont un rôle à jouer. Ils ne sont peut-être pas les seuls ou peut-être pas les instruments les mieux adaptés pour le citoyen pour faire valoir les droits de l’homme.
Alors je lance cette question : Nous aurons un autre congrès dans trois ans. Peut-être y a-t-il là quelque chose à explorer davantage plus tard.
Mon autre remarque est un peu un ajout à ce qui vient de faire l’objet des interventions de Monsieur Abadie et de Monsieur Berger-Perrin et vise simplement à vous présenter la position de notre Cour suprême au Canada, qui fonctionne évidemment dans un contexte tout différent, puisque nous sommes juges de tout : nous sommes juges constitutionnels et nous sommes juges ordinaires. Notre système ne fait pas la distinction au niveau des compétences. Nous estimons, et c’est de jurisprudence constante de la Cour, qu’il est très important d’envisager les questions constitutionnelles dans un cadre d’expérience, dans une situation existante, plutôt que dans l’abstrait. Et nous avons poussé cette idée jusqu’à dire qu’un simple tribunal administratif, s’il est autorisé par sa loi constituante à traiter des questions de droit en général doit traiter aussi des questions constitutionnelles [3]. Nous en avons décidé ainsi, croyant que ce tribunal administratif, qui est l’instance la plus proche des réalités sociales et des réalités de vie est le plus à même de s’exprimer alors que le tribunal d’appel et le tribunal de dernière instance devraient avoir le bénéfice de l’expertise particulière de ce tribunal administratif.
M. Zinzindohoue, Association ouest-africaine des hautes juridictions francophones : Je voudrais vous faire part de deux préoccupations : la première se situe par rapport aux éléments retenus pour aborder la question du procès équitable. Je me demande s’il s’agissait des seuls éléments, mais les développements qui ont eu lieu ont montré qu’en dehors de ces éléments, il fallait prendre en compte l’indépendance des juges, ainsi que la liberté de la défense. Les éléments qui ont été retenus ne sont donc pas les éléments exhaustifs du procès équitable.
Ma seconde préoccupation est une réflexion qui fait suite à la question posée par Madame le président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Je ne réponds pas du tout en tant que président de Cour suprême, mais en tant que spécialiste des procédures, pour donner quelques pistes de réflexion. Si nous nous trouvons dans l’hypothèse d’une décision de juridiction suprême ou d’une juridiction judiciaire ayant l’autorité de la chose jugée et qu’il y a violation manifeste de la Constitution, je pense que la procédure de révision, c’est-à-dire de rectification de la décision qui viole manifestement la Constitution, peut être une première piste. Les voies de révision de procès sont un premier élément.
Une seconde piste peut être la formule française du « tribunal des conflits », parce que la même question qui est posée pour une Cour suprême peut être posée pour une Cour constitutionnelle. Si une Cour constitutionnelle rend une décision qui viole la Constitution, que peut-il se passer ? Il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école. Et je crois que la Cour a trouvé une formule pour rattraper, pour réformer, pour rectifier. Si ma mémoire est bonne, peutêtre les collègues béninois peuvent le confirmer, il y a eu une ordonnance présidentielle qui a été prise. Dans un premier cas, il a été dit que ce texte violait la Constitution, mais après, il a été déclaré conforme à la Constitution. Donc je crois que la juridiction peut réformer, rectifier, si vraiment il y a une erreur. Tout le problème est de savoir par quelle voie elle va être saisie dans une telle situation. Est-ce une voie de révision ? Faut-il envisager un tribunal des conflits ou peut-être la solution européenne : une Cour régionale qui puisse donc aborder ces questions. Dans les pays où il y a deux Cours suprêmes, la question se pose effectivement et c’est une difficulté. Au Bénin, la Constitution est claire là-dessus. Il n’y a pas de concurrence entre les deux Cours, mais c’est une question intéressante, parce qu’il ne s’agit pas
d’une hypothèse d’école.
M. Ndolimana, Cour constitutionnelle du Rwanda : Je voudrais vous faire part de notre expérience au Rwanda qui est, me semble-t-il, différente de celle qu’on a développée ici depuis hier. Je vais profiter de l’occasion qui m’est offerte pour demander au rapporteur d’ajouter un mot qui me semble important dans le rapport à la page 12 [p. 646 du présent volume] où il est fait mention du Rwanda au dernier paragraphe. La deuxième phrase commence par le mot « le contrôle est préventif ». Je voudrais ajouter « et systématique ». Notre expérience est en effet tout à fait différente de celle qui est présentée ici. Au Rwanda tout d’abord, la Cour constitutionnelle ne connaît pas du contentieux électoral, elle ne s’occupe que du contrôle de la constitutionnalité. Ce contrôle est préventif et systématique, c’est-à-dire que toute loi, tout traité international, tout décret-loi, avant d’être promulgué par le président de la République, doit être soumis à la Cour constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité. La Cour se prononce dans la huitaine sur la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité de la loi ou du décret-loi, et dans les quatre jours en cas d’urgence. Et la décision, l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, s’impose à tout le monde, même au président de la République. C’est-à-dire que si l’arrêt déclare la loi ou le décret-loi conformes à la Constitution, le président de la République a un délai de dix jours pour les promulguer. Il n’a pas le droit de veto. Passé ce délai, les décrets-lois seront sanctionnés et promulgués par le Premier ministre, les lois seront sanctionnées et promulguées par le président de l’Assemblée nationale de transition.
À ce niveau-ci, le principe du contradictoire et le principe du droit au recours se trouvent donc inconcevables dans notre système.
-
[1]
La délégation du Tribunal fédéral suisse a souhaité que la présentation orale du rapport introductif figure également dans les Actes. [Retour au contenu] -
[2]
Voir ci-dessous l’annexe p. 729. [Retour au contenu] -
[3]
Voir ci-dessous l’annexe p. 734. [Retour au contenu]
Rapport général
sous la présidence de
de la Cour constitutionnelle de Roumanie

Libreville, deuxième Congrès de l’ACCPUF
De gauche à droite : Madame Louise ANGUÉ, juge à la Cour constitutionnelle du Gabon, Monsieur Costica BULAI, juge à la Cour constitutionnelle de Roumanie.

par Madame Louise ANGUÉ,
juge à la Cour constitutionnelle du Gabon
Septembre 2000
Le rapport général a été préparé en collaboration avec monsieur Ferdinand Mélin-Soucramanien,
professeur des Universités, agrégé de droit public.
La littérature a souvent brocardé les règles du procès en y voyant un droit de chicane conduisant à égarer les requérants dans les arcanes de la procédure. Il suffit de se remémorer la satire féroce de Racine dans les Plaideurs, de Molière, dans le Misanthrope, ou encore la description saisissante qu’en fait Kafka dans le Procès, pour s’en convaincre.
Pourtant, ce sentiment largement partagé fait fi d’une autre dimension de la procédure. Celle-ci peut aussi être conçue comme une garantie pour les requérants en ce sens qu’elle représente le moyen de faire valoir leurs droits en justice. Les droits de l’action serviraient donc les droits substantiels. Ils en seraient les vecteurs indispensables. C’est exactement cette idée qu’exprimait Montesquieu dans l’esprit des lois lorsqu’il écrivait que « … les formalités de justice sont nécessaires à la liberté ».
C’est cette idée également qui s’est imposée dans le droit contemporain sous la forme du droit à un procès équitable qui inclut à la fois le droit d’accès au juge, et le droit à une bonne justice lorsque cet accès est réalisé. Le droit à un procès équitable qui vise à insuffler une valeur de justice dans le procès a désormais acquis la dimension d’un principe transcendant les frontières. On le trouve ainsi exprimé dans la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ou dans le pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966.
Il ne fait donc aucun doute que le thème de ce deuxième Congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français a été particulièrement judicieux. Après avoir évoqué en 1997 à Paris, un droit substantiel : le principe d’égalité, il semble logique de s’interroger aujourd’hui à Libreville sur la portée d’un droit formel dont la fonction est précisément de permettre la mise en œuvre effective des droits substantiels. En effet, sans accès au juge constitutionnel, les droits inscrits dans nos Constitutions ne demeureraient que de simples « promesses » sans effet juridique.
Ce rapport de synthèse n’a pas pour objet de dresser un inventaire à la Prévert des différentes solutions retenues par la trentaine de Cours participantes. Une telle démarche serait sans intérêt d’autant que les rapports nationaux et les trois sous-rapports de synthèse fournissent une masse d’informations sans équivalent jusqu’à ce jour sur la question de l’accès au juge constitutionnel. Nous voudrions ici très simplement faire état de quelques réflexions suscitées par la lecture de ces rapports, sans d’ailleurs qu’il soit possible de les citer tous, et surtout formuler certaines interroga-
tions pouvant déboucher sur des orientations nouvelles. À ce propos, l’on pourrait s’interroger sur le point de savoir si l’élargissement de l’accès au juge constitutionnel représente un progrès de l’État de droit ?
Dans cette perspective, les différentes expériences nationales montrent que pour les requérants, si l’accès au juge constitutionnel paraît de prime abord représenter une voie étroite (première partie) ; il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un chemin sûr (seconde partie).
I. L’accès au juge Constitutionnel : une voie étroite ?
La doctrine a tendance à présenter le modèle américain de justice constitutionnelle comme celui qui ouvrirait grande la porte de l’accès au juge constitutionnel, tandis que dans le modèle autrichien ou européen seules les autorités politiques jouiraient du privilège d’engager l’action constitutionnelle.
Sans entrer dans ce débat doctrinal qui privilégie un système par rapport à un autre, on constate à la lecture des différents rapports nationaux, dans le cadre du contrôle a priori, que le nombre des initiateurs est tantôt limité, tantôt étendu.
Bien entendu, ce problème d’élargissement de l’accès au juge constitutionnel ne se pose pas dans le cadre du contrôle a posteriori qui ne peut se concevoir sans l’intervention des particuliers.
A. – Conditions de recevabilité dans le cadre du contrôle a priori
a) Accès limité aux autorités publiques
Lorsque les Cours constitutionnelles s’inscrivent dans le cadre du modèle autrichien de justice constitutionnelle, s’agissant d’un contrôle préventif et abstrait des normes, le principe est que seules certaines autorités publiques peuvent saisir le juge constitutionnel.
Comme cela a été souligné dans plusieurs rapports, dans cette hypothèse, l’intérêt pour agir est en quelque sorte présumé. La qualité pour agir présuppose l’intérêt pour agir, les autorités publiques saisissant le juge constitutionnel dans « l’intérêt de la Constitution ». Elles jouent ainsi, peu ou prou, le rôle de « procureurs » défendant le respect de la norme fondamentale.
En conséquence, ces autorités sont peu nombreuses et sont généralement celle-là mêmes qui participent au processus d’élaboration des normes contrôlées. Evidemment, ceci contribue à accréditer l’idée selon laquelle dans le cadre du contrôle a priori, la cour constitutionnelle représente davantage un « co-législateur » ou encore un « législateur négatif » selon l’heureuse formule d’Hans Kelsen, qu’une véritable juridiction.
C’est ainsi que toutes les Cours constitutionnelles admettant un contrôle a priori peuvent être saisies avant la promulgation des lois organiques ou ordinaires et avant la ratification des traités internationaux, d’abord, par le chef de l’État c’est-à-dire, le plus souvent le président de la République ou le Roi comme au Cambodge ou au Maroc. Cette prérogative essentielle du chef de l’État en fait le premier gardien de la Constitution, même si les statistiques montrent qu’il n’use de cette faculté qu’avec parcimonie. La plupart des cours peuvent également être saisies par le gouvernement pris dans son ensemble ou par le Premier ministre, tout dépendant ici de la nature du régime, présidentiel ou parlementaire, pour lequel a opté le pays considéré.
Aux côtés de l’exécutif, le pouvoir législatif a aussi un rôle éminent à jouer. Ici, plusieurs possibilités peuvent être envisagées. Parfois seuls les présidents des organes délibérants ont qualité pour agir. D’autres fois, les parlementaires peuvent saisir le juge constitutionnel, soit en groupe composé d’une fraction ou d’un nombre prédéterminé de membres des chambres, soit, ce qui est plus rare, en leur nom propre comme en Moldavie où est même prévu l’existence d’un « avocat parlementaire ».
Bien sûr, dans l’hypothèse d’une saisine individuelle des députés ou sénateurs, la porte d’accès au juge constitutionnel leur est ouverte. D’autres fois encore, ce sont à la fois les présidents de chambre et les parlementaires qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle. C’est le cas par exemple du Gabon qui, outre les autorités précitées, inclut également les autorités judiciaires. Ainsi, les présidents des Cours judiciaire, administrative et des comptes peuvent saisir le juridiction constitutionnelle.
On le voit, lorsqu’est prévu un contrôle a priori, les autorités de saisine paraissent avant tout resserrées autour des principaux titulaires des pouvoirs exécutif et législatif. C’est la raison pour laquelle les spécialistes de contentieux constitutionnel parlent dans ce cas de « saisine fermée ». Toutefois, derrière la rigueur apparente du principe se dissimulent nombre de tempéraments. Ainsi, selon la nature de l’État d’autres requérants que les autorités publiques nationales stricto sensu peuvent être admis à faire entendre leur
voix au cours du procès constitutionnel.
Dans les États fédéraux ou régionaux tels que la Belgique, la Moldavie et bientôt Madagascar, les représentants des États fédéraux ou des régions autonomes se voient reconnaître un droit de saisine de la juridiction constitutionnelle à laquelle incombe alors un rôle primordial dans le maintien de l’unité du pays.
Comme on le sait, en Suisse, pour des raisons historiques et sociologiques propres, la compétence principale du Tribunal fédéral réside précisément dans le contrôle des lois des Cantons formant la Confédération.
De même, dans les États accordant un statut spécial à certaines religions ou communautés religieuses, l’accès au juge constitutionnel peut encore être élargi au profit de celles-ci. Ainsi, au Liban, la Constitution permet un droit d’action devant le juge constitutionnel des dix-huit chefs de communautés religieuses jouissant d’un statut garanti par l’État. Dans une affaire particulièrement intéressante du 23 novembre 1999, le Conseil constitutionnel Libanais a examiné pour la première fois la recevabilité d’un tel recours en veillant bien à ne pas se prononcer sur la régularité de la désignation du requérant comme chef religieux de sa propre communauté, mais en se bornant à constater que la fonction qu’il remplissait lui conférait qualité pour agir.
D’autres États sont encore allés plus loin dans l’élargissement de l’accès au juge constitutionnel en y incluant les particuliers.
b) Accès élargi aux particuliers
Dans certains pays comme la Belgique, le Bénin, le Canada, la Centrafrique, le Gabon, l’Île Maurice et la Suisse, le droit de saisir le juge constitutionnel est accordé aux personnes physiques ou morales. Dans ce cas, la personne physique ou morale qui engage l’action constitutionnelle doit justifier d’un intérêt pour agir. Il s’agit alors pour le requérant d’établir que l’acte attaqué lèse ses droits fondamentaux.
L’objection majeure que l’on pourrait formuler contre ce système est qu’un tel élargissement favoriserait un grand afflux de saisines, et par conséquent, risquerait de provoquer un engorgement excessif des juridictions constitutionnelles. Ce qui, à brève échéance, ne manquerait pas de compromettre l’exercice de leur mission dans la mesure surtout où ces juridictions sont généralement tenues de statuer dans des délais très courts.
Mais les tenants de l’extension aux particuliers de l’accès au juge constitutionnel, dans le cadre du contrôle a priori, la justifient par le fait que les autorités publiques qui se retrouvent seules habilitées à engager le recours constitutionnel sont aussi celles-là mêmes qui procèdent à l’élaboration des normes à contrôler. Intervenant dans l’intérêt général, leurs motivations et leurs réactions ne peuvent évidemment pas être les mêmes que celles qui animeraient le particulier devant une norme portant atteinte à ses droits fondamentaux.
En outre, la nécessité d’assurer la protection des droits fondamentaux des individus demeure un impératif pour le juge constitutionnel, elle ne saurait donc faire l’objet d’un marchandage dans le simple souci de prévenir un surcroît de travail éventuel qui pourrait d’ailleurs trouver des allègements dans le cadre de l’organisation interne du fonctionnement de chaque juridiction constitutionnelle.
Par ailleurs, il faut relever que dans la très grande majorité des cas, la saisine ne peut pas provenir de la Cour constitutionnelle elle-même. Sauf qu’à l’occasion de l’examen d’une affaire donnée, les Cours peuvent parfaitement soulever des moyens ou des conclusions d’office, voire, comme dans le cas français, évoquer la constitutionnalité d’une loi déjà promulguée à condition que la loi soumise présentement au contrôle « la modifie, la complète ou en affecte le domaine ».
Néanmoins, les Cours constitutionnelles francophones, à l’exception notable des Cours égyptienne et slovène, ne se voient pas reconnaître par les textes, ni ne se reconnaissent d’elles-mêmes, une faculté d’auto-saisine. Si grande soit notre volonté de voir garantir pleinement le respect du droit constitutionnel, nous nous permettons de penser que ceci est heureux, dans la mesure où conférer un tel pouvoir aux juridictions constitutionnelles risquerait de conduire à un véritable « gouvernement des juges » et, in fine, contribuerait à desservir la cause du droit constitutionnel [1].
Bien entendu les conditions de recevabilité du recours en constitutionnalité ne se limitent pas seulement à la qualité et à l’intérêt pour agir du requérant, il faut ajouter l’exigence du respect des délais dans lesquels celui-ci peut saisir le juge constitutionnel, délais qui, à l’analyse, nous paraissent bien brefs.
c) Brièveté des délais pour agir
Avec la question des délais pour agir dans le cadre du contrôle préventif, on bute sur une difficulté sérieuse sur la route du procès constitutionnel. Ainsi, le contrôle ayant lieu avant la promulgation des textes législatifs par le chef de l’État, nécessairement le délai pour agir devant le juge constitutionnel est conditionné par le délai de promulgation.
C’est ainsi qu’au Sénégal, les requérants n’ont que six jours pour saisir le Conseil constitutionnel, quinze jours en France ou au Mali, trente jours au Maroc…
Il s’agit certes d’une donnée inhérente au contrôle a priori qui présente bien des avantages, notamment en termes de sécurité juridique, puisqu’elle crée les conditions permettant de purger rapidement et autant que possible l’ordre juridique de textes contraires à la Constitution. Mais le revers de la médaille est qu’en pratique, les requérants peuvent se voir aisément priver de tout accès au juge constitutionnel.
Deux considérations sont à prendre en compte à cet égard :
D’abord à cette brièveté des délais peuvent venir se rajouter d’autres difficultés purement matérielles comme l’accessibilité des textes votés par le Parlement. Ce problème se rencontre dans des pays où le recours est ouvert aux simples particuliers qui se trouvent parfois confrontés à l’impossibilité concrète de se procurer une loi avant qu’elle ne soit promulguée.
Ensuite, l’absence d’une disposition constitutionnelle prescrivant un délai avant l’expiration duquel le président de la République ne peut promulguer la loi ainsi adoptée expose les requérants à un risque de forclusion.
Le rapport français fait mention, en ce sens, d’une espèce intéressante dont l’examen a donné lieu à la décision du 7 novembre 1997 par laquelle le Conseil constitutionnel français a déclaré irrecevable une saisine parlementaire dirigée contre une loi déjà promulguée par le président de la République. Pour l’heure, ce qui permet de prévenir ce risque de forclusion, c’est une simple convention, une « coutume constitutionnelle » si l’on préfère, qui veut que le chef de l’État s’abstient de promulguer un texte tant qu’il n’est pas certain que celui-ci ne fera pas l’objet d’un recours.
C’est pourquoi, des réformes ont été proposées en particulier par la Cour constitutionnelle de la République gabonaise qui a suggéré que soit prévu dans la Constitution, non seulement un délai maximum pour la promulgation, mais également un délai minimum durant lequel la promulgation ne peut intervenir.
Des difficultés de cette nature ne se rencontrent évidemment pas dans le cadre du contrôle a posteriori, où le juge constitutionnel est encore plus accessible.
B. – Conditions d’accès au juge constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori
Dans une série d’États francophones existe un mécanisme de question préjudicielle par lequel les juridictions de droit commun peuvent, soit spontanément, soit à la demande des parties, renvoyer à la Cour constitutionnelle le soin de trancher les questions mettant en jeu l’exercice des droits fondamentaux. Un tel système se rencontre notamment en Belgique, au Bénin, au Gabon, au Sénégal, au Togo ou encore en Roumanie. Et, comme il a été souligné dans le rapport français, une réforme constitutionnelle en ce sens a été initiée en France dès 1990, mais sans succès. Le recours a posteriori peut également consister en un recours direct en annulation porté par l’individu devant la Cour constitutionnelle.
Si certaines règles procédurales spécifiques au contrôle a posteriori, telle que l’exigence d’un intérêt à agir, pourraient venir restreindre l’accès au juge constitutionnel, il semble que les Cours ne fassent pas preuve en la matière d’un formalisme excessif.
a) L’intérêt pour agir
Il paraît naturel qu’un intérêt pour agir soit exigé des requérants dès lors qu’ils exercent un recours contre une norme produisant déjà des effets de droit. Dans cette hypothèse, les initiateurs du contrôle de constitutionnalité sont pratiquement placés dans la position de parties en conflits au cours d’un procès devant une juridiction ordinaire. C’est un véritable droit subjectif, un
« intérêt juridiquement protégé » au sens où l’entendait von Hiering, que les requérants font valoir devant la juridiction constitutionnelle.
À première vue, cet intérêt pour agir obéit aux critères habituels d’appréciation de cette condition, notamment par les juridictions civiles ou administratives. C’est ainsi, entre autres, que l’intérêt doit être né et actuel. Autrement dit, il est nécessaire qu’au moment du procès constitutionnel l’objet du litige soit encore présent.
Toutefois, à y regarder de plus près, il apparaît que l’appréciation portée par le juge constitutionnel sur cette condition de l’intérêt à agir est généralement bienveillante. Cette attitude est d’ailleurs parfois guidée par le texte constitutionnel lui-même.
Ainsi, au Canada, c’est la Charte de 1982 sur les droits et libertés qui impose à la Cour suprême une « interprétation souple et libérale » de l’intérêt à agir afin de ne pas entraver l’exercice des libertés qu’elle prévoit. Mais, le plus souvent, c’est le juge constitutionnel qui, au fil de ses décisions, trace les contours d’un intérêt à agir entendu de manière compréhensive.
Il en résulte que les décisions d’irrecevabilité sont très peu fréquentes devant la plupart des Cours constitutionnelles admettant l’existence d’un contrôle a posteriori.
Il nous semble que la raison profonde de ce phénomène réside dans le fait que le contrôle de constitutionnalité, même exercé a posteriori, conserve une coloration d’ordre public. Bien que les parties agissent en leur nom propre pour défendre leurs droits subjectifs, en fin de compte, c’est le respect du droit objectif qui est indirectement garanti.
b) L’absence de formalisme excessif
Mais d’autres facteurs concourent encore à l’élargissement de l’accès au juge constitutionnel lorsque sont exercés des recours a posteriori. D’abord, on remarque que les conditions de recevabilité relatives à la présentation des recours individuels sont minimales. Il est le plus souvent simplement attendu du requérant qu’il mentionne ses noms, prénoms et adresse et qu’il motive son recours en précisant, d’une part, qu’elle est la norme attaquée et d’autre part, quelle est la norme de référence du contrôle. Devant certaines Cours constitutionnelles, comme celle du Bénin, le requérant analphabète appose son empreinte digitale au bas du recours en guise de signature.
On peut considérer que l’adoption de ce système, dès lors qu’il est assorti d’un filtrage efficace, revêt un intérêt majeur pour l’ouverture de l’accès au juge constitutionnel. En effet, le principal reproche formulé contre un contrôle exercé exclusivement a priori consiste à soutenir qu’il laisserait subsister des normes potentiellement inconstitutionnelles dans l’ordre juridique. Or, le contrôle préventif, associé à un mécanisme de question préjudicielle permet de combler cette lacune tout en préservant le monopole des Cours constitutionnelles qui représente à nos yeux une garantie fondamentale de cohérence et d’unité de l’ordre juridique.
Il faut enfin indiquer qu’aussi bien dans le cadre du contrôle a priori qu’en ce qui concerne le contrôle a posteriori, la procédure constitutionnelle est généralement peu onéreuse dans la mesure où le ministère d’avocat n’est presque jamais obligatoire, même s’il est toujours possible. La barrière de l’argent n’entrave donc pas l’accès au juge constitutionnel, même si certaines juridictions prévoient l’existence de frais d’enregistrement ou le versement de cautions. C’est le cas notamment du Canada, de l’Égypte ou de la Suisse. Cependant, il convient de remarquer que les sommes exigées dans ce cas sont purement symboliques et ne paraissent pas de nature à freiner l’ardeur procédurière même des requérants aux revenus modestes [2].
Pareillement, lorsqu’il est prévu le paiement d’une somme d’argent afin de sanctionner un éventuel exercice abusif du droit d’agir, non seulement la mauvaise foi du requérant doit être démontrée, mais encore les amendes paraissent peu dissuasives et, en tout cas, sans commune mesure avec celles pouvant être prononcées à l’occasion d’un procès pénal par exemple.
La seule exception notable paraît être celle de la Moldavie où la cour peut infliger une amende égale à vingt-cinq fois le salaire minimum, ce qui peut sembler excessif compte tenu de l’impérieuse nécessité de ne pas placer d’obstacle infranchissable sur la voie permettant d’accéder au juge constitutionnel. En somme, sur cette première partie du rapport général, l’on pourrait répondre avec certitude que l’accès au juge constitutionnel est loin d’être une voie aussi étroite qu’il le paraît de prime abord, puisque dans plusieurs États il est ouvert à des intervenants autres que les seules autorités publiques traditionnelles.
Et en raison même de cette tendance à plus d’ouverture quasi générale, il est permis d’affirmer également que l’élargissement de l’accès au juge constitutionnel représente un réel progrès de l’État de droit, en tous les cas un facteur important de son affermissement.
À ce propos, il semble que la seule question qui resterait posée serait de savoir si cet élargissement de l’accès au juge constitutionnel doit être uniforme, c’est-à-dire d’harmonisation générale ou si chaque région ou chaque État ne devrait pas le concevoir selon ses réalités culturelles et sociologiques propres.
II. L’accès au juge constitutionnel : un chemin sûr.
Après avoir recherché si l’accès au juge constitutionnel était réellement une voie étroite, on peut maintenant passer au second volet de ce rapport pour constater que cet accès est, en tout état de cause, un chemin sûr pour le requérant. Il aurait d’ailleurs été assez paradoxal que les Cours constitutionnelles, qui assurent un contrôle rigoureux des droits – garanties comme le droit au juge ou les droits de la défense, ne s’appliquent pas à elles-mêmes ces principes. D’autant plus, que le respect de ces règles essentielles peut leur être imposé « par le haut » dans la mesure où nombre d’instruments internationaux tels que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ou la Convention européenne des droits de l’homme peuvent être, soit incorporées dans le « bloc de constitutionnalité » des différents États envisagés, soit considérés comme applicables à toute procédure juridictionnelle, fût-elle constitutionnelle.
De fait, la plupart des rapports soulignent l’importance que revêt l’accès au juge constitutionnel qui, bien davantage que l’aspect quantitatif précédemment évoqué, représente un élément central de la définition d’un État de droit.
Mais il importe aussi de tenir compte des spécificités propres à chaque grande « famille » de juridiction constitutionnelle à laquelle se rattachent les Cours appartenant à l’Association. Sans formuler de jugement de valeur, il est aisé de constater que les Cours se situant dans le cadre du contrôle a priori subissent d’importantes contraintes liées à la nature même de ce type de contrôle, ce qui implique une adaptation des principes directeurs du procès ; alors que, dans l’exercice de leur compétence a posteriori, l’allègement des contraintes permet l’application intégrale de ces principes par les Cours concernées.
A. – L’Adaptation des principes directeurs du procès dans le cadre du Contrôle a priori
D’emblée, il faut souligner que les Cours correspondant au modèle autrichien de justice constitutionnelle sont placées dans une position relativement inconfortable face aux pouvoirs exécutif et législatif.
En effet, les modalités techniques du contrôle a priori conduisent nécessairement à une imbrication étroite, confinant parfois à la confrontation, entre les autorités d’édiction des normes infra – constitutionnelles et celles chargées d’en contrôler la conformité à la norme fondamentale. Dans ces conditions, il est clair que la marge de manœuvre des cours constitutionnelles est réduite si on la compare à celle des cours suprêmes coiffant le pouvoir judiciaire.
a) La brièveté des délais de jugement
La première difficulté naît du fait que les Cours constitutionnelles exerçant un contrôle préventif interviennent au cours du processus d’élaboration des lois organiques et ordinaires ou de ratification des traités internationaux, ce qui les contraint à juger d’affaires présentant un haut degré de complexité dans des délais extrêmement brefs. Ainsi, dans plusieurs Pays comme la République centrafricaine, la France, le Maroc ou le Sénégal, la Cour ne dispose que d’un délai préfix de trente jours, qui peut être ramené à huit jours en cas d’urgence. Devant les cours Tchadienne ou béninoise, le délai est encore plus court puisqu’elles doivent impérativement statuer dans un délai maximum de quinze jours. D’ailleurs, le rapport du Bénin souligne combien ce délai est difficile à tenir et précise même qu’en raison de l’essor du contentieux il n’est pas toujours respecté, ce qui suscite évidemment des difficultés théoriques et pratiques considérables. Dans le cas du Gabon, il est même prévu une procédure que l’on pourrait qualifier « d’extrême urgence » puisque lorsque la cour est saisie de la constitutionnalité d’ordonnances prises par le président de la République sur le fondement de l’article 26 de la Constitution, elle doit se prononcer dans les quarante-huit heures.
En soi, cette brièveté des délais de jugement imposé par les textes constitutionnels pourrait sembler bénéfique tant l’exigence d’un délai raisonnable de jugement paraît liée à celle d’une bonne administration de la justice. Toutefois, il faut bien voir également que dans les États où le contrôle préventif s’est épanoui depuis plusieurs années de nouveaux problèmes sont apparus. Outre l’augmentation quantitative du nombre des saisines qui est partout observable, on assiste également à un saut qualitatif dans la richesse de l’argumentation développée par les requérants. Dès lors, il apparaît de plus en plus délicat pour le juge constitutionnel de répondre dans les délais aussi brefs à des recours comportant parfois plusieurs dizaines de moyens souvent enrichis par des mémoires ampliatifs.
Quelle solution préconiser pour répondre à un tel problème ? faut-il envisager l’extension des délais ? Il semble difficile d’étendre indéfiniment les délais de jugement sans différer de manière inconsidérée la date de promulgation de la norme soumise au contrôle. D’autant plus que certains textes comme les lois de finances doivent impérativement être entrés en vigueur à une date fixée par la constitution elle-même. On pourrait, bien sûr, étendre ce délai de quelques jours et le porter de trente à quarante-cinq ou soixante jours, mais il n’est pas certain que cela change grand chose à l’affaire.
Une autre solution pourrait consister, en s’inspirant du droit belge, à prévoir dans la constitution une sorte de « sursis à exécution des décisions législatives ». En effet, en Belgique, lorsque la cour d’arbitrage est saisie d’un recours en annulation, il est possible que le requérant assortisse sa requête d’une demande de suspension.
La cour doit alors statuer « sans délai » sur cette demande de suspension. En pratique, dans un premier temps, la cour d’arbitrage rend une décision provisionnelle dans un délai de un à trois mois, puis dans un second temps, elle doit se prononcer au principal moins de trois mois après l’éventuel arrêt ayant suspendu l’application du texte attaqué.
Ce mécanisme qui s’apparente aux procédures d’urgences comme le référé ou le sursis à exécution que l’on rencontre notamment en contentieux administratif, pourrait permettre au juge constitutionnel d’apporter une réponse graduée en fonction du degré de difficulté des questions soulevées. Si l’affaire est simple, que le recours ne comporte pas de moyens sérieux, il reste possible de trancher le litige rapidement. En revanche, s’il existe des moyens sérieux et que l’entrée en vigueur rapide de la norme attaquée n’est pas déterminante, la cour peut en suspendre l’application en tout ou partie durant un laps de temps raisonnable, sans que cette décision ne préjuge forcément de la décision au fond qu’elle prendra ultérieurement.
b) La maîtrise du procès par le juge
Cette brièveté des délais emporte une série de conséquences sur la conduite du procès constitutionnel. Celui-ci ne peut raisonnablement se dérouler dans les circonstances présidant aux contentieux ordinaires.
C’est pourquoi, la procédure devant les cours constitutionnelles exerçant un contrôle a priori est nécessairement inquisitoire. Dans ces conditions, parler d’application du principe du contradictoire ou de l’égalité des armes s’agissant de ces Cours ne peut relever que d’une impropriété de langage. Avant tout, le principe du contradictoire représente la loi des parties. Comme le savent bien les processualistes, le principe du contradictoire au sens strict n’a de sens que lorsque deux ou plusieurs parties font valoir des prétentions opposées devant un juge, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du contrôle a priori, où il n’y a, ni parties, ni droits subjectifs en cause.
Fondamentalement, il s’agit toujours d’un « procès fait à un acte » selon l’expression forgée par le Doyen Bonnard à propos du recours pour excès de pouvoir. De plus, il est communément admis en droit processuel que si le juge doit faire observer le principe du contradictoire entre les parties, il est quant à lui placé hors du champ de la contradiction. On ne peut donc pas soutenir davantage que la contradiction s’instaurerait entre le juge constitutionnel et les requérants.
En conséquence, il paraît peu opportun de s’interroger sur le point de savoir si devant les cours constitutionnelles admettant un contrôle préventif, le principe du contradictoire est pleinement ou partiellement respecté, puisqu’en droit, il est tout simplement inapplicable faute de l’existence de véritables parties.
Néanmoins, il reste que devant ces Cours les textes imposent des communications de pièces et que se sont développées, souvent de manière empirique, des procédures qui permettent l’instauration d’un échange d’arguments essentiellement durant la phase d’instruction.
D’abord, il faut souligner que lorsque les Cours constitutionnelles pratiquant un contrôle a priori sont saisies, une obligation de publicité s’impose. À cette fin, il est généralement prévu que le recours est transmis pour information aux autorités de saisines et, éventuellement, qu’il est publié dans un recueil officiel.
En France, la publication des saisines au Journal officiel résulte d’une pratique instaurée en 1983, mais il a fallu attendre 1994 pour que les observations du gouvernement adressées en réplique soient également portées à la connaissance du public.
Ensuite, on peut noter que la procédure est principalement écrite et que les pièces mêmes du dossier sont peu nombreuses, ce qui est naturel s’agissant d’un contentieux normatif. Le dossier officiel de procédure contient au minimum la lettre de saisine, les éventuels mémoires ampliatifs et, évidemment, la norme attaquée.
Toutefois, le juge – rapporteur peut l’enrichir de tous les éléments lui paraissant utiles pour forger sa conviction, parmi lesquels les précédents jurisprudentiels, les solutions du droit comparé ou encore les sources doctrinales. Enfin, il faut insister sur le fait que la procédure d’instruction est totalement inquisitoire, c’est-à-dire que c’est le juge qui est le véritable maître du
procès constitutionnel.
C’est la raison pour laquelle le rapporteur peut parfaitement décider de consulter par écrit ou oralement toute personne de son choix, qu’il s’agisse d’un avocat, d’un expert, voire comme en France du secrétariat du gouvernement qui peut présenter des observations écrites ou produire des fiches techniques sur des points particuliers.
Dans tous les cas, il n’y a pas à proprement parler de contradiction, mais plutôt information de la Cour constitutionnelle pour contribuer à éclairer son jugement. Ce caractère inquisitoire de la procédure permet aussi de comprendre pourquoi le juge peut parfaitement soulever des moyens et conclusions d’office lors de la phase de jugement sans nécessairement en avertir au préalable les autorités de saisine afin que celles-ci fourbissent de nouveaux arguments en réplique.
B. – L’application des principes directeurs du procès dans le cadre du contrôle a posteriori
Dans le cadre du contrôle a posteriori, on retrouve toutes les garanties procédurales assurant aux parties une certaine justice du procès. Le contrôle de constitutionnalité met réellement en présence des parties défendant leurs droits subjectifs. Aussi, n’y a-t-il rien d’étonnant à ce que, non seulement le principe du contradictoire, mais aussi celui de l’égalité des armes, y jouent pleinement leur rôle.
a) Le principe du contradictoire
S’agissant en premier lieu du principe du contradictoire, il exige pour l’essentiel que le débat soit réel et loyal. Il confère à chacune des parties adverses le même droit élémentaire : celui d’être présent devant le juge et d’être en mesure de défendre ses intérêts.
C’est bien ainsi que l’ont compris les cours constitutionnelles pratiquant le contrôle a posteriori puisque l’accès à leur enceinte est toujours largement ouvert aux parties ou à leurs représentants.
Ainsi, en Égypte, en Bulgarie ou à l’Ile Maurice, les parties se voient garantir un accès au juge à toutes les étapes de la procédure. Elles peuvent produire des mémoires écrits ou choisir de s’exprimer oralement. De plus, la publicité des débats est complète, sauf dans les cas où la confidentialité exige la tenue de l’audience à huis – clos. Comme l’indique le rapport belge, cette publicité suscite évidemment l’attrait de la presse et de l’opinion publique pour les audiences concernant des affaires sensibles.
On peut même relever que le principe du contradictoire s’applique avec tant de rigueur que certaines juridictions comme la Cour suprême du Canada ont dû imaginer des moyens de limiter le temps de parole des avocats.
En France, sous l’ancien régime, les juges avaient parfois recours à la clepsydre pour arrêter les avocats trop prolixes.
Au Canada, les juges de la Cour suprême ont fixé la durée de leur plaidoirie à une heure maximum avec la possibilité de la reprendre ensuite pour quelques minutes afin de répliquer à la partie adverse.
b) Le principe de l’égalité des armes
Quant au principe de l’égalité des armes, il est généralement conçu comme un corollaire du principe du contradictoire. Il signifie simplement que la procédure doit être équilibrée ou équitable en ce sens que toute partie dans un procès doit avoir la possibilité d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie adverse.
Peut être, au-delà d’une simple question d’accès au juge, avec l’égalité des armes, est ce de bonne justice qu’il s’agit.
Ce principe juridique, qui prend sa source dans une exigence morale, paraît généralement bien respecté par les Cours exerçant un contrôle concret des normes. Ainsi, en Belgique ou au Canada, il est expressément prévu que les parties doivent pouvoir se faire communiquer le dossier de procédure dans son intégralité. Aucune pièce de la procédure ne peut être soustraite sous peine de rompre l’équilibre entre les parties. De même, si le juge, exerçant son pouvoir d’instruction et d’investigation, ordonne une expertise ou effectue un déplacement sur le terrain, il doit impérativement en avertir chacune des parties.
Enfin, un autre facteur du caractère accusatoire de la procédure est que le procès étant véritablement l’affaire des parties, si le juge veut soulever des moyens ou conclusions d’office, il doit leur laisser le temps de préparer leur défense. Au Canada, les choses sont encore plus simples puisque le juge se voit tout bonnement interdire de statuer ultra petita. Dans ce dernier cas, l’office du juge s’efface presque complètement derrière la volonté des parties à qui il appartient de tracer seules les contours du litige constitutionnel. Sur cette deuxième partie du rapport général, il est permis d’affirmer que l’accès au juge constitutionnel constitue un chemin sûr. En effet, après la définition et la garantie des droits fondamentaux et des libertés publiques par les différentes constitutions, le juge constitutionnel représente l’instrument incontournable par lequel le requérant met en œuvre la défense effective des
droits et libertés ainsi définis.
Pour finir, il faut encore souligner que ce deuxième Congrès de l’Association prouve une fois de plus combien il est utile de confronter nos expériences à propos d’une question transversale de droit constitutionnel. Cette démarche, qui constitue véritablement du droit comparé, et non simplement du droit juxtaposé comme à l’accoutumé dans ce type de manifestation scientifique, permet de faire émerger des concepts communs. Surtout, elle nourrit notre réflexion à tous sur les voies et moyens de faire progresser encore davantage l’État de droit dans nos pays.
Si l’on ne devait tirer qu’un seul enseignement de cette rencontre, l’on pourrait dire qu’elle a montré qu’en même temps qu’il faut ouvrir davantage les portes des Cours constitutionnelles, il faut aussi faire rimer plus d’accès avec un meilleur accès.
À nous de faire en sorte que le chemin qui mène au juge constitutionnel demeure une voie royale.
-
[1]
Voir ci-dessous les débats p. 709. [Retour au contenu] -
[2]
Voir ci-dessous les débats p. 708. [Retour au contenu]
Débats
M. Bulai, président de séance, Cour constitutionnelle de Roumanie : Je vous remercie Madame Louise Angué pour votre rapport qui contient beaucoup de réflexions sur des questions soulevées dans nos débats jusqu’ici. Il contient également des questions nouvelles et notamment certaines propositions.
M. Onida, Cour constitutionnelle d’Italie : Avant tout je voudrais remercier Madame la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon pour son invitation à participer à ce congrès en qualité d’observateur, et aussi remercier Monsieur le président de séance pour me permettre de prendre la parole. Bien que la Cour italienne ne soit pas membre de l’ACCPUF, nous entretenons des relations étroites avec le Conseil constitutionnel français et avec bien d’autres Cours associées, notamment avec la Cour constitutionnelle du Gabon, dont nous avons eu l’honneur de recevoir, à Rome, il y a quelques mois, Madame la présidente et quelques uns de ses collègues.
J’ai suivi avec attention et beaucoup d’intérêt les rapports et les interventions. À l’issue d’une vision superficielle, il pourrait apparaître qu’il y a trop de difficultés à comparer un si grand nombre d’expériences et de systèmes différents : Cour constitutionnelle séparée de l’ordre judiciaire ou Cour suprême unique ; contrôle de constitutionnalité diffus ou concentré, a priori ou a posteriori, abstrait ou concret ; systèmes d’accès à la Cour très différents ; etc. Sur ce point, je dirais que la Cour italienne appartient à la famille des Cours constitutionnelles, les plus nombreuses en Europe, qui sont séparées de l’ordre judiciaire et sont chargées d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori, sans limites de temps. La Cour exerce son contrôle essentiellement par voie d’exception. Cependant, il n’est pas prévu de recours individuel direct devant la Cour pour violation des droits fondamentaux.
Toutefois, au-delà des différences, il y a des problèmes communs à la justice constitutionnelle dans tous les pays, puisque les objectifs de la justice constitutionnelle sont universels : le respect de la Constitution et la protection des droits fondamentaux. C’est pourquoi j’espère et je souhaite que l’ACCPUF soit un instrument de développement des relations entre Cours Constitutionnelles même au delà du domaine de la francophonie.
Les différences entre les expériences constitutionnelles s’expliquent en général par l’histoire. Ainsi, le problème de la justice constitutionnelle en tant que telle ne se pose même pas dans les pays, comme les États-Unis, où l’on a reconnu dès le début que la loi ordinaire est soumise à la Constitution et donc que les juges (chaque juge) ont le pouvoir, voire le devoir de l’écarter lorsqu’il s’agit d’une loi inconstitutionnelle.
En Europe était dominante l’idée que, le juge étant soumis à la loi, il ne pouvait la contester. C’est pourquoi ont été créées les Cours constitutionnelles chargées du contrôle de constitutionnalité des lois que les juges ordinaires ne pouvaient pas effectuer. Dans les pays où l’idée de l’incontestabilité de la loi a été dans une certaine mesure maintenue, comme c’est la cas de la France, on a admis seulement le contrôle de constitutionnalité a priori, avec la conséquence que la loi, une fois promulguée, reste inattaquable, bien que désormais même en France cette idée soit fortement affaiblie à partir du moment où l’on a reconnu la supériorité sur la loi, des traités internationaux et de la convention européenne des droits de l’homme, donc de textes normatifs paraconstitutionnels.
Par contre, là où l’idée de l’inconstitutionnalité de la loi a été abandonnée, on a en général admis le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois. Mais, il ne s’agit pas seulement d’éviter que ne soient promulguées ou que ne soient appliquées des lois inconstitutionnelles. Il s’agit aussi, pour ainsi dire, de faire circuler le « sang » de la Constitution dans le système juridique. Cela se fait aussi par l’interprétation conforme à la Constitution et ceci est la tâche de chaque juge.
Donc on peut dire que la garantie de la Constitution n’est pas confiée seulement à la Cour constitutionnelle, mais aussi aux juges ordinaires. Toutefois, la Cour constitutionnelle peut remplir un rôle essentiel même dans le domaine de l’interprétation, à travers l’autorité des interprétations conformes et en rappelant aux juges leur devoir d’interpréter la loi conformément à la Constitution. Pour ce qui est de la Cour italienne, on peut relever que nombre de décisions rejettent la question de constitutionnalité soulevée, mais sur la base d’une interprétation de la loi différente de celle adoptée par le juge qui l’a soulevée.
Enfin, je voudrais signaler l’importance croissante du problème de la protection concrète des droits fondamentaux. Lorsque la violation de ces droits est causée par la loi elle-même ou par son application obligatoire, le remède est le contrôle de constitutionnalité de la loi. Mais que dire lorsque la violation est causée par une mauvaise interprétation ou application des lois, ou par un défaut de fonctionnement d’une autorité publique ? En principe, la réponse traditionnelle à ce problème, en Europe, est que la solution se trouve dans le système juridictionnel à condition que soit garanti à tous le droit d’action judiciaire et qu’il y ait toujours un juge qui puisse être saisi.
Mais il peut arriver que cela ne soit pas suffisant. La violation du droit fondamental peut être causée par la décision du juge ou par la procédure juridictionnelle elle-même : par exemple, en cas de manque d’indépendance ou d’impartialité du juge, ou de violation du droit à la défense. Dans ce sens-ci une garantie ultérieure est donnée aux citoyens par les systèmes où est prévu le recours individuel direct à la Cour constitutionnelle pour violation des droits fondamentaux, causée par n’importe quel acte d’une autorité publique, à la seule condition d’avoir épuisé les voies de recours ordinaires (comme c’est le cas de l’Allemagne ou de l’Espagne). En Italie, comme je l’ai dit, un tel recours n’est pas prévu bien que parfois les exceptions de constitutionnalité cachent la tentative de provoquer l’intervention de la Cour constitutionnelle pour protéger dans le cas concret le droit fondamental violé ou menacé.
En général, l’objection que l’on oppose au système du recours individuel c’est que l’on risque d’avoir trop de recours et que la Cour ne serait pas à même de les examiner. Il peut être nécessaire, donc, d’envisager des filtres : ce qui est un réel problème pratique, mais qui ne peut pas, à mon avis, empêcher la recherche d’un système toujours plus efficace de protection juridictionnelle des droits fondamentaux.
M. Vandernoot, conseiller d’État, référendaire honoraire à la Cour d’arbitrage de Belgique : Il est hors de question dans mon chef de répliquer aux conclusions. Ce serait tout à fait hors de propos et d’autant moins opportun que le rapport général est vraiment excellent.
Je voudrais simplement apporter ma petite pierre à l’édifice en vous suggérant, peut-être, de lever ce qui me paraît constituer une légère contradiction interne dans le rapport. À la fin de la page 12 [I-A. c)] [p. 693 du présent volume], à propos du contrôle a priori, il est relevé à juste titre que ce contrôle présente bien des avantages, notamment en termes de sécurité juridique, puisqu’il permet de purger rapidement et définitivement l’ordre juridique de textes contraires à la Constitution. Or au haut de la page 18 [p. 695 du présent volume], il est fait état d’un reproche formulé à l’égard du contrôle a priori. Il est écrit ceci : « en effet le principal reproche formulé contre un contrôle exercé exclusivement a priori consiste à soutenir qu’il laisserait subsister des normes potentiellement inconstitutionnelles dans l’ordre juridique ». Je pense que ce reproche a un certain fondement.
Alors, pour lever cette incohérence et pour souligner les mérites attachés au contrôle a priori, je suggère de modifier très légèrement une ligne de la fin de la page 12 [I-A. c)] [p. 693 du présent volume], et le texte serait le suivant : « il s’agit certes d’une donnée inhérente au contrôle a priori qui présente bien des avantages, notamment en termes de sécurité juridique ». Mais la suite serait rédigée de la manière suivante : « puisqu’elle crée les conditions permettant autant que possible de purger rapidement l’ordre juridique de textes contraires à la Constitution ». En réalité, mon amendement vise à faire sauter, vous l’aurez compris, le mot « et définitivement », parce que le contrôle a priori n’écarte pas, malheureusement, l’hypothèse où la juridiction n’aurait pas aperçu, pour une raison ou pour une autre, un vice de constitutionnalité qui pourrait apparaître ultérieurement.
M. Guéna, Conseil constitutionnel français : Je tenais à revenir sur le dernier paragraphe de la page 13 du rapport général [I-A. c)] [p. 693 du présent volume] qui semble dire que le président de la République française se serait hâté un jour de promulguer une loi pour éviter qu’il puisse y avoir un recours devant le Conseil constitutionnel. Il est vrai que cela pourrait arriver, mais alors ce ne serait plus la République française.
En effet, lorsqu’une loi est votée, le service juridique du Conseil constitutionnel prend la précaution de s’adresser à l’Assemblée nationale et au Sénat pour savoir si l’on a l’intention de faire un recours et ces informations sont transmises au premier ministre qui présente le décret de promulgation, et au président de la République qui promulguera. Dans ce cas-là, lorsque nous savons qu’il doit y avoir un recours, ce qui n’est pas toujours le cas, il est bien évident que le président de la République ne prendrait pas sur lui de promulguer avant que le Conseil ne se soit prononcé. Or dans le cas d’espèce que je connais particulièrement bien, tous les groupes parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat ont répondu à notre service juridique qu’ils n’avaient pas l’intention de présenter un recours. Et le Premier ministre et le président de la République en ont été avisés. De ce fait, le processus de promulgation est entré en marche. Or, au moment où le décret de promulgation qui est fait par le Premier ministre allait être soumis au président de la République, c’est-à-dire à un moment où l’on ne peut plus revenir en arrière, des requérants ont déposé la requête devant le Conseil constitutionnel. Il n’y a eu aucun incident. Le président de la République a promulgué. Les requérants ont parfaitement compris qu’ils s’y étaient pris trop tard et qu’ils nous avaient donné des informations inexactes au départ. Et, la preuve qu’il n’y a eu aucune manœuvre, laquelle aurait été, je le répète, condamnable, c’est que cela s’est passé en période de cohabitation où le Premier ministre était Monsieur Jospin et le président de la République, Monsieur Chirac. Donc je décline toute responsabilité du Conseil constitutionnel, du Premier ministre et du président de la République dans le fait que la loi ait été promulguée alors qu’arrivait au Conseil constitutionnel la requête des saisissants.
Mme Angué, rapporteur, Cour constitutionnelle du Gabon : Je voudrais juste apporter une précision à ce sujet à l’intention de Monsieur le président Guéna. Ce que le rapporteur a voulu démontrer, c’est qu’il n’y a pas de texte qui interdise au président de la République de promulguer à n’importe quel moment pendant le délai qui lui a été donné pour promulguer. C’est cette idée que le rapporteur général a voulu transcrire.
M. Bulai, président de séance, Cour constitutionnelle de Roumanie : Pour parler de l’expérience roumaine, la loi prévoit en Roumanie que après l’adoption de la loi, celle-ci reste au Parlement pendant cinq jours, même si elle est adoptée définitivement. Dans ce délai-là, les députés ont la possibilité de l’étudier de près, pour avoir la possibilité de s’exprimer en connaissance de cause sur une éventuelle objection d’inconstitutionnalité. Bien sûr pendant ce délai de cinq jours, dans lequel encore une fois la loi reste au Parlement, le texte n’est pas envoyé au président pour promulgation. Il reste à la disposition des députés qui l’ont déjà voté, mais qui peuvent l’étudier encore une fois.
Donc, aucune interdiction n’est faite au président de promulguer la loi. Même après ce délai de cinq jours, il reste encore un délai pour motiver l’objection d’inconstitutionnalité, parce que nous avons l’obligation de vérifier la légalité de la saisine. Donc cela suppose une rédaction attentive des objections d’inconstitutionnalité. Le problème, en quelque sorte, reste donc à résoudre.
M. Berger-Perrin, Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune : Je veux tout d’abord adresser mes remerciements de tout cœur à l’ACCPUF d’avoir invité à travers ma modeste personne le barreau francophone et donc les avocats francophones. Je pense que de tels échanges sont sources d’enrichissements réciproques. Je voulais aussi remercier la Cour constitutionnelle du Gabon pour la gentillesse et la qualité de son accueil, bien conforme à la traditionnelle hospitalité africaine.
Sur le fond, on nous a remis ce matin un document en même temps que le rapport général qui constitue, si j’ai bien compris, le questionnaire qui a servi de support intellectuel aux rapports nationaux qui nous ont été distribués. Ce questionnaire se termine de la manière suivante : « Assiste-t-on à une professionnalisation des requêtes et ou des requérants ? Si oui, en quoi ? Et si elles n’étaient pas prévues à l’origine, l’intervention et la présence d’avocats ont-elles modifié le procès ? Si oui, en quoi ? »
Je n’ai pas entendu de réponse à ces questions. En outre, lorsque l’on a évoqué le rôle de l’avocat, ce fut à deux reprises. La première, pour évoquer le coût de l’intervention de l’avocat et dire que le fait que son intervention ne soit pas obligatoire rendra ainsi le recours devant une Cour constitutionnelle moins onéreux. La seconde fois pour souligner que les avocats étaient bavards et qu’il fallait parfois prévoir des règlements limitant leur temps de parole. Je trouve cette image un peu réductrice. Et si elle est parfois conforme à ce que l’on entend dans certaines enceintes, je pense que dans une assemblée de cette qualité, bien évidemment, il ne s’agit pas là de la conception que l’on a de la défense. Je rappelais hier qu’il n’y avait pas de procès équitable sans magistrats indépendants, cela a été utilement développé ce matin. Je rappelais également qu’il ne pouvait pas y avoir de défense libre sans l’intervention d’avocats professionnels, expérimentés et spécialisés.
Je crois donc qu’il faut que, d’une manière ou d’une autre, le rôle de l’avocat soit valorisé dans la conclusion de vos travaux. Il s’agit là d’un droit fondamental de tout individu que vous êtes donc chargés de protéger. L’assistance pour des personnes qui, quoi qu’on en dise, peuvent ne pas connaître la loi est quelque chose d’absolument indispensable. Voilà ce que je voulais souligner en remerciant encore une fois l’ACCPUF de m’avoir donné l’occasion de faire entendre ma parole d’avocat dans cette enceinte de hauts juristes et de hauts magistrats.
M. Benjelloun, Conseil constitutionnel du Maroc : Je voudrais intervenir à propos de l’assistance de l’avocat. Il n’y a pas de vraie justice sans magistrat indépendant, mais si l’on ajoute qu’il n’y a pas de justice sans l’assistance d’avocats, on risque d’aller très loin. Cela voudrait dire, si l’expression est retenue comme telle, que le recours à l’avocat est obligatoire. À ce momentlà, on réduira la liberté. Je pense à ce que mon collègue suggère : que l’on écrive noir sur blanc que le requérant a le choix soit de se défendre lui-même, soit de se défendre par un représentant ou de recourir à un avocat.
M. Berger-Perrin, Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune : Je ne veux pas engager un débat mais simplement dire que dès lors que l’assistance par un avocat est un droit fondamental, il faut que les États donnent des moyens à l’individu pour, le cas échéant, se faire assister par un avocat s’il le souhaite.
Mme Angué, rapporteur, Cour constitutionnelle du Gabon : Je voudrais apaiser un peu les inquiétudes de Maître Berger-Perrin. Je n’ai pas donné lecture intégralement du rapport général. J’ai juste fait ressortir les points essentiels, mais lorsque j’ai parlé de la question de l’avocat, et du coût du procès constitutionnel, je pense qu’il est indiqué quelque part que cela n’empêche pas le ministère d’avocat. Mais le recours à un avocat n’est pas obligatoire quand bien même il est possible. À partir du moment où il est possible, il est permis. Chaque partie, selon ses moyens, à ce moment-là, a la possibilité de recourir à l’assistance d’un avocat. Cela est prévu.
M. Gonthier, Cour suprême du Canada : Dans le même ordre d’idée, j’étais un peu mal à l’aise en lisant à la page 18 [I-B. b)] [p. 696 du présent volume] « la barrière de l’argent n’entrave donc pas l’accès au juge constitutionnel », même si certaines juridictions prévoient l’existence de frais d’enregistrement ou le versement de cautions. Je suis tout à fait d’accord sur le fait que les frais de Cour, c’est-à-dire les frais versés au tribunal, ne sont pas une difficulté. Là où se situe la difficulté, c’est au niveau du coût pour présenter la cause. Selon notre expérience dans les affaires constitutionnelles, le rôle de l’avocat est primordial dans la présentation et dans la recherche des arguments qui peuvent intéresser le tribunal. Et il y a une question de coût qui n’est peut-être pas obligatoire, au niveau légal, mais qui est incontournable en pratique.
Nous avons parlé de l’égalité des armes. L’État, lui, est normalement armé. Il a ses avocats et il a ses experts. L’individu qui se représente seul généralement ne le sera pas. Alors si l’on parle d’égalité d’armes, je pense que dans les faits, il faut une certaine égalité de compétence entre la représentation des parties devant le tribunal. Comme Maître Berger-Perrin y a fait allusion, il est également possible que l’État insiste pour assurer cette égalité. Dans le cas du Canada, le gouvernement fédéral a un programme d’aide au justiciable qui conteste la constitutionnalité de loi [1].
Mon inquiétude est donc qu’à la page 18, cette phrase lue seule et hors contexte peut laisser penser que l’accès au juge constitutionnel est facilement ouvert à tous. Cela ne correspond pas à notre expérience.
Je crois qu’il y aurait lieu de, à mon sens, souligner cet aspect de l’égalité des armes, c’est-à-dire de la qualité dans la représentation des intérêts ou des parties en présence. Je n’ai pas de modification précise à suggérer, mais c’est le sens de la précision à apporter à cet endroit-là ou ailleurs dans le rapport.
Mme Ouinsou, Cour constitutionnelle du Bénin : Je remercie le rapporteur général pour la clarté et la qualité de son exposé. Il y a une petite observation à faire à la page 11 [p. 693 du présent volume]. Il y a une proposition, plutôt un jugement de valeur qui est porté. Je n’ai pas le souvenir que l’assemblée générale l’ait adopté. Donc, il serait bien de poser la question à l’assistance pour que tout un chacun se prononce et qu’on l’adopte. Il s’agit de l’auto-saisine.
M. Lô, Conseil constitutionnel du Sénégal : Mon intervention se situe dans la suite de celle de Monsieur Berger-Perrin et de celle du représentant du Canada sur la nécessaire présence d’un avocat dans la procédure. En matière criminelle, il y a les commissions d’office qui sont faites au profit des accusés qui, devant la complexité des problèmes qui sont soulevés devant les Cours d’assises, ne pourraient pas se défendre et sauver leur tête. S’ils n’ont pas les moyens de constituer un avocat, on n’a qu’à en commettre un d’office. C’est l’État qui commet d’office.
D’autre part, il y a la pratique de l’assistance judiciaire qui consiste à mettre des fonds à la disposition des barreaux pour assister les prévenus ou les accusés qui n’ont pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat.
Je ne vois pas pourquoi un procès constitutionnel, qui est infiniment plus complexe qu’un procès ordinaire, ne pourrait pas entraîner le bénéfice de telles dispositions au profit des individus qui pourraient, devant ces Cours constitutionnelles défendre leurs droits qui sont atteints par des dispositions légales.
Ce problème mérite réflexion. On ne doit pas l’écarter, parce qu’il est rare qu’un individu se présente devant une Cour constitutionnelle pour faire valoir ses droits. La voie la plus usitée est la voie de l’exception et le procès est alors déjà préparé par les différents tribunaux qui ont eu à connaître du problème juridique. Mais le problème se pose, parce que comme on l’a dit, on revient un peu à ce que Monsieur Abadie suggérait, il y a ici le dédoublement de deux procès. Il y a certes un procès qui est fait à la loi, donc presque à l’ordre public. Mais comme cela conditionne la solution d’un droit individuel, je pense qu’il ne devrait pas y avoir la possibilité de refuser la présence d’un avocat. On devrait même rendre cette présence obligatoire, compte tenu de la complexité des problèmes qui sont posés devant les hautes juridictions et donc envisager la mise en place d’une assistance judiciaire.
Je pense que cela mérite réflexion et la suggestion pourrait être faite aux constituants pour qu’on prévoit, en fait, un système qui serait mis en place pour assister ceux qui voudraient saisir les Cours constitutionnelles pour la défense de leurs droits individuels bafoués.
M. Guéna, Conseil constitutionnel français : La question qui est reprise par notre collègue du Sénégal – après l’intervention du représentant des barreaux francophones est une affaire très importante. Si j’interviens sur ce point, c’est parce que nous, Français, nous sommes dans un système de contrôle a priori et que jusqu’à nouvel ordre, y étant, nous entendons y demeurer. Et nous sommes – quand nous sommes saisis – saisis de façon objective, sur un objet dont il nous est demandé s’il est conforme aux normes constitutionnelles. Jusqu’à présent, nous savons très bien que nombre de parlementaires s’adressent à des avocats, pour rédiger les mémoires qui nous sont envoyés. Mais nous ne sommes pas disposés à franchir le pas en considérant cela obligatoire, en tout cas dans le contrôle a priori. Quant au contrôle a posteriori, je préfèrerais que l’on réserve également la solution de ce problème. Nous ne sommes pas disposés à écrire qu’il est souhaitable qu’il y ait ministère d’avocat pour présenter et soutenir la requête.
M. Lô, Conseil constitutionnel du Sénégal : Je ne veux pas qu’il y ait de confusion dans mon intervention. Ce matin, quand nous avons présidé la séance consacrée au procès équitable, nous avons dit il faut situer le moment du procès. Et nous avons considéré que le contrôle a priori n’est pas un contrôle à proprement juridictionnel. C’est le prolongement de l’activité législative, qui se situe au niveau du Conseil constitutionnel, qui va donner son imprimatur, après l’examen de conformité avec la Constitution de la loi. Donc à ce niveau-là, le problème ne se pose pas. Et j’avais demandé qu’on évacue cet aspect du contrôle a priori de nos débats.
En revanche, la question se pose devant les Cours qui acceptent le contrôle a posteriori et qui permettent à des individus dont les droits sont violés de saisir directement ces Cours. Il y a un certain nombre de pays qui ont, en quelque sorte, fait des avancées en ce sens-là. Cela ne concerne que ces pays-là. Cela ne concerne pas la France qui n’accepte pas, en fait, de contrôle juridictionnel a priori comme a posteriori.
M. Guéna, Conseil constitutionnel français : Je suis tout à fait d’accord sur la question du contrôle a priori, mais je ne voudrais pas qu’il y ait d’équivoque en quoi que ce soit. Et même sur le problème de l’intervention obligatoire – employons ce mot – d’un avocat lors du contrôle a priori, je crois que le sujet est trop important pour qu’il soit improvisé.
M. Bulai, président de séance, Cour constitutionnelle de Roumanie : Nous pourrons en faire l’objet de notre prochain congrès.
M. Melchior, Cour d’arbitrage de Belgique : Je souhaitais faire une remarque – un projet de suggestion de modification de texte. Quand à la page 14 [I-B. b)] [p. 695 du présent volume] on oppose le contrôle a priori et le contrôle a posteriori, l’impression se dégage du rapport qu’il n’existerait qu’un seul contrôle a posteriori, celui de l’exception d’inconstitutionnalité et de la question préjudicielle. Or cela n’est pas vrai.
Certains États – ils ne sont pas nombreux, mais il y a au moins le Bénin et la Belgique – connaissent le recours en annulation. Donc après la publication de la loi, quand la loi éventuellement est entrée en vigueur, il est possible d’attaquer la loi par un recours direct en annulation. Ceci demanderait, je crois, à être inséré dans le rapport.
Ceci m’amène à évoquer le problème de l’avocat. Je crois que l’usage, l’intérêt d’un avocat est évident, mais qu’il n’est certainement pas souhaitable et qu’il est même peu recommandé de prévoir que, dans le contrôle a posteriori, l’intervention d’un avocat soit obligatoire. C’est en effet une obligation qui est de nature à entraver l’accès à la juridiction. Pour la Convention européenne des droits de l’homme, par exemple, la proposition avait été faite en 1950 d’inscrire la nécessité de recourir à un avocat ; cette obligation n’a pas été retenue justement pour ne pas entraver l’accès au juge. Mais il est clair naturellement que parfois le requérant individuel n’a pas beaucoup de moyens ou bien se débrouille relativement mal. Mais il y a des requérants individuels chez nous, des recours en annulation, développés par des individus – et même parfois par des étudiants d’ailleurs – qui ont abouti à une annulation sans qu’il y ait eu avocat. D’autre part, notre loi prévoit que si la Cour estime que la complexité de l’affaire, dans le cas d’un recours particulier, demande l’intervention d’un avocat, la Cour peut ordonner qu’il y ait recours à un avocat.
Enfin le système de l’assistance judiciaire est appliqué également pour les recours en annulation ou bien les questions préjudicielles devant la Cour d’arbitrage.
Mme Mborantsuo, Cour constitutionnelle du Gabon : Mesdames, Messieurs les congressistes, chers collègues, Mesdames, Messieurs les observateurs, notamment les professeurs de droit, les représentants de la Cour européenne, le représentant de la Commission africaine des droits de l’homme, le représentant du réseau africain des constitutionnalistes, avant de vous inviter à rejoindre la salle d’apparat pour la cérémonie solennelle de clôture de nos assises, je voudrais tout d’abord remercier sincèrement les observateurs, tous ceux qui ont bien voulu se joindre à nous, membres de l’ACCPUF, pour nous apporter aussi leurs réflexions et ainsi enrichir les débats qui ont porté successivement sur le droit au recours, sur la recevabilité des requêtes et sur le procès équitable.
À vous, congressistes, je sais que beaucoup d’entre vous sont venus de très loin. Je pense ainsi à ceux qui viennent de l’île Maurice, ceux qui viennent du Cambodge et bien d’autres. Le trajet était très long et certains d’entre vous n’ont pas jusqu’à ce jour retrouvé leurs bagages !
Je voudrais vous remercier sincèrement de la participation active à ces travaux. Les interventions des uns et des autres ont été très fructueuses, très utiles. Et j’ose espérer que les remarques que vous avez faites seront utilement exploitées et seront intégrées dans les différents rapports de synthèse, ainsi que dans le rapport général dont notre collègue, Madame Angué, vient de vous en donner lecture. Merci.
-
[1]
Voir ci-dessous l’annexe p. 749. [Retour au contenu]
IV. Annexes
Annexe 1 : documents venant au soutien des rapports et débats
Le désistement de la saisine de requérants à un procès constitutionnel
n° 11-93 du 23 juin 1993
Le conseil constitutionnel
En sa séance du 23 juin 1993, statuant en matière constitutionnelle, conformément à l’article 82 (alinéa premier) de la Constitution et à l’article premier de la Loi n° 92-23 du 30 mai 1992 portant Loi organique sur le Conseil constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit :
vu la Constitution, notamment en son article 82 alinéa premier ;
vu la Loi n° 92-23 du 30 mai 1992 portant Loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment en son article 20 [1] ;
vu la Loi n° 92-25 du 30 mai 1992 relative à la Cour de Cassation, notamment en son article 33 ;
vu les requêtes en rabat d’arrêt du 17 novembre 1992 de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation, d’ordre du Garde des Sceaux et du 22 novembre 1992 du Conseil de la compagnie multinationale Air Afrique ;
vu la requête en date du 28 décembre 1992 de maîtres Doudou Ndoye et Moustapha Ndoye, avocats à la Cour, invoquant l’inconstitutionnalité de l’article 33 alinéa 2 de la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 ;
vu l’arrêt n° 1 du 19 février 1993 rendu par la Cour de Cassation, toutes chambres réunies ;
vu la lettre n° 245 du 3 juin 1993 du greffier en chef de la Cour de Cassation, enregistrée le même jour au Greffe du Conseil constitutionnel, sous le numéro 2/C/93 ;
Madame Marie-José Crespin ayant été entendue en son rapport ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
1. CONSIDÉRANT que par arrêt n° 1-C.C/C.R/92 du 19 février 1993, la Cour de Cassation, statuant toutes chambres réunies, a décidé :
de surseoir à statuer sur les requêtes en date des 17 et 22 novembre 1992 de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation, d’ordre du Garde des Sceaux et de la compagnie multinationale Air Afrique, représentée par Maître Rasseck Bourgi, Avocat à la Cour, aux fins de rabat de l’arrêt n° 34 du 11 avril 1990, rendu par la deuxième Section de la Cour suprême, statuant en matière sociale, dans le litige opposant la compagnie précitée à cinq de ses ex-agents ;
de saisir le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 33 alinéa 2 de la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 relative à la Cour de Cassation et soulevée par Maîtres Doudou Ndoye et Moustapha Ndoye, Avocats à la Cour représentant ces cinq ex-agents d’Air Afrique, défendeurs au recours en rabat d’arrêt.
Sur la recevabilité de la procédure engagée devant le Conseil constitutionnel :
2. CONSIDÉRANT, d’une part, que la présente saisine, faite par lettre n° 245 du 3 juin 1993 du greffier en chef de la Cour de Cassation, enregistrée le même jour au Greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 2/C/93, conformément à l’article 20 de la Loi organique n° 92-23, est régulière ;
3. CONSIDÉRANT, d’autre part, que la question préjudicielle est recevable, comme ayant été soulevée contre une Loi organique qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle de conformité à la Constitution, avant sa promulgation ; qu’elle est intervenue dans une période transitoire de réforme des institutions judiciaires, et ce, en application de l’article 6 de la Loi constitutionnelle n° 92-22 du 30 mai 1992 portant révision de la Constitution (J.O.S. n° 5469 du 1er juin 1992) ;
SUR LE MOYEN PRÉSENTÉ :
4. CONSIDÉRANT qu’en son article 33, la Loi organique critiquée dispose :
« Les décisions de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt. Celle-ci est présentée, de sa propre initiative ou sur instruction du ministre de la Justice par le Procureur général, ou déposée par les parties elles mêmes. La requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour de Cassation. »
« Cette voie de recours n’est applicable aux arrêts rendus par la Cour suprême dans les matières qui relèvent des compétences de la Cour de Cassation depuis l’entrée en vigueur de la présente Loi organique que si lesdits arrêts n’ont pas été entièrement exécutés à la date du pourvoi. »
« Les requêtes en rabat d’arrêt sont jugées en chambres réunies. Les magistrats ayant eu à se prononcer antérieurement dans l’affaire ne prennent pas part au délibéré. »
5. CONSIDÉRANT que les requérants invoquent l’inconstitutionnalité du 2e alinéa de cet article 33, en ce qu’il autorise la rétroactivité de nouvelle voie de recours « qui permet de reprendre des causes ayant acquis définitivement l’autorité de la chose jugée dans le cadre des lois et règlements en vigueur au moment où elles ont été jugées », et en la subordonnant à la non-exécution de l’arrêt déféré.
Sur le principe de la non-rétroactivité des lois :
6. CONSIDÉRANT qu’en instituant, par le vote de la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992, une nouvelle voie de recours qu’est le rabat d’arrêt, et en décidant de l’appliquer aux décisions de l’ancienne Cour suprême, le législateur a conféré à ladite loi un caractère rétroactif ;
7. CONSIDÉRANT que la règle de la non-rétroactivité des lois n’a de valeur constitutionnelle qu’en matière pénale, conformément aux articles 6 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 11.2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ; qu’en tout autre domaine, elle est un principe général du droit auquel la loi peut déroger ; qu’il s’ensuit que le législateur est en droit de donner un caractère rétroactif à une loi ;
8. CONSIDÉRANT, néanmoins, que la modification, l’abrogation d’une loi comme la rétroactivité d’une loi nouvelle, ne peuvent remettre en cause des situations existantes, que dans le respect des droits et libertés de valeur constitutionnelle ;
Qu’en effet, s’il appartient au législateur, sous réserve de l’application immédiate de la loi pénale plus douce, de déterminer la date d’entrée en vigueur d’une loi, le pouvoir qui lui est ainsi conféré n’est pas sans limites ;
Sur l’autorité de la chose jugée :
9. CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contestable qu’à la date de l’adoption de la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992, instituant la procédure de rabat d’arrêt, la décision déférée rendue par l’ancienne Cour suprême était devenue définitive du fait de l’épuisement des voies de recours et de l’expiration des délais de recours, prévus par les textes en vigueur au moment où elle a été rendue ; que dès lors elle était devenue irrévocable ;
10. CONSIDÉRANT que ladite Loi organique, en créant une nouvelle voie de recours et en la rendant applicable à une telle décision de justice, remet en cause les droits reconnus des justiciables et aboutit ainsi à les priver de garanties constitutionnelles ;
11. CONSIDÉRANT que cette atteinte à l’autorité de la chose jugée viole, en outre, le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et l’article 80 de la Constitution ainsi que par les conventions, les lois et coutumes en vigueur ;
Que le principe de la séparation de pouvoirs interdit aux pouvoirs législatif et exécutif d’empiéter sur le pouvoir judiciaire en censurant ou en anéantissant les décisions de justice passées en force de chose jugée, et en privant les citoyens des droits garantis par la Constitution ;
12. CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, le fait de limiter la procédure de rabat d’arrêt aux décisions rendues par l’ancienne Cour suprême et non entièrement exécutées à la date de la requête en rabat d’arrêt, est contraire aux principes de valeur constitutionnelle ;
Qu’en effet une telle restriction subordonne l’autorité de la chose jugée s’attachant aux arrêts de l’ancienne Cour suprême, à leur exécution ou à leur inexécution qui ne relève nullement du juge, mais des parties elles-mêmes ;
13. CONSIDÉRANT, surtout, que la mise en œuvre de la procédure de rabat d’arrêt de l’article 33 alinéa 2 par la Cour de Cassation entraînerait une inégalité non justifiée entre les justiciables, en ouvrant la nouvelle voie de recours à certains d’entre eux et pas à d’autres, selon qu’ils cherchent à remettre en cause une sentence non entièrement exécutée ou une sentence déjà exécutée, en violation du principe de l’égalité devant la loi et devant la justice, consacré par l’article 6 de la Déclaration de 1789, l’article 7 de la Déclaration de 1948, l’article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et les articles premier et 7 de la Constitution ;
14. CONSIDÉRANT, en conséquence, qu’en adoptant la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 créant la procédure de rabat d’arrêt et dont l’article 33 alinéa 2 étend l’application aux arrêts de la Cour suprême qui n’ont pas été entièrement exécutés à la date de pourvoi (en réalité de la requête en rabat d’arrêt), bien qu’ils soient passés en force de chose jugée, le législateur a outrepassé ses compétences et empiété sur les prérogatives du pouvoir judiciaire, en violation de principes à valeur constitutionnelle, sans qu’en aucun cas, celle violation puisse être justifiée par la sauvegarde d’un intérêt général ou de l’ordre public ;
DÉCIDE
Article premier L’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant la Cour de Cassation et relative au rabat de l’arrêt n° 34 du 11 avril 1992 de la Cour suprême est recevable ;
Article 2 – L’alinéa 2 de l’article 33 de la Loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992, sur la Cour de Cassation, n’est pas conforme à la Constitution ;
Article 3 – Il ne peut plus être fait application de cette disposition conformément à l’article 20 de la Loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel ;
Article 4 – La présente décision sera notifiée au président de la République, au président de l’Assemblée nationale et aux auteurs du recours ;
Article 5 – La présente décision sera publiée au Journal officiel du Sénégal.
Délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 23 juin 1993 à laquelle siégeaient :
Monsieur Youssoupha Ndiaye, président ; Madame Marie-José Crespin, Membre – rapporteur ;
Monsieur Amadou SO, Membre ; Monsieur Ibou Diaite, Membre.
Avec l’assistance de Maître Doudou Salmone Fall, greffier en chef.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président, les autres membres du Conseil et le greffier en chef.
Extraits de la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 du Conseil constitutionnel français
Loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 novembre 1999, par MM. […] députés, dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution de la conformité à celle-ci de la loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant Loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par les députés saisissants enregistré le 30 novembre 1999 ;
Vu les observations du gouvernement enregistrées le 8 décembre 1999 ;
Vu la lettre de Monsieur Pierre Albertini, député, enregistrée le 9 décembre 1999 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes en mettant en cause sa conformité à la Constitution ;
Considérant qu’un député a, par lettre adressée au Conseil constitutionnel, demandé à ne pas être compté parmi les signataires de la saisine, en invoquant « la confusion qui a accompagné la signature de cette saisine » ;
Considérant qu’en vertu de l’article 61 de la Constitution et de l’article 18 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, la saisine du Conseil constitutionnel par les membres du Parlement résulte indivisiblement d’une ou plusieurs lettres signées par au moins soixante députés ou soixante sénateurs ; que l’effet de cette saisine est de mettre en œuvre, avant la clôture de la procédure législative, la vérification par le Conseil constitutionnel des dispositions de la loi déférée ; qu’aucune disposition de la Constitution non plus que de la Loi organique relative au Conseil constitutionnel ne permet aux autorités ou parlementaires habilités à déférer une loi au Conseil constitutionnel de le dessaisir en faisant obstacle à la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité engagé ; que dès lors, hormis les cas d’erreur matérielle, de fraude ou de vice du consentement, le Conseil constitutionnel ne saurait prendre en compte des demandes exprimées en ce sens ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le consentement du député concerné ait été vicié ou que celui-ci ait commis une erreur matérielle en saisissant le Conseil constitutionnel ; que la signature manuscrite apposée sur la saisine a pu être authentifiée ; qu’il y a lieu, par suite, de le faire figurer au nombre des signataires de la saisine ;
[…]
DÉCIDE
Article premier. – Est déclarée conforme à la Constitution la loi portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes.
Article 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1999, présidée par M. Yves Guéna et où siégeaient : MM. Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
Extraits de la décision n° 2-95 du 25 février 1995 du Conseil constitutionnel du Liban
Objet du recours : Annulation de la Loi n° 406 du 12-1-1995, publiée au n° 4 du Journal officiel du 26 janvier 1995.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Réuni le 25 février 1995, sous la présidence de M. Wajdi Mallat, en présence de tous ses membres, Messieurs Jawad Osseyrane, Adib Allam, Kamel Raydane, Michel Turkieh, Pierre Gannagé, Salim el-Azar, Mohammed el– Majzoub, Antoine Khair et Khaled Kabbani
Ayant pris connaissance du dossier et des pièces qui accompagnent le recours présenté, ainsi que des conclusions du conseiller rapporteur déposées en date du 18 février 1995, Attendu que le recours présenté a été inscrit au Greffe du Conseil le 6 février 1995 et vise à faire déclarer non conforme à la Constitution la Loi n° 406 du 12 janvier 1995, publiée au n° 4 du Journal officiel du 26 janvier 1995, qui modifie certaines dispositions de la Loi du 16 juillet 1962 relative à l’organisation des juridictions « charei », sunnite et chiite ; que les députés auteurs du recours ont demandé la suspension de l’application de cette loi et son annulation ; qu’à l’appui de leur demande, les requérants soutiennent d’abord que la Loi n° 406 du 12 janvier 1995 a été adoptée en violation des principes et des règles de procédure qui doivent être suivies pour la présentation et le vote des lois ; qu’elle est contraire ensuite au principe de la séparation des pouvoirs, clairement énoncé dans la Constitution ; qu’elle méconnaît enfin le paragraphe (h) du préambule de la Constitution, ainsi que les articles 20, 56 et l’alinéa 3 de l’article 65 de celle-ci ;
Attendu que postérieurement à la présentation de la demande, trois requêtes ont été présentées au Conseil par les députés Khodr Ali Tlaiss, Ibrahim Bayane et Mounir Hojjeiri, que le députés Tlaiss, dans sa requête soutient ne point reconnaître la signature telle qu’elle est apposée sur la demande déposée au Conseil ; que cette demande lui serait ainsi étrangère ; que de leur côté, les députés Bayane et Hoggeiri affirment que leur participation au recours provient d’une équivoque.
Attendu enfin que le Conseil a reçu une requête du député Ayman Shoucair en date du 11 février 1995, dans laquelle celui-ci déclare se joindre au recours présenté, tel qu’il a été formulé dans son objet et ses motifs ;
Vu ce qui précède
En la forme :
Considérant que les titulaires du recours devant le Conseil constitutionnel, limitativement énumérés à l’article 19 de la Constitution, quand ils demandent l’annulation d’une loi inconstitutionnelle, exercent une prérogative que la Constitution leur confère dans l’intérêt général, et qui se trouve ainsi dépourvu de tout caractère litigieux personnel ; qu’un tel recours issu d’un pouvoir constitutionnel, devient définitif à dater de son inscription auprès du Conseil constitutionnel, et ne peut être postérieurement rétracté ; qu’en conséquence, les requêtes subséquentes présentées au Conseil par les députés Ibrahim Bayane et Mounir Hoggeiri, visant au retrait du recours qu’ils avaient antérieurement déposé, ne sauraient être acceptées ;
que la demande du député Khodr Ali Tlaiss dans laquelle celui-ci déclare, d’une manière insuffisamment claire, ne point reconnaître la signature figurant sur la demande conjointe du recours, ne saurait avoir d’effet sur la validité de celui-ci ;
qu’il en est de même de la demande présentée postérieurement par le député Aymane Shoucair en date du 11 février 1995, seize jours après la parution de la Loi n° 406 au Journal officiel du 26 janvier 1995 ;
qu’en effet le nombre des dix députés exigé par la Constitution pour la validité du recours se trouve atteint indépendamment des requêtes postérieures des deux députés sus-mentionnés ; qu’en conséquence, le recours, tel que présenté initialement au Conseil constitutionnel, en date du 6 février 1995, l’a été dans le délai fixé par l’article 19 (dernier alinéa) de la Loi du 14 juillet 1993, et se trouve recevable en la forme.
[…]
Par ces motifs.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil constitutionnel, faisant suite à sa décision du 11 février 1995, décide à l’unanimité :
1. De recevoir le recours en la forme.
2. De déclarer irrecevables les demandes de retrait, survenues postérieurement à l’inscription du recours au Greffe du Conseil, pour les motifs ci-haut mentionnés.
3. D’annuler, parce que non conforme à la Constitution, la Loi n° 406 du 12 janvier 1995, publiée au Journal officiel le 26 janvier 1995, et ayant pour objet de modifier les dispositions relatives à l’organisation des juridictions « charei » sunnite et jaafarite.
4. De publier la présente décision au Journal officiel.
Décision rendue le 25 février 1995
Les membres : Khaled Kabbani, Antoine Khair, Salim el-Azar, Pierre Gannagé, Mohammed el-Majzoub, Michel Turkieh, Kamel Raydane, Adib Allam, Jawad Osseyrane.
Le président : Wajdi Mallat.
Extraits de la décision n° 126 du 6 décembre 1995 de la Cour constitutionnelle de Roumanie
Publiée au Journal officiel n° 51 du 13 mars 1996
Florin Bucur Vasilescu : président Viorel Mihai Ciobanu : juge Victor Dan Zla˘tescu : juge
Raul Petrescu : procureur
Doina Suliman : magistrat assistant
Sur le rôle, le prononcé sur l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de la Loi n° 5/1973 concernant le fonds locatif et la réglementation des rapports entre les propriétaires et les locataires, de l’arrêté du Conseil des ministres n° 860/1973 portant sur l’établissement des mesures de mise en pratique de la Loi n° 5/1973 et de la Loi de l’administration publique locale n° 69/1991, soulevée par les intimés M.L., C.E. et C.K dans le dossier n° 4018 /1993 du Tribunal Medias¸.
Les débats ont eu lieu en audience publique, le 29 novembre 1995, les conclusions des parties présentes et du représentant du Ministère public ont été consignées dans le jugement avant dire droit de la même date, lorsque la Cour, ayant besoin de temps pour délibérer, a renvoyé le prononcé au 6 décembre 1995.
La Cour,
vu les actes et les documents du dossier, constate ce qui suit :
Les requérants M.L. et M.F. ont traduit en justice les intimés M.L., C.E. et le Conseil local de la commune Târnava, demandant la résiliation du contrat de bail et l’évacuation,
l’affaire faisant l’objet du Dossier n° 4018/1993 du Tribunal Medias¸.
Par le Jugement avant dire droit n° 14 du 26 octobre 1994, le Tribunal Medias¸ a saisi la Cour constitutionnelle d’une exception d’inconstitutionnalité concernant les dispositions de la Loi n° 5/1973, de l’Arrêté du Conseil des ministres n° 860/1973 et de la Loi n° 69/1991, soulevée par les intimés M.L. C.E. et C.K. […]
La Cour,
vu le jugement avant dire droit de saisine, le point de vue du sénat et du gouvernement, le rapport concernant l’affaire dressé par le juge-rapporteur, l’argumentation des parties et du représentant du ministère public, les dispositions de la Loi n° 5/1973 et de l’arrêté du Conseil des ministres n° 860/1973, les dispositions de la Constitution et de la Loi n° 47/1992, constate ce qui suit :
[…]
Lors des débats, les intimés sont revenus sur l’exception d’inconstitutionnalité de la Loi n° 69/1991. Mais, conformément à l’article 26 alinéa 1er de son règlement d’organisation et de fonctionnement, une fois saisie, la Cour doit procéder à l’examen de la constitutionnalité du texte critiqué, les dispositions portant sur le sursis, l’interruption et l’extinction du procès n’étant pas applicables. Mais, on ne constate pas de dispositions inconstitutionnelles dans le texte de la Loi de l’administration publique locale n° 69/1991.
Vu les considérants exposés, en vertu de l’article 144 lettre c) de la Constitution, de même que de l’article 13 alinéa (1) lettre A c) de l’article 25 alinéa (1) et de l’article 26 de la Loi n° 47/1992,
La Cour, au nom de la loi, décide : l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de la Loi n° 5/1973 et de l’Arrêté du Conseil des Ministres n° 860/1973, soulevée par M.L. C.E. et C.K. dans le Dossier n° 4018/1993 du Tribunal Medias¸ est rejetée.
Recours dans un délai de 10 jours à partir de la communication.
Prononcée en audience publique, le 6 décembre 1995.
Président Maître de conférence,
dr. Florin Bucur Vasilescu
Extraits de la décision n° 73 du 4 juin 1996 de la Cour constitutionnelle de Roumanie
Publiée au Journal officiel n° 255 du 22 octobre 1996
Ioan Deleanu : président Antonie Iorgovan : juge Victor Dan Zla˘tescu : juge Raul Petrescu : procureur
Maria Bratu : magistrat assistant
Sur le rôle, le prononcé sur l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 330, de l’art. 330 1, de l’art. 330 2, de l’art. 3303 et de l’art. 3304 du Code de procédure civile, soulevée devant la section civile de la Cour suprême de Justice par : B.M., dans le dossier n° 2914/1995, A.E. et A.C. dans le dossier n° 3232/1995, G.R. et D.G., dans le dossier n° 3658/1995, de même que par B.V.D., dans le dossier n° 1925/1995.
[…]
La Cour,
vu les actes et les documents du dossier, constate ce qui suit :
Dans le Jugement avant dire droit du 23 novembre 1995, prononcé dans le dossier n° 2914/1995, la Cour Suprême de Justice, la Section civile, a décidé de saisir la Cour Constitutionnelle, afin de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 330, de l’art. 330 1, de l’art. 3302, de l’art. 3303 et de l’art. 3304 du Code de procédure civile.
Dans la motivation de l’exception il est soutenu que les dispositions de ces articles – introduites après l’adoption de la Constitution – sont contraires aux dispositions constitutionnelles de l’art. 16 et de l’art. 128. Il a été également soutenu que l’institution du recours en annulation, en faveur du Ministère public, sans délai, constituait une violation de l’art. 128 corroboré à l’art. 16 de la Constitution.
[…]
Dans le jugement avant dire droit du 2 février 1996, prononcé dans le dossier n° 3658/1995, c’est toujours la section civile de la Cour suprême de Justice qui saisit la Cour constitutionnelle de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 330, de l’art. 3301, de l’art. 3302, de l’art. 3303 et de l’art. 3304 du Code de procédure civile. Il est soutenu que les dispositions mentionnées sont contraires à l’article 16 alinéa (1) et à l’article 128 de la Constitution.
Mais l’instance judiciaire n’exprime pas son opinion sur l’exception soulevée.
Dans le jugement avant dire droit du 15 mars 1996, prononcé dans le dossier n° 1925/1995, la section civile de la Cour suprême de Justice a décidé de saisir la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 3301 du Code de procédure civile. Dans la motivation de l’exception il est soutenu que les principes prévus par l’article 128 de la Constitution sont violés, car le Ministère public a la possibilité de déposer recours, n’importe quand, contre les arrêts judiciaires irrévocables, ce qui génère une iniquité par rapport aux autres participants au procès civil.
[…]
La Cour,
après avoir examiné les jugements avant dire droit, le point de vue du gouvernement, les rapports du juge-rapporteur, les conclusions des parties et du procureur, de même que les dispositions de l’art. 330, de l’art. 3301, de l’art. 3302, de l’art. 3303 et de l’art. 3304 du Code de procédure civile, rapportés aux dispositions de la Constitution et de la Loi n° 47/1992, constate ce qui suit :
La Cour constitutionnelle a compétence pour statuer sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées en vertu des dispositions de l’art. 144 lettre c) de la Constitution et de l’art. 23 de la Loi n° 47/1992.
[…]
Par conséquent, de l’ensemble des jugements avant dire droit il résulte que l’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 330, de l’art. 3301, de l’art. 3302, de l’art. 3303 et de l’art. 3304 du Code de procédure civile a été soulevée.
Au cours des débats, les conclusions au fond ont renoncé aux exceptions d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 330, de l’art. 3303 et de l’art. 3304 du Code de procédure civile. Mais l’instance judiciaire ne peut pas prendre acte de ce renoncement. L’exception d’inconstitutionnalité est une exception d’ordre public, son invocation soulevant la contrariété de certaines dispositions légales avec les dispositions de la loi fondamentale, et la décision portant sur l’exception est d’intérêt général. Par conséquent, l’exception d’inconstitutionnalité n’est ni à la disposition de la partie qui l’a soulevée ni ne peut être retirée par l’instance judiciaire suite à renoncement exprès.
[…]
La Cour, au nom de la Loi, décide :
1. Admettre l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art 3302 alinéa 1er du Code de procédure pénale, soulevée par M.I., A.E., D.G. dans les dossiers n° 2914/1995, n° 3232/1995 et n° 3658/1995, sur le rôle de la Cour suprême de Justice.
2. Rejeter l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 3301 du Code de procédure civile soulevée par B.I., D.G., B.V.D. dans les dossiers n° 2914/1995, n° 3232/1995, n° 3658/1995 et n° 1925/1995 sur le rôle de la Cour suprême de Justice, allégant l’inconstitutionnalité des dispositions de l’art. 3301 du Code de procédure civile.
3. Constate que les dispositions de l’art. 330, de l’art. 3302 alinéa 2, de l’art. 330 3 et de l’art. 3304 du Code de procédure civile sont constitutionnelles.
Recours dans un délai de 10 jours à partir de la communication.
Prononcée en audience publique, le 4 juin 1996.
Président, Prof.univ.dr. Ioan Deleanu
-
[1]
L’article 20 de la Loi organique n° 92-23 sur le Conseil constitutionnel prévoit que : « Lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’État ou la Cour de Cassation est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et surseoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé. Le Conseil se prononce dans le délai de trois mois à compter de la date de la saisine.
Si le Conseil estime que la disposition dont il a été saisi n’est pas conforme à la Constitution, il ne peut plus en être fait application. » [Retour au contenu]
La représentation par ministère d’avocat d’un défendeur lui-même avocat
Privy Council Appeal n° 36 of 1997
D. Hurnam : Appellant
v.
S.S.V. Paratian : Respondent From
The Supreme Court of Mauritius [1]
Reasons for decision of the Lords of the judicial Committee of the Privy Council of the 17th December 1997.
Delivered the 29th January 1998
Present at the hearing :
Lord Lloyd of Berwick Lord Steyn
Lord Hope of Craighead Lord Saville
Mr. Justice Gault [Delivered by Lord Lloyd of Berwick]
The appellant, Mr. Dev Hurnam, is a barrister with chambers in Port Louis, Mauritius. He is the defendant in defamation proceedings brought against him by Mr. Siva Paratian, a Superintendent of Police with over 35 years’ service in the Mauritius Police Force. According to the statement of claim the defendant addressed a public meeting at Tombeau Bay on 6th September 1991 in the course of which he described the plaintiff as being a thief and as having taken bribes. The defence is justification and fair comment.
The case came on for hearing on 21st February 1995 before Forget J., the Senior Puisne Judge. He found in favour of the plaintiff, and awarded Rs. 250,000 damages. The defendant appealed. The first and main ground of appeal was that he did not receive a fair hearing at the trial in breach of his rights under the Constitution of Mauritius. For reasons which will appear later, it is unnecessary to refer to the other grounds of appeal. The Court of Civil Appeal upheld the judge’s decision. They dealt with the first ground of appeal in a single brief paragraph. With the leave of the Supreme Court of Mauritius the defendant was granted leave to appeal to the Privy Council. At the conclusion of that hearing their Lordships allowed the appeal and indicated that they would give their reasons later. Their Lordships’
reasons for their decision now follow.
Before their Lordships the defendant repeated the arguments which he had advanced below. The ground on which it is said that he did not receive a fair hearing is as follows. At the start of the trial the defendant sought leave to conduct his own defence. He had informed the judge of his intentions by letter dated 20th February 1995. Mr. Sauzier on behalf of the plaintiff objected. He submitted that it would be most improper for a barrister to conduct his own defence. The judge ruled as follows :
« The defendant, Mr. D. Hurnam is praying for leave to defend the statement of claim in his own proper person.
This is how I propose to deal with the matter. I think that Mr. Hurnam cannot wear two hats. He is allowed to appear as counsel for defendant Hurnam in which case he would take his seat normally as a barrister does ; he must be properly dressed but defendant D. Hurnam will disappear and make default. On the other hand, defendant
D. Hurnam, as a layman, is, I think, entitled to defend the statement of claim against him. He will then be acting as the defendant and represented by counsel (sic).
In the circumstances defendant D. Hurnam will not be allowed to take his seat in the Bench reserved for Counsel ; he will not be dressed up as a Counsel ; he will make no opening speech, he will offer no argument in law and he will make no submission in law and on facts but he will be authorised to cross-examine, to give evidence in his own name and call witnesses.
In my personal opinion, I find the situation rather unusual and rather embarrassing, but then I have to do it. »
Their Lordships will refer to this as the first ruling. There was then a short break, at the end of which the defendant indicated that he would conduct his own case in the light of the judge’s ruling. The plaintiff then gave evidence-in-chief. He and other witnesses were cross-examined by the defendant. At the close of the plaintiff’s case, the defendant gave evidence and called a number of witnesses. It was then for Mr. Sauzier to make his closing submission on behalf of the plaintiff. The defendant intervened. He sought leave to address the court at the end of Mr. Sauzier’s submission. Mr. Sauzier again objected. He said it would be most improper, and would go against the earlier ruling. « Only plaintiff’s counsel should be allowed to submit ».
The judge then gave a second ruling as follows :
« Since the question is cropping up now I may as well tackle it once and for all. Mr. Hurnam has intimated his wish to address the Court at the end of the day now that all the witnesses have been examined and cross-examined. Mr. Hurnam has drawn my attention to Section 12 of the Courts Act which indeed lays down that any party to proceedings may address the Court with leave of the Court.
My reading of Section 12 is that in certain circumstances when a party to proceedings is represented by Counsel or even when he is not represented by Counsel certain matters may have to be elucidated and the Court may very well call upon the party to say certain things to take a certain stand but to my mind Section 12 does not open the door to a party at the end of the day when he is not represented by Counsel but where he has been allowed to defend in his own name to stand up and address the Court and make submissions or to enlighten the Court. In this particular case the choice was wide open to the defendant to have counsel to assist him with all the privileges which Counsel enjoys before our Courts but he chose deliberately with the leave of the Court to defend in his own name. The case has lasted several days and not once the Court interfered to prevent the defendant from calling his witnesses, from examining his witnesses, from re-examining his witnesses and produce all documents. I would say that in those circumstances the defendant having made his choice not to be represented by Counsel would be precluded from addressing the Court any more.
On the other hand if there is any document which still has to be filed or information which the defendant may provide in defence of the claim against him he is of course entitled to furnish and to produce such documents but I should think that there is none to come since the case has been going on for quite some time. »
So the defendant was shut out from addressing the court altogether.
When the case reached the Court of Civil Appeal, the defendant was represented by counsel. Counsel addressed a full argument in support of the main ground of appeal, citing, inter alia, section 10 of the Constitution and section 12 of the Courts Act. But the Court of Civil Appeal did not deal with any of counsel’s arguments. What the court said was as follows :
« This ground is, in our opinion, misconceived. The appellant had the choice to be represented by counsel of his choice or to represent himself during the course of the trial. Having elected to conduct his own case and having been granted full latitude to crossexamine the respondent and his witnesses and to depone himself and call his own witnesses, the appellant could not claim the rights of Counsel and make submissions to the court as he could be granted only those rights enjoyed by a member of the public – Vice Halsbury’s Laws of England, 4th ed., vol. 3 page 601, para. 1117 and the English and Empire Digest vol. 3 (1920) at page 355, para. 472. »
Their Lordships regret that they can derive little assistance from the reasoning of the Court of Civil Appeal. The questions for decision were whether, having elected to conduct his own defence, the defendant ought (1) to have been allowed the same rights as any other litigant in person and (2) if so, whether those rights included the right to address the court. The reference to Halsbury’s Laws, vol 3, 4th ed. page 601 answers question (1) in favour of the defendant. It does not touch question (2). The English and Empire Digest vol. 3, page 355, para. 472 cites a ruling of the Recorder of London in Reg. v. Philips (1844) 1 Cox C.C. 17 as authority for the proposition that a barrister conducting a criminal prosecution on his own behalf will not be allowed to comment on the evidence or address the jury. But the case was decided over 150 years ago, and is very scantily reported. It can hardly be regarded as carrying much authority today. It was not suggested that in England today a barrister, acting on his own behalf in a civil case, would not be entitled to address the court like any other litigant in person.
And so their Lordships come to the relevant Mauritius legislation. Chapter II of the Constitution provides as follows :
« 3. Fundamental rights and freedoms of the individual.
It is hereby recognised and declared that in Mauritius there have existed and shall continue to exist… the following human rights and fundamental freedoms.
(a) the right of the individual to life, liberty, security of the person and the protection of the law ;
…
10. Provisions to secure protection of law…
(8) Any court or other authority required or empowered by law to determine the existence or extent of any civil right or obligation shall be established by law and shall be independent and impartial, and where proceedings for such a determination are instituted by any person before such a court or other authority the case shall be given a fair hearing within a reasonable time. »
The Courts Act provides as follows :
« 12. Rights of audience.
In any proceedings before the Supreme Court, any of the following persons may address the court – (a) any party to the proceedings, with leave of the court ;
(b) a barrister… »
Rule 60 of the Rules of the Supreme Court of Mauritius provides :
« Any party may make application to the Court by motion, or to a judge, praying leave to prosecute, or defend, a suit in his own proper person ; and the Court or judge may, on sufficient cause shown to its, or his, satisfaction by such party, make order that such party may sue, or defend, as the case may be, in such Court, in person, without the assistance of an attorney, subject to such conditions as the said Court or judge may think fit in each particular case to impose on such party. »
Mr. De Speville for the plaintiff points out, correctly, that whereas a barrister under section 12 of the Courts Act has an unfettered right to address the court on behalf of his client, a litigant in person requires the leave of the court. Under rule 60 of the Rules of the Supreme Court the court may impose on a litigant in person such conditions as the court may think fit.
How did the judge apply these provisions when he came to make his first ruling ? He was clearly right to rule that the defendant should not appear robed, or sit in counsel’s row : see Halsbury’s Law 4th ed. (Reissue) (1989) vol. 3, page 313, para. 402, footnote
13. But he gives no reason for prohibiting the defendant from making an opening speech, or from offering any argument on the law or the facts. Indeed he may even have thought that he had no discretion in the matter. This may be the explanation for his curious comment « I find the situation rather unusual and rather embarrassing, but then I have to do it ».
Similarly, in his second ruling, the judge said :
« … but to my mind Section 12 does not open the door to a party at the end of the day when he is not represented by Counsel but where he has been allowed to defend in his own name to stand up and address the Court and make submissions or to enlighten the Court. »
This again suggests that the judge may have been under some misapprehension as to the scope and effect of section 12 of the Courts Act.
But it is unnecessary to enquire too closely into the judge’s reasoning, since section 12 on its face clearly confers a discretion, but a discretion which, in their Lordships’ opinion, the judge was bound to exercise in such a way as to secure the defendant a fair hearing in accordance with the overriding requirements of section 10 (8) of the Constitution. A trial in which one party has the opportunity to address the court on the facts and the law, and the other party is denied that opportunity, cannot be a fair trial. It makes no difference whether one or other or both parties are litigants in person.
Of course there may be occasions when a litigant in person abuses his right to address the court. In such a case the court may do what is necessary to prevent an abuse of its process, without being in danger of infringing the litigant’s rights under section 10 (8) of the Constitution. Mr. De Speville suggested that it may have been for reasons of that kind that the judge denied the defendant the opportunity to address the court in the present case. But this is mere speculation. There is not a hint of any such reason in either of the judge’s rulings.
Nor would such a reason be consistent with allowing the defendant to cross-examine the plaintiff and his witnesses. If there was a risk of the proceedings becoming acrimonious, or of some other abuse of the courts’ process, it would surely have occurred during the defendant’s lengthy cross-examination of the plaintiff, a crossexamination which started on 21st February 1995 and continued throughout the whole of 22nd February 1995. Yet the cross-examination appears to have been conducted with propriety. The court never found it necessary to restrain or rebuke the defendant at any stage.
Their Lordships consider that there was no justification for the judge’s initial ruling whereby the defendant was denied the right to address the court ; but even if there had been some legitimate concern at that stage, the judge should certainly have reconsidered the question in the light of the defendant’s conduct of his defence before giving his second ruling. The conclusion is inescapable that the defendant did not have a fair hearing, contrary to the requirements of section 10 (8) of the Constitution.
The only other argument advanced by Mr. De Speville was as follows. The defendant was offered a choice at the beginning of the trial whether to appear by counsel or to conduct his defence in person on terms imposed by the court. Since he chose the latter course, he is bound by his election. This seems to have been the argument which was accepted by the Court of Civil Appeal. But for the reasons already discussed, the court was not entitled to impose terms which deprived the defendant of his constitutional right to a fair trial. It follows that he should never have been forced to make the choice as presented. It was for these reasons that their Lordships allowed the appeal and set aside the orders of the Court of Civil Appeal and the trial judge. It will be open to the plaintiff to apply for a fresh trial which, in the circumstances, should be before a different judge. The respondent must pay the appellant’s costs before their Lordships’ Board and in the Court of Civil Appeal. He must also pay any costs thrown away at the trial.
-
[1]
Note du Secrétariat général de l’ACCPUF : Le Conseil Privé de la Reine détient une compétence en matière de contrôle de constitutionnalité des lois vis à vis de certains États du Commonwealth dont l’Île Maurice. Aux termes de l’article 81-1 de la Constitution mauricienne, le Comité judiciaire du Conseil Privé peut ainsi être saisi d’un pourvoi contre toute décision définitive du juge local dans une affaire impliquant une question d’interprétation d’une norme constitutionnelle. [Retour au contenu]
La compétence de la juridiction administrative de première instance pour trancher les litiges de conformité
Extraits de la décision de la Cour suprême du Canada, Douglas/Kwantlen Faculty Association contre Douglas college [1] du 6 décembre 1990
[1990] 3 RCS Douglas/Kwantlen Faculty Association c. Douglas College 570 Douglas College Appelant
c.
Douglas/Kwantlen Faculty Association
Intimée
et
Le procureur général du Canada et le procureur général de la Saskatchewan
Intervenants
répertorié : douglas/kwantlen faculty assn. c. douglas college
n° du Greffe : 20800.
1989 : 18, 19 mai ; 1990 : 6 décembre.
Présents : Le juge en chef Dickson et les juges Wilson, La Forest, L’Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et Cory.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
[…]
Droit constitutionnel – Tribunal compétent – Grief – Décision préliminaire d’un arbitre sur la constitutionnalité d’une disposition – Est-ce un tribunal compétent ? – A-t-il compétence sur ce grief ? – Charte canadienne des droits et libertés, art. 15, 24(1).
Le Douglas College est un des collèges d’un système d’enseignement postsecondaire créé en Colombie-Britannique par la College and Institute Act. Sur désignation, un collège devient une personne morale et est à toutes fins pratiques un mandataire de la Couronne ne pouvant exercer ses pouvoirs qu’à ce titre. Il est assujetti à un contrôle direct et important du ministre. Son conseil est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre amovible et son budget annuel est soumis à l’approbation du ministre. Le ministre a le pouvoir d’établir des politiques ou d’émettre des directives concernant l’enseignement et la formation post-secondaires, d’offrir des services jugés nécessaires, d’approuver tous les règlements du conseil et d’accorder les fonds nécessaires.
La convention collective, qui était régie par le Labour Code et était entrée en vigueur après l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, prévoit la retraite obligatoire à 65 ans (art. 4.04). Deux membres de la faculté qui devaient prendre leur retraite bientôt ont déposé un grief contestant l’article 4.04 qui, selon eux, viole le par. 15(1) de la Charte. L’arbitre nommé conformément à la convention collective a conclu dans une décision préliminaire que le collège était un mandataire de la Couronne assujetti à la Charte et que toute mesure prise par lui, y compris la convention collective, constitue une « loi » au sens du par. 15(1) de la Charte. Cette décision préliminaire n’a pas examiné la question de savoir si l’article 4.04 de la convention collective était justifié en vertu de l’article premier ou de savoir s’il était interdit à l’association de prétendre aux avantages de la Charte. Un appel à la Cour d’Appel de la Colombie-Britannique a été rejeté.
Les questions constitutionnelles auxquelles la Cour doit répondre sont de savoir
(1) si la Charte s’applique à la négociation et à l’administration de la disposition sur la retraite dans la convention collective ; (2) si cette disposition ou son application constitue la « loi » au sens de ce terme au par. 15(1) de la Charte ; (3) si le conseil d’arbitrage nommé pour résoudre un grief contestant la constitutionnalité de cette disposition est un tribunal compétent aux termes du par. 24(1) de la Charte ; (4) si le conseil d’arbitrage peut connaître d’un tel grief.
Les procureurs généraux du Canada et de la Saskatchewan sont intervenus.
Arrêt : Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Dickson et les juges La Forest et Gonthier : Le collège est un mandataire de la Couronne établi par le gouvernement pour mettre en œuvre une politique gouvernementale. Dans la forme et dans les faits, il fait simplement partie de l’appareil gouvernemental. Le gouvernement peut permettre au conseil du collège d’exercer un certain pouvoir discrétionnaire, mais il nomme les membres du conseil à titre amovible et de plus peut en tout temps réglementer le fonctionnement du collège par loi. Dans l’exécution de ses fonctions, le collège exécute des actes gouvernementaux. Les actions du collège dans la négociation et l’application de la convention collective sont celles du gouvernement aux fins de l’art. 32 de la Charte. Sa situation est très différente de celle des universités qui gèrent leurs propres affaires.
Pour les raisons examinées dans l’arrêt McKinney c. L’Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 000 la convention collective est une loi. Elle a été conclue par un mandataire du gouvernement en application des pouvoirs qui lui étaient conférés par une loi dans la poursuite d’une politique gouvernementale. Même si l’association intimée a donné son accord à la convention collective, cela ne change rien au fait que le gouvernement l’a conclue en vertu d’un pouvoir conféré par la loi et qu’elle était ainsi une mesure gouvernementale. On ne peut tolérer que le gouvernement poursuive des politiques qui violent les droits reconnus par la Charte au moyen de contrats et d’ententes conclus avec d’autres personnes ou organismes.
Le pouvoir d’un tribunal lui vient du mandat conféré par la loi. La compétence d’un tribunal établi par une loi doit se trouver dans une loi et s’étend non seulement à l’objet du litige et aux parties, mais également à la réparation demandée. Dans l’exercice du mandat conféré par la loi, un tribunal a le pouvoir de se prononcer sur la validité constitutionnelle d’une loi qu’il est appelé à appliquer. Lorsqu’un tribunal fait ce qu’il a le pouvoir de faire en vertu de la loi, il a non seulement le pouvoir d’interpréter les dispositions législatives pertinentes, mais aussi celui de décider si la loi a été adoptée validement. La Constitution du Canada rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. S’il conclut que la loi qu’on lui demande d’appliquer est invalide, un tribunal doit la traiter comme si elle était inopérante en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
L’arbitre avait compétence sur les parties, sur l’objet du litige et la réparation demandée. En vertu de l’art. 98 du Labour Code, l’arbitre a le pouvoir exprès de régler définitivement tout différend qui naît de la convention collective et il dispose de modes de réparation variés à cette fin, y compris le pouvoir d’interpréter et d’appliquer toute loi visant à régir les relations de travail. Le terme « loi » à l’art. 98 inclut la Charte. Ici, le grief n’est pas fondé uniquement sur les clauses de la convention collective, mais s’appuie aussi sur l’application du par. 15(1)
de la Charte. La présente espèce est compliquée parce que la décision de l’arbitre était une décision « préliminaire » qui ne portait que sur sa compétence et la question de savoir si la convention collective ou la politique de retraite obligatoire pouvait être considérée comme une « loi » aux fins de la Charte. Cependant, le redressement demandé était une réparation en vertu de l’art. 98. La clause de retraite obligatoire est invalide et un arbitre, nonobstant toute disposition de la convention collective en sens contraire, peut déclarer inapplicable une clause « contestée » d’une convention collective.
La pratique qui consiste à soumettre à un tribunal une question constitutionnelle plutôt que de demander initialement le contrôle judiciaire est assez naturelle dans le contexte d’aujourd’hui et ne contrevient pas au concept du partage des pouvoirs. Même si les pratiques informelles d’un tribunal peuvent ne pas être tout à fait adaptées aux questions constitutionnelles, la pratique comporte des avantages évidents. D’abord, la Constitution doit être respectée et tout citoyen, lorsqu’il comparaît devant des organismes décisionnels établis pour se prononcer sur ses droits et ses devoirs, devrait pouvoir faire valoir les droits et libertés garantis par la Constitution. De plus, un tribunal spécialisé peut de façon expéditive et peu coûteuse faire le tri des faits et établir un dossier pour le bénéfice d’un tribunal d’appel. Cette compétence spécialisée peut être d’une aide inestimable en matière d’interprétation constitutionnelle.
Puisque l’arbitre, dans sa décision préliminaire, n’a pas examiné les questions de savoir si la violation du par. 15(1) était justifiée en vertu de l’article premier ou si l’association était irrecevable à invoquer ces droits constitutionnels ou était réputée y avoir renoncé, notre Cour n’a pas été appelée à trancher ces questions.
Il est inutile d’examiner si l’arbitre était un « tribunal compétent » au sens du par. 24(1).
Les juges Wilson et L’Heureux-Dubé : Le conseil arbitral nommé par les parties en vertu du Labour Code a compétence, en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, pour se prononcer sur la question constitutionnelle soulevée par le grief. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si le conseil est un « tribunal compétent » au sens du par. 24(1) de la Charte. Il est préférable de ne pas se prononcer sur la question de savoir si un tribunal peut avoir cette compétence même en l’absence de dispositions précises dans la loi habilitante et dans la convention collective. La Charte s’applique au Douglas College et l’art. 15 s’applique à l’article contesté de la convention collective.
Les critères pertinents pour déterminer si une entité est assujettie à la Charte sont de savoir (1) si la branche législative, exécutive ou administrative du gouvernement exerce un contrôle général sur l’entité en question ;
(2) si l’entité exerce une fonction gouvernementale traditionnelle ou une fonction qui, de nos jours, est considérée comme une responsabilité de l’État ; et (3) si l’entité agit conformément au pouvoir que la loi lui a expressément conféré en vue d’atteindre un objectif que le gouvernement cherche à promouvoir dans le plus grand intérêt public.
Le collège fait partie du gouvernement aux fins de l’art. 32 de la Charte compte tenu du fait qu’il est un mandataire de la Couronne établi, subventionné et largement contrôlé par le gouvernement, ainsi que du fait qu’il exécute une fonction gouvernementale dans l’intérêt public. Le collège n’est pas un organisme autonome mais fait plutôt partie de « l’appareil gouvernemental » et, contrairement aux universités, il n’a pas perdu une indépendance historique lorsque le gouvernement a décidé d’intervenir. Ses actions sont donc assujetties à l’art. 15 de la Charte. Il n’est pas nécessaire que le gouvernement exerce un contrôle direct sur l’application de l’article 4.04.
Une interprétation fondée sur l’objet des diverses dispositions de la Charte dans lesquelles figurent les termes « loi », ou « règle de droit » peut conduire à des interprétations différentes de ces termes dans le contexte de ces dispositions. Il n’est pas nécessaire de conclure à l’existence d’une « loi » pour qu’intervienne le par. 15(1). Si, cependant, il faut qu’une « loi » soit en cause avant d’appliquer l’art. 15, cette loi existe dans la convention collective et, en particulier, à l’article 4.04. De manière subsidiaire, une autre « loi » semblable peut être trouvée dans la loi habilitante du collège qui contient une disposition conférant expressément au conseil le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail. Par conséquent, la négation alléguée d’égalité résultait d’une « loi » ou d’une conduite pouvant faire l’objet d’une réparation en droit, et la première exigence du par. 15(1) est satisfaite.
Le juge Sopinka : Le juge Sopinka est d’accord avec la position adoptée par le juge La Forest à l’exception de sa conclusion que la convention collective dans la présente espèce est une « loi » au sens de l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il ne faut pas écarter la nature consensuelle des politiques en cause lorsqu’il s’agit de décider si elles constituent une « loi ».
La Charte a été conçue pour protéger l’individu du pouvoir coercitif de l’État et non contre ses propres actes volontaires dans ses contacts avec les entités de l’État. Quoique le mot « loi » ne se limite pas à l’activité législative, il doit y avoir un élément de contrainte, même dans une « activité » gouvernementale pour que celle-ci puisse être qualifiée de « loi ». Cet élément d’imposition ou d’exigence de la part de l’État distingue la « loi » des droits et obligations volontairement assumés.
Le juge Cory : Le juge Cory souscrit aux motifs du juge Wilson concernant l’application à la présente situation du critère qu’elle a formulé dans l’arrêt McKinney. Ce critère fournit un moyen de déterminer si une entité fait partie du gouvernement auquel la Charte s’applique. À tous autres égards, il souscrit aux motifs du juge La Forest.
[…]
La compétence de l’arbitre
Observations préliminaires
J’examine maintenant les troisième et quatrième questions constitutionnelles. Par souci de commodité, je les cite de nouveau :
9512 3.Un conseil d’arbitrage nommé par les parties en vertu de la convention collective pour résoudre un grief contestant la constitutionnalité de cette disposition est-il un tribunal compétent aux termes du par. 24(1) de la Charte ?
9512 4.Un conseil d’arbitrage peut-il connaître d’un tel grief ?
Le paragraphe 24(1) de la Charte, mentionné dans la troisième question constitutionnelle, parle d’une demande à un
« tribunal compétent » lorsqu’il y a eu violation ou négation des droits reconnus par la Charte. Il se lit ainsi :
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
Bien qu’il ne soit pas mentionné dans les questions constitutionnelles, le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, qui prévoit que la Constitution rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit, est également pertinent. Il se lit ainsi :
52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada ; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
La Cour d’Appel a refusé de se prononcer sur la question de savoir si l’arbitre était un tribunal compétent en vertu du par. 24(1). Elle a souligné qu’aucune réparation n’était demandée en vertu de cette disposition et qu’elle n’avait donc pas à examiner la question. Elle a plutôt décidé que, en vertu de l’art. 52, si l’arbitre concluait à la violation de l’art. 15 de la Charte, il pouvait déclarer inopérante la clause de la convention collective.
La thèse des parties
Devant notre Cour, l’avocat du collège a soutenu que le par. 52(1) ne confère pas compétence et que l’organisme qui déclare une loi inopérante doit être un tribunal compétent en vertu du par. 24(1) qui confère le pouvoir de remédier à des violations de la Charte en invalidant les dispositions législatives contestées ou en rendant d’autres ordonnances convenables et justes. Il a soutenu en outre qu’un conseil arbitral n’est tout simplement pas un tribunal au sens du par. 24(1). Il a soutenu subsidiairement que l’arbitre n’avait pas compétence sur l’objet du litige ou la réparation demandée. La compétence de l’arbitre découle de la convention collective des parties et de la législation applicable en matière de relations de travail. Bien que l’al. 98g) du Labour Code permette à l’arbitre [TRADUCTION] « [d’]interpréter et appliquer toute loi visant à régir les relations de travail… nonobstant toute incompatibilité de ses dispositions avec celles de la convention collective », la Charte, selon l’avocat, n’était pas le genre de loi visée par cette disposition. Il a également prétendu que le processus assez informel de l’arbitrage n’est pas le forum approprié pour soulever des questions relatives à la Charte.
L’avocat de l’intimée a soutenu, par contre, qu’en common law un tribunal compétent comprend tout tribunal ayant compétence pour entendre le litige. Il a souligné que l’arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, a dit qu’un tribunal compétent est un organisme qui, indépendamment de la Charte, a compétence sur les parties, l’objet du litige et la réparation demandée. L’avocat a soutenu que l’arbitre satisfaisait à ces critères en vertu des dispositions du Labour Code et des clauses de la convention collective.
L’avocat du procureur général du Canada, intervenant, a soutenu qu’on devrait répondre par la négative à la troisième question constitutionnelle et par l’affirmative à la quatrième. Il a soutenu qu’un conseil arbitral ne peut être un tribunal compétent au sens du par. 24(1) de la Charte parce que la disposition ne fait que reconnaître que, lorsqu’un tribunal a déjà compétence sur l’objet et la réparation demandée, le plaignant peut s’adresser à cet organisme pour obtenir la réparation que cet organisme peut accorder en cas de violation de la Charte. Il a ajouté qu’une convention collective ne peut faire d’un particulier un tribunal ni permettre à un arbitre de se prononcer sur la validité ou l’applicabilité d’une loi d’une province ou du Canada. L’arbitre n’a pas de pouvoirs plus étendus que ceux que lui confère la convention collective. À son avis toutefois, un arbitre, bien qu’il ne soit pas un tribunal compétent aux fins du par. 24(1), a le pouvoir de décider quelle est la loi applicable et d’exécuter son mandat d’une manière conforme à la Charte. Sur ce fondement, il peut donc décider qu’une disposition d’une convention collective est invalide ou inopérante parce qu’incompatible avec la Charte. Le deuxième intervenant, le procureur général de la Saskatchewan, a demandé qu’on réponde par la négative aux troisième et quatrième questions constitutionnelles. Selon lui, ni le par. 24(1) ni l’art. 52 ne peuvent servir de fondement indépendant au pouvoir de se prononcer sur des questions relatives à la Charte. À son avis, un tribunal doit exercer ses pouvoirs de manière conforme à la Charte. Un tribunal ne peut décider qu’une loi est invalide ou accorder une réparation formelle en vertu de la Charte que s’il en a le pouvoir en vertu de sa loi habilitante, pouvoir que, a-t-on prétendu, ni la convention collective ni la législation appropriée ne conférait à l’arbitre. Le procureur général a également soutenu que l’attribution de compétence sur les questions relatives à la Charte est assujettie aux limites de l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et à l’exigence générale du par. 24(1) de la Charte que les personnes puissent faire
valoir leurs droits devant un tribunal.
La jurisprudence
En résumé, l’appelant – et le procureur général de la Saskatchewan à cet égard – soutient que l’arbitre n’a pas compétence pour appliquer la Charte. Cette thèse trouve appui dans plusieurs jugements du juge Marceau de la Cour d’Appel fédérale qui est un ardent défenseur de cette opinion. Il a d’abord exposé ce point de vue dans l’arrêt Canada c. Vincer, [1988] 1 C.F. 714. Dans cette affaire, le père de deux enfants à charge, séparé de son épouse en vertu d’une entente selon laquelle les enfants résideraient pendant un temps égal chez chacun des parents, demandait la moitié des sommes payables en vertu de la Loi de 1973 sur les allocations familiales, S.C. 1973-74, ch. 44, pour ses deux enfants. Sa demande a été rejetée parce que les allocations familiales ne sont pas divisibles et parce qu’en vertu de la loi, elles sont habituellement payables à la mère sauf dans des circonstances exceptionnelles prévues par les règlements qui ne s’appliquaient pas au demandeur. Cependant, le comité de révision établi en vertu de la Loi s’était prononcé en faveur du requérant parce qu’à son avis les dispositions de la Loi et des règlements semblaient violer la Charte et la Loi canadienne sur les droits de la personne, S.C. 1976-77, ch. 33. Il avait donc recommandé l’examen de ces dispositions. Cette décision a été attaquée dans une demande fondée sur l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10. La question était de savoir si le comité de révision avait compétence pour trancher la question relative à la Charte. La Cour d’Appel fédérale a conclu que le comité n’avait pas compétence. L’opinion du juge Pratte était cependant fondée sur le point de vue que les dispositions contestées ne violaient pas la Charte et celle du juge Stone sur le fait que la loi, telle que rédigée, ne conférait pas au comité de révision le mandat d’appliquer la Charte. Par conséquent, seuls les motifs du juge Marceau appuient l’argumentation générale de l’appelant et du pro-
cureur général de la Saskatchewan.
Le juge Marceau a d’abord rejeté la prétention que le comité de révision pouvait tirer sa compétence directement du par. 24(1) de la Charte. Citant l’arrêt Mills c. La Reine, précité, il a affirmé qu’il est maintenant clairement établi que la Charte ne confère en elle-même aucune compétence à quelque cour ou tribunal que ce soit. Il a ajouté que la compétence doit être prévue dans une loi et doit s’étendre non seulement à l’objet de la demande, mais aux parties intéressées et à la réparation recherchée. Dans la loi en cause devant lui, le pouvoir de verser les allocations de la manière demandée n’existait pas. Il a ajouté que le pouvoir conféré en vertu de la version anglaise du par. 24(1) était limité à une « court » et que, bien que la version française parle d’un « tribunal », l’interprétation de dispositions législatives bilingues ne devrait pas normalement donner à un terme une signification que le terme correspondant dans l’autre version ne pourrait avoir.
Le juge Marceau a ensuite traité de l’argument que la décision prise par le comité ne constituait pas une décision sur le droit, mais simplement une opinion. À son avis, la difficulté tenait à ce que le comité avait appliqué le droit et que, décision ou non, il s’agirait d’un précédent comme tout autre jugement. Dans ce contexte, il voyait également des difficultés découlant des dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867 sur le pouvoir judiciaire comme les remarques ultérieures dans ses motifs l’indiquent.
Enfin, et cela se rapporte au dernier point, il était d’avis que pour qu’un tribunal puisse contester la validité constitutionnelle d’une loi du Parlement, il devait faire partie du pouvoir judiciaire du gouvernement. Selon lui, chacun des trois pouvoirs – les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire – a des fonctions exclusives et le contrôle de la validité des dispositions législatives du Parlement ou des législatures relève exclusivement du pouvoir judiciaire.
Le juge Marceau a confirmé son opinion dans ses motifs des arrêts ultérieurs Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Association des Employeurs maritimes (1988), 89 N.R. 278 (C.A.F.), et Poirier c. Canada (Ministre des Affaires des anciens combattants), [1989] 3 C.F. 233, où il a saisi l’occasion de réfuter plusieurs arguments s’opposant à son opinion. Encore une fois, le juge Marceau n’a pu rallier les autres juges siégeant dans la même affaire et qui ont tranché ces questions sur des motifs plus restreints. Sa position peut cependant trouver un certain appui dans l’arrêt Re Blainey and Ontario Hockey Association (1986), 54 O.R. (2d) 513 (autorisation de pourvoi refusée, [1986] 1 R.C.S. xii), rendu à la majorité par la Cour d’Appel de l’Ontario. Dans cet arrêt, la majorité a conclu que la Commission des droits de la personne de l’Ontario avait eu raison de conclure qu’elle n’avait pas compétence pour entendre la demande de Mme Blainey qui ne pouvait porter plainte contre la discrimination sexuelle exercée contre sa fille par une organisation sportive, en raison d’une disposition du Code qui écartait expressément ce comportement de l’interdiction générale de la discrimination sexuelle. Le juge Finlayson, dissident, dans l’arrêt Cuddy Chicks Ltd. v. Ontario (Labour Relations Board) (1989), 62 D.L.R. (4th) 125 (C.A. Ont.), aux pp. 147 et 148, s’est fondé sur cette décision mais la majorité en a décidé autrement.
Les tribunaux sont unanimes pour dire qu’un tribunal n’a le pouvoir d’accorder une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte, que s’il a compétence sur l’objet de la demande, les parties et la réparation demandée, comme l’indique le juge Marceau, bien que certains juges aient exprimé l’opinion (suivant le raisonnement de l’arrêt Re Nash and The Queen (1982), 70 C.C.C. (2d) 490 (C. Prov. T.-N.)) qu’un « tribunal » peut être un tribunal compétent au sens de cet article. Je n’ai pas à aller plus loin sur cette question pour l’instant et je vais examiner les décisions traitant du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
L’opinion prédominante des tribunaux est que, dans l’exercice du mandat conféré par la loi, un tribunal a le pouvoir de se prononcer sur la validité constitutionnelle d’une loi qu’il est appelé à appliquer. L’une des premières décisions est l’arrêt Re Shewchuk and Ricard ; Attorney-General of British Columbia (1986), 28 D.L.R. (4th) 429, de la Cour d’Appel de la Colombie-Britannique. Dans cette affaire, la plaignante qui avait donné naissance à un enfant naturel a intenté une procédure devant le juge Auxier de la Cour provinciale en vertu de la Child Paternity and Support Act, R.S.B.C. 1979, ch. 49, de la province alléguant que l’intimé était le père. Si la paternité était établie, le père pouvait être tenu de subvenir aux besoins de l’enfant jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans une requête préliminaire, l’intimé a cependant demandé un jugement déclaratoire portant que la loi était inopérante parce qu’elle violait le par. 15(1) de la Charte en établissant
une discrimination fondée sur le sexe, puisqu’un père putatif ne dispose pas des mêmes recours que la mère en vertu de la loi si celle-ci abandonne l’enfant et que le père doit en prendre soin. Le juge Auxier a décidé qu’elle avait compétence pour entendre la demande, que la disposition contestée violait le par. 15(1) et qu’elle n’était pas sauvegardée par l’article premier de la Charte. Le procureur général a ensuite intenté un appel au moyen d’un exposé de cause devant le juge Locke de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui a confirmé la décision. À la question de savoir si le juge Auxier avait outrepassé sa compétence, il a répondu : [TRADUCTION]
« Non, si la décision est restreinte aux faits particuliers de l’espèce et n’est pas considérée comme une déclaration générale ». La Cour d’Appel de la Colombie-Britannique a confirmé la décision. Traitant de la question de la compétence, le juge Macfarlane, au nom de la cour sur ce point, a dit ceci, aux pp. 439 et 440 :
[TRADUCTION] Il est avéré que le pouvoir de rendre un jugement déclaratoire sur la validité constitutionnelle des lois adoptées par le Parlement ou l’une des législatures ressortit à la compétence exclusive des instances supérieures.
Mais il est également avéré que si une personne comparaît devant un tribunal à la suite d’une inculpation, d’une plainte ou d’un autre acte de procédure qui relève régulièrement de la compétence de ce dernier, il s’ensuit que le tribunal a compétence d’une part, pour juger que la loi sur laquelle repose l’inculpation, la plainte ou l’autre acte de procédure est inopérante du fait des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, et d’autre part, pour rejeter l’inculpation, la plainte ou l’autre acte de procédure. Le prononcé d’un jugement déclaratoire portant que la loi contestée est inopérante n’est, dans ce contexte, rien de plus qu’une décision sur une question juridique dont le tribunal est régulièrement saisi. Cela n’empiète aucunement sur le droit exclusif des instances supérieures d’accorder un redressement par voie de bref de prérogative, y compris un jugement déclaratoire.
Peu de temps après, le juge Pratte, au nom d’une Cour d’Appel fédérale unanime, a approuvé ce passage dans l’arrêt Zwarich c. Canada (Procureur général), [1987] 3 C.F. 253. Dans cette affaire, le requérant avait été privé de prestations visées à la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, ch. 48, parce que le par. 44(1) de cette loi prévoit qu’une personne qui a perdu son emploi en raison d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif n’est pas admissible au bénéfice des prestations. Ses appels devant le conseil d’arbitrage d’abord et le juge-arbitre ensuite avaient été rejetés. Devant le juge-arbitre, son seul moyen d’appel, soulevé également devant le conseil d’arbitrage, était que le par. 44(1) violait l’art. 7 et le par. 15(1) de la Charte. Le conseil d’arbitrage et le juge-arbitre ont refusé de se prononcer sur cette question, le juge-arbitre décidant que ni lui ni le conseil d’arbitrage n’avaient compétence en vertu du par. 24(1) de la Charte pour se prononcer sur cette question. Cependant, la Cour d’Appel n’a pas partagé ce point de vue sur la question de la compétence. Le juge Pratte a souligné que, bien que ces organismes n’aient pas le droit de rendre des jugements déclaratoires puisqu’il s’agit d’un pouvoir réservé aux cours supérieures, ils doivent appliquer le droit comme tout autre tribunal. Ce faisant, ils doivent déterminer ce qu’est le droit, ce qui signifie qu’ils doivent non seulement interpréter les lois pertinentes, mais examiner si elles ont été validement adoptées. Il a ajouté que s’ils concluent que la disposition législative pertinente viole la Charte, ils doivent se prononcer dans le cas dont ils sont saisis comme si la disposition n’avait jamais été adoptée.
L’arrêt Zwarich c. Canada, précité, a été rendu avant l’arrêt Canada c. Vincer, précité, mais il ne fait pas de doute que l’opinion adoptée par le juge Pratte est celle retenue par la plupart des membres de la Cour d’Appel fédérale. Cela découle clairement des arrêts postérieurs Canada (Procureur général) c. Druken, [1989] 2 C.F. 24 (les juges Heald, Mahoney et Stone), et Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada), [1989] 2 C.F. 245 (les juges Hugessen, Lacombe et Desjardins) dans lesquels des formations différentes ont retenu l’interprétation formulée dans l’arrêt Zwarich c. Canada. Il en est de même d’autres cours d’appel provinciales ; voir Moore v. British Columbia (1988), 50 D.L.R. (4th) 29 (C.A.C.-B.) ; Cuddy Chicks Ltd. v. Ontario (Labour Relations Board), précité.
Comme l’a souligné le juge Pratte dans l’arrêt Canada (Attorney General) v. Alli, (1988), 51 D.L.R. (4th) 555 (C.A.F.), à la p. 560, il est difficile de concilier ses remarques dans l’arrêt Zwarich c. Canada, précité, avec celles du juge Marceau dans l’arrêt Canada c. Vincer, précité. Il est cependant fort possible de concilier les deux arrêts. Dans l’arrêt Zwarich c. Canada, le tribunal faisait ce qu’il avait le pouvoir de faire en vertu de la loi, c’est-à-dire déterminer l’admissibilité du requérant aux prestations d’assurance-chômage. Ce faisant, il avait non seulement le pouvoir d’interpréter les dispositions législatives pertinentes, mais aussi celui de décider si la loi avait été adoptée validement. Le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit que la Constitution – la loi suprême du Canada – rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Un tribunal doit respecter la Constitution de sorte que, s’il conclut que la loi qu’on lui demande d’appliquer est invalide, il doit la traiter comme si elle était inopérante.
Cependant, lorsqu’un tribunal doit déterminer si des droits reconnus par la Charte ont été violés ou accorder une réparation en vertu du par. 24(1), la situation est différente. Le pouvoir d’un tribunal lui vient du mandat conféré par la loi. C’est la conception retenue par le juge Stone dans l’arrêt Canada c. Vincer, précité. Selon lui, le mandat du comité de révision se limitait à réviser la décision qu’aucune allocation ne pouvait être versée. Cette conception a été retenue dans plusieurs autres arrêts ; voir Gerrard v. Saskatoon (City) (1987), 44 D.L.R. (4th) 767 (C.A. Sask.) ; Canada (Attorney General) v. Alli, précité ; Canada (Procureur général) c. Sirois (1988), 90 N.R. 39 (C.A.F.) ; Poirier c. Canada (Ministre des Affaires des anciens combattants), précité, les juges Pratte et Desjardins ; Cuddy Chicks Ltd. v. Ontario (Labour Relations Board), précité. Bref, un tribunal administratif est limité à exercer le mandat conféré par la loi. Comme le juge L’Heureux-Dubé l’a dit dans l’arrêt Supermarchés Jean Labrecque Inc. c. Flammand, [1987] 2 R.C.S. 219, à la p. 232 :
Le Tribunal du travail est un tribunal administratif qui tire ses pouvoirs de la loi qui le crée. Ceux-ci sont donc limités par sa loi constitutive. En conséquence, le Tribunal et un juge de ce tribunal doivent se conformer strictement aux pouvoirs que leur confère cette loi sous peine d’excès de juridiction ou d’abus de compétence.
Il s’ensuit, comme le juge McIntyre dans l’arrêt Mills c. La Reine, précité, l’a affirmé au sujet d’un tribunal compétent en vertu du par. 24(1) et comme le collège appelant l’a soutenu, que la compétence d’un tribunal établi par une loi doit se trouver dans une loi et doit s’étendre non seulement à l’objet du litige et aux parties, mais également à la réparation demandée. Lorsqu’il exerce cette compétence, il peut, dans l’exercice de son mandat, conclure qu’une loi est invalide en vertu de la Charte.
La distinction que j’ai tenté d’établir entre l’exercice du pouvoir conféré par le par. 24(1) de la Charte et l’obligation d’un tribunal d’appliquer la Constitution dans le cadre de l’exécution du mandat conféré par la loi a été bien exprimée dans l’arrêt Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada), précité. Dans cette affaire, la question était de savoir si une femme qui avait présenté une demande ordinaire de prestations en vertu de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage pouvait les recevoir bien que l’art. 31 de la Loi l’interdise parce qu’elle avait plus de 65 ans. Cette question soulevait évidemment celle de savoir si l’art. 31 violait le par. 15(1) de la Charte. Le juge Lacombe, au nom de la cour, a dit ceci, aux pp. 254 et 255 :
Dans l’espèce, c’est le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 qu’on a invoqué et non le paragraphe 24(1) de la Charte. La requérante n’a pas demandé au conseil arbitral et à cette Cour de déclarer que l’article 31 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage devait être modifié pour le rendre conforme à l’article 15 de la Charte ou d’ordonner un remède qui impliquerait l’adoption d’ajustements législatifs appropriés.
Il s’agit plutôt et seulement de savoir si l’article 31 de la Loi est, dans sa totalité, inopérant parce qu’il est incompatible avec l’article 15 de la Charte.
Les trois juges de la Cour d’Appel de l’Ontario ont exprimé des opinions semblables dans l’arrêt Cuddy Chicks, précité.
Application à l’espèce
J’en viens maintenant à l’application de ces principes à l’espèce. La question est de savoir si, au cours de l’audition d’un grief en vertu d’une convention collective, l’arbitre peut appliquer la Charte et accorder la réparation demandée par suite de sa violation. Je ne doute pas qu’il le peut. En vertu de l’art. 98 du Labour Code, précité, l’arbitre a le pouvoir exprès [TRADUCTION] « de régler définitivement tout différend qui naît de la convention collective » (je souligne), et il dispose de modes de réparation variés à cette fin. Dans l’exécution de ses fonctions, l’arbitre a le pouvoir, en vertu de l’al. 98g), d’interpréter et d’appliquer toute loi visant à régir les relations de travail.
Il est clair que l’arbitre a compétence sur les parties. La question est de savoir s’il a également compétence sur l’objet du litige et la réparation demandée. Il est clair que le grief de l’association n’est pas fondé uniquement sur les clauses de la convention collective, mais s’appuie aussi sur l’application du par. 15(1) de la Charte. À mon avis, l’al. 98g) permet à l’arbitre d’appliquer la Charte. Le terme « loi », à l’al. 98g), doit inclure la Charte. Il est vrai qu’une réserve apportée à l’al. 98g) fait que la loi en question doit viser à régir les relations de travail et que ce n’est pas là le seul but de la Charte.
Cependant, il est certain que ces relations sont de celles que vise le par. 15(1).
Je reconnais (et je reviendrai sur ce point plus loin) que l’application de la Charte compliquera davantage la tâche de l’arbitre. Des arguments d’ordre pratique, bien qu’ils ne soient pas concluants quant à la question, doivent être pris en compte. Le collège insiste beaucoup dans son argumentation sur le fait que le processus relativement informel de l’arbitrage n’est pas bien adapté au volume ou à la nature de la preuve qui serait présentée dans des demandes fondées sur la Charte. Bien que je reconnaisse un certain mérite à cet argument, je ne peux accepter la prétention du collège que l’interprétation et l’application de la Charte est très différente de l’application des lois ordinaires dont sont chargés les arbitres. Par exemple, il y a peu de différence avec certaines dispositions des codes sur les droits de la personne que les arbitres peuvent déclarer prévaloir sur des dispositions de conventions collectives.
Cette opinion est appuyée par lord Denning dans l’arrêt Taylor (David) & Son, Ltd. v. Barnett, [1953] 1 All E.R. 843 (C.A.),
lorsqu’il dit, à la p. 847 :
[TRADUCTION] Il existe, non pas une règle de droit pour les arbitres et une autre pour le tribunal, mais une seule règle de droit pour tous. Si un contrat est illégal, les arbitres doivent refuser d’y faire droit comme le ferait le tribunal.
A fortiori, je pense qu’il ne peut y avoir une Constitution pour les arbitres et une autre pour les tribunaux.
Les premiers écrits sur la Charte expriment une opinion semblable. Ainsi, Gibson dans son article « La mise en application de la Charte canadienne des droits et libertés » dans Tarnopolsky et Beaudoin, éd., Charte canadienne des droits et libertés (1982), aux pp. 632 et 633 affirme :
Il est possible aussi que la Charte puisse être appliquée dans certaines circonstances par des arbitres autres que des « cours de justice » et des « tribunaux ». Supposons, par exemple, que l’on soumettait à un arbitrage un différend entre le gouvernement du Canada et un de ses employés sur la question de savoir si l’employé pouvait être renvoyé pour avoir ouvertement appuyé un parti politique. Étant donné que la Constitution du Canada, qui comprend la Charte, constitue selon l’article 52(1) la « Loi suprême du Canada », et étant donné que les arbitres doivent normalement agir conformément à la loi, il nous semble que cet arbitre hypothétique serait tenu de considérer tous les aspects pertinents de la Charte dans sa décision. Bien entendu, toutes les cours de justice, tous les tribunaux ou tous les autres arbitres ne seraient pas compétents relativement à toutes les violations de la Charte. Il faudra toujours établir que la situation relève de la compétence de l’organisme saisi de l’affaire. La compétence pourrait être restreinte pour des motifs ayant trait : (a) à l’objet du litige, (b) aux parties et (c) à la réparation demandée.
Voir également Hogg, Constitutional Law of Canada (2e éd. 1985), à la p. 693.
Compte tenu de considérations semblables, la Cour d’Appel de la ColombieBritannique dans l’arrêt Moore v. British Columbia, précité, une affaire assez similaire à celle-ci, est arrivée à la même conclusion. Le juge Macfarlane, au nom de la cour, a conclu, à la p. 40 :
[TRADUCTION] Un arbitre, agissant conformément aux dispositions de la convention collective, a compétence sur les parties, l’objet du litige (le renvoi), et peut apporter toutes les réparations appropriées qu’il conviendrait qu’un tribunal compétent accorde en vertu du par. 24(1) de la Charte. Je partage l’avis de cette cour que l’al. 98g) confère à l’arbitre le pouvoir d’accorder les réparations convenables dans des cas comme l’espèce. J’ajouterais que je n’interprète pas ses propos comme signifiant nécessairement que l’arbitre est un tribunal compétent en vertu du par. 24(1).
La question en l’espèce est un peu plus compliquée parce que la décision de l’arbitre était une décision « préliminaire » qui ne portait que sur sa compétence et la question de savoir si la convention collective ou la politique de retraite obligatoire pouvait être considérée comme une « loi » aux fins de la Charte. Cependant, il semble que le redressement réellement demandé était une réparation en vertu de l’art. 98 parce que les auteurs du grief avaient été mis à la retraite à tort et ce, parce que la clause de mise à la retraite obligatoire était invalide et ne pouvait être invoquée.
Il est vrai que l’art. 15.03 de la convention collective prévoit que l’arbitre n’est pas habilité à ajouter, supprimer ou modifier quoi que ce soit dans les dispositions de la convention collective. Il faut cependant tenir compte, à ce sujet, du fait que l’al. 98g) reconnaît qu’une disposition législative peut prévaloir sur une clause de la convention collective. Il est certain que face à une clause « contestée » d’une convention collective, l’arbitre peut la déclarer inapplicable. Même si l’association voulait également que ses enseignants soient réintégrés, cette réparation relèverait des pouvoirs de l’arbitre en vertu de l’al. 98b). Si la clause sur la retraite était jugée inopérante, alors tout congédiement serait contraire à la convention collective.
Je suis donc d’avis de conclure que l’arbitre a compétence sur la réparation ou l’ordonnance demandée en l’espèce ainsi que sur les parties et l’objet du litige.
Considérations pratiques
Je sais que jusqu’à récemment l’application de normes constitutionnelles par les tribunaux administratifs a pu être jugée assez inhabituelle ; voir Re Windsor Airline Limousine Services Ltd. and Ontario Taxi Association 1688 (1980), 117 D.L.R. (3d) 400 (C. div. Ont.), le juge Reid, à la p. 403. Mais cette décision et d’autres font ressortir que ce n’est pas entièrement nouveau. Les tribunaux, et les commissions des relations du travail en particulier, sont reconnus compétents depuis un certain temps déjà pour examiner des questions constitutionnelles ; voir les arrêts R. v. Ontario Labour Relations Board, Ex parte Dunn (1963), 39 D.L.R. (2d) 346 (H.C. Ont.) ; Northern Telecom Canada Ltd. c. Syndicat des travailleurs en communication du Canada, [1983] 1 R.C.S. 733 ; Four B Manufacturing Ltd. c. Travailleurs unis du vêtement d’Amérique, [1980] 1 R.C.S. 1031 ; Conseil canadien des relations du travail c. Paul L’Anglais Inc., [1983] 1 R.C.S. 147. Ces arrêts, comme le juge Finlayson l’a souligné dans Cuddy Chicks Ltd. v. Ontario (Labour Relations Board), précité, à la p. 142, se limitaient à la question de la compétence des tribunaux. En ce qui concerne d’autres questions, comme le juge Desjardins le souligne dans l’arrêt Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada), précité, à la p. 278, les parties pourraient se prévaloir des brefs de prérogative ou d’autres recours analogues. Mais si ces tribunaux peuvent se prononcer sur ces questions aux fins de compétence, je ne vois pas pourquoi un tribunal qui examinerait d’autres questions constitutionnelles soulevées dans l’exercice de son mandat contreviendrait aux dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867 sur le pouvoir judiciaire, en particulier à l’art. 96. La question qui lui est posée dans un tel cas est la question relativement restreinte qui relève de son mandat prévu par la loi. Comme le juge Desjardins le souligne dans l’arrêt Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada), précité, à la p. 279, il serait anormal que les tribunaux responsables de l’interprétation de la loi sur cette question ne puissent se prononcer intégralement sur la question, sous réserve du contrôle judiciaire. Je partage l’avis exprimé dans les décisions déjà citées qu’il s’agit d’une fonction tout à fait différente d’une déclaration formelle d’invalidité, qui relève uniquement de la compétence d’une cour fédérale.
Il semble assez naturel dans le contexte d’aujourd’hui que la pratique soit maintenant de soumettre à un tribunal une question constitutionnelle, plutôt que de demander initialement le contrôle judiciaire. Comme le juge Desjardins le fait aussi remarquer (à la p. 278), la Charte ajoute une nouvelle dimension au système juridique canadien en ce qu’elle accorde maintenant aux individus des droits qui n’existaient pas auparavant contre les textes législatifs. Elle souligne ceci, à la p. 279 : « Rien d’étonnant à ce que des individus, qui prétendent avoir ces droits, les réclament dans des organismes qui ont été créés pour départager de façon expéditive leurs droits vis-à-vis [de] l’administration ». Dans les arrêts Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307, Conseil canadien des relations du travail c. Paul L’Anglais Inc., précité, et Northern Telecom Canada Ltd.
c. Syndicat des travailleurs en communication du Canada, précité, notre Cour a accepté que les tribunaux, dans l’exercice de leur mandat, se prononcent sur des questions constitutionnelles. Dans le dernier arrêt, le juge Estey a écrit, aux pp. 741 et 742 :
Il est essentiel, dans un régime fédéral comme celui que crée la Loi constitutionnelle, que les tribunaux soient, dans la société, l’autorité qui contrôle les bornes de la souveraineté propre des deux gouvernements pléniers et celle qui surveille les organismes à l’intérieur de ces sphères pour vérifier que leurs activités demeurent dans les limites de la loi. Ces deux rôles appartiennent, cela va de soi, aux tribunaux selon leurs compétences respectives. L’arrêt Jabour, précité, visait les cours supérieures de compétence générale dans les provinces, mais les mêmes principes s’appliquent aux cours de juridiction inférieure lorsqu’elles agissent dans les limites de leur compétence qui est définie par leur loi constitutive. Ces cours doivent, pour appliquer les lois du pays, que ces lois soient fédérales ou provinciales, déterminer la valeur constitutionnelle de la mesure en cause si le problème se pose. Ces cours qui ont une compétence d’exception doivent, cela va de soi, se prononcer sur une affaire qui est légalement de leur ressort.
J’estime en outre que rien dans le partage des pouvoirs entre les fonctions législatives, exécutives et judiciaires n’empêche un tribunal d’exercer ainsi sa compétence. Bien que, de façon générale, ce partage de pouvoirs existe (voir l’arrêt Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455, aux pp. 469 et 470), il n’est pas défini de façon rigide dans notre système de gouvernement. Le juge Dickson (avant d’être juge en chef) s’est exprimé ainsi dans le Renvoi relatif à la Loi de 1979 sur la location résidentielle, [1981] 1 R.C.S. 714, à la p. 728 :
Comme le professeur Hogg l’a souligné dans l’ouvrage Constitutional Law of Canada (1977), à la p. 129, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 ne prévoit pas une « séparation générale des pouvoirs ». Notre constitution ne sépare pas les fonctions législative, exécutive et judiciaire, et insiste que chaque secteur de gouvernement n’exerce que ses propres fonctions. Ainsi, il est évident que la législature de l’Ontario peut attribuer des fonctions non judiciaires aux cours de l’Ontario et, sous réserve de l’art. 96 de l’A.A.N.B. qui est au centre du présent pourvoi, attribuer des fonctions judiciaires à un organisme qui n’est pas une cour.
Sur cette question, je partage l’affirmation suivante du professeur Pépin dans « La compétence des tribunaux administratifs de décider de la constitutionnalité d’une loi, notamment de sa compatibilité avec la Charte canadienne des droits et libertés » (Ottawa 1989), Barreau canadien – Programme national de F.J.P. 71 :
La théorie de la séparation des pouvoirs nous invite tout au plus à prendre conscience qu’il ne convient pas de déléguer allègrement d’importantes fonctions judiciaires à des organismes administratifs, surtout s’ils ne sont pas organisés de façon adéquate.
Je sais que des considérations pratiques importantes interviennent dans la décision de permettre ou non aux tribunaux administratifs de se prononcer sur des questions constitutionnelles. Les avantages et les inconvénients de cette décision ont déjà donné lieu à de nombreux débats théoriques ; voir Pépin, précité ; Gosselin « L’alchimie des Chartes vue de l’intérieur du tribunal administratif : le retour au Cheval de Troie ? » (1989), Les Tribunaux administratifs à la lumière des chartes, Barreau du Québec ; Côté, « La recevabilité des arguments fondés sur les chartes des droits devant les tribunaux administratifs » (1989), 49 R. du B. 455 ; Pinard, « Le pouvoir des tribunaux administratifs québécois de refuser de donner effet à des textes qu’ils jugent inconstitutionnels » (1987), R.D. McGill 170 ; Evans, « Administrative Tribunals and Charter Challenges » (1988), 2 C.J.A.L.P. 13 ; Murray, « Labour Arbitration and the Charter », Labour Law, New Swords and New Shields : The Year in Review in Labour Law (Canadian Bar Association – Annual Institute on Continuing Legal Education) (1987) ; Kuttner, « Constitution as Covenant : Labour Law, Labour Boards and the Courts from the Old to the New Dispensation » dans Labour Law Under the Charter (1988) ; Les tribunaux administratifs (Rapport Ouellette 1987) ; Review of Ontario’s Regulatory Agencies (Macauley Report 1989).
Parmi les inconvénients cités par ces auteurs, est celui de s’opposer à la raison d’être des tribunaux administratifs – la spécialisation des fonctions, la simplicité des règles de preuve et de procédure, la rapidité des décisions. Encore une fois, les tribunaux ne sont pas tous du même calibre. Ils ne sont pas nécessairement présidés par des juristes, et ne comportent pas la garantie d’indépendance des cours de justice. En outre, les parties ne disposeront peut-être pas toujours du type de preuve requis pour résoudre des questions fondées sur la Charte de sorte que le dossier sera incomplet non seulement devant l’arbitre ou d’autres tribunaux, mais en fin de compte devant une cour au moment du contrôle judiciaire. Devant les cours, une disposition permet d’obtenir la participation du procureur général de la province, participation qui, comme le juge Finlayson le souligne dans l’arrêt Cuddy Chicks Ltd. v. Ontario (Labour Relations Board), précité, à la p. 145, peut ne pas être appropriée dans le cas de tribunaux administratifs. Le professeur Pépin, précité, aux pp. 15 et 16, énumère plusieurs de ces difficultés dans l’extrait suivant :
À mon avis, les tribunaux administratifs n’ont pas été créés pour décider de la constitutionnalité des lois. Confier pareille responsabilité à ces tribunaux, c’est aller à l’encontre de leurs raisons d’être : spécialisation des fonctions, simplicité et originalité des règles de procédure et de preuve, rapidité des décisions, présence de non juristes chez les décideurs ; c’est accentuer leur « allure » judiciaire ; c’est exacerber les difficultés relatives à certaines garanties d’indépendance que l’on commence à vouloir exiger de leurs membres ; c’est multiplier les occasions de contrôle judiciaire sur les décisions de ces organismes alors que les cours supérieures commencent à leur reconnaître une certaine autonomie dans les domaines relevant de leur compétence naturelle (« home territory »).
Les tribunaux administratifs ne sont pas un forum approprié pour débattre de ce qui est raisonnable dans une société libre et démocratique ou pour décider de la constitutionnalité des lois auxquelles ils doivent leur existence et leurs attributions.
Ceux qui s’opposent à ce que les tribunaux se prononcent sur des questions constitutionnelles invoquent également la position américaine où la clause de suprématie de la Constitution des États-Unis, l’art. VI, ressemble beaucoup au par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans ce pays, la règle, en ce qui concerne le palier fédéral au moins, est que les organismes administratifs ne peuvent se prononcer sur des questions constitutionnelles ; voir Davis Administrative Law Treatise, 2nd ed., vol. 4, pp. 434 et 435. Mais cette conception semble être justifiée aux États-Unis en raison de la séparation rigide des pouvoirs ; voir Corpus Juris Secundum (1983), vol. 73, aux pp. 535 et 536. Comme je l’ai déjà dit, cette théorie n’a pas sa place dans la structure constitutionnelle canadienne. Qui plus est, l’arrêt Southern Pacific Transportation Co. v. Public Utilities Commission, 18 Cal.3d 308 (1976), de la Cour suprême de la Californie a proposé la réévaluation générale de cette théorie ; voir la Note, « The Authority of Administrative Agencies to Consider the Constitutionality of Statutes » (1976-77), 90 Harv. L. Rev. 1682. Pour ces raisons, je pense que nous devrions hésiter à suivre la conception américaine dans ce domaine.
Je ne pense pas non plus que les considérations pratiques déjà mentionnées, qui ont pourtant un certain poids, devraient dissuader notre Cour d’adopter ce qui est maintenant le courant clairement prédominant chez les tribunaux de notre pays. Car s’il y a des inconvénients à permettre aux arbitres ou à d’autres tribunaux administratifs de se prononcer sur des questions constitutionnelles dans l’exercice de leur mandat, il y a également des avantages évidents. D’abord et avant tout, il va de soi que la Constitution doit être respectée. Le citoyen, qui comparaît devant des organismes décisionnels établis pour se prononcer sur ses droits et ses devoirs, devrait pouvoir faire valoir les droits et libertés garantis par la Constitution. Le professeur Côté, précité, s’exprime ainsi sur la question, à la p. 462 :
… malgré les inconvénients réels que cela implique, on doit reconnaître la possibilité aux justiciables de faire valoir leurs droits constitutionnels devant les tribunaux administratifs. Si l’on devait décider en dernier ressort que les tribunaux administratifs sont tenus d’appliquer un texte législatif incompatible avec la Charte, on porterait un dur coup à l’autorité de la Constitution, car cela impliquerait que, devant ces organes de l’exécutif, c’est en pratique la loi qui a préséance sur la Charte. Le « gouvernement » serait soumis à la Charte sauf lorsqu’il emprunte la forme particulière du tribunal administratif. Celui-ci jouirait ainsi, au nom de l’efficacité et de la spécialisation des tâches, d’un statut particulier au sein de l’Administration.
Il existe des avantages certains à soulever ces questions devant le tribunal. La question peut être soulevée au début du processus dans le contexte où elle se pose sans que le citoyen soit obligé de s’adresser d’abord à un autre organisme, une cour, où les frais sont plus élevés et les délais plus longs. Comme le juge Marceau le souligne dans l’arrêt Poirier c. Canada (Ministre des Affaires des anciens combattants), précité, à la p. 247, bien que le citoyen puisse dans certains cas juger utile de suivre cette voie, la vérité est qu’il arrive souvent que les décisions rendues à ce niveau ne soient pas contestées ; voir Cuddy Chicks Ltd. v. Ontario (Labour Relations Board), précité, à la p. 132, le juge Grange. Je pense qu’une personne ne devrait pas être obligée de faire trancher ces questions devant un palier supérieur.
Il y a également des avantages certains pour le processus décisionnel à permettre que des procédures simples, expéditives et peu coûteuses d’organismes d’arbitrage et administratifs fassent le tri des faits et établissent un dossier pour le bénéfice d’un tribunal d’appel. Sur cette question comme sur d’autres, il est important de bénéficier de l’expertise de l’arbitre ou de l’organisme. Cette compétence spécialisée peut être d’une aide inestimable en matière d’interprétation constitutionnelle. Le professeur Pinard, précité, aux pp. 173 et 174, a attiré l’attention sur ce facteur dans l’extrait suivant :
… les tribunaux administratifs possèdent une compétence, une expertise et une connaissance d’un milieu particulier qu’ils pourraient avantageusement mettre au service de la mise en {œ}uvre de la primauté de la Constitution. Leur position privilégiée quant à l’appréhension des faits pertinents leur permet d’élaborer une approche fonctionnelle des droits et libertés tout comme des préceptes constitutionnels généraux.
La note de la Harvard Law Review déjà mentionnée s’étend sur cette question (pp. 1694 à 1697). Par exemple, cette étude souligne que dans les cas de dispositions législatives susceptibles d’interprétations différentes, qui soulèvent ou non des problèmes constitutionnels, il est extrêmement important que l’évaluation judiciaire des différentes possibilités ne soit pas examinée dans le vide. L’opinion éclairée du tribunal est inestimable. Et, du point de vue du fonctionnement des organismes lui-même, je pense qu’il est important que ceux qui sont appelés à prendre des décisions gouvernementales portent leur attention sur les valeurs consacrées par la Charte. Je devrais ajouter que les décisions constitutionnelles des arbitres ou des autres tribunaux ou organismes administratifs ne devraient évidemment pas bénéficier de la déférence judiciaire ; voir Cuddy Chicks Ltd. v. Ontario (Labour Relations Board), précité, à la p. 31, le juge Grange.
Dans ce cas, en effet, ils n’agissent pas dans les limites de leur expertise.
Puisqu’en l’espèce l’arbitre pouvait, en vertu de son mandat, examiner la validité de l’article 4.04 de la convention collective, je partage l’avis de la Cour d’Appel qu’il est tout à fait inutile d’examiner si l’arbitre était un « tribunal compétent » au sens du par. 24(1) et je n’ai donc pas l’intention d’aller plus loin sur ce point.
Dispositif
Je souligne encore que le tribunal n’a pas traité des questions de savoir si la violation de l’art. 15 était justifiée en vertu de l’article premier de la Charte ou si, après avoir consenti à la convention collective, les membres de l’association devraient être irrecevables à invoquer leurs droits constitutionnels ou devraient être réputés y avoir renoncé. Par conséquent, la Cour d’Appel et notre Cour n’ont pas été appelées à trancher ces questions, qui devaient être traitées à la deuxième étape des audiences arbitrales.
Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens. Je suis d’avis de répondre aux questions constitutionnelles de la façon suivante :
9512 1. La Charte canadienne des droits et libertés s’applique-t-elle à la négociation et à l’application de la disposition sur la retraite dans la convention collective liant l’appelant et l’intimée ?
– 9512 Oui.
9512 2. Cette disposition ou son application constitue-t-elle la « loi » au sens de ce terme au par. 15(1) de la Charte ?
– 9512 Oui.
9512 3. Un conseil d’arbitrage nommé par les parties en vertu de la convention collective pour résoudre un grief contestant la constitutionnalité de cette disposition est-il un tribunal compétent aux termes du par. 24(1) de la Charte ?
9512 Il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.
9512 4. Un conseil d’arbitrage peut-il connaître d’un tel grief ?
9512 Oui, dans l’exercice de son mandat.
-
[1]
Jurisprudence confirmée notamment par les arrêts :
Tétrault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immiration) du 6 juin 1991.
Cuddy Chicks Ltd. C. Ontario (Commission des relations de travail) du 6 juin 1991.
Weber c. Ontario Hydro du 29 juin 1995.
et Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles) du 8 février 1996. [Retour au contenu]
L’assistance au justiciable partie à un procès constitutionnel
les textes canadiens
Programme de contestation judiciaire du Canada [1]
Le Programme de contestation judiciaire du Canada est un organisme national, sans but lucratif, créé en 1994 pour financer les actions en justice qui feront évoluer les droits à l’égalité et les droits linguistiques garantis par la Constitution canadienne.
Le Programme est dirigé par un conseil d’administration composé de bénévoles qui sont responsables de la bonne marche administrative du Programme. S’ajoutent au conseil, des comités distincts, qui assument de manière indépendante les décisions s’appliquant aux causes financées et aux montants accordés. Le Comité des droits à l’égalité et le Comité des droits linguistiques sont composés de personnes expérimentées, qui allient leurs connaissances à un engagement tant sur les questions de droits linguistiques ou d’égalité que dans les organismes communautaires.
Quels types de causes le Programme finance-t-il ?
Le Programme finance les causes invoquant les droits linguistiques aux niveaux fédéral ou provincial, garantis par la Constitution du Canada. Sont également financées, les causes contestant les lois, les politiques ou pratiques fédérales fondées sur l’article 15 (égalité) de la Charte canadienne des
droits et libertés. Les causes ne sont financées que si elles sont susceptibles de modifier une loi, une politique ou une pratique de manière à ce que celle-ci respecte les droits linguistiques ou les droits à l’égalité.
Financement des causes de droits à l’égalité
Il y a quatre catégories de financement disponible pour des causes de droits à l’égalité : le financement pour l’élaboration d’une action, le financement d’une action en justice, le financement d’une étude d’impact, et la promotion et accès au Programme.
Le financement pour l’élaboration d’une action est disponible pour faire des recherches et consultations avant que la cause ne soit entendue devant les tribunaux.
Le financement d’une action en justice est disponible pour défrayer les coûts de la démarche devant les tribunaux.
Le financement d’une étude d’impact sera consenti à une personne ou à un groupe qualifié pour leur permettre de faire des recherches sur une décision et de préparer un document de travail qui identifiera les impacts potentiels du jugement.
Le financement pour la promotion et l’accès au Programme peut être accordé à des activités liées à l’égalité, telles des réunions de consultations stratégiques sur des questions juridiques particulières de droits à l’égalité. On peut également financer des réunions où l’on abordera des causes de droits à l’égalité et la production de matériel d’information ou de documents de travail. Ce financement vise à ce que les gens comprennent mieux ce qu’est l’égalité et ce que le Programme de contestation judiciaire fait pour promouvoir les droits à l’égalité.
Financement des causes portant sur les droits linguistiques
Il y a quatre (4) catégories de financement disponible pour des causes de droits linguistiques : le financement pour les négociations, le financement pour l’élaboration d’une action, le financement d’une action en justice et le financement d’une étude d’impact.
Le financement pour l’élaboration d’une action est disponible pour faire des recherches et consultations avant que la cause ne soit entendue devant les tribunaux.
Le financement d’une action en justice est disponible pour défrayer les coûts de la démarche devant les tribunaux.
Le financement d’une étude d’impact est consenti à une personne ou à un groupe qualifié pour leur permettre de faire des recherches sur la décision et de préparer un document de travail qui identifiera les impacts potentiels du jugement.
Le financement pour les négociations est disponible pour résoudre une action liée aux droits linguistiques en discutant avec des représentants du gouvernement engagés dans l’action ; on arrive ainsi à une solution sans se présenter nécessairement devant les tribunaux.
Qu’est ce que le Programme ne peut financer ?
Selon l’entente avec le gouvernement, nous ne pouvons pas financer les éléments suivants :
- les contestations des lois, politiques ou pratiques provinciales (ceci uniquement à l’égard du financement des droits à l’égalité) ;
- les causes abordant des questions déjà financées par le Programme ou qui sont présentement devant les tribunaux ;
- les plaintes invoquant la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi sur les langues officielles ;
- l’éducation populaire, le développement communautaire, le lobbying ou les activités de pressions politiques.
Qui peut recevoir du financement du Programme ?
Le Programme n’accorde le financement qu’aux membres de groupe historiquement défavorisés, aux membres de groupes minoritaires de langues officielles ou à des organismes sans but lucratif qui représentent ces groupes.
Comment soumettre une demande de financement
Afin de traiter votre demande, nous devons savoir :
- qui est impliqué dans votre cause ou votre projet ;
- les questions – soulevées dans votre cause ou projet ;
- où et quand votre cause ou projet aura lieu ;
- pourquoi vous entreprenez cette démarche ;
- et comment le Programme peut vous appuyer.
Si vous avez déjà un avocat ou une avocate, ou si quelqu’un travaille avec vous à ce projet, vous pourriez lui demander de collaborer à l’élaboration de votre demande. Si vous ne le faites pas, donnez-nous le plus de détails possibles et nous vous aiderons à la compléter. Il n’y a pas de formulaire de demande de financement et cette demande est gratuite. Les demandes doivent être faites par écrit et comporter TOUS les renseignements indiqués plus loin, tels les copies de documents importants, un budget détaillé et un plan de travail. Les renseignements qui suivent visent à vous faciliter la tâche dans votre demande, en vous fournissant des directives concernant l’information à inclure à cette demande et dans votre plan de travail ainsi que la manière de préparer votre budget (veuillez consulter la rubrique Préparer votre budget).
Une liste de contrôle à faire paraît à la fin de ce guide. Il s’agit d’un rappel des choses à inclure à votre demande. Nous vous prions de nous faire parvenir une copie de cette liste avec votre demande de financement.
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DE L’INFORMATION
Jusqu’à ce qu’une décision de financement soit rendue, nous traitons les renseignements contenus dans votre demande, de manière confidentielle. Cela signifie que, sans votre consentement, nous ne divulguons ces renseignements à personne de l’extérieur du Programme. Ceci inclut votre nom, votre lieu de résidence, ce sur quoi porte la cause ou le projet et quels arguments vous entendez utiliser.
Nous ne faisons exception à cette règle que si l’information est déjà rendue publique. Par exemple, si votre cause est devant les tribunaux, elle est consignée aux registres publics. Dans ce cas, nous ne demanderons pas votre accord si nous voulons divulguer certains renseignements de nature publique.
CE QUE VOUS DEVEZ NOUS DIRE
Les pages suivantes identifient les renseignements spécifiques à votre cause, que nous devons recevoir afin que le Comité soit en mesure de prendre une décision sur le financement. Nous avons tenté de vous faciliter la tâche en distinguant les exigences liées aux différents types de demandes.
FINANCEMENT POUR UNE ACTION EN JUSTICE
Cette partie s’applique au financement d’actions en justice pour les parties ou pour les intervenants. Si vous avez retenu les services d’un avocat ou d’une avocate, vous pouvez lui demander de vous fournir l’information indiquée plus bas. En plus des renseignements généraux, voici ce que nous devons savoir :
Qui est impliqué – nous avons besoin de vos nom, adresse, numéros de téléphone, de télécopieur, et de tout autre renseignement nous permettant de communiquer avec vous ; nous devons avoir les mêmes renseignements pour votre avocate, s’il y a lieu ; nous voulons aussi connaître les qualifications de votre avocat.
Les faits – décrivez en détails ce qui est arrivé et pourquoi vous croyez devoir aller devant les tribunaux ; fournissez des renseignements sur les démarches que vous avez déjà entreprises afin de résoudre votre cas et comment cela a fonctionné jusqu’à maintenant.
Loi, politique et pratique – décrivez en détail la loi ou l’action du gouvernement que vous voulez contester et comment cela a violé vos droits ; envoyez une copie de la loi, si vous le pouvez.
Votre cause – identifiez quel ministère ou représentant gouvernemental vous entendez poursuivre et pourquoi ; indiquez à quel tribunal vous vous adresserez ; parlez-nous des jugements déjà rendus par les tribunaux dans votre cause.
Vos arguments/soutien à votre cause – décrivez les droits sur lesquels vous vous appuyez et d’où ils proviennent (la Charte, la Constitution) ; parlez-nous d’autres décisions des tribunaux concernant les questions soulevées par votre action et comment vous entendez les utiliser dans votre plaidoyer ; indiquez-nous s’il y a d’autres parties ou intervenants qui soutiennent votre cause ; identifiez les groupes communautaires et autres qui vous appuient et vous aident sans être engagés dans votre action.
Opposition à votre cause – décrivez les jugements d’autres tribunaux qui pourraient nuire à votre cause et comment votre action est différente des autres ; dites-nous ce que vous pensez que le gouvernement utilisera comme arguments dans votre cause ; parleznous de tout autre intervenant qui est en désaccord avec votre point de vue.
La preuve – décrivez les témoins que vous ferez comparaître en cour et ce que vous croyez qu’ils diront ; décrivez tout document que vous entendez présenter en cour et faites parvenir des copies au Programme ; détaillez les démarches de recherche et de consultation que vous devez entreprendre dans votre préparation et pourquoi vous désirez les effectuer.
Solution – décrivez ce que vous voulez
que le tribunal fasse à propos de la loi, politique ou pratique et comment ceci vous aidera personnellement, en plus d’être bénéfique aux autres.
Importance de votre cause – expliquez pourquoi cette cause est importante pour les membres des groupes défavorisés ou des communautés minoritaires de langues officielles ; expliquez pourquoi le Programme devrait financer cette cause.
Plan d’action – fournissez les grandes lignes de votre plan d’action ; quand la cause débutera (a débuté) devant les tribunaux ; quelles sont les étapes importantes de votre cause et quand vous prévoyez qu’elles surviendront ; qui vous appuiera à chaque étape.
FINANCEMENT DE L’ÉLABORATION D’UNE ACTION EN JUSTICE
Vous devriez consulter attentivement la partie portant sur le financement des causes. Nous voulons recevoir le plus grand nombre possible de ces renseignements à cette étape. Nous ne nous attendons pas à ce que tout soit prêt – la raison d’être du financement pour l’élaboration d’une action est précisément de vous aider à amasser toutes les informations pertinentes. Nous devons obtenir le plus de renseignements possibles concernant les aspects suivants :
- qui est impliqué ;
- les faits ;
- loi, politique ou pratique ;
- votre argumentation, soutien à votre cause ;
- solution ;
- importance de la cause.
Si vous soumettez une demande pour la tenue d’une consultation communautaire pendant le processus d’élaboration de l’action, nous vous prions de nous fournir les renseignements suivants :
Raison d’être – pourquoi vous désirez tenir une consultation et les bénéfices que vous attendez de cette démarche.
Qui – qui vous voulez consulter ; comment ils ont été choisis ; quelle expérience et connaissances ils peuvent apporter ; qui organisera la consultation.
Où/quand – où et quand les consultations auront lieu.
De plus, nous aurons besoin d’un plan de travail de l’élaboration de votre cause : ce plan indiquera ce que vous entendez faire dans le cadre de votre projet d’élaboration (incluant les consultations), les étapes importantes de votre plan de travail, qui réalisera ces étapes et quand elles seront accomplies.
FINANCEMENT D’UNE ÉTUDE D’IMPACT
Quand vous aurez choisi la cause que vous voulez considérer, nous aurons besoin des renseignements suivants afin d’en venir à une décision sur votre demande de financement pour une étude d’impact
La cause – le nom de la cause, quel tribunal en a jugé et quand ; envoyez une copie du texte complet du jugement rendu.
Pourquoi – dites-nous pourquoi cette cause devrait faire l’objet d’une étude ; décrivez brièvement quelle question ou groupe cette cause influencera dans l’avenir ; parleznous de tout organisme communautaire qui croit en l’importance de cette cause ; identifiez les personnes ou les groupes qui recevront une copie de votre étude lorsqu’elle sera terminée.
Qui – nous devons savoir qui vous êtes et comment communiquer avec vous (adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, etc.) ; identifiez qui effectuera l’étude d’impact et décrivez ses qualifications.
Plan de travail de l’étude d’impact – comment vous ou le recherchiste avez planifié votre étude ; à qui vous parlerez ; combien de temps cela prendra.
FINANCEMENT POUR LES NÉGOCIATIONS
(Droits linguistiques seulement)
Si vous soumettez une demande de financement pour les négociations dans une cause linguistique, vous devez nous dire :
Qui est impliqué – nous avons besoin de vos nom, adresse, numéros de téléphone, de télécopieur, et de tout autre renseignement nous permettant de communiquer avec vous ; nous devons avoir les mêmes renseignements pour votre avocate, s’il y a lieu ; nous voulons aussi connaître les qualifications de votre avocat.
Loi, politique et pratique – décrivez en détail la loi ou l’action du gouvernement que vous voulez contester et comment elle a violé vos droits linguistiques ; envoyez une copie de la loi.
Les faits – décrivez en détails, ce qui est arrivé et les raisons qui vous poussent à vouloir négocier avec le gouvernement dans ce domaine ; fournissez des renseignements sur les démarches que vous avez déjà entreprises afin de résoudre votre cas et comment cela a fonctionné jusqu’à maintenant.
Questions soulevées/Points de vue – décrivez en détails quels sont les éléments avec lesquels vous êtes en désaccord avec le gouvernement et ceux sur lesquels vous êtes en accord ; présentez votre point de vue concernant les questions qui exigent une négociation et dites-nous ce que le gouvernement exprime à propos de celles-ci ; le gouvernement a-t-il accepté de négocier ?
Soutien à votre cause – décrivez les droits sur lesquels vous vous appuyez et d’où ils proviennent (la Charte, la Constitution) ; parlez-nous d’autres décisions des tribunaux concernant les questions soulevées par votre action et comment vous entendez les utiliser dans vos négociations ; indiquez-nous s’il y a des groupes communautaires ou autres qui vous aident ou soutiennent votre cause.
Importance de la question soulevée – expliquez pourquoi cette question est importante pour les membres de communautés minoritaires de langues officielles ; expliquez pourquoi le Programme devrait financer les négociations entourant cette problématique.
Plan de travail des négociations – fournissez les grandes lignes de votre plan de négociations ; quelles sont les étapes importantes de vos négociations et quand vous prévoyez qu’elles surviendront ; qui vous appuiera à chaque étape des négociations
FINANCEMENT POUR LA PROMOTION ET L’ACCÈS AU PROGRAMME
(Droits à l’égalité seulement)
Le financement pour la promotion et l’accès au Programme est accordé pour une gamme d’activités. Les renseignements suivants ne sont qu’un aperçu général, un guide. S’il y a des renseignements qui ne sont pas pertinents à votre projet, vous n’êtes pas tenus de nous les faire parvenir.
Quoi – fournissez une description détaillée de votre projet ; les questions liées aux droits à l’égalité qui seront abordées ; qui participera et qui sera consulté ; quelles expériences et connaissances apporteront ces personnes au projet ; quel sera le résultat final – document de travail, dépliant, rapport de consultation ; à qui ils seront distribués.
Pourquoi – décrivez l’importance de ce projet pour la communauté luttant pour les droits à l’égalité ; qui sera touché par les questions soulevées par votre projet ; qui bénéficiera de votre projet ; pourquoi vous êtes intéressé à réaliser ce projet ; comment ce projet est pertinent au mandat de promotion et d’accès au Programme.
Qui – nous devons savoir qui vous êtes et comment communiquer avec vous (adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, etc.) ; identifiez qui sera responsable du projet et ses qualifications.
Où et quand – si votre projet comprend des rencontres ou des consultations, indiquez les dates, l’heure et les lieux de ces réunions.
Plan de travail du projet – fournissez un plan de travail détaillé, incluant une liste des étapes-clés et du moment où elles seront complétées.
COPIES DE DOCUMENTS IMPORTANTS
Pour faciliter votre accès au financement, nous devons bien saisir votre cause ou projet. Si vous possédez des documents qui nous aideraient en ce sens, veuillez nous les faire parvenir.
Si vous ne pouvez acquitter les frais encourus, nous nous chargerons de photocopier les documents que vous voulez inclure à votre demande et de vous les remettre.
Nous aimerions obtenir copie des documents suivants, s’ils sont pertinents à votre cause :
Lettres-notes – des lettres que vous avez envoyées ou reçues du gouvernement ou de ceux qui ont été engagés dans votre cause ou projet ; des lettres de groupes et organismes intéressés à votre cause ou projet ; notes des rencontres où votre cause ou projet a été discuté.
Publications-Documents de travail – si vous êtes à élaborer ou si vous utilisez une publication ou un document de travail existant, nous aimerions en obtenir copie ; si ces documents ne sont pas disponibles au moment de votre demande veuillez nous les faire parvenir dès qu’ils le seront.
Document des tribunaux – nous aimerions consulter tous les documents importants que votre avocat a déposés en cour ; il peut s’agir par exemple, de « plaidoyers » ou « factums ». Votre avocat ou votre avocate peut vous aider à identifier ceux dont vous aurez besoin ; il se pourrait que nous vous demandions également des copies de documents que d’autres personnes engagées dans votre cause ont déposés en cour.
Éléments spécifiques – nous nous attendons à ce que vous nous fassiez parvenir les documents ou dossiers particuliers que nous requérons. Nous ne demandons que les items qui nous permettront une compréhension approfondie de votre cause.
-
[1]
Documents signalés par la Cour suprême du Canada, disponibles en ligne à l’adresse http ://www.ccppcj.ca. [Retour au contenu]
Le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire et la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples
Résolution de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur le droit à un procès équitable
et à l’assistance judiciaire en Afrique ;
26e session ordinaire, 1-15 novembre 1999, Kigali, Rwanda
Kigali, le 15 novembre 1999.
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, réunie en sa 26e session ordinaire, tenue à Kigali, Rwanda, du 1er au 15 novembre 1999 ;
Considérant les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatives au droit à un procès équitable, en particulier les articles 7 et 26 ;
Rappelant la résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès équitable adoptée lors de sa 11e session ordinaire tenue à Tunis, Tunisie, en mars 1992 ;
Rappelant également la résolution sur le respect et le renforcement de l’indépendance de la magistrature adoptée lors de la 19e session ordinaire tenue à Ouagadougou, Burkina Faso, en mars 1996 ;
Prenant bonne note des recommandations du séminaire sur le droit à un procès équitable en Afrique organisé en collaboration avec la société africaine de droit international et comparé et Interights, à Dakar, Sénégal, du 9 au 11 septembre 1999 ;
Reconnaissant l’importance du droit à un procès équitable et l’assistance judiciaire et la nécessité de renforcer les dispositions de la Charte africaine relatives à ce droit ;
- Adopte la déclaration et les recommandations de Dakar sur le droit à un procès équitable en Afrique, ci-jointes ;
- Demande au secrétariat de faire parvenir la déclaration et les recommandations de Dakar aux ministères de la Justice et aux présidents de la Cour suprême de tous les États parties, aux associations d’avocats, aux écoles de droit d’Afrique et aux organisations non-gouvernementales ayant le statut d’observateur en d’en faire rapport à la 27e session ordinaire ;
- Décide de créer un groupe de travail sur le droit à un procès équitable sous la supervision du commissaire Kamel RezagBara et composé des autres membres de la Commission et des représentants d’organisations non gouvernementales ;
- Demande au groupe de travail de préparer un projet de principes généraux et de directives sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire à la lumière des dispositions de la Charte africaine, de le présenter à la 27e session ordinaire de la Commission et de solliciter les commentaires des membres de la Commission pendant la période comprise entre la 27e et la 28e sessions ;
- Demande également au groupe de travail de présenter un rapport à la 28e session ordinaire sur le projet définitif de principes généraux et de directives sur le droit à un procès équitable et l’assistance judiciaire pour examen ;
- Demande au secrétariat de fournir au groupe de travail tout l’appui et l’assistance nécessaires pour mener à bien sa mission.
Déclaration et recommandations de Dakar
Conformément à sa mission qui vise la promotion et la protection des droits humains en Afrique, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) a organisé à Dakar, au Sénégal, du 9 au 11 septembre 1999, en collaboration avec la société de droit international et comparé et INTERIGHTS, un séminaire sur le droit à un procès équitable. Les participants à ce séminaire ont eu le privilège d’entendre plusieurs communications présentées par une grande variété d’experts, d’universitaires, de militants des droits humains, d’avocats et de magistrats issus, en particulier, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, de la Cour internationale de justice, de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et du Tribunal international pour le Rwanda, ainsi que d’ONG africaines et internationales qui ont permis de faire une analyse comparée de la mise en œuvre du principe du droit à un procès équitable.
Les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, notamment en ses articles 7 et 26, la Résolution sur le droit à une procédure de recours et à un procès équitable adoptée, en mars 1992, à Tunis, et la résolution sur le respect et le renforcement de l’indépendance des magistrats adoptée à Ouagadougou, en mars 1996, ont servi de base aux débats. Le séminaire a également examiné les conclusions et recommandations du séminaire international sur le droit à un procès équitable, qui avait été organisé, en décembre 1995, au Caire, par l’Union des avocats arabes, en collaboration avec la Commission.
Par ailleurs, les participants ont tenu compte des contextes politique, social et économique qui influent sur le respect du droit à un procès équitable en Afrique, notamment les conflits armés et autres situations qui engendrent de massives violations des droits humains, et ils ont exprimé leur préoccupation du fait que la ratification, par les États africains, des instruments des droits humains n’est pas toujours suivie par la prise de mesures concrètes visant à mettre en œuvre les obligations souscrites dans le cadre de ces traités.
Les participants ont identifié diverses questions qui entravent la mise en œuvre du droit à un procès équitable ainsi que les mesures susceptibles de permettre une protection efficace de ce droit en Afrique. Des questions spécifiques ont été mises en exergue au cours des débats afin de définir les mesures pratiques que devraient prendre les différents acteurs tels que la Commission, les États africains, les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, les praticiens du droit et les organisations non gouvernementales, pour garantir et promouvoir l’application des normes qui régissent les procès équitables.
Déclaration
Le droit à un procès équitable est un droit fondamental dont la violation porte atteinte à tous les autres droits. C’est pourquoi il n’est pas possible d’y déroger compte tenu, notamment, du fait que la Charte africaine ne prévoit expressément aucune dérogation aux droits qu’elle garantit. La réalisation de ce droit dépend de l’existence de certaines conditions et elle est entravée par certaines pratiques, en particulier :
1. État de droit, démocratie et procès équitable
Le droit à un procès équitable ne peut être pleinement respecté que dans un environnement dans lequel l’État de droit ainsi que les droits et libertés fondamentaux sont observés. L’État de droit suppose l’existence d’institutions politiques soumises à une stricte obligation de rendre compte.
2. Indépendance et impartialité des magistrats
Même s’il existe, dans la plupart des pays africains, des dispositions constitutionnelles et légales qui posent le principe de l’indépendance des magistrats, ces dispositions ne suffisent pas, à elles seules, à garantir l’indépendance et l’impartialité des magistrats. Parmi les questions et pratiques qui portent atteinte à l’impartialité et à l’indépendance des magistrats on note, entre autres, l’absence de procédures transparentes et impartiales pour la nomination des juges, les ingérences de l’exécutif dans l’administration de la justice et sa prééminence dans les affaires judiciaires, l’absence de la sécurité de l’emploi et d’une rémunération garantie et l’insuffisance des ressources destinées au système judiciaire.
3. Tribunaux militaires et juridictions spéciales
Dans de nombreux pays africains, les tribunaux militaires et les juridictions spéciales existent à côté des institutions judiciaires ordinaires. Les tribunaux militaires ont pour objectif de connaître des infractions de nature purement militaire commises par le personnel militaire. Les tribunaux militaires sont tenus de respecter les normes relatives au procès équitable dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. En tout état de cause, ils ne doivent, en aucun cas, exercer leur juridiction sur des civils. De même, les tribunaux spéciaux ne doivent pas connaître des infractions qui ressortissent à la compétence des tribunaux ordinaires.
4. Tribunaux traditionnels
Il est reconnu que les tribunaux traditionnels sont en mesure de jouer un rôle dans l’instauration de sociétés pacifiques et d’exercer leur autorité sur une importante frange de la population des pays africains. Cependant, ces tribunaux ont également de graves insuffisances qui résultent, souvent, en un déni du droit à un procès équitable. Les tribunaux traditionnels ne dérogent pas aux dispositions de la Charte africaine relatives aux procès équitables.
5. Indépendance des avocats et des barreaux
L’existence d’un barreau indépendant est indispensable pour assurer la protection des garanties à un procès équitable. Les barreaux doivent protéger et défendre l’indépendance de leurs membres. L’aptitude des avocats à représenter leurs clients sans être menacés par des actes de harcèlement, d’intimidation ou d’ingérence est une composante essentielle du droit à un procès équitable. Dans maints pays, les avocats chargés de défendre des causes impopulaires ou des individus ou des groupes perçus comme des opposants au gouvernement s’exposent au harcèlement ou à la persécution. Il existe un moyen efficace pour protéger les avocats, il consiste à s’abstenir de les assimiler avec leurs clients ou avec les intérêts de ces clients alors qu’ils ne font qu’exercer leur fonction. Les relations entre barreaux de pays différents et la possibilité, pour les avocats africains, de défendre un individu dans un pays autre que celui dont ils sont ressortissants renforce l’indépendance des avocats et des barreaux.
6. Autres défenseurs des droits humains
Les parajuristes, les parents ou les familles des victimes des violations des droits humains et de crimes ou de personnes suspectées ou accusées, ainsi que les militants des droits humains représentant des victimes, des individus suspectés ou accusés ne devraient pas être confondus avec les personnes qu’ils défendent et, par conséquent, ils ne devraient pas être soumis à des actes de harcèlement ou de persécution lorsqu’ils agissent dans le cadre de la protection des droits humains de ces individus, notamment du droit à un procès équitable.
7. Impunité et réparations efficaces
Lorsque l’État manque de prendre correctement en charge les violations des droits humains, cette situation est, souvent, source d’un déni de justice systématique et, parfois, de conflit et de guerre civile. Dans les sociétés qui sortent d’une situation de conflit, le droit à une réparation et à une justice efficaces est souvent ignoré pour des raisons d’opportunité politique. Le droit à un procès équitable ne permet pas le recours à l’amnistie pour absoudre les auteurs de violations des droits humains de leurs responsabilités.
8. Victimes de crimes et d’abus de pouvoir
Le droit à un procès équitable reste sans objet tant que les victimes de crimes et d’abus de pouvoir n’ont pas la possibilité de saisir les tribunaux et d’obtenir une réparation effective. Les normes en matière de droit de l’homme et les lois et procédures nationales ne protègent pas efficacement les droits et intérêts des victimes fondées à bénéficier de procédures judiciaires équitables et efficaces qui protègent leur bien être et leur dignité.
9. Assistance judiciaire
L’assistant judiciaire est un élément essentiel du droit à un procès équitable. La plupart des personnes accusées et lésées n’ont pas les moyens de rémunérer des services juridiques compte tenu du coût élevé des frais de justice et des honoraires des avocats. Il incombe aux gouvernements de fournir une assistance juridique aux indigents afin de rendre plus effectif le droit à un procès équitable. La contribution des magistrats ainsi que celle des ONG et associations professionnelles qui interviennent dans le domaine des droits humains devrait être encouragée.
10. Femmes et procès équitable
Les processus et institutions juridiques reflètent les discriminations dont les femmes sont victimes au sein de la société. La discrimination fondée sur le genre pénalise les femmes lorsqu’elles veulent avoir accès à la justice ainsi que quand elles sont parties à un procès, accusées dans le cadre d’une procédure pénale, victimes d’un acte criminel, témoins et avocats comparaissant devant les institutions judiciaires. Les femmes ne sont pas suffisamment présentes dans les postes de l’administration judiciaire et les procédures légales ne tiennent pas assez compte des questions qui les touchent.
11. Enfants et procès équitable
Les enfants sont fondés à jouir de toutes les garanties et droits à un procès équitable applicables aux adultes et même à une protection supplémentaire. La charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant requiert que « tout enfant accusé ou convaincu d’une infraction à la législation pénale a droit à un traitement spécial adapté à son sens de la dignité et de sa propre valeur et susceptible de renforcer, chez lui, le respect des droits humains et des libertés fondamentales. »
Recommandations
La Commission africaine devrait :
- regrouper et exposer toutes ses déclarations sur le droit à un procès équitable dans un ensemble de principes cohérents, en harmonie avec l’article 45(I)(b) de la Charte africaine ;
- définir comme prioritaires certains aspects du procès équitable en Afrique, tels que l’accès à l’assistance judiciaire, les procès dans les tribunaux militaires ou traditionnels, l’impunité et la discrimination exercée à l’endroit des femmes dans les procédures judiciaires, en vue de leur examen au cours des sessions ordinaires ;
- donner comme instruction à ses rapporteurs spéciaux de prêter une attention toute particulière aux aspects du droit à un procès équitable qui entrent dans le cadre de leur compétence ou qui s’y rapportent ;
- assurer le suivi des efforts visant à faciliter l’accès à la justice et à permettre une réparation effective en demandant aux États parties de prévoir dans leurs rapports une section spéciale réservée à la mise en œuvre du droit à un procès équitable, notamment une analyse des ressources mises à la disposition des institutions judiciaires dans le cadre du budget national ;
- prendre en charge la question du droit à un procès équitable, en particulier celle de l’indépendance des magistrats, et établir le contact avec les magistrats et les barreaux locaux à l’occasion des missions de promotion et de protection effectuées dans d’autres Etats ;
- œuvrer, en collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l’homme et les autres institutions intergouvernementales appropriées, à la fourniture d’une assistance technique aux Etats dans le but d’améliorer les performances et les procédures des institutions judiciaires touchant à la réalisation du droit à un procès équitable ;
- créer un mécanisme spécifique de suivi et surveiller l’application du droit à un procès équitable en Afrique ;
- distribuer, chaque année, un recueil de ses décisions et résolutions aux ministères de la justice des différents Etats en demandant qu’il soit mis à la disposition des écoles de droit, des fonctionnaires de l’ordre judiciaire, des centres de formation judiciaire, des barreaux et des services chargés de faire appliquer la loi ;
- transmettre ce document au Ministère de la Justice et au chef de l’administration judiciaire de chaque État en leur demandant de le distribuer aux fonctionnaires de la justice et des services chargés de faire appliquer la loi, aux barreaux et aux écoles de droit.
Les États parties à la Charte africaine devraient :
- doter les institutions judiciaires ainsi que celles chargées de faire appliquer la loi de ressources suffisantes afin de leur permettre de fournir aux individus ayant recours au processus juridique des garanties plus efficaces et plus effectives en matière de procès équitable ;
- examiner, en urgence, les voies et moyens par lesquels une assistance judiciaire pourrait aussi être fournie aux personnes accusées se trouvant dans une situation d’indigence, notamment par l’intermédiaire de programmes de défense publique et d’assistance judiciaire dotés de financements adéquats ;
- en collaboration avec les barreaux et ONG, permettre la création de nouveaux programmes d’assistance judiciaire novateurs et, en particulier, permettre aux parajuristes de fournir, pendant l’étape précédant le procès, une assistance judiciaire aux personnes suspectées qui se trouvent en situation d’indigence ainsi qu’une représentation pro bono aux personnes accusées dans le cadre de poursuites pénales ;
- solliciter l’assistance du Haut Commissariat aux droits de l’homme, d’autres agences des Nations Unies et de sources bilatérales et multilatérales afin d’amender les dispositions constitutionnelles et légales en vue d’une mise en œuvre effective du droit à un procès équitable, notamment de la protection des droits des victimes d’actes criminels et d’abus de pouvoir et de leurs avocats ;
- améliorer les compétences dans le domaine judiciaire par la mise en œuvre de programmes d’éducation continue, en accordant une attention toute particulière à l’application, au niveau national, des normes internationales des droits humains, et accroître les ressources des institutions judiciaires et de celles chargées de faire appliquer la loi ;
- incorporer la Charte africaine dans leur législation nationale et adopter, au niveau national, des mesures concrètes pour mettre en œuvre leurs obligations en vertu de la Charte, notamment par des mesures spécifiques garantissant le respect de l’obligation de protéger le droit à un procès équitable ;
- prendre immédiatement des mesures visant à garantir une représentation plus satisfaisante et plus effective des femmes devant les institutions judiciaires, amender les procédures judiciaires ayant des effets discriminatoires pour les femmes et susciter une prise de conscience de la dimension genre chez les fonctionnaires de l’ordre judiciaire ainsi que chez ceux appartenant aux services chargés de faire appliquer la loi ;
- prévoir, dans les rapports périodiques qu’ils rédigent à l’intention de la Commission, une section spéciale concernant la mise en œuvre du droit à un procès équitable, notamment une étude sur les ressources mobilisées au profit des institutions judiciaires dans le cadre du budget national ;
- œuvrer, en collaboration avec les communautés locales, à l’identification et au règlement des problèmes qui se posent au niveau des tribunaux traditionnels et qui entravent la réalisation du droit à un procès équitable ;
- veiller à ce que la législation soit appliquée sans discrimination aux citoyens ordinaires comme aux personnalités publiques et que les actes d’abus de pouvoir fassent l’objet d’une prompte investigation afin que les personnes déclarées coupables soient poursuivies ;
- fixer l’âge de la responsabilité pénale au-dessous duquel les enfants seront présumés incapables de commettre une infraction criminelle et mettre en place des procédures et institutions distinctes ou spécifiques pourtraiter les cas d’enfants accusés ;
- ratifier, s’ils ne l’ont pas déjà fait, tous les traités se rapportant au droit à un procès équitable, notamment le Protocole de la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant et les statuts de la Cour pénale internationale ;
- respecter l’indépendance des avocats et des barreaux, en particulier leur droit à remplir leur mission sans être soumis à une forme quelconque d’ingérence et / ou d’intimidation ;
- veiller à ce que tous les procès devant les tribunaux militaires respectent les principes du droit à un procès équitable et que les civils ne soient pas traduits devant ces juridictions ;
- prendre des mesures afin de garantir que toutes les affaires impliquant des civils soient jugées par des juridictions ordinaires et que les tribunaux spéciaux soient abolis et progressivement supprimés ;
- procéder par étapes pour abolir la peine de mort et, entre-temps, s’assurer que toutes les personnes jugées pour une infraction passible de la peine de mort jouissent de tous les droits à un procès équitable ;
- accorder le droit d’audience à des avocats originaires d’autres pays africains et examiner la possibilité d’adopter des traités régionaux ou sous-régionaux à cet effet, lorsque ces instruments existent.
Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire devraient :
- examiner les insuffisances des dispositions constitutionnelles et légales qui portent préjudice au droit à un procès équitable, notamment aux droits des victimes, et faire des recommandations spécifiques afin d’amener les autorités à y remédier ;
- faire des recommandations aux autorités nationales sur les besoins en ressources et en formation des magistrats pour améliorer la mise en œuvre des garanties à un procès équitable ;
- créer, lorsqu’il n’existe pas, un forum pour organiser des échanges de vues réguliers entre les représentants des institutions judiciaires, des écoles de droit et des services
- chargés de faire appliquer la loi à l’effet de trouver une solution aux problèmes qui nuisent au droit à un procès équitable ;
- établir des contacts avec la Commission africaine dans le but d’obtenir régulièrement des informations sur les évolutions qui interviennent en matière de mise en œuvre, au niveau national, du droit à un procès équitable en vertu de la Charte africaine ;
- porter à l’attention de la Commission les affaires et pratiques qui menacent l’indépendance et l’impartialité des magistrats ;
- prendre des mesures et initier des procédures afin de faire échec aux pratiques, en particulier à la corruption, qui remettent en cause leur indépendance et leur impartialité ;
- adopter des mesures visant à garantir l’élimination de la discrimination à l’endroit des femmes à la fois en ce qui concerne leur nomination à des emplois dans la hiérarchie judiciaire et en tant que parties à des procédures judiciaires.
Les barreaux devraient :
- en collaboration avec les institutions publiques et les ONG concernées, permettre à des parajuristes de fournir une assistance judiciaire à des personnes suspectées se trouvant dans une situation d’indigence pendant l’étape précédant le procès ;
- instituer des programmes en vue d’assurer une représentation pro bono des personnes accusées dans le cadre d’un procès pénal ;
- créer un forum abritant des échanges de vues réguliers avec les représentants du gouvernement et de la justice sur les voies et moyens grâce auxquels le droit à un procès équitable pourrait être amélioré ;
- prendre des mesures afin de protéger et de garantir l’intégrité et l’indépendance des membres de la profession judiciaire ;
- prendre des initiatives hardies pour favoriser le recrutement et la nomination des femmes à des postes de l’administration judiciaire et fournir à leurs membres une formation pour les amener à prendre conscience de la dimension genre ;
- instituer, à l’attention de ses membres, un programme d’éducation continue sur les questions qui contribuent à promouvoir les droits à un procès équitable et essayer de trouver l’assistance technique et les ressources susceptibles de permettre d’y arriver ;
- mettre en place des programmes de coopération avec les organisations professionnelles de juristes basées dans d’autres pays et encourager les États à accorder le droit d’audience aux avocats d’autres pays africains lorsque ce droit existe.
Les organisations non gouvernementales et les organisations communautaires devraient :
- examiner la possibilité de mettre en œuvre des moyens novateurs et de substitution afin de fournir une assistance judiciaire aux personnes accusées en situation d’indigence, notamment par le biais de la mise sur pied de programmes ciblant les parajuristes, les cliniques juridiques les crédits pour rémunérer les avocats commis d’office et les programmes relatifs à des contentieux d’intérêt général ;
- élaborer, conjointement avec les magistrats et les autres organismes de l’État, des programmes afin de contribuer à la formation des fonctionnaires de l’ordre judiciaire et des services chargés de faire appliquer la loi en ce qui concerne certains aspects des droits à un procès équitable ;
- entreprendre l’étude de questions liées aux procès équitables et faire des recommandations concernant les mesures que les différents organes de l’État doivent prendre pour une meilleure administration de la justice et l’équité des procès ;
- en collaboration avec les services chargés de faire appliquer la loi, produire des affiches portant des textes rédigés dans un langage simple et concernant les droits des personnes accusées ou détenues et les placarder sur tous les lieux de détention ;
- aider la Commission à diffuser ses décisions et à distribuer aux écoles de droit, aux fonctionnaires des services de la justice, aux centres de formation judiciaire, aux services chargés de faire appliquer la loi et aux barreaux des documents et informations relatifs au procès équitable.
Annexe 2: programme triennal (2001 – 2003)

Le programme de travail pour l’exercice triennal à venir (années 2001 à 2003) s’inscrit dans la continuité des efforts déployés depuis la création de l’association, mais innove également de manière à répondre de façon toujours plus pertinente aux attentes des juges constitutionnels et citoyens de l’espace francophone.
Trois actions correspondant à trois objectifs principaux seront conduites de manière complémentaire :
1. Le premier objectif est un objectif d’ordre documentaire. Il vise à accroître les ressources de droit comparé disponibles en matière de droit constitutionnel francophone.
2. Le second consiste à développer la diffusion de la jurisprudence constitutionnelle et, ultimement, au renforcement des institutions qui la produisent.
3. Enfin, le troisième objectif consiste à renforcer la coopération entre les institutions membres par la mise en place de la base de données jurisprudentielle qui permettra à chaque cour constitutionnelle de prendre connaissance, efficacement, des précédents rendus par ses homologues.
1. Accroître les ressources documentaires disponibles en matière de droit constitutionnel comparé.
Depuis 1997, l’ACCPUF a publié trois ouvrages de référence :
Les Actes de son premier Congrès consacré au principe d’égalité en novembre 1997 ; Le bulletin n° 1, synthèse des jurisprudences francophones relatives à ce même principe d’égalité, paru en novembre 1998 ;
Enfin le bulletin n° 2, recueil des textes régissant l’organisation et le fonctionnement des institutions membres. Cette troisième publication est disponible depuis novembre 1999 à la fois sur papier, sur CD Rom et sur le site Internet de l’ACCPUF.
L’année 2000 sera elle consacrée à la publication des Actes du second Congrès, dont la parution est prévue avant la fin de l’année 2000.
L’exercice triennal s’inscrira dans cette démarche, à savoir la publication annuelle d’un ouvrage de référence de droit constitutionnel francophone ainsi que la mise à jour du bulletin n° 2.
Le choix du thème du Bulletin n° 3 qui paraîtra à l’automne 2001 sera arrêté prochainement.
Le bulletin n° 4 (publication de l’année 2002) devrait préparer le troisième congrès, dont le thème sera retenu définitivement à la Conférence des présidents intermédiaires.
Enfin l’année 2003 sera consacrée par la publication des Actes du troisième congrès. Les mises à jour du bulletin n° 2 s’inscrivent elles aussi dans la poursuite de ses efforts documentaires. La mise à jour conditionne en effet la fiabilité de ce recueil de texte sans précédent. La première est déjà disponible sur papier, CD Rom et sera bientôt sur le site Internet.
2. Participer à la vulgarisation de la jurisprudence et, ultimement, au renforcement de l’autorité des institutions chargées du contrôle de constitutionnalité.
Le projet consiste en la mise en place d’un observatoire de l’activité des cours constitutionnelles.
Neutre et impartial, cet observatoire devrait porter à notre connaissance :
- les décisions importantes des cours ;
- les communiqués de presse, le cas échéant ;
- les changements dans la composition des cours, etc.
La mise à disposition du juge constitutionnel et du citoyen des communiqués de presse préparés par les juridictions ellesmêmes serait la clé de voûte de ce projet, selon la problématique et partant du constat suivants :
Les juges peuvent avoir besoin de la presse pour préserver leur indépendance par rapport au pouvoir et aux pressions extérieures mais à trop livrer ils risquent aussi de faire perdre au débat juridique la sérénité qu’il doit impérativement conserver.
En ce qui concerne les juridictions de nature constitutionnelle le paradoxe est encore plus frappant. Car, si les exigences du débat démocratique voudraient que le public fût informé des décisions générales de justice qui les concernent, la complexité de celles-ci en rend délicate leur vulgarisation.
Pourtant, la plupart des cours constitutionnelles se plient à cet exercice civique qui consiste à délivrer, en même temps que la décision, un communiqué de presse qui expose les principaux faits et/ou points de droit soulevés par la requête et jugés par l’institution. Ceci vaut tant pour les cours qui statuent sur un litige concret et a posteriori que pour
celles qui statuent in abstracto.
La première difficulté que rencontrent les cours constitutionnelles est de s’exprimer. Les membres et collaborateurs des cours sont en général astreints à une stricte obligation de réserve surtout s’il n’existe pas d’opinion dissidente. Le communiqué de presse permet de mettre en valeur les points nouveaux de jurisprudence et de leur donner l’interprétation « légitime ».
La seconde difficulté est d’éviter des contresens immédiats de la presse générale. La doctrine s’emparera des décisions et les commentera à sa guise mais l’écho immédiat qu’en donne la presse nationale écrite ou audiovisuelle repose alors, avec les communiqués, sur une version certifiée de ce qu’à voulu dire la Cour.

Enfin, ultimement, ce qui est en jeu c’est la connaissance que le public a de son juge constitutionnel et l’opinion qu’il peut se forger de la défense par ce juge des droits et libertés fondamentaux.
En communiquant régulièrement, on peut penser que l’institution œuvre à la fois pour nourrir le débat public et renforcer sa légitimité.
Nul doute que ce travail a un coût. Le communiqué doit être rédigé et refléter l’opinion majoritaire de la Cour.
Le projet de développer une rubrique
« Actualité jurisprudentielle » repose sur cette conviction, que ce coût est rentable et que sa rentabilité pourrait être démultipliée si les communiqués bénéficiaient d’une diffusion plus large et immédiate sur le site de l’Association.
D’ores et déjà, ceux des cours française, canadienne et roumaine sont régulièrement mis en ligne et envoyés par simple abonnement du maître de toile à la liste de diffusion gérée par les cours elles-mêmes.
Il est donc proposé d’héberger ces communiqués d’annonce ou de décision finale afin de maintenir une veille de jurisprudence constitutionnelle en liaison étroite et sous le contrôle des cours.
Plusieurs organes de presse, dont R.F.I., ont montré leur intérêt pour l’ouverture d’une telle rubrique.
3. Renforcer la coopération entre nos institutions par la mise en place de la base de données jurisprudentielle destinée à éclairer le juge constitutionnel qui doit trancher une question de droit nouvelle ou controversée, mais aussi à lui permettre d’asseoir plus fortement sa jurisprudence en se référant, le cas échéant, dans sa motivation, à des solutions similaires prononcées par les cours étrangères.
La mise en place de la base de données jurisprudentielle francophone est au cœur du projet de mise en réseau des cours constitutionnelles actuellement mené par l’association. Dans cette optique, l’exercice triennal 1997-2000 a consacré son énergie à approfondir la coopération avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit dite Commission de Venise qui développe depuis 1993 une base de données des jurisprudences constitutionnelles européennes.

Ces réalisations de l’espace européen constituent une référence utile pour notre association ; s’ajoute le fait que huit cours membres de l’association sont également membres de la Commission de Venise (Cour d’arbitrage de Belgique, Cour constitutionnelle de Bulgarie, Cour suprême du Canada, Conseil constitutionnel de France, Cour constitutionnelle de Moldavie, Cour constitutionnelle de Roumanie, Cour constitutionnelle de Slovénie, Tribunal fédéral suisse). D’où le choix de ce vecteur de rationalisation dans la mise à disposition de la jurisprudence. L’accord de coopération avec la Commission de Venise a en effet donné à l’association l’autorisation d’utiliser le même outil d’indexation : le thésaurus systématique de la Commission de Venise que cinq séminaires de formation ont contribué à divulguer.
L’accueil réservé à ces séminaires, la participation massive des membres de l’association et le travail d’indexation commencé par les cours participantes sont de réels encouragements.
La perspective d’une fusion de notre base de données et de celle de la Commission de Venise est aujourd’hui évoquée.
Intellectuellement : il s’agirait de poursuivre le travail d’indexation et l’enrichissement mutuel du thésaurus de la Commission de Venise.
Techniquement, nous pourrions disposer d’une interface pour accéder à la fois aux jurisprudences des juges constitutionnels francophones, et à celles des cours européennes, enfin aux jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme ou encore de la Cour constitutionnelle sudafricaine, ou aux résolutions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.
Ce programme d’action intéresse d’ores et déjà de nombreux partenaires et réseaux similaires aux nôtres, notamment le réseau international des hautes juridictions administratives, celui des médiateurs et ombudsmans francophones, ou celui des cours latino américaines qui ont demandé à l’ACCPUF conseils et recommandations.

Annexe 3: Programme, liste des participants, discours prononcés lors du Deuxième Congrès et communiqué de presse
Programme du Deuxième congrès 14-15 septembre 2000
Jeudi 14 septembre 2000,
Palais international des conférences, Cité de la Démocratie
9h 00 : Cérémonie d’ouverture.
Discours d’accueil de Madame Marie Madeleine Mborantsuo, président de la Cour constitutionnelle du Gabon.
Discours d’introduction de Monsieur Yves Guéna, président du Conseil constitutionnel de France, président sortant de l’ACCPUF.
Discours d’ouverture de Monsieur Didjob Divungi Di Ndinge, vice-président de la République gabonaise, représentant Monsieur le président de la République, chef de l’État.
10 h 00 : Pause.
10 h 30 : Présentation du premier sous-rapport de synthèse par la Cour constitutionnelle du Bénin : « Le droit au recours », sous la présidence de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar.
Discussion sur le premier thème.
12 h 30 : Déjeuner offert par la Cour constitutionnelle du Gabon, à la Cité de la démocratie.
15 h 00 : Présentation du deuxième sous-rapport de synthèse par le Conseil constitutionnel du Maroc : « La recevabilité de la saisine », sous la présidence du Conseil constitutionnel du Cambodge.
16 h 00 : Pause.
16 h 30 : Discussion sur le deuxième thème.
17 h 30 : Fin des travaux de la première journée.
18 h 15 : Cocktail offert par Monsieur Gérard Larôme, Chargé d’affaires a.i. à l’Ambassade de France, à la résidence de France.
20 h 30 : Dîner offert par Monsieur Jean-François Ntoutoume-Emane, Premier ministre, chef du gouvernement de la République gabonaise, à l’hôtel Méridien Re-Ndama.
Vendredi 15 septembre 2000,
Palais international des conférences, Cité de la Démocratie
9h 00 : Présentation du troisième sous-rapport de synthèse par le Tribunal fédéral suisse : « La notion de procès équitable », sous la présidence du Conseil constitutionnel du Sénégal.
10 h 00 : Pause.
10 h 30 : Discussion sur le troisième thème.
12 h 00 : Déjeuner offert par Monsieur Pierre Marie DONG, président du Conseil national de la Communication de la République gabonaise, à la Résidence le Maïsha.
14 h 30 : Présentation du rapport général par la Cour constitutionnelle du Gabon, sous la présidence de la Cour constitutionnelle de Roumanie.
Discussion sur le rapport général.
16 h 30 : Pause.
17 h 00 : Cérémonie de clôture.
Discours de Monsieur Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie.
Discours de clôture de Madame Marie Madeleine Mborantsuo, président de la Cour constitutionnelle du Gabon, président entrant de l’ACCPUF.
Conférence de presse (Président sortant et Bureau entrant).
Cocktail offert par la Cour constitutionnelle de la République gabonaise.
20 h 30 : Dîner de gala offert par S.E. Monsieur Didjob Divungi Di Ndinge, vice-président de la République gabonaise, représentant Monsieur le président de la République, chef de l’État, à l’hôtel Intercontinental Okoumé Palace
Samedi 16 septembre 2000
7 h 00 à 17 h 00 : Excursion touristique à Nyonié.
Liste des participantsau deuxième Congrès de l’ACCPUF
I – Liste des participants par institution d’appartenance
En qualité de membres de l’accpuf



Au titre du secrétariat général de l’accpuf, en qualité d’experts et en qualité d’organisateurs
Dominique REMY-GRANGER, secrétaire générale de l’ACCPUF, chef du service des relations extérieures du Conseil constitutionnel français
Patricia HERDT, secrétariat général de l’ACCPUF, chargée de mission au service des relations extérieures du Conseil constitutionnel français
Monsieur Rudolph DÜRR, Commission de Venise du Conseil de l’Europe
Monsieur Pierre VANDERNOOT, référendaire honoraire à la Cour d’arbitrage de Belgique, conseiller d’État en Belgique, maître de conférence à l’U.L.B.
Monsieur Christian QUENTIN, secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Gabon.
Monsieur Jules EYI-EDZANG, directeur de cabinet de Madame le président de la Cour constitutionnelle du Gabon.
EN QUALITÉ D’INVITÉS, NON MEMBRES DE L’ACCPUF
Invités des cours constitutionnelles :
Invités de la Cour constitutionnelle du Gabon:
Monsieur Charles DEBBASCH, doyen, professeur de droit
Monsieur Denis LEVY, professeur de droit
Monsieur Valerio ONIDA, juge à la Cour constitutionnelle italienne
Monsieur Jean-Joseph TRAMONI, professeur de droit
Monsieur Abraham ESSONO, juriste
Monsieur Jean-Pierre KOMBILA, professeur de droit
Monsieur MOUTELET NGUELET, juriste
Monsieur Joseph NDONG-OBIANG, constitutionnaliste
Monsieur Samuel NDOUTOUM-ZENG, juriste
Monsieur Christian OSSAGOU, juriste
Monsieur Guy ROSSATANGA, constitutionnaliste
Invité du Conseil constitutionnel du Liban :
Docteur Fayez HAGE-CHAHINE, professeur à la Faculté de droit de l’Université Saint Joseph de Beyrouth (Liban) et à l’Académie de droit international de La Haye, directeur du CEDROMA.
Invités de l’ACCPUF :
Monsieur le Bâtonnier Bruno BERGER-PERRIN, représentant la Conférence Internationale des Barreaux de Tradition Juridique Commune
Monsieur Jean-Paul COSTA, président de chambre à la Cour européenne des droits de l’homme
Monsieur Fidèle MENGUÉ-ENGOUANG, professeur, représentant le réseau africain de droit constitutionnel
Monsieur Isaac NGUÉMA, président de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
Monsieur Benoît RIBADEAU-DUMAS, secrétaire général adjoint du Conseil d’État (France), représentant l’Association internationale des hautes juridictions administratives
Monsieur Stanislas ZALINSKI, Délégation aux droits de l’homme et à la démocratie, Agence intergouvernementale de la Francophonie, représentant l’Organisation internationale de la Francophonie
Monsieur Abraham ZINZINDOHOUE, président de la Cour suprême du Bénin, président de l’Association Ouest Africaine des Hautes Juridictions Francophones
II – Liste des participants par ordre alphabétique
ABADIE Georges, conseiller (Conseil constitutionnel, France).
AIDID FARAH Abdillahi, conseiller (Conseil constitutionnel, Djibouti). AKAKPO Koffi Charles, juge (Cour constitutionnelle, Togo).
ALBERINI Juliane, chef du service de documentation (Tribunal fédéral, Suisse). ANCHOUEY Michel, vice-doyen, conseiller membre (Cour constitutionnelle, Gabon). ANGUÉ Louise, conseiller membre (Cour constitutionnelle, Gabon).
ANNOUR Samir Adam, conseiller (Conseil constitutionnel, Tchad). ARABADJIEV Alexandre, juge (Cour constitutionnelle, Bulgarie). BALDE Chaïkou Yaya, conseiller (Cour suprême, Guinée).
BENJELLOUN Abdelaziz, président (Conseil constitutionnel, Maroc).
BERGER-PERRIN Bruno, représentant la Conférence Internationale des Barreaux de Tradition Juridique Commune.
BINNIE Ian, juge puîné (Cour suprême, Canada). BISSECK Dagobert, conseiller (Cour suprême, Cameroun).
BOLY Abdouramane, conseiller (Cour suprême, Burkina Faso). BOLY Bintou, conseiller (Cour suprême, Burkina Faso).
BOSSUYT Marc, juge (Cour d’arbitrage, Belgique).
BOUNAMA Didi Ould, président (Conseil constitutionnel, Mauritanie). BOUNGOUÉRÉ Dominique, conseiller membre (Cour constitutionnelle, Gabon). BULAI Costicaˇ, juge (Cour constitutionnelle, Roumanie).
CARDOSO Fernando, Secrétaire (Tribunal suprême de Justice, Cap Vert). CHIRDON ABASS Omar, président (Conseil constitutionnel, Djibouti). CISSE SIDIBE Aïssata, conseiller (Cour constitutionnelle, Mali).
COSTA Jean-Paul, président de chambre à la Cour européenne des droits de l’homme.
DA SILVA Antonio, député, deuxième secrétaire (Assemblée nationale populaire, Guinée Bissau).
DARKEM Joseph, secrétaire général (Conseil constitutionnel, Tchad). DEBBASCH Charles, doyen, professeur de droit (France).
DENIS-OUINSOU Conceptia, présidente (Cour constitutionnelle, Bénin). DIALLO Abou Moussa, conseiller (Conseil constitutionnel, Mauritanie). DIALLO Ibrahima Sory, conseiller (Cour suprême, Guinée).
DICKO Abdoulaye, président (Cour constitutionnelle, Mali). DOLDUR Constantin, juge (Cour constitutionnelle, Roumanie). DÜRR Rudolph, Commission de Venise du Conseil de l’Europe. ESSONO Abraham, juriste (Gabon).
EYI-EDZANG Jules, directeur de cabinet de Madame le président de la Cour constitutionnelle du Gabon.
FISˇER Zvonko, juge (Cour constitutionnelle, Slovénie).
FRANK Edouard, président (Cour constitutionnelle, Centrafrique). GABA Sipohon Franc, juge (Cour constitutionnelle, Togo).
GBEHA-AFOUDA Marcelline-Claire, secrétaire général (Cour constitutionnelle, Bénin). GOMES RODRIGUES Eduardo Alberto, juge conseiller (Tribunal suprême de Justice,
Cap Vert).
GONTHIER Charles D., juge puîné (Cour suprême, Canada).
GUÉNA Yves, président (Conseil constitutionnel, France), président sortant de l’ACCPUF. GUILAO Robert, conseiller (Cour suprême, Guinée).
HAGE-CHAHINE Fayez, professeur à la Faculté de droit de l’Université Saint Joseph de Beyrouth (Liban) et à l’Académie de droit international de La Haye, directeur du CEDROMA.
HENNEUSE Roger, juge (Cour d’arbitrage, Belgique).
HERDT Patricia, secrétariat général de l’ACCPUF, chargée de mission au service des relations extérieures du Conseil constitutionnel français.
HOUNTONDJI Alexis, conseiller (Cour constitutionnelle, Bénin).
KABBANI Khaled, ancien membre du Conseil constitutionnel du Liban, premier conseiller au Conseil d’État (Représentant le Conseil constitutionnel, Liban).
KAKOU-MAYAZA Jean-Eugène, conseiller membre (Cour constitutionnelle, Gabon).
KHAIR Antoine, ancien Membre du Conseil constitutionnel du Liban, président de chambre au Conseil d’État (Représentant le Conseil constitutionnel, Liban).
KOLLY Gilbert, juge fédéral (Tribunal fédéral, Suisse).
KOMBILA Jean-Pierre, professeur de droit à l’Université de Libreville (Gabon). KONE Mamoudou, greffier en chef (Cour constitutionnelle, Mali).
LEVY Denis, professeur de droit (France).
LÔ Mamadou, conseiller (Conseil constitutionnel, Sénégal). LOUDGHIRI Mohamed, conseiller (Conseil constitutionnel, Maroc). MALÉKOU Paul, conseiller membre (Cour constitutionnelle, Gabon).
MANE Manuel, député, membre de la Commission spécialisée (Assemblée nationale populaire, Guinée Bissau).
MAVCˇICˇ Arne, directeur du Centre d’information juridique (Cour constitutionnelle, Slovénie).
MBORANTSUO Marie Madeleine, président (Cour constitutionnelle, Gabon), président de l’ACCPUF.
MELCHIOR Michel, président (Cour d’arbitrage, Belgique).
MENGUÉ-ENGOUANG Fidèle, professeur, représentant le réseau africain de droit constitutionnel.
MENOUNI Abdeltif, conseiller (Conseil constitutionnel, Maroc).
MERLIN-DESMARTIS Marie, chef du service juridique (Conseil constitutionnel, France). MOUTELET NGUELET, juriste (Gabon).
MOUTSINGA Hervé, conseiller membre (Cour constitutionnelle, Gabon). NDOLIMANA Pierre, président (Cour constitutionnelle, Rwanda).
NDONG Jean-Pierre, doyen, conseiller membre (Cour constitutionnelle, Gabon). NDONG-OBIANG Joseph, constitutionnaliste (Gabon).
NDOUTOUM-ZENG Samuel, juriste (Gabon).
NGOMO MBENGONO Francisco Javier, président (Tribunal constitutionnel, Guinée équatoriale).
NGUÉMA Isaac, président de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. NGUEMA NDONG Adolfo, magistrat (Tribunal constitutionnel, Guinée équatoriale).
ONDO ANGUE Juan Carlos, magistrat (Tribunal constitutionnel, Guinée équatoriale). ONIDA Valerio, juge à la Cour constitutionnelle italienne.
OSSAGOU Christian, juriste (Gabon).
PASSET Marc, conseiller (Cour constitutionnelle, Centrafrique). PEEROO Shaheeda, juge (Cour suprême, Maurice).
PIT Taing San, secrétaire général (Conseil constitutionnel, Cambodge). PRAK Sok, conseiller (Conseil constitutionnel, Cambodge).
QUENTIN Christian, secrétaire général de la Cour constitutionnelle du Gabon. RAJAONARIVONY Jean-Michel, juge constitutionnel (Haute Cour constitutionnelle,
Madagascar).
RAKOTONDRABAO Dieudonné, juge constitutionnel (Haute Cour constitutionnelle, Madagascar).
REMY-GRANGER Dominique, secrétaire générale de l’ACCPUF, chef du service des relations extérieures du Conseil constitutionnel français.
RIBADEAU-DUMAS Benoît, secrétaire général adjoint du Conseil d’État (France), représentant l’Association internationale des hautes juridictions administratives.
ROSSATANGA Guy, constitutionnaliste.
SCHUBARTH Martin, président (Tribunal fédéral, Suisse).
SILVA GOMES Oscar Alexandre, président, juge conseiller (Tribunal suprême de Justice, Cap Vert).
THOR Péng Leath, conseiller (Conseil constitutionnel, Cambodge). TONJOKOUÉ Marc-Aurélien, conseiller membre (Cour constitutionnelle, Gabon). TRAMONI Jean-Joseph, professeur de droit (France).
VANDERNOOT Pierre, référendaire honoraire à la Cour d’arbitrage de Belgique, conseiller d’État en Belgique, maître de conférence à l’U.L.B.
YOADIMNADJI Pascal, président (Conseil constitutionnel, Tchad). YOUMSI Joseph, avocat général (Cour suprême, Cameroun).
ZALINSKI Stanislas, Délégation aux droits de l’homme et à la démocratie, Agence intergouvernementale de la Francophonie, représentant l’Organisation internationale de la Francophonie.
ZINZINDOHOUE Abraham, président de la Cour suprême du Bénin, président de l’Association Ouest Africaine des Hautes Juridictions Francophones.
14 septembre 2000

Discours d’accueil de Madame Marie Madeleine Mborantsuo, président de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise.
Monsieur le vice-président de la République, représentant Monsieur le président de la République, chef de l’État,
Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
Messieurs les présidents des institutions de la République,
Monsieur le président de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français,
Monsieur le représentant de Monsieur le secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie,
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,
Excellences, Distingués invités, Chers collègues,
C’est un grand privilège pour le Gabon d’abriter aujourd’hui, à Libreville, les travaux du deuxième congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF), privilège doublé de l’honneur qui lui est ainsi fait d’être pour quelques jours, la capitale du monde constitutionnel francophone. Aussi, est-ce avec une profonde joie et un grand plaisir sincère que les membres de la Cour constitutionnelle du Gabon se joignent à moi pour, d’une part, remercier les participants du premier congrès, d’avoir bien voulu fixer leur choix sur notre pays et, d’autre part, souhaiter aux congressistes venus d’horizons divers ainsi qu’à tous nos invités extérieurs, une très cordiale bienvenue et un séjour des plus agréables en terre gabonaise.
Monsieur le vice-président de la République,
Nous sommes convaincus que vous saurez traduire à son Excellence, Monsieur le président de la République notre sentiment de profonde gratitude pour le soutien sans faille dont nous avons toujours bénéficié de sa part et sans lequel, du reste, les présentes assises n’auraient pu se tenir à Libreville.
Nous y voyons une preuve supplémentaire, non seulement de votre volonté affirmée de soutenir notre Institution dans sa mission de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais aussi de son engagement résolu à prendre constamment une part active à toutes les initiatives ou actions visant à promouvoir et à renforcer l’État de droit.
Nous adressant à vous-même, Monsieur le vice-président de la République, il nous plaît de saluer votre présence effective à la cérémonie d’ouverture de ce congrès, présence ressentie par tous les congressistes comme un hommage rendu à leur jeune association et comme un acte visant à les encourager à poursuivre leur action.
Soyez-en remercié.
Monsieur le Premier ministre,
La Cour constitutionnelle a toujours su compter sur votre présence et celle des membres de votre gouvernement à chacune de ses manifestations officielles. Elle s’honore de vous accueillir à l’ouverture de ce congrès.
Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles,
Votre présence à cette cérémonie témoigne, s’il en est besoin, de l’intérêt que vous portez à la Cour constitutionnelle et à sa mission de renforcement de l’État de droit. Nous vous en savons gré.
Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,
Nous sommes très sensibles à l’insigne honneur que vous nous faites en prenant personnellement part à cette cérémonie solennelle d’ouverture de nos assises.
Vous contribuez par votre présence à la rehausser du prestige de vos pays respectifs.
Nous en sommes très flattés et vous exprimons notre profonde gratitude.
Monsieur le président de l’association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du Français,
Nous avons appris avec grande satisfaction votre nomination à la présidence du Conseil constitutionnel de France en remplacement de Monsieur Roland Dumas dont il nous plaît de saluer ici l’initiative louable de la création de notre Association ainsi que le rôle éminent qu’il a joué pour son rayonnement.
Nous saisissons cette occasion pour vous présenter nos chaleureuses félicitations pour cette brillante promotion et vous exprimer notre admiration pour l’œuvre appréciable que avez accomplie en si peu de temps à la tête de l’ACCPUF
Monsieur le représentant de Monsieur le secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie,
L’institution que vous représentez est le partenaire privilégié de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français. Grâce à ses interventions multiformes, notre Association a pu se développer et asseoir ses fondements sur des bases solides.
C’est ici encore l’occasion solennelle de lui rendre, à ce titre, un juste tribut de reconnaissance.
Nous voulons saluer également la présence parmi nous du représentant de la Commission Européenne des Droits de l’Homme et du président de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Parmi nos illustres hôtes figurent certaines personnalités qui ont rendu des services de qualité remarquable à la Cour constitutionnelle du Gabon. Nous avons nommé :
Monsieur le professeur Denis Levy,
Monsieur le doyen Charles Debbasch,
sans oublier Messieurs les présidents François Luchaire et Gérard Conac qui, empêchés, n’ont pu faire le déplacement de Libreville.
Que ces personnalités veuillent bien trouver ici l’expression renouvelée de notre confiance et de notre amitié.
Mesdames et Messieurs les présidents des Cours et Conseils constitutionnels,
Mesdames et Messieurs les congressistes,
Nous voici au rendez-vous de Libreville, pris lors du premier congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français, tenu à Paris les 10 et 11 avril 1997.
À cet égard, nous pensons que les congrès de notre Association devraient être pour nous tous l’occasion idéale de mesurer le chemin parcouru et d’entrevoir les actions futures.
Dans cet esprit, il nous paraît utile de rappeler brièvement l’évolution historique de la justice constitutionnelle au Gabon.
Libreville, qui s’honore de vous offrir l’hospitalité, porte un nom évocateur comportant une forte charge émotionnelle de liberté. Comme Freetown en Sierra Leone dont elle est la traduction française, Libreville se veut avant tout la ville qui a rendu leur liberté et leurs droits à des hommes, à des femmes et à des enfants victimes de l’esclavage, institution honnie qui a, pendant des siècles, arraché des peuples entiers à leur terre natale.
L’on se souviendra en effet que, un an après l’abolition officielle de l’esclavage, très exactement le 28 septembre 1849, une cinquantaine d’anciens captifs parmi les deux cent quarante sept libérés au large de nos côtes et envoyés à Gorée au Sénégal où ils ont été affranchis, débarquèrent à nouveau sur les rivages du Gabon pour des besoins en main-d’œuvre. Ils furent installés en tant que travailleurs libres dans un petit village de quarante-deux cases construites par eux-mêmes, sous la direction du capitaine Parant, officier de marine.
L’amiral Bouët-Willaumez, gouverneur général à l’époque, donna à ce village le nom de Libreville.
Depuis lors, le Gabonais, témoin privilégié de cet événement historique majeur, reste très attaché à la défense des libertés individuelles et des droits de l’homme.
Aussi, mettra-t-il toujours un point d’honneur à œuvrer en faveur de la mise en place d’institutions ayant justement pour mission la défense de ces acquis historiques. C’est ainsi que, dès février 1959, alors qu’à l’occasion du référendum de 1958, il vient à peine d’entrer comme État-membre dans la Communauté franco-africaine, le Gabon se dote d’une loi constitutionnelle qui, déjà, consacre les droits et libertés de l’homme et du citoyen et institue pour leur protection un organe spécial, distinct des tribunaux ordinaires, le Conseil juridique. Cette instance devait être obligatoirement saisie par le gouvernement des projets de lois et de décrets réglementaires, et, en outre, pouvait en cas de contestation, statuer sur l’éligibilité des députés et la régularité de leur élection.
L’année suivante, le Gabon accède à l’indépendance et la loi constitutionnelle du 14 novembre 1960 institue une Cour suprême.
Au sein de cette Cour suprême siégeant en plénière et compétente aussi bien en matière judiciaire, administrative que comptable, la fonction constitutionnelle, formellement précisée, ne se limite plus au seul contrôle des actes législatifs et réglementaires, mais va s’étendre au contrôle des accords internationaux et au contentieux de toutes les élections politiques et des opérations de référendum.
Certes, cette Cour suprême issue de la Loi constitutionnelle du 14 novembre 1960 n’aura guère le temps d’exercer ses compétences polyvalentes, notamment celles en matière constitutionnelle.
En effet, le 21 février 1961, soit moins de quatre mois après, une nouvelle Constitution voit le jour, avec une Cour suprême dont les compétences sont réparties entre quatre chambres : constitutionnelle, judiciaire, administrative et des comptes.
Cependant, malgré l’élargissement de ses compétences, la chambre constitutionnelle n’aura qu’un rôle essentiellement consultatif.
Il faut attendre la Conférence nationale de mars-avril 1990 pour voir naître, avec l’affirmation de l’État de droit, une véritable juridiction constitutionnelle, c’est-à-dire une juridiction autonome exerçant la plénitude de ses compétences.
C’est l’actuelle Cour constitutionnelle instituée par la Constitution du 26 mars 1991 et dont le champ d’action ne cesse de s’élargir.
Mesdames et Messieurs les congressistes,
Nous étions loin de penser que nous serions rassemblés en si grand nombre à ce rendez-vous de Libreville.
C’est la preuve que nous avons tous voulu accorder à ce deuxième congrès tout l’intérêt qu’il requiert. Et ce, à plus d’un titre : démontrer notre détermination à parfaire et à conforter notre édifice commun et, au-delà de cet objectif, réaffirmer la spécificité et le dynamisme de l’espace francophone à travers nos activités juridiques et juridictionnelles.
Le pays d’accueil, quant à lui, se flatte d’y voir en outre, un signe gratifiant la collaboration active de la Cour constitutionnelle du Gabon à la bonne fin du projet de création de notre Association, à la mise en place de celleci et à son fonctionnement régulier. Sans doute récompense-t-il aussi son implication, d’entrée de jeu, au sommet de la hiérarchie en tant que membre fondateur assurant la première vice-présidence de l’Association.
Les présentes assises ont été précédées par deux réunions importantes :
d’abord le séminaire de formation des agents de liaison de notre Association pour la sous-région de l’Afrique équatoriale, des Grands Lacs et Haïti, tenu les 11 et 12 septembre 2000 à l’Hôtel Intercontinental Okoumé Palace ;
ensuite l’Assemblée générale de l’ACCPUF qui s’est réunie hier, au siège de la Cour constitutionnelle, et dont nous laisserons notre collègue, le président du Conseil constitutionnel de France, tirer les principales conclusions.
Pour ce deuxième congrès comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, le thème choisi est : « l’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures ».
Il s’agira de rechercher les voies et moyens permettant une protection plus efficiente des droits fondamentaux et des libertés publiques et individuelles par l’accès du plus grand nombre au juge constitutionnel. Nous espérons que les débats qui vont s’instaurer autour de ce thème seront aussi fructueux que ceux menés autour du précédent thème, « le principe d’égalité ».
Nous voudrions saisir cette opportunité pour porter à votre connaissance que le Gabon et d’autres États africains, dont le Sénégal et le Bénin ont initié une réflexion visant à créer, en Afrique francophone, une association régionale offrant des rapports de similitudes avec l’ACCPUF. L’objectif essentiel de cette association est la recherche d’une meilleure adaptation des décisions et activités des juridictions constitutionnelles aux spécificités culturelles de cette partie du monde.
Nous voulons croire que ce projet, le moment venu, recevra de la part de l’ACCPUF un accueil favorable.
Mesdames et Messieurs les congressistes, chers collègues,
Notre programme de travail est très chargé et l’ampleur de la tâche à laquelle nous allons devoir faire face est de nature à nous retenir exclusivement à Libreville. Cependant, admettre qu’il n’en soit qu’ainsi ne serait pas conforme aux traditions d’hospitalité africaine. Aussi avons-nous pris soin de vous aménager, à l’issue de nos assises, quelques moments d’évasion et de détente dans un site du Gabon profond.
En formant les vœux les plus fervents pour le succès de nos travaux, je vous renouvelle, Mesdames et Messieurs les congressistes, au nom de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, mes souhaits de bienvenue.
Je vous remercie de votre aimable attention.

Discours d’introduction de Monsieur Yves Guéna, président du Conseil constitutionnel français,
président de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français
Monsieur le vice-président de la République,
Madame le président de la Cour constitutionnelle,
Chers et éminents collègues.
Monsieur le vice-président,
C’est d’abord vers vous que je me tourne, sensible à votre présence lors de cette séance inaugurale, en représentation de Monsieur le président de la République, Monsieur Bongo. Comme je suis un vieil africain, je puis dire que je sais ce que le Gabon doit au président Bongo, l’une des figures de proue de l’Afrique.
Il a su, avec votre concours, Monsieur le vice-président, conduire ce pays sur la voie de la démocratie et dans le sens du progrès national.
Démocratie et droits de l’homme, nous en avons la démonstration aujourd’hui même alors que nous transmettons à Madame Mborantsuo la présidence de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français. Chaque nation doit mener à son rythme la mise en œuvre de la démocratie ; il n’y a pas de modèle stéréotypé que l’on pourrait appliquer à tous les cas. Le président Bongo a su trouver, avec bonheur, les voies de la démocratie dans ce pays.
Le progrès matériel ensuite. Certes, c’est un atout pour le Gabon que ses richesses naturelles. Encore fallait-il savoir les exploiter en sorte qu’elles bénéficient au plus grand nombre. Ça n’était pas si facile, ce fut réussi alors que l’on connaît de par le monde tant d’autres exemples contraires. Je salue là aussi l’œuvre du président Bongo, et, Monsieur le vice-président, l’action de ceux qui ont la chance de le seconder dans sa haute mission.
*
L’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français atteint, avec la première alternance, la maturité. Créée en 1997 à Paris, à l’initiative de la France et avec le soutien de l’Agence intergouvernementale de la francophonie, l’Association comptait déjà trente six membres, elle en dénombre aujourd’hui trente neuf.
L’Association ne regroupe pas encore, mais peu s’en faut, toutes les cours constitutionnelles des États membres ou associés du Sommet des chefs d’États et de gouvernements ayant en partage l’usage du français. Je salue ici le représentant du secrétaire général, Monsieur Boutros Boutros-Ghali lequel n’a malheureusement pas pu se rendre à Libreville. Nul autre mieux que lui sans doute n’a compris combien le partage d’une langue, d’un vocabulaire se décline dans les mots mais aussi dans l’esprit. L’espace francophone se veut, et se donne depuis sa réorganisation, avant tout comme un espace de paix, de démocratie et de respect des droits de l’homme. À ce titre, notre Association y a toute sa place.
La France quitte la présidence de l’Association mais elle la laisse en toute confiance et avec joie à la présidente de la Cour constitutionnelle qui accueille ce deuxième Congrès.
Madame,
J’ai eu l’occasion, l’avantage et le plaisir de vous rencontrer déjà à plusieurs reprises. J’ai pu apprécier votre science juridique, vos capacités d’organisation, votre esprit de décision et j’ose le dire, votre charme. C’est avec joie que je vous passe le flambeau de la présidence ; il ne pourrait aujourd’hui être en meilleures mains.
Aux côtés de Madame Mborantsuo, l’équipe du nouveau bureau qui va gérer l’activité de l’Association pour les trois années à venir reflète la diversité et la richesse de l’espace francophone :
La présidente de la Cour suprême du Canada, portée à la première viceprésidence,
La présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin, à la deuxième vice-présidence,
Le président du Conseil constitutionnel de Djibouti, à la troisième vice-présidence, La Cour constitutionnelle de Roumanie sera chargée de la Trésorerie de l’Association. Enfin, désormais, le président sortant assurera la transition comme membre de droit, ce qui me vaut l’honneur et le privilège de partager pour un mandat encore les responsabilités du Bureau.
Cette équipe hérite d’une situation financière saine et d’un acquis de réalisations concrètes. En particulier le mandat fixé par la première assemblée générale de créer un site internet a été rempli, et pratiquement la moitié des membres de l’Association sont désormais mis en réseau. Les efforts déployés par chacune des institutions membres pour se former, se doter, parfois avec le soutien de l’Agence de la francophonie, du matériel adéquat, concernent d’abord et c’est normal, les interlocuteurs, publics ou privés, nationaux. La tâche du prochain bureau sera donc de développer les interconnexions des cours entre elles ; de constituer, avec l’aide précieuse de la Commission pour la démocratie par le droit du Conseil de l’Europe, une base de données jurisprudentielles qui, ultérieurement, permettra aux Cours des deux espaces, francophone et européen, de bénéficier d’une vaste documentation comparative.
Le nouveau bureau dispose d’un instrument en bon état. Il saura, nous en sommes assurés, en user au mieux.
Le deuxième Congrès qui se tient aujourd’hui, trois ans après le premier est ressenti par nous tous comme un moment fort de la vie de l’Association, notamment parce qu’il réunit outre ses membres, les associations, institutions ou personnalités avec lesquelles celle-ci est en relation. Je tiens notamment à saluer la présence ici des représentants des présidents de la Cour européenne et de la Commission africaine des droits de l’homme.
Je voudrais maintenant, pour en introduire les travaux, rappeler les circonstances qui ont conduit à retenir le thème de ce deuxième Congrès.
Dès l’origine, les représentants des cours associées à la phase préparatoire de la création de l’association avaient souhaité qu’alternent sujets théoriques touchant à des questions de principe et des sujets plus pratiques, quitte à être descriptifs.
Le premier Congrès avait, en 1997, consacré deux journées de travail au principe d’égalité, pour lesquelles vingt-six rapports nationaux avaient été présentés.
À Beyrouth, en septembre 1998, la deuxième Conférence des chefs d’institutions retint le thème général de « L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures ».
L’objectif principal tel qu’exprimé par les participants à la Conférence était de mieux connaître, voire de découvrir, les différentes voies d’accès à la juridiction constitutionnelle, d’être à même d’en apprécier avantages et inconvénients, en somme d’évaluer les qualités de leur propre système à l’aune des autres.
Tout de suite a été exclu du champ d’analyse le contentieux électoral, dont toutes les cours membres de l’Association ne connaissent pas.
Après une longue discussion, déjà très instructive, il a été décidé de ne pas se limiter aux conditions de la saisine et de la recevabilité mais d’étendre l’analyse à la procédure de traitement de la requête. Il ne s’agit pas de la question de principe du droit au juge mais des modalités qui en aménagent l’exercice, qui permettent d’y accéder et d’en obtenir une décision.
En conséquence, le questionnaire envoyé aux membres et auquel ont répondu trente Cours, traite chronologiquement le parcours d’une requête.
Une demi-journée de travail sera consacrée à chacune des étapes.
La saisine tout d’abord : qui peut saisir, sur quoi et quand ?
Ensuite la recevabilité de cette saisine : à quelle condition est-elle acceptable, sinon comment est-elle rejetée ?
Enfin, quels sont les règles et principes, écrits ou non, qui président à l’examen de l’affaire ?
Je tiens ici à remercier tout particulièrement les trois cours qui ont rédigé les rapports de synthèse sur chacun de ces trois thèmes : la Cour constitutionnelle du Bénin, le Conseil constitutionnel du Maroc, le Tribunal fédéral suisse.
Je suis convaincu que ces rapports susciteront des échanges particulièrement fructueux qui devraient permettre aux uns et aux autres, par le simple fait de la juxtaposition des expériences, de mettre en perspective la leur.
*
Je ne voudrais pas terminer ce discours d’ouverture des travaux du deuxième Congrès sans dire le plaisir que j’ai à le faire en Afrique et, particulièrement, au Gabon, pour les raisons que j’ai rappelées au début de mon propos.
Si l’image du français ne se limite pas à l’Afrique et à Madagascar, nos amis Cambodgiens ou Bulgares en témoignent, le continent africain en reste le cœur.
Je salue tous les participants à notre Congrès, rassemblés autour des droits de l’homme et dans le respect et la pérennité de notre langue.
Et encore merci au merveilleux pays qui nous accueille et qui va présider nos travaux durant trois ans.
Vive le Gabon !
Discours d’ouverture de Son Excellence Monsieur Didjob Divungi Di Ndinge
vice-président de la République gabonaise.
Représentant le président de la République, chef de l’État
Monsieur le président de l’association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français,
Monsieur le Premier ministre, Madame le président de la Cour consti-
tutionnelle de la République gabonaise,
Monsieur le représentant de Monsieur le secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie,
Mesdames et Messieurs les présidents des Cours et Conseils constitutionnels,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs les congressistes,
Monsieur le président de la République, chef de l’État, son Excellence El Hadj Omar Bongo, me fait l’honneur de le représenter à cette cérémonie d’ouverture du deuxième Congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français, qui se tient à Libreville, capitale du Gabon.
C’est donc un sentiment de réelle et légitime fierté qu’il me plaît d’exprimer ici en son nom, en celui du gouvernement et de l’ensemble du Peuple gabonais, à l’endroit de toutes les délégations qui ont fait le déplacement, et qui permettent ainsi d’inscrire Libreville, deux ans après Paris, dans les annales de l’histoire de votre jeune et dynamique Association.
C’est aussi le lieu pour moi, d’adresser à tous les présidents des Cours et Conseils Constitutionnels ici présents, les sincères
remerciement du président de la République gabonaise, Son Excellence El Hadj Omar Bongo, pour avoir bien voulu répondre favorablement à l’invitation qu’il leur a adressée, afin que ce Congrès se tienne à Libreville.
Et je saisis cet instant particulier pour vous adresser nos souhaits les plus chaleureux de bienvenue et d’excellent séjour en terre gabonaise.
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, le Congrès de Libreville se situe dans le droit fil de la troisième Conférence des ministres de la Justice des Pays francophones, qui s’est tenue en Égypte, du 30 octobre au 1er novembre 1995. La Déclaration du Caire adoptée à cette occasion, avait mis en place un plan d’action francophone en faveur de la justice, de l’État de droit, des Droits de l’homme et du Développement pour la période allant de 1996 à 2000.
Comme vous le savez également, les orientations et les stratégies contenues dans cette déclaration concernant essentiellement :
- l’appui aux organes juridictionnels chargés, au niveau national, du contrôle de la constitutionnalité des lois et de la légalité des actes administratifs ;
- et la mise en commun des expériences de vos différentes Institutions, dans le cadre de vos rencontres de concertation, bilatérales et multilatérales, favorisant les échanges de documentation, d’information et de jurisprudence.
Je note à cet effet avec satisfaction que votre Association, qui en est déjà à son deuxième Congrès, suit exactement la démarche initiée dans le cadre de la période quinquennale fixée par le plan d’action du Caire.
Je ne puis donc m’empêcher de vous adresser, à toutes et à tous, mes plus vives et sincères félicitions pour l’engagement et le dynamisme de vos Institutions, s’agissant de la promotion de la justice, de l’État de droit, des Droits de l’homme et des Libertés dans nos différents États.
Mesdames, Messieurs,
L’Association des Cours constitutionnelles constitue ainsi un espace nouveau de rencontres et d’échange qui vient élargir le champ des organes mis en place dans le cadre de la francophonie.
Dernière née des Institutions francophones, elle représente par ailleurs une avancée significative, s’accordant parfaitement avec le nouveau contexte général de liberté, de pluralisme politique et d’expression démocratique.
Elle a aussi le mérite particulier de se situer dans un rapport intelligent et structurant avec le nouvel environnement social, politique et économique de notre planète, consécutif aux grande mutations géostratégiques nées de la Guerre Froide, et marquées notamment par la chute du mur de Berlin en Europe et la poussée démocratique dans le reste du monde.
Et je voudrais dire, du haut de cette tribune, qu’à l’heure de la mondialisation et de la globalisation, les pays du Sud, en grand nombre dans cette salle, ont bien leur place au sein de cette grande famille.
C’est pourquoi, je saisis cette opportunité pour observer que la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, héritière de l’ancienne Chambre de la Cour suprême, créée au lendemain de l’indépendance, a pu déjà, en maintes circonstances, faire ses preuves. En tant que gardienne des lois, elle répond ainsi, aux dispositions de la Constitution qui stipule, je cite : « Elle est juge de la Constitutionnalité des lois et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. »
L’ouverture que lui offre ainsi l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français lui permet d’affirmer, au plan international, la notoriété acquise ces dernières années à la faveur d’une contribution déterminante dans l’affermissement de notre jeune démocratie.
Et le thème de votre Congrès, « l’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures », constitue à n’en point douter, une marque essentielle de ce souhait et de cette volonté réaffirmée, non seulement d’harmoniser mais aussi d’accélérer, dans nos pays en construction notamment, les conditions d’une réelle bonne gouvernance.
Je n’ai donc nul doute que ce Congrès permettra de lancer définitivement les activités de votre Association, et que les résolutions et recommandations qui vont êtres adoptées, enrichies par l’expérience et la compétence de chacun de vous, seront profitables aux institutions que vous représentez, à l’espace francophone et aux citoyens de nos différents États.
Mesdames et Messieurs les congressistes,
En terminant mon propos, je voudrais vous assurer que votre Association pourra toujours compter, dans l’accomplissement de ses nobles missions, sur le soutien de Son Excellence El Hadj Omar Bongo, président de la République, chef de l’État, et sur celui du gouvernement et du Peuple gabonais tout entier.
Je déclare ouverts les travaux du deuxième Congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français.
Je vous remercie.
15 septembre 2000
Message de Monsieur le secrétaire général de l’Organisation internationale de la francophonie.
Excellences, Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Je suis particulièrement heureux de pouvoir m’adresser à vous, aujourd’hui. Et croyez bien que je regrette de ne pouvoir le faire de vive voix.
Mes premiers mots veulent d’abord aller vers le président de la République, S.E. Omar Bongo. Et je tiens à redire, ici, tout ce que l’Afrique doit à son infinie sagesse. Et tout ce que la Francophonie doit à sa détermination, je dirais même, à ses élans visionnaires.
C’est dire l’engagement constant et l’apport toujours plus fructueux de son grand pays au sein de notre Communauté.
Comme en témoigne, une fois encore, l’accueil et le soutien réservés par le Gabon à cette grande manifestation de la Francophonie, dans l’une de ses dimensions essentielles. Je veux dire la démocratie.
Et je me réjouis particulièrement de voir le Gabon honoré comme il se doit par la nomination au poste de présidente, de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français, de Madame Marie Madeleine Mborantsuo.
Je voudrais donc, Madame la présidente, vous adresser mes plus chaleureuses félicitations. Et j’ai envie d’ajouter que votre nomination est un motif supplémentaire de fierté pour toutes les femmes de la Francophonie. Je voudrais, aussi, féliciter, le président sortant, Monsieur Yves Guéna.
Permettez-moi, enfin, de saluer tous ceux qui ont contribué à l’organisation de ce 2e Congrès. Mais aussi toutes celles et tous ceux qui, par leur présence, à Libreville, ont démontré que l’ACCPUF, créée il y a seulement trois ans, répond à un besoin fort dans l’espace francophone.
Et je voudrais saisir l’occasion que vous m’offrez pour vous dire le rôle essentiel qui est le vôtre dans le processus d’approfondissement de l’État de droit.
Un rôle d’autant plus exemplaire que vous avez choisi, au sein de cette Association, de l’exercer, en parfaite complémentarité et en totale solidarité, au nom de cette langue que nous avons en partage.
C’est la raison pour laquelle, les Cours constitutionnelles ont été étroitement associées à la préparation du symposium sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone, qui se tiendra, à Bamako, du 1er au 4 novembre prochains. Et aux travaux duquel l’association est vivement conviée. À cet égard, le séminaire préparatoire qui s’est déroulé au Tchad, du 29 au 31 mars derniers, sur le thème des institutions de la démocratie et de l’État de droit a permis d’établir un bilan contrasté.
Si le phénomène démocratique n’est pas, ou n’est plus contesté, dans son essence, ni dans ses modes d’institutionnalisation, il n’en demeure pas moins que les institutions mises en place – qu’il s’agisse des institutions classiques ou des institutions nouvelles, dont les Cours constitutionnelles – sont confrontées à un certain nombre de difficultés. Qu’il s’agisse de leur indépendance réelle. Qu’il s’agisse de leur capacité d’autonomie financière et matérielle.
Le défi, aujourd’hui, est donc celui de l’effectivité de ces institutions et de leur rôle dans la vie démocratique.
La Francophonie s’est investie, très tôt, et continue à s’investir dans le soutien aux cours constitutionnelles et à votre association qui sont, je le répète, des acteurs incontournables de la démocratie, des droits de l’homme et du renforcement de l’État de droit dans nos pays membres.
Mais il est clair, dans le même temps, que compte tenu de l’engagement croissant qui est le vôtre, compte tenu, aussi, des ressources financières souvent insuffisantes dont vous disposez, la Francophonie doit se doter d’un plan encore plus ambitieux de coopération avec d’autres organisations internationales qui poursuivent le même dessein.
Et je veux vous dire, ici, que vous pouvez compter sur moi pour soutenir cette initiative, à vos côtés.
Et je suis convaincu que les travaux que vous avez menés, durant ces deux jours, seront à même d’affiner notre réflexion en la matière. Soyez donc assurés que j’en prendrai connaissance avec le plus grand intérêt.
Boutros BOUTROS-GHALI
Discours de clôture de Madame Marie Madeleine Mborantsuo, président de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise
Monsieur le premier ministre, chef du gouvernement,
Messieurs les présidents des Institutions constitutionnelles,
Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement,
Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs les présidents des Cours et Conseils constitutionnels des pays ayant en partage l’usage du français, Monsieur le représentant du secrétaire général de l’Organisation internationale
de la francophonie, Distingués invités,
Mesdames, Messieurs, chers congressistes,
Ce n’est pas sans émotion qu’à l’issue de ce deuxième Congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français, je vous exprime, au nom des membres de la Cour constitutionnelle du Gabon et au mien propre, mes sincères remerciements pour m’avoir portée à la tête de notre Association pour les trois ans à venir. Mon émotion est d’autant plus grande qu’au delà du réel plaisir personnel que j’éprouve, je vois aussi dans cette charge un grand honneur pour mon pays.
Je partage cet honneur avec mes collègues du Canada, Madame Beverley Mc Lachhlin, portée à la première vice-présidence ; du Bénin, Madame Conceptia D. Ouinsou, portée à la deuxième vice-présidence ; de Djibouti, Monsieur Omar Chirdon Abass, porté à la troisième vice-présidence et de la Roumanie, Monsieur Lucian Mihai, chargé de la Trésorerie Générale de notre Association.
À mon tour, je leur adresse mes plus vives félicitations.
En ce qui me concerne, je mesure tout le poids de la responsabilité qui m’échoit.
Il me revient en effet de faire en sorte que se poursuive la réalisation des objectifs assignés à l’ACCPUF et que se traduisent dans la pratique les orientations issues du présent congrès ainsi que celles que nous adopterons consensuellement au cours de mon mandat.
Je ne doute pas que j’y parviendrai, car je sais pouvoir compter à la fois sur le Bureau de l’Association, sur ses membres et plus particulièrement sur mon prédécesseur, j’ai nommé Monsieur Yves Guéna, à qui je voudrais une fois encore rendre hommage pour l’habileté, la compétence et le dynamisme avec lesquels il a dirigé notre Association durant son mandat. Nous savons qu’il continuera à nous assister de ses conseils et avis en sa qualité de membre statutaire du Bureau.
Mesdames et Messieurs les congressistes, chers collègues,
Le congrès qui s’achève ce jour a eu pour thème : « L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures ».
Ce thème est parfaitement complémentaire du premier dans la mesure où il apparaît que la seule reconnaissance dans les Constitutions de nos pays et dans les textes supranationaux des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne suffit pas pour promouvoir et préserver, tant entre les citoyens qu’entre les nations, une existence paisible où doivent régner la fraternité et la solidarité ; il faut encore, nécessairement, organiser et assurer la protection de ces droits et libertés. Ce qui est, pour ce qui nous concerne, la mission assignée au juge constitutionnel et, partant, l’objectif visé par le thème de notre Congrès.
Ce thème, subdivisé en trois sous-thèmes, à savoir : le « droit au recours «, la « recevabilité de la saisine « et la « notion de procès équitable «, a fait l’objet d’un examen par les institutions membres et donné lieu à plus d’une trentaine de rapports nationaux.
Le droit au recours s’entend de la qualité des requérants, de la nature des actes contrôlés et des délais de saisine du juge constitutionnel. Il ressort de l’examen de ce sous-thème présenté par la Cour constitutionnelle du Bénin que la saisine du juge constitutionnel est tantôt accordée aux seules autorités publiques, tantôt à celles-ci et aux personnes physiques, voire, dans certains pays, aux personnes morales et aux étrangers.
Quant aux actes contrôlés, ils sont les mêmes dans la quasi totalité des pays, c’està-dire essentiellement les lois organiques, les lois, les actes réglementaires, les règlements des Assemblées et les traités et accords internationaux, exception faite de la Constitution et des actes de gouvernement. Pour ce qui est des délais de saisine du juge constitutionnel, notamment dans le cadre du contrôle a priori, ils sont, de façon générale, assez brefs dans la plupart des pays.
Le deuxième sous-thème, consacré à la recevabilité de la saisine, traite des conditions prescrites par la loi en vue de l’examen de la requête au fond par le juge constitutionnel.
L’analyse de ce sous-thème présenté par le Conseil constitutionnel du Maroc laisse apparaître une relative uniformité des solutions retenues par les Cours et conseils en la matière.
Ainsi le requérant doit figurer parmi ceux expressément désignés par la loi ; il doit justifier d’un intérêt pour agir, étant entendu que pour les autorités publiques, cet intérêt est présumé. Il est également souligné la gratuité de la procédure à quelques rares exceptions près.
Le troisième sous-thème est consacré quant à lui à la notion de procès équitable. Il s’agit notamment de savoir si dans un procès en contrôle de constitutionnalité, on retrouve toutes les garanties procédurales assurant aux parties une certaine justice du procès.
De l’examen du rapport y relatif présenté par le tribunal fédéral suisse, il ressort que si le principe du contradictoire doit être rigoureusement observé pour garantir une justice équitable en ce qui concerne le contrôle a posteriori, mettant en présence deux intérêts subjectifs, il n’en est pas de même dans le cadre du contrôle a priori, dans lequel seule la norme doit être contrôlée pour rétablir l’ordre public constitutionnel.
Ce sont ces trois sous-rapports qui constituent le substrat du rapport général présenté par la Cour constitutionnelle du Gabon.
De la richesse des échanges résultant de l’analyse générale de ce thème, chacune de nos institutions nationales saura tirer le maximum d’enseignements adaptables à son environnement naturel, aux aspirations et au génie de son peuple.
Mesdames et Messieurs,
Le Congrès thématique de notre Association a été précédé par la tenue de son Assemblée générale qui a examiné tous les points inscrits à son ordre du jour. À l’issue de ses travaux, l’Assemblée générale a adopté le rapport moral, le rapport financier, le Règlement intérieur, la modification des statuts, ainsi que le programme triennal de l’Association pour la période 2000-2003.
Par ailleurs, l’Assemblée générale a ratifié la convention passée avec le Conseil de l’Europe, agréé les adhésions des Institutions du Cameroun, du Rwanda et de la Slovénie et enregistré favorablement la demande d’adhésion de l’Albanie. Ces adhésions témoignent de la vitalité et du rayonnement de notre Association. Nous souhaitons aux nouveaux adhérents la plus cordiale bienvenue au sein de notre grande famille.
Mesdames et Messieurs les congressistes, chers collègues,
L’Assemblée générale a décidé que le troisième congrès de notre Association se tienne à Ottawa, au Canada, en 2003.
Ce choix répond au souci de donner à toutes les régions représentées au sein de l’ACCPUF l’occasion d’abriter les travaux des différents organes de notre Association. Il permet, en outre, aux institutions membres d’élargir leurs horizons en vivant sur le terrain les expériences des autres. À cet égard, le Canada présente des particularités certainement enrichissantes. En effet, à cheval sur deux cultures, la culture anglosaxonne et la culture latine, il dispose ainsi à la fois de deux sources de droit.
À l’heure de la mondialisation et du nouvel ordre démocratique, notre Association pourrait tirer avantage de l’expérience de ce grand pays, notamment dans l’entreprise d’harmonisation souhaitable de nos législations et sur laquelle portent déjà nos regards.
Mesdames, Messieurs,
Les travaux de notre congrès se sont déroulés sous les meilleurs auspices et dans un climat de sérénité.
Nous saisissons cette occasion pour adresser, une fois de plus, notre témoignage de très profonde reconnaissance à Monsieur le président de la République gabonaise.
Nos remerciements vont également à Monsieur le vice-président de la République, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à Monsieur le président du Sénat, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale, à Monsieur le président du Conseil national de la communication, à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie, à l’Organisation Internationale de la Francophonie et à l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie, qui nous ont apporté leur soutien tant moral que matériel pour la réussite de ce congrès.
Nous savons gré également à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué au succès de nos travaux.
Je ne voudrais pas terminer sans faire une mention spéciale à Madame Dominique Remy-Granger, secrétaire général de notre Association, et à son assistante, Mademoiselle Patricia Herdt, qui ont fait preuve de dévouement, de disponibilité et de professionnalisme durant la période triennale qui s’achève. Nous saurons compter sur elles tout au long de celle que nous inaugurons.
Mesdames et Messieurs les congressistes, chers collègues,
Nous arrivons à la fin de nos travaux. Vous avez dû, lors de votre séjour parmi nous, subir quelques désagréments ou relever quelques imperfections dans l’organisation matérielle de nos assises.
Nous sollicitons donc votre indulgence pour ces imperfections ainsi que pour celles qu’il vous sera donné de relever encore au cours de notre visite touristique.
Nous n’aurons plus l’occasion de vous faire officiellement nos adieux. Aussi, permettez-moi, au nom de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise et au mien propre, de vous souhaiter à tous un bon retour dans vos pays respectifs, en espérant que vous emportez de notre pays et de ses Institutions le meilleur souvenir, celui d’un État de droit qui se construit patiemment et résolument, en dépit des vicissitudes qui caractérisent actuellement l’évolution politique de notre continent.
Je déclare clos les travaux du deuxième congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles des pays ayant en Partage l’Usage du Français.
Vive l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français. Vive la coopération juridique internationale,
Je vous remercie.

Allocution de remerciement prononcée par Monsieur Charles D. Gonthier, juge à la Cour suprême du Canada, représentant le premier vice-président de l’Association
des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français
On me confie l’honneur de vous présenter une résolution de remerciement. En l’introduisant, vous me permettrez d’évoquer la richesse de nos échanges et la générosité de nos hôtes par quelques remarques de mon cru. Je pense aux repas somptueux qu’on nous a servis, et de façon particulière à ce déjeuner du premier jour qu’on ne saurait rivaliser. En effet, je ne connais aucun président de tribunal ou juge en chef qui pourrait exercer une autorité égale à la vôtre, Madame Mborantsuo, en imposant aux
membres de son tribunal d’apporter chacun un mets du pays avec interdiction de l’acheter. Je pense aussi à ces danses du Gabon si hautes en couleur et en rythme et à cette petite danseuse qui ingénument a saisi nos cœurs. Je sais combien s’inquiètent les organisateurs d’une activité comme celle-ci tout au cours de son déroulement. Vous n’aviez pas à être inquiète car votre générosité, vos sourires ont appelé les nôtres.
Comment mieux vous remercier qu’en vous disant quel exemple vous nous laissez, quel défi vous nous posez, à nous, qui devons recevoir le prochain congrès au Canada, vous avez apporté une autre pierre à la construction de la maison de la Fraternité dont le monde a grand besoin et dont Jacques Attali a écrit qu’elle est le défi du siècle qui vient comme la Liberté et l’Égalité l’ont été du siècle qui s’achève.
Je souhaite qu’en vous recevant au Canada dans trois ans, nous sachions y apporter une autre pierre et qu’entre temps nous continuerons à cimenter et élargir nos échanges et notre collaboration, notamment à Djibouti l’an prochain. J’aimerais donc présenter la résolution suivante :
Au terme des travaux du deuxième congrès de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français, les membres de l’Association et tous les participants, très sensibles à l’accueil chaleureux et amical qui leur a été réservé, expriment leurs très sincères remerciements à la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, son Président et chacun des membres et personnel, au président de la République, Chef de l’État, à toutes les autorités gabonaises et au peuple gabonais et en particulier ceux et celles qui se sont particulièrement occupés de nous, pour toutes les marques de considération et les honneurs dont ils ont été l’objet durant leur séjour à Libreville.
Alors, je vous propose l’adoption de cette résolution.
Libreville, le 15 septembre 2000.
Communiqué de presse
L’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF), qui réunit une quarantaine d’institutions, a tenu à Libreville sa deuxième Assemblée générale et son deuxième Congrès du 13 au 15 septembre 2000.
L’Assemblée générale a voté un Règlement intérieur en complément des statuts modifiés, désigné un nouveau bureau et adopté un programme triennal.
Le nouveau Bureau qui fonctionnera pour trois années consécutives, est ainsi constitué :
Président, le président de la Cour constitutionnelle du Gabon, Madame Marie Madeleine Mborantsuo,
Premier vice-président, la présidente de la Cour suprême du Canada, Madame Beverley McLachhlin,
Deuxième vice-président, la présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin, Madame Conceptia D. Ouinsou,
Troisième vice-président, le président du Conseil constitutionnel de Djibouti, Monsieur Omar Chirdon Abass,
Trésorier, le président de la Cour constitutionnelle de Roumanie, Monsieur Lucian Mihai,
Membre de droit, en tant que président sortant de l’association, le président du Conseil constitutionnel de France, Monsieur Yves Guéna.
Il comporte en outre, et n’ayant pas voix délibérative :
- un observateur de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, Madame Christine Desouches, déléguée aux droits de l’homme et à la démocratie,
- et le secrétaire général, Madame Dominique Remy-Granger, chef du service des relations extérieures du Conseil constitutionnel français.
Le deuxième programme d’action triennal poursuivra la tâche engagée par le premier, notamment en publiant un ouvrage de référence par an et en développant les pages du site Internet de l’association (http ://www. accpuf.org) consacrées d’une part à l’actualité de la jurisprudence constitutionnelle des cours membres et d’autre part à la construction d’une base de données qui devrait permettre ultimement à chacun des membres des cours constitutionnelles de l’espace francophone, de disposer des précédents de leurs collègues ainsi que des jurisprudences des cours de l’espace européen.
Ce projet nécessite une familiarisation des membres et collaborateurs des cours constitutionnelles avec une méthode commune d’indexation des décisions, ce qui est l’objet des séminaires de formation dont le cinquième s’est réuni à Libreville les 11 et 12 septembre 2000.
Les travaux du Congrès se sont tenus sur deux journées les 14 et 15 septembre 2000 et portaient sur « L’accès au juge constitutionnel : modalités et procédures ». Chacune des cours participantes a produit un rapport national comprenant plusieurs dizaines de rubriques suivant un questionnaire établi par le bureau depuis plus d’un an.
Ces informations rassemblées ont été synthétisées autour de trois thèmes majeurs.
Le jeudi 14 au matin, après une cérémonie solennelle d’ouverture présidée par S.E. Monsieur Didjob Divungi Di Ndinge, vice-président de la République gabonaise représentant le président de la République, chef de l’État, un premier rapport présenté par la Cour constitutionnelle du Bénin, sous la présidence de la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar, a permis d’aborder le droit au recours dans toute sa diversité. Certaines cours, dont la Cour gabonaise, l’ouvrent très largement et l’autorisent sur de nombreux textes, d’autres ont des pratiques à la fois plus étroites et abstraites.
Les travaux du jeudi après-midi ont porté sur la question centrale de la recevabilité des requêtes. Le rapport présenté par le Conseil constitutionnel du Maroc, sous la présidence du Conseil constitutionnel du Cambodge, a bien mis en valeur les différentes formalités qui sont imposées au requérant pour pouvoir user de son droit au recours et les différentes procédures que les cours ont adopté pour l’admettre dans les meilleures conditions.
Le vendredi 15 au matin sous la présidence du Conseil constitutionnel du Sénégal et introduit par le rapport du Tribunal fédéral suisse, les congressistes ont discuté de la très délicate question des conditions du procès équitable. Il ne suffit pas en effet de pouvoir accéder au juge constitutionnel, il est également nécessaire que devant lui se déroule un procès dans lequel les droits des parties en présence soient également garantis. Les débats autour de ce thème ont été très enrichissants et ont notamment permis de mettre en valeur une distinction fondamentale entre contentieux constitutionnels et notamment entre celles des cours qui se prononcent avant la promulgation de la loi (abstraitement) et celles qui tranchent le litige concret né à l’occasion de l’application de la loi ou d’une autre norme (règlement, décision de justice…).
La Cour constitutionnelle gabonaise, dans le rapport général final, a noté cette diversité tout en relevant certaines constantes. Les juridictions constitutionnelles ont le souci d’interpréter les textes qui réglementent le droit au recours devant elles de manière souple, extensive et libérale. Parallèlement elles ont, bien qu’elles soient souvent appelées à statuer dans des délais brefs, le souci de préserver les droits des parties dans les contentieux concrets et / ou la transparence de la procédure dans le contentieux abstrait. Les participants au Congrès ont été reçus par plusieurs autorités de la République gabonaise :
- S.E. Monsieur Didjob Divungi Di Ndinge, vice-président de la République gabonaise représentant le président de la République, chef de l’État,
- Monsieur Jean-François NtoutoumeEmane, Premier ministre, chef du gouvernement,
- Monsieur Georges Rawiri, président du Sénat,
- Monsieur Guy Nzouba-Dama, président de l’Assemblée nationale,
- Monsieur Pierre-Marie Dong, président du Conseil National de la Communication,
- Monsieur le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Francophonie.
Les travaux du Congrès seront intégralement publiés d’ici à la fin de l’année 2000. Ils constitueront nul n’en doute un instrument de référence indispensable tant aux juristes qu’aux citoyens des pays concernés.
V. Statuts et règlement intérieur
Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF) :
Statuts du 9 avril 1997, modifiés [1]
L’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français, réunie en assemblée générale constitutive à Paris, le 9 avril 1997, à Paris, après délibération, adopte les statuts suivants :
Titre I
Dénomination et durée de l’association
Article premier
Il est créé, entre les institutions adhérant aux présents statuts, une association intitulée « Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF) ».
Article 2
La durée de l’Association est illimitée.
Titre II
Buts, composition et siège de l’association
Article 3 – Buts et moyens d’action.
L’Association a pour but de favoriser l’approfondissement de l’État de droit par un développement des relations entre les institutions qui, dans les pays ayant en partage l’usage du français, quelles que soient leurs appellations, ont dans leurs attributions, compétence de régler en dernier ressort avec l’autorité de chose jugée, les litiges de conformité à la Constitution.
À cet effet, elle recourt aux moyens suivants :
- elle développe entre les institutions membres les échanges d’idées et d’expériences sur les questions qui leur sont soumises ou intéressent leur organisation et leur fonctionnement ;
- elle organise entre les institutions membres une étroite coopération en matière de formation et d’assistance technique, soit sous sa propre responsabilité, soit dans le cadre d’autres associations regroupant des juridictions suprêmes auxquelles adhèrent les institutions membres, en lien avec les coopérations existantes dans le cadre multilatéral francophone ;
- elle organise des Congrès thématiques qui favorisent le contact entre les membres des institutions et l’échange d’information ;
- elle pourra publier tous bulletins ou revues.
Article 4
Acquisition et perte de la qualité de membre.
4.1. – Catégories de membres et conditions d’admissions
Sont membres :
les institutions constitutives, ou leur successeur [2], à savoir :
- Cour d’arbitrage, BELGIQUE
- Cour constitutionnelle, BÉNIN
- Cour constitutionnelle, BULGARIE
- Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, BURKINA FASO
- Cour suprême, BURUNDI
- Comité permanent de l’Assemblée nationale du CAMBODGE
- Cour suprême, CANADA
- Tribunal suprême, CAP VERT
- Cour constitutionnelle, CENTRAFRIQUE
- Conseil constitutionnel, COMORES
- Cour suprême, CONGO
- Conseil constitutionnel, CÔTE D’IVOIRE
- Conseil constitutionnel, DJIBOUTI
- Cour suprême constitutionnelle, ÉGYPTE
- Conseil constitutionnel, FRANCE
- Cour constitutionnelle, GABON
- Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, GUINÉE
- Commission permanente à l’Assemblée nationale, GUINÉE BISSAU
- Tribunal constitutionnel, GUINÉE ÉQUATORIALE
- Cour de Cassation, HAÏTI
- Conseil constitutionnel, LIBAN
- Haute Cour constitutionnelle, MADAGASCAR
- Cour constitutionnelle, MALI
- Conseil constitutionnel, MAROC (en tant que membre observateur)
- Cour suprême, MAURICE
- Conseil constitutionnel, MAURITANIE
- Cour constitutionnelle, MOLDAVIE
- Tribunal suprême, MONACO
- Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, NIGER
- Cour constitutionnelle, ROUMANIE (en tant que membre observateur)
- Conseil constitutionnel, SÉNÉGAL
- Cour suprême, SEYCHELLES
- Tribunal fédéral, SUISSE
- Chambre constitutionnelle de la Cour d’Appel, TCHAD
- Cour constitutionnelle, TOGO
- Cour suprême, ZAÏRE
- les institutions répondant à la définition donnée au premier alinéa de l’article 3 et dont la candidature aura été retenue par l’Assemblée générale ou la Conférence des présidents [3].
Entre deux Assemblées générales ou Conférences des présidents, le Bureau peut admettre des institutions non membres, en qualité d’observateurs.
Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l’Assemblée générale avec voix délibérative.
4.2. – Retrait ou suspension de la qualité de membre.
Toute institution membre peut se retirer librement de l’Association. Le retrait prend effet dès qu’il a été notifié officiellement à la présidence de l’Association.
Le Bureau peut constater la suspension de l’institution membre qui n’a pas réglé ses cotisations suivant les modalités prévues par le Règlement intérieur.
À titre exceptionnel et conservatoire, le Bureau peut décider la suspension d’une institution membre, soit parce qu’elle a dans les faits cessé d’exister, soit parce qu’elle ne répond plus à l’esprit de l’Association. La décision du Bureau est soumise à l’Assemblée générale suivante.
Il est mis fin à la suspension dans les conditions où il est procédé à une adhésion.
Article 5 – Siège.
Le siège social de l’Association est situé à Paris.
Titre III
Organes de l’association
Article 6
L’Association est dirigée par une Assemblée générale qui se réunit tous les trois ans. Elle est administrée et gérée par son Bureau.
Le Secrétariat général, qui comprend le secrétaire général et ses collaborateurs, est un organe administratif qui assiste le président et le Bureau de l’Association dans leurs tâches respectives.
Entre deux Assemblées générales, l’Association peut se réunir en Conférence de chefs d’institution, sur proposition de son Bureau ou sur demande de la moitié des membres.
Article 7 – L’Assemblée générale.
7.1. – Fréquence
L’Assemblée générale se réunit tous les trois ans sur convocation du Bureau dans le pays déterminé par l’Assemblée générale précédente. Le Bureau peut toutefois modifier le choix de l’Assemblée générale, en cas de circonstances exceptionnelles, après consultation de la Conférence des chefs d’institution prévue à l’article 9.
Le Congrès thématique se tient à la même époque que l’Assemblée générale.
7.2. – Composition
L’Assemblée générale est formée par les chefs de corps des institutions membres, assistés ou remplacés en tant que de besoin par des délégués supplémentaires.
7.3. – Attributions
L’Assemblée générale examine le rapport moral du président et le rapport financier du trésorier.
Elle fixe le montant des cotisations et adopte un état prévisionnel triennal de recettes et dépenses.
Elle décide de l’adhésion des nouveaux membres et, le cas échéant, des suspensions ou des retraits de membres.
Elle se prononce sur les candidatures à la présidence, attribuée au chef de corps de l’institution qui accueille la plus prochaine Assemblée générale.
Elle pourvoit par élection à chacun des postes du bureau de l’Association pour les trois ans à venir.
Elle est seule compétente pour modifier les statuts.
Elle adopte le Règlement intérieur.
Elle détermine le programme de l’Association pour les trois années suivantes.
Elle discute de l’ensemble des questions en relation avec ses buts et ses moyens, soumises à elle par le Bureau.
Elle ratifie toute convention passée entre l’Association et d’autres organismes internationaux.
Elle discute de toutes autres questions soumises par au moins un quart des institutions membres au plus tard deux mois avant sa réunion.
Elle désigne en tant que de besoin le ou les comités d’experts nécessaires pour assurer la permanence de ses réflexions ou de ses actions.
Les rapports introductifs aux débats sont adressés au plus tard un mois avant l’Assemblée générale.
Les votes sont acquis à la majorité simple. Chaque délégation dispose d’une voix. Par exception, les modifications statutaires doivent être adoptées par les deux tiers des délégations membres adhérant à l’Association.
Article 8 – Le Bureau.
Le Bureau assure l’exécution des décisions de l’Assemblée générale dont il exerce les pouvoirs par délégation. Il veille à l’application des vœux émis et des résolutions prises par l’Assemblée générale et peut prendre, à cet égard, toute décision appropriée.
8.1. – Fréquence
Le Bureau se réunit, une fois l’an en session ordinaire sur convocation de son président. Il se réunit en sessions extraordinaires sur proposition du président ou de la majorité des membres. Les procès verbaux des séances sont envoyés à tous les membres de l’Association.
Si l’un des membres du Bureau ne peut assister à la réunion, il a la possibilité de donner mandat de le représenter à un membre de son institution par lui désigné, à un autre membre du Bureau ou d’exprimer son opinion par écrit. Le président peut procéder à la consultation des membres du Bureau par correspondance ou tout autre moyen de communication.
8.2. – Composition
Le Bureau comprend le président, trois vice-présidents, le trésorier, en tant que de besoin et à la diligence du président, le secrétaire de chacun des comités d’experts mentionnés à l’article 7.3. alinéa 12, et comme observateur, à l’invitation du président, un représentant de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie au titre de la coopération juridique et judiciaire.
Chacun des postes est attribué séparément par l’Assemblée générale à une des institutions membres.
Le Bureau est renouvelable à chaque Assemblée générale. Sa composition reflète équitablement la composition géographique de l’Assemblée générale. Toutefois, le premier vice-président est le chef de l’institution du pays dans lequel se tiendra le prochain Congrès. En outre, le président sortant est membre de droit du Bureau pendant le mandat qui suit immédiatement l’exercice de sa présidence.
Les travaux sont présidés par le chef de l’institution à laquelle la présidence a été dévolue par l’Assemblée générale, ou par un autre membre de cette institution expressément désigné par le président. Les chefs des institutions détenant les autres postes peu-
vent désigner, sous leur contrôle et leur responsabilité, un membre ou ancien membre de leurs institutions respectives pour assurer leurs tâches courantes au sein du Bureau.
Le représentant d’une institution reste en fonction jusqu’à l’Assemblée générale suivante, sauf s’il démissionne ou si son institution d’appartenance avise le secrétaire général de son remplacement.
8.3. – Présidence
Le président représente l’Association pour les actes de la vie civile. Il préside l’Assemblée générale. Il ordonnance les dépenses et les recettes. Il peut toutefois déléguer sa signature au secrétaire général pour certains actes d’administration, notamment pour les dépenses et les recettes n’excédant pas le montant défini dans la délégation.
Les vice-présidents, dans l’ordre de leur désignation, remplacent le président en tant que de besoin.
8.4. – Attributions
Le Bureau adopte l’état prévisionnel annuel de recettes et de dépenses et les décisions modificatives. Il arrête les comptes annuels.
Il fixe l’ordre du jour de l’Assemblée générale et sélectionne le thème du Congrès triennal.
Le Bureau délibère valablement lorsque la moitié de ses membres est présente. En cas de vote et de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Une proposition unanime du Bureau peut être soumise par écrit à l’approbation des membres de l’Association. Si elle reçoit l’accord écrit de la majorité desdits membres, elle est considérée comme adoptée en Assemblée générale.
Article 9 – La conférence des chefs d’institution.
La Conférence des chefs d’institution est formée des chefs des institutions membres. Si l’un des chefs d’institution ne peut assister à la réunion, il a la possibilité de donner mandat de le représenter à un membre de son institution par lui désigné.
La Conférence débat des problèmes qui, en vertu de l’article 3 des statuts sont du ressort de l’Association et formule sur ces questions des recommandations exprimant l’opinion de l’Association.
La Conférence peut être assistée dans sa tâche par les comités d’experts prévus à l’article 7.3, alinéa 12.
L’ordre du jour de la Conférence est fixé par le Bureau.
Article 10
Le Secrétariat général permanent.
10.1. – Désignation
Le secrétaire général de l’Association, extérieur au Bureau, est désigné par ce dernier pour un mandat de six ans.
10.2. – Attributions
Le secrétaire général assure, sous le contrôle du président et du Bureau, l’administration courante de l’Association.
Il organise, sous l’autorité du président, les réunions du Bureau, de la Conférence des chefs d’institution et de l’Assemblée générale de l’Association.
Il assiste aux réunions du Bureau avec voix consultative.
Il ordonnance, par délégation du président et sous le contrôle du trésorier, les dépenses et les recettes de l’Association et assure le recouvrement de ses produits. À cette fin, il est habilité à faire fonctionner le compte courant bancaire de l’Association.
10.3 – Siège
Le Secrétariat permanent est établi à Paris. Le Bureau y tient normalement ses réunions mais il peut également, à l’initiative du président ou de la majorité de ses membres, se réunir dans tout autre lieu du siège d’une institution membre de l’Association.
Titre IV
Dispositions diverses
Article 11 – Ressources de l’association. Les ressources de l’Association sont :
le produit des cotisations annuelles des membres ;
La cotisation comporte deux éléments :
- un droit fixe, arrêté annuellement par le Bureau de l’Association ;
- des contributions exceptionnelles dont le montant est déterminé librement par chaque membre.
Le montant de la partie fixe de la cotisation est arrêté selon un barème qui répartit les États en trois groupes pour tenir compte de la capacité contributive ;
- les subventions, contributions et soutiens aux actions de coopération des États et organisations internationales, notamment de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie ;
- les dons ou subventions provenant de particuliers ou d’organismes privés ou publics pour la réalisation des buts de l’Association ou à des fins précisées par le donateur ;
- les ressources provenant des publications ou autres activités de l’Association.
Article 12 – Frais résultant du fonctionnement des organismes statutaires.
Les frais de déplacement et de séjour liés au fonctionnement des organes statutaires sont à la charge des institutions membres représentées.
Les dépenses résultant de l’organisation d’une Assemblée générale, du Congrès thématique et des publications en résultant, sont à la charge de l’Association avec la participation de l’institution membre du pays d’accueil. Il incombera à la Conférence des chefs d’institution de formuler des propositions à cette fin. Les dépenses résultant d’une session du Bureau ou de l’organisation d’une conférence sont assurées par le budget de l’Association.
Article 13 – Dissolution de l’association.
Une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le Bureau au moins six mois à l’avance dans le lieu qu’il détermine peut décider la dissolution de l’Association.
La dissolution de l’Association ne peut résulter que d’une décision de l’Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des membres de l’Association. Les avoirs de celle-ci, s’il en est, sont attribués sur proposition du Bureau à une organisation œuvrant pour des buts de même nature ou, à défaut, à une organisation philanthropique œuvrant en faveur du développement.
Article 14 – Règlement intérieur.
Les règles budgétaires et comptables, les modalités de reddition et de contrôle des comptes, les modalités de vote dans les organes statutaires, les modalités de constitution et de fonctionnement des comités d’experts et plus généralement les questions non traitées dans les présents statuts sont déterminées par le Règlement intérieur.
Article 15 – Dispositions transitoires.
Par dérogation à l’article 7 alinéa 2 des présents statuts, le premier état prévisionnel triennal de recettes et de dépenses sera adopté par le Bureau à l’occasion de sa première réunion.
Par dérogation à l’article 7 alinéa 8 des présents statuts, le programme de l’Association pour la première période triennale sera adopté par la Conférence des chefs d’institution à l’occasion de sa première réunion.
Article 16
La présente Association est régie par la Loi française du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Fait à Paris, le 9 avril 1997. Le président, Roland Dumas.
Le Premier vice-président, Marie Madeleine Mborantsuo.
Le Deuxième vice-président, Ariranga Pillay.
Le Troisième vice-président, Pierre Gannagé.
Le trésorier, Antonio Lamer.
Le secrétaire général, Dominique Remy Granger.
-
[1]
Les statuts ont été modifiés par l’Assemblée générale réunie le 13 septembre 2000 à Libreville, conformément à l’article 7.3 des présents statuts. [Retour au contenu] -
[2]
Note du Secrétariat général de l’ACCPUF : Il s’agit, au 13 septembre 2000, de la Cour constitutionnelle du Burundi, du Conseil constitutionnel du Cambodge, du Conseil constitutionnel du Tchad et de la Cour suprême de Justice de la République démocratique du Congo (ex-Zaïre). [Retour au contenu] -
[3]
Note du Secrétariat général de l’ACCPUF : Il s’agit, au 13 septembre 2000, d’une part de la Cour suprême du Cameroun, de la Cour constitutionnelle du Rwanda et de la Cour constitutionnelle de Slovénie dont l’adhésion à l’association en qualité de membre à part entière a été ratifiée par l’Assemblée générale du 13 septembre 2000 et d’autre part de la Cour constitutionnelle d’Albanie, autorisée à participer aux travaux de l’association en qualité d’observateur par l’assemblée générale précitée jusqu’à son adhésion formelle. [Retour au contenu]
Le règlement intérieur de l’ACCPUF
Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français (ACCPUF) :
Règlement intérieur
Titre I
Admission et obligations des membres
Article premier
Toute institution légalement constituée répondant à la définition de l’article 3 des statuts, qui désire faire partie de l’Association en fait la demande écrite au président. Le Bureau statue sur cette demande dans sa plus prochaine séance. L’adhésion est ratifiée par la plus proche Assemblée générale ou Conférence des présidents, conformément à l’article 4-1 des statuts.
Article 2
Toute demande d’admission implique l’adhésion sans réserve aux statuts et règlements de l’Association.
Article 3
La cotisation annuelle est due intégralement même en cas d’admission ou de démission en cours d’année.
Article 4
Les cotisations annuelles sont appelées avant la fin du premier trimestre de chaque année et sont payées avant le 30 novembre de l’année en cours par les membres, et, au moment même de l’adhésion, pour les nouveaux membres.
Article 5
Toute institution membre en retard de plus d’une année dans le règlement de sa cotisation reçoit du Secrétariat général une notification dès le mois de décembre.
Si, en dépit du rappel prévu à l’alinéa précédent, une institution membre ne s’est pas acquittée de sa cotisation deux années de suite, le Bureau peut constater la suspension de cette institution.
Article 6
La suspension de la qualité de membre entraîne la suppression de la voix délibérative à l’Assemblée générale, de la livraison gratuite des publications de l’Association, et, le cas échéant, des avantages consentis par elle lors des réunions statutaires.
Titre II
Administration et fonctionnement
Article 7
Le secrétaire général exécute par délégation du président, et sous son contrôle, les actes suivants :
- recruter le personnel en fonction du budget approuvé et des disponibilités financières ;
- décider du recours éventuel à un ou plusieurs consultants extérieurs et fixer leur rémunération en fonction des programmes à traiter ;
- liquider les dépenses et en effectuer le paiement. Toutefois, pour le paiement de sommes supérieures au montant de la cotisation la plus élevée du barème, le visa du trésorier est requis ;
- d’une manière générale, effectuer toutes opérations nécessaires au fonctionnement normal de l’Association.
Le secrétaire général assiste de droit aux réunions du Bureau avec voix consultative.
Article 8
L’exercice financier s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui lui donne son nom. Les comptes sont arrêtés dans le premier semestre suivant la fin de chaque année civile. Ils sont certifiés par un commissaire aux comptes nommé par le Bureau dans le cadre légal du pays du siège social.
Article 9
Le trésorier présente le rapport annuel sur la gestion financière de l’Association.
Titre III
L’assemblée générale ordinaire
Article 10
L’Assemblée générale ordinaire se réunit de droit tous les trois ans au lieu où se tient le Congrès.
Le Bureau se réunissant l’année précédant la tenue de l’Assemblée générale et du Congrès triennal est compétent pour arrêter les dates de ceux-ci.
Les convocations sont faites trois mois au moins avant la date fixée pour la réunion par le Bureau. L’ordre du jour est indiqué sur la convocation.
Article 11
Chaque institution membre dispose d’une voix délibérative confiée à son président ou, à défaut, au représentant de ce dernier, dûment mandaté.
Article 12
La procédure d’approbation des décisions se fait par consensus sauf si un tiers des membres présents demande un vote par bulletins.
Titre IV
Désignation des membres du bureau
Article 13
Les candidatures aux postes de membres du Bureau doivent parvenir au Secrétariat général un mois au moins avant l’Assemblée générale. Le Secrétariat général les communique à la réunion du Bureau précédant l’Assemblée générale.
L’élection des membres du Bureau a lieu au scrutin secret. Un vote est organisé pour chaque poste à pourvoir.
Titre V
Désignation du secretaire général
Article 14
Le secrétaire général est élu au scrutin secret par les cinq membres du Bureau ayant voix délibérative. Son mandat est de six ans.
Article 15
Sauf décès ou démission en cours de mandat, le secrétaire général est élu au cours de la première réunion d’un Bureau entrant. En cas de décès ou de démission du secrétaire général entre deux assemblées générales, le président désigne un secrétaire général par intérim, jusqu’à la plus proche réunion du Bureau au cours de laquelle il est pourvu au remplacement du secrétaire général.
Article 16
Les candidats doivent être collaborateurs salariés d’une institution membre de l’Association, laquelle accepte de les mettre, en tant que de besoin, à la disposition de l’Association.
Les candidatures au poste de secrétaire général doivent parvenir au Secrétariat général de l’Association six mois avant la date prévue de renouvellement.
Elles sont diffusées pour information à l’ensemble des membres de l’Association.
Approuvé par l’Assemblée générale ordinaire, le 13 septembre 2000.